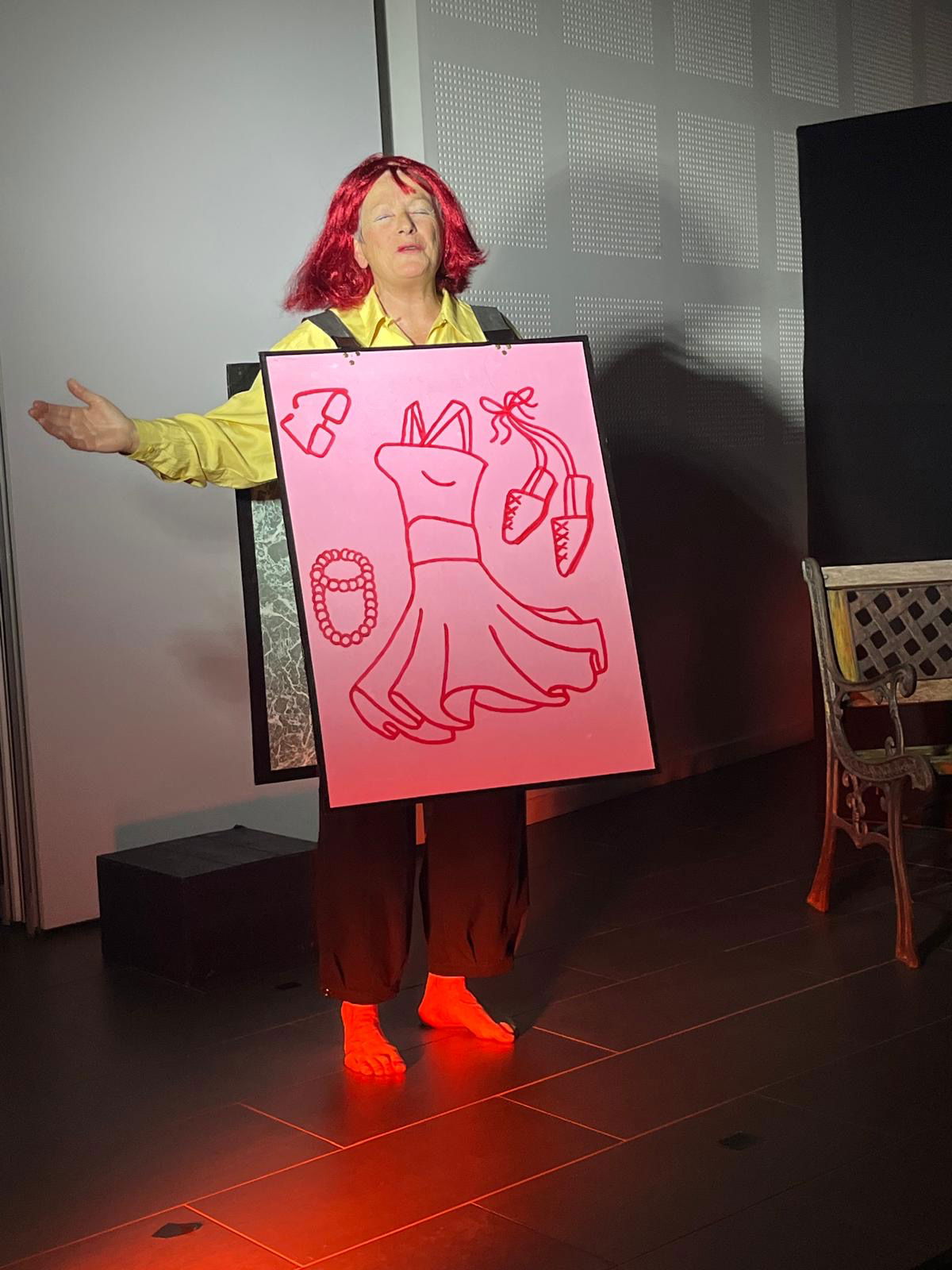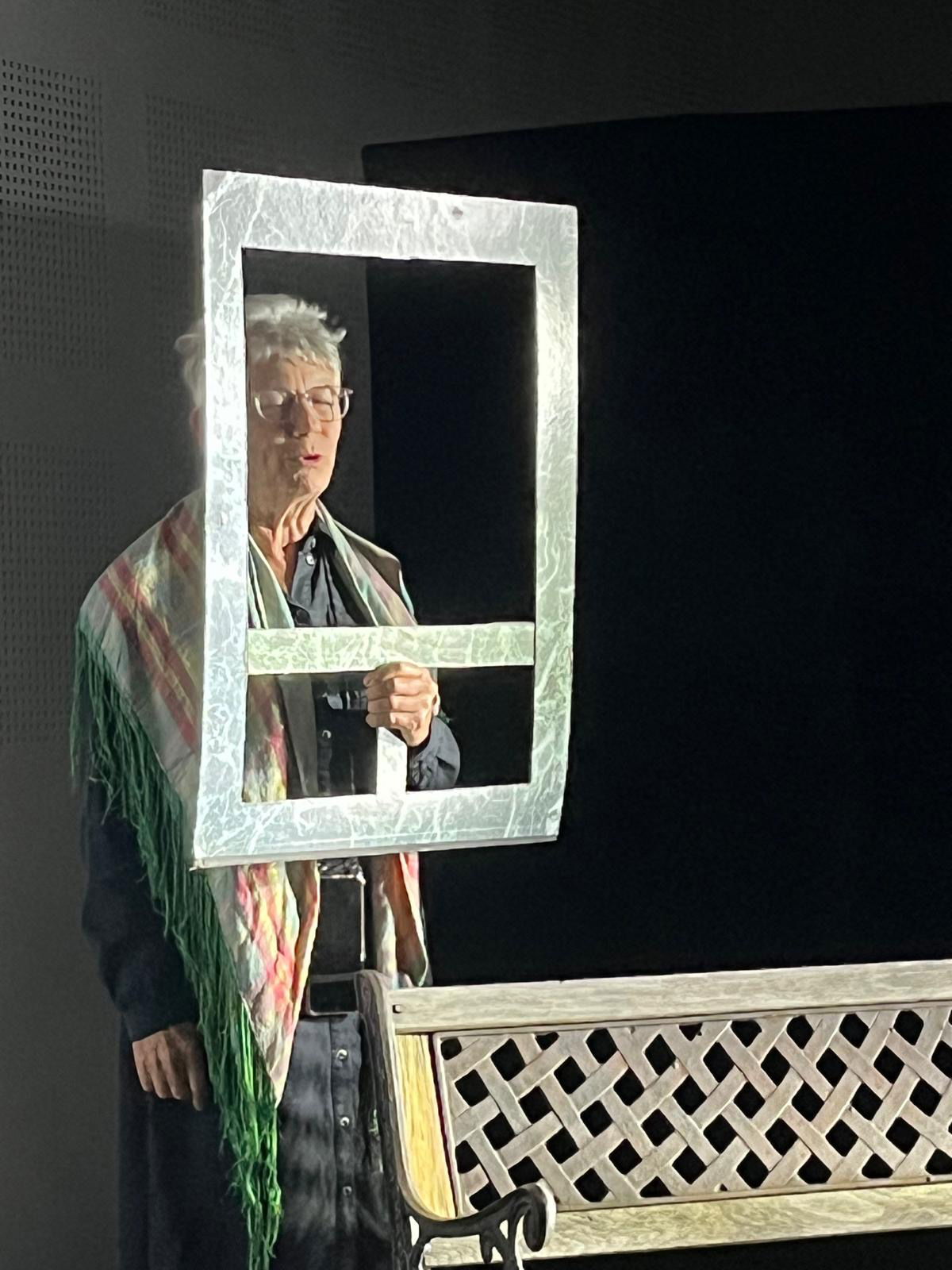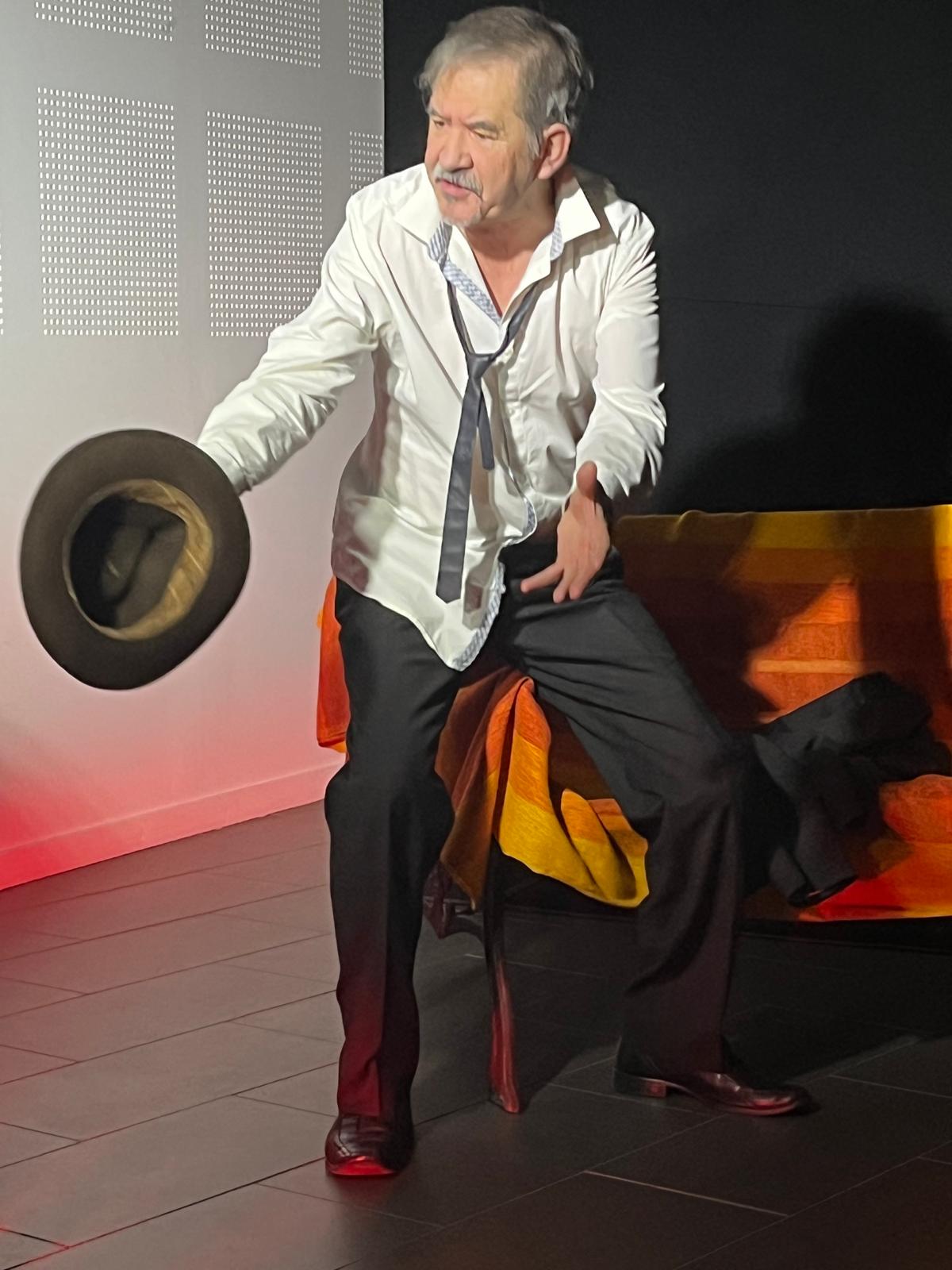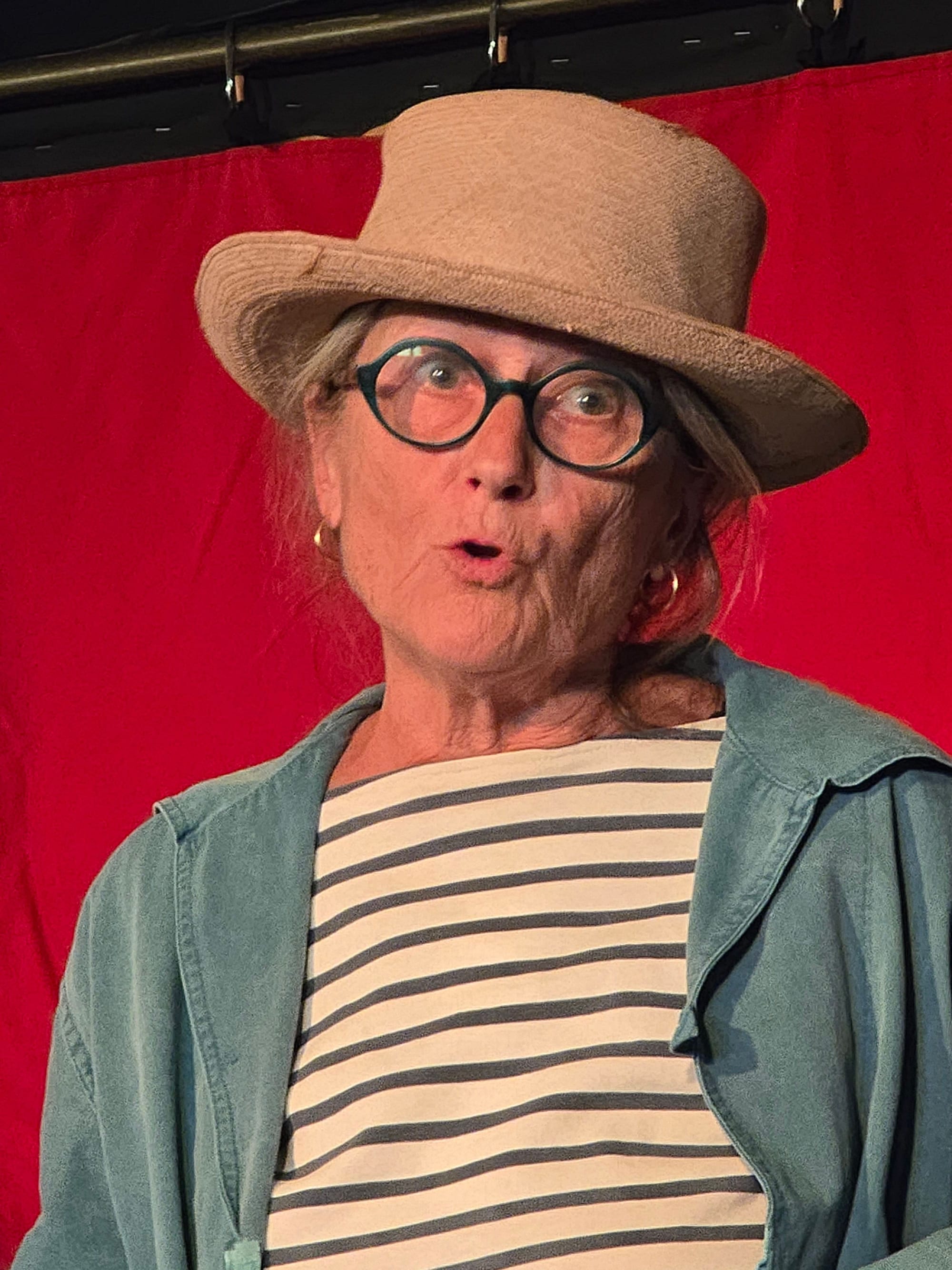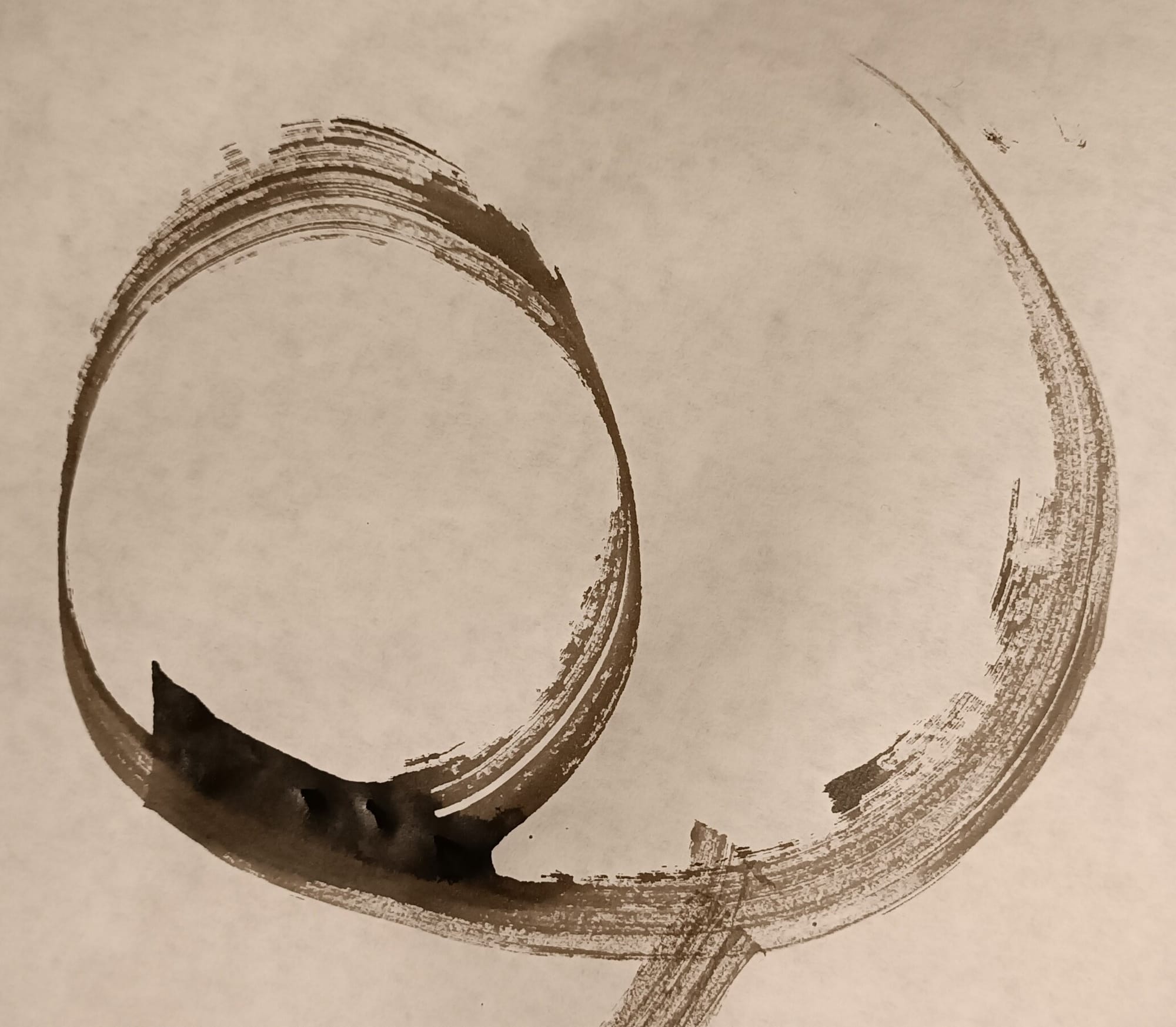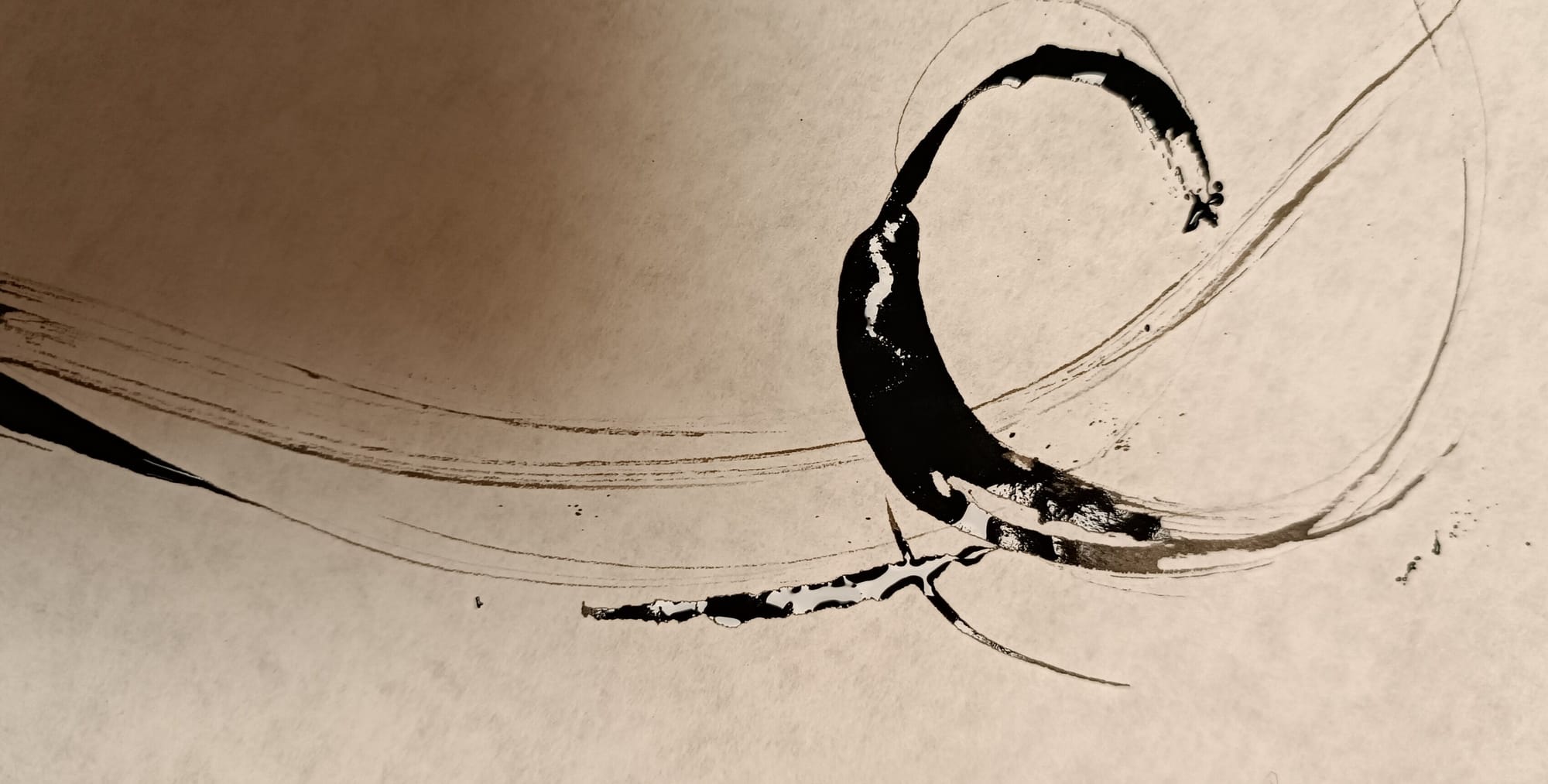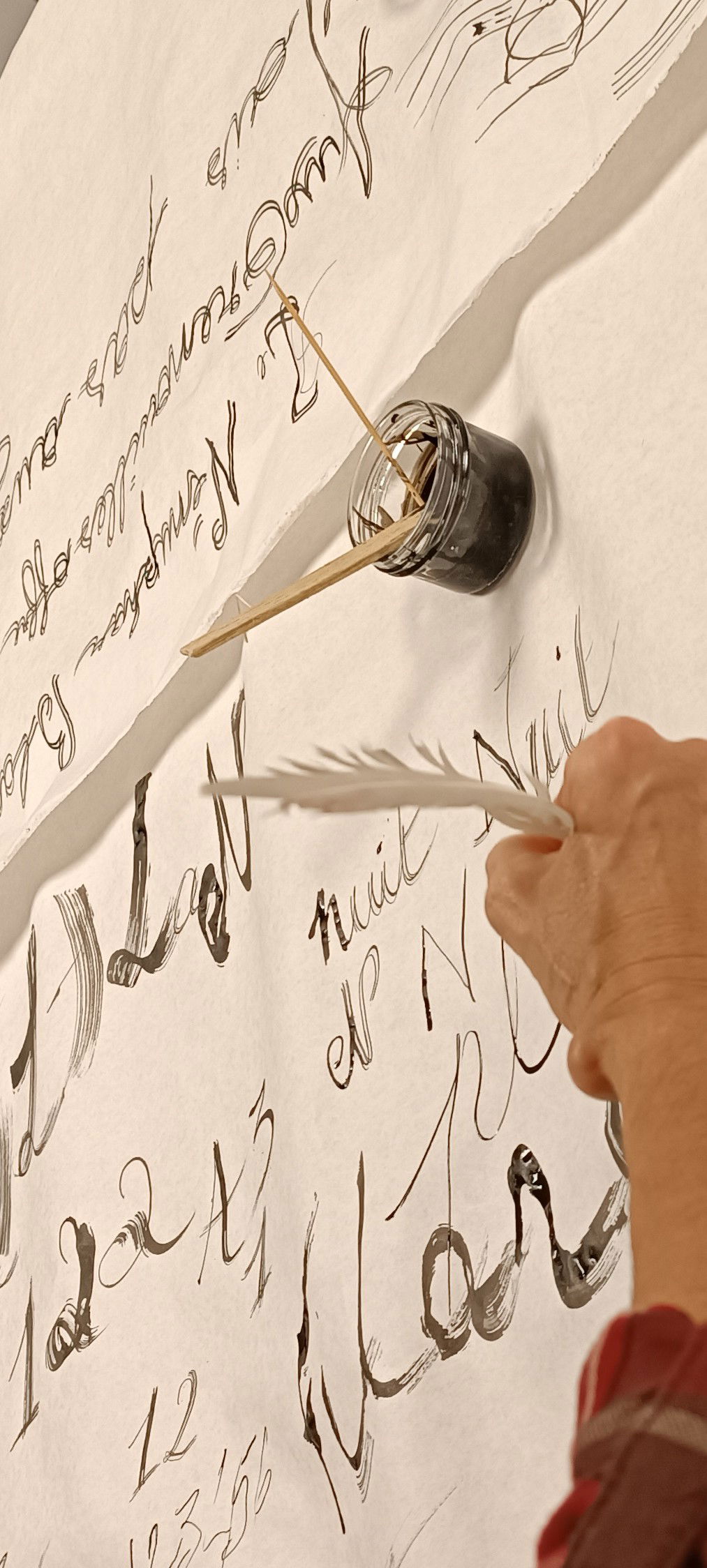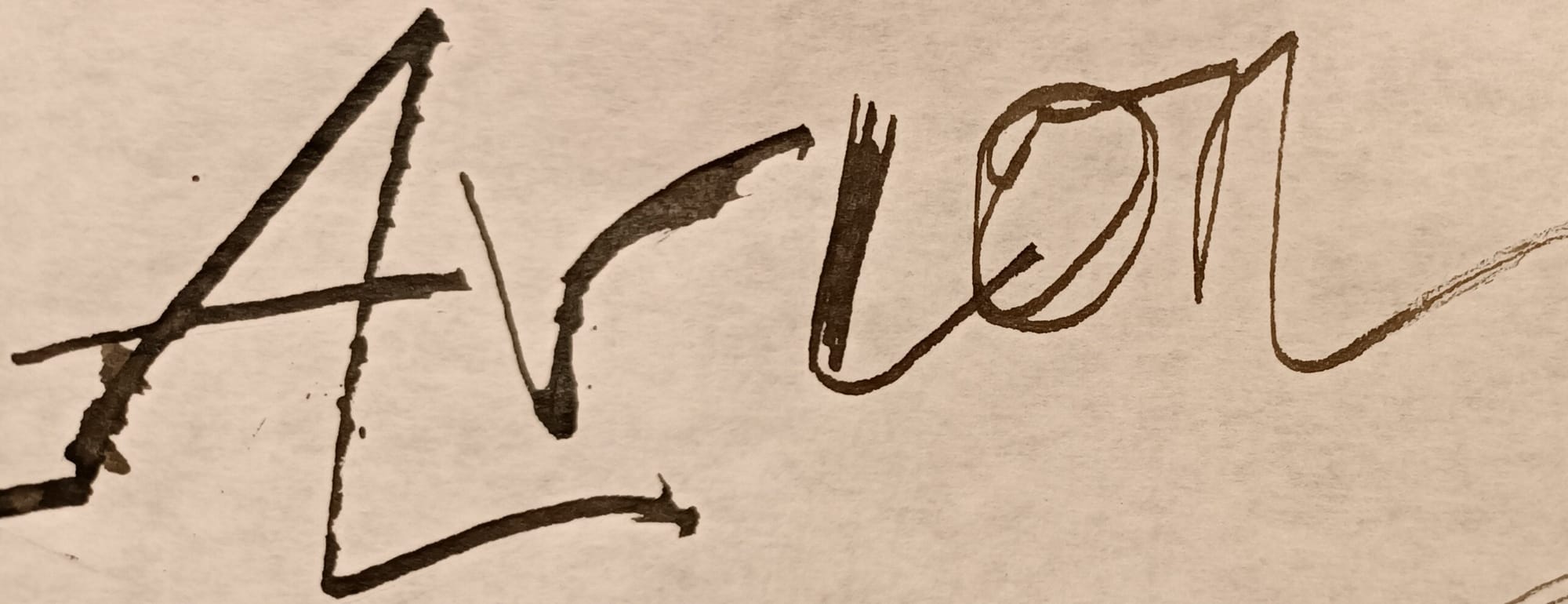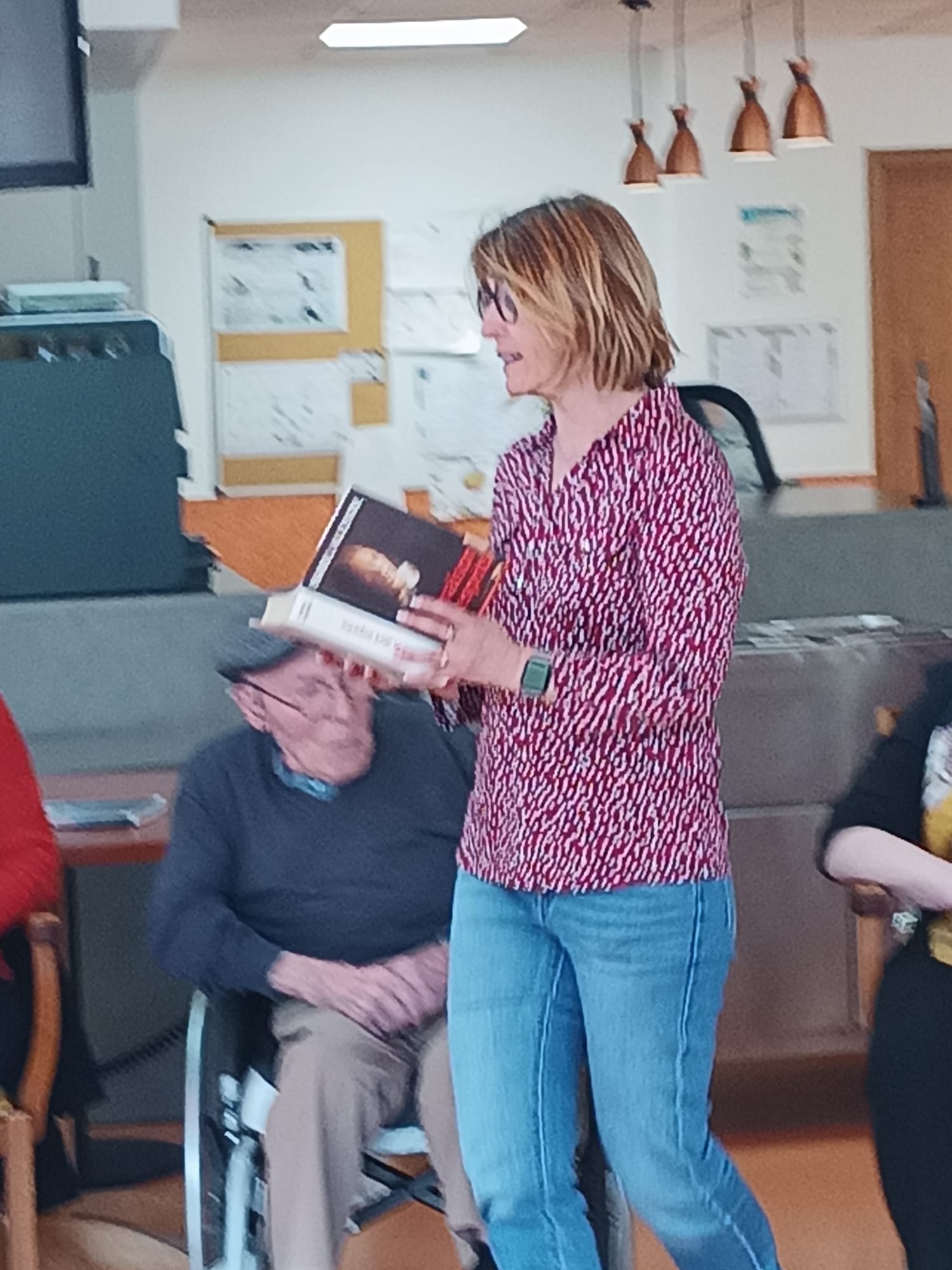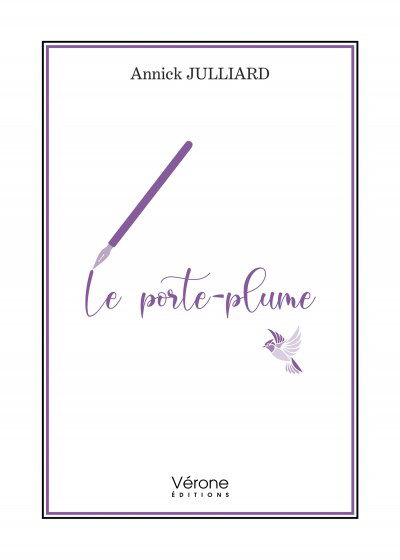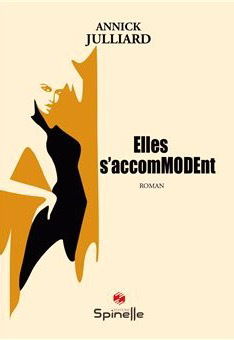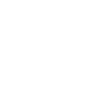- Accueil
- Lieu des ateliers
- Ecrire et faire vivre l'écrit
- Les ateliers d'écriture créative
- Les ateliers de gestuelle graphique
- Les ateliers de diction
- Àgenda
- Ateliers d'écriture
- À propos
- À propos
- À propos
- À propos
- PROJETS 2025 - 2026
- À propos
- dans les coulisses du spectacle
- Témoignages
- À propos
- retour sur images
- Retour sur images
- retour sur images
- retour sur images
- À propos
- du texte écrit au texte lu : faire vibrer les mots
- Galerie
- Galerie
- À propos
- Galerie de photos "déambulation de mots à Taussat"
- Lectures en EPHAD
- Retour en images lectures en Ephad
- Recueil de nouvelles
- Nouvelles extraites du recueil
- Printemps des poètes 2024
- Textes écrits et lus par les participantes
- La tempête
- LA Grâce
- Lectures au Jardin de Lanton
- Galerie
- Galerie
- Lectures Café Jardin 2024
- Galerie
- Textes lus au Café Jardin de Lanton
- TEXTES LUS AU CAFE JARDIN DE LANTON
- TEXTES LUS AU CAFE JARDIN DE LANTON
- L'écriture dans tous ses états
- Récits sur le thème "se raconter"
- récits sur le thème "se raconter"
- récits sur le thème "se raconter"
- Récits sur le thème du "trésor enfoui"
- Récits sur le thème du "trésor enfoui"
- récits sur le thème du "trésor enfoui"
- Récits sur "la bouteille à la mer"
- Écriture en résidence par Annick
- Romans écrits par Annick Julliard
- De la céramique à l'écriture
- La démarche de création par Émilie
- Processus de fabrication
- Galerie
- L'oeil de la photographie par Lucile
- Galerie
- explorer toutes les techniques pour une plus grande satisfaction...
- Concours de nouvelles 2023
- Concours de nouvelles 2023
- Lecture Publique 12 décembre 2023
- Nouvelles
- Nouvelles
- Nouvelles
- Nouvelles
- Nouvelles
- Nouvelles
- Nouvelles
- Nouvelles
- Nouvelles
- Nouvelles
- Nouvelles
- Nouvelles
- NOUVELles
- Nouvelles
- Nouvelles
- Nouvelles
- Nouvelles
- Nouvelles
- Nouvelles
- Contact
La littérature
dans
tous ses états
contact :
atelierslitteraires@gmail.com
(+33) 06 75 47 80 62
site administré et mis à jour par Jean-François Sabourin
association culturelle
adhésion annuelle à l’association : 10 €
cotisation anuelle pour participer
aux différentes activités : 50 €
Les ateliers se tiennent
dans les locaux de la
Maison des Associations
de Lanton
25 avenue David De Vignerte
les mardis de 9 h 15 à 12 h 15
les mercredis de 17 h à 20 h
les jeudis de 10 h à 12 h
(hors périodes
de congés scolaires)
et faire vivre l'écrit
Trois ateliers vous sont proposés
sous l’impulsion de Pascale, Patricia et Jean-François
qui partagent et transmettent leurs savoirs
et des savoir-faire pour le plaisir d’écrire
et de se découvrir.
- Les ateliers d’écriture (Jean-François)
- Les ateliers de diction et de mise en voix (Pascale)
- Les ateliers de gestuelle graphique (Patricia)
Ces ateliers s’adressent à tous
écrivains débutants ou confirmés
et se veulent avant tout des moments d’échanges
dans la bonne humeur et le respect de chacun.
Vous voulez apprendre, vous voulez transmettre,
alors… poussez la porte de ces ateliers selon votre choix,
vos attentes et vos envies.
Les ateliers d'écriture créative
La démarche
Les propositions d’écriture sont des dispositifs qui stimulent l’imaginaire. Ainsi, les contraintes libèrent l’écrit et facilitent l’apprentissage de procédés et techniques narratifs, poétiques et stylistiques. L’atelier d’écriture est un moyen de mettre en pratique une démarche d’écrit. Il permet de développer les compétences d’une façon différente, ludique et conviviale. L’atelier est le lieu du passage, de la transmission d’une expérience particulière de création. C’est aussi un lieu et un moment d’expérimentation en groupe. Il met en avant le processus d’écriture : on essaie, on coopère, on questionne, on décortique, on fabrique des textes, on joue avec les mots, on découpe la narration, on façonne des personnages dans un véritable laboratoire d’écriture. C’est à travers la pratique et l’expérimentation que chacun développe son savoir-faire.
La méthode
Un atelier d'écriture créative c’est un lieu de rencontre avec l’univers de l’Autre tout en se re-connectant à son propre univers (sensible, créatif). Un espace où les participants sont invités, à être, à apprendre et à explorer ensemble, non pas chacun isolé, mais relié aux autres dans une démarche constructive et bienveillante. Chaque « écrivant » est sollicité pour produire du texte, le partager par des lectures et le faire évoluer. Les notions littéraires (procédés narratifs, jeux linguistiques, effets stylistiques, construction syntaxique, etc.) sont abordées sous un angle pratique et concret selon une éthique éditoriale et pédagogique basée sur le respect du rythme de chacun.
L'animation
Jean-François Sabourin, auteur, chroniqueur littéraire, formé à la pratique des ateliers d'écriture créative à l'Aleph à Paris et aux techniques de l'OuLiPo (OUvroir de LIttérature POtentielle), anime ces ateliers par la pratique d’écriture sous contraintes linguistiques. L’écriture créative pour "désapprendre" à écrire !
est à l'écriture
ce que le chant est à la parole.
"Par les connaissances diverses qu’elle requiert, par la dextérité et la sûreté du geste qu’elle implique, par la créativité qu’elle stimule, la calligraphie a plus que jamais sa place dans le champ de l’expression graphique, plastique, artistique contemporaine…"
Dans cet atelier, sous l'impulsion de Patricia, les participant(e)s sont invité(e)s à partir à la rencontre de leurs propres écritures graphiques, volontaires, intentionnelles...
Par le geste et la trace exprimer, appuyer visuellement l'intention, l'émotion d'un mot (ou tout son contraire !), donner (une autre) vie aux mots...
Sûreté du geste, maîtrise de l'outil, entraîner son corps, son épaule, son bras, son poignet, sa main qui maîtrise l'outil.
De l'encre noire, des lamelles de cageots biseautées sur du papier de verre... suffisent à donner vie à cet art !
Elle mettra son talent au service de l'illustration de chacune des nouvelles qui composeront un livre à venir sur le thème de
"la rencontre", objet d'un travail d'écriture partagée au sein des ateliers d'écriture.
Les ateliers de diction
La mise en voix des textes produits en atelier d'écriture
La mise en voix est une activité artistique dans laquelle il s’agit de transmettre le texte, de le « faire passer ». Elle reprend toutes les caractéristiques de l’oralisation par un travail d’adresse et de regard et une explicitation du sens que l’on aura découvert précédemment dans les ateliers d'écriture. Les participants travaillent sur leur voix, le rythme de la diction et l'élocution qui permettent d'ouvrir l'émotion de l'intérieur vers l'extérieur, de mettre en musique les mots de chacun. Apprendre à respirer et les techniques de la lecture à haute voix.
La mise en espace des textes
Dans le cadre d’une mise en espace, à la voix s’ajoutent le corps et l’espace « utilisés » comme signes symboliques pour exprimer le sens du texte (situation, relations, sentiments…). On est toujours dans une lecture, mais on fait un pas vers la mise en jeu. Dans cette forme, les placements et les changements de placements, les gestes, un accessoire, pourront accompagner la lecture pour faire naître le sens par l’image. C'est le « pousser devant soi » vers une interprétation des personnages.
L'animation
Pascale Billard par son expérience de la scène et du jeu théâtral anime ces ateliers de diction et de mise en scène des textes écrits en ateliers d'écriture. Ces ateliers sont une passerelle entre l'écrit et la verbalisation de l'écrit en vue de lectures de textes en public.
Deux nouvelles représentations du spectacle "Vous dites femmes !"
le vendredi 6 mars à 20 h 30 à l'Estran St Médard en Jalles
le 26 juin à la ferme de Lanton (après-midi)
Organisation d'une animation dans le cadre du Printemps des poètes 2026
Ecriture en résidence du 20 au 26 avril pour 8 écrivaines de l'association
Lectures publiques dans les librairies "Le Jardin des lettres" à Andernos les Bains et "la petite Parenthèse" à Audenge
Lectures auprès des résidents en EPHAD
lectures publiques au bar "Le Love" à Andernos Les Bains et à la gare d'Arès avec l'association "Une gare des regards"
mardi 24 février 2026
dans la salle d'activités de la MAJ
(animé par Jean-François)
1- écriture spontanée : imaginer des stuations de cause à effet sous forme de citations
2- écriture créative : faire l'auto portrait d'un personnage de roman (support vidéo)
3- Écriture partagée : écrire un texte à étapes obligatoires
en immersion
jeudi 26 février 2026
dans la salle d'activités de la MAJ
(animé par Jean-François)
- Structurer son imaginaire
- Le squelette du récit
- La structure narrative du récit
- La méthodologie
- Les personnages
- Les dialogues
- Le point de vue de narration
en immersion
jeudi 5 mars 2026
dans la salle d'activités de la MAJ
(animé par Patricia)
- L’appropriation des techniques pour réaliser l' "objet livre"
- Le processus de réalisation
- La matière première ; les ingrédients
- La méthodologie
- Le calendrier
Ce livre sera imprimé et édité au printemps 2026. Il sera disponible dans toutes les librairies et médiathèques du Bassin au prix de 12 € et donnera lieu à des lectures publiques et des séances de dédicaces.
Avec lui les mots vont voyager pour aller au plus près de leurs lecteurs !
Pour permettre de financer son impression, une vente par souscription a été lancée.
Vous pouvez vous procurer le bulletin de souscription :
1) auprès d'un(e) des adhérent(e)s de l'association
2) en écrivant directement à l'association à l'adresse : atelierslitteraires@gmail.com
3) en utilisant l'onglet de contact qui s'affiche sur ce site.
de ce livre, une vente par souscription
a été lancée.
Vous pouvez vous procurer le bulletin
de souscription :
1) auprès d'un(e) des adhérent(e)s
de l'association
2) en écrivant directement à l'association à l'adresse : atelierslitteraires@gmail.com
3) en utilisant l'onglet de contact
qui s'affiche sur ce site.
Ce bulletin de souscription est à retourner accompagné du réglement de 12 €
soit à l'un(e) des membres de l'association
soit directement à l'adresse de l'association :
11 rue Agrippa d'Aubigné 33138 Lanton
PROJETS 2025 - 2026
ATELIERS "HORS LES MURS"
L'association mènera cette année plusieurs partenariats
- avec les médiathèques du Nord Bassin pour des lectures de textes écrits en ateliers (Andernos Les Bains, Arès, Lanton et Audenge)
- avec l'EPHAD de Lanton pour la lecture de textes auprès des résidents
- avec les associations à l'ancienne gare d'Arès
- avec l'association "LESELLESDUBASSIN" et "LES RESTOS DU COEUR"
- avec l'école de musique d'Andernos pour une soirée "lecture musicales" au printemps 2026 (contacts en cours)
- avec les librairies d'Andernos les Bains "Le Jardin des Lettres" et d'Audenge "La petite Parenthèse".
L'association a aussi vocation à proposer des soirées de lecture chez des particuliers (à la demande). Prendre contact avec l'association : atelierslitteraires@gmail.com ou au 06 75 47 80 62 pour connaître les modalités.
SPECTACLE
Après le succès des deux représentations en novembre 2025 du spectacle intitulé "Vous dites Femmes !" (sous la direction de Pascale Billard metteur en scène) la troupe de l'association se produira de nouveau le vendredi 6 mars 2026 à 20 h 30 au Café associatif L'Estran à Saint-Médard-en-Jalles.
Un nouveau spectacle est en gestation pour l'automne 2026.
RECUEIL DE NOUVELLES
Dans le cadre de ses ateliers d’écriture, onze auteures membres de l’association ont collaboré à l'écriture d'un recueil de nouvelles sur le thème de "la rencontre". Le livre qui comporte près de 200 pages et onze nouvelles illustrées par leurs auteures sera imprimé et publié courant premier trimestre 2026. Il sera mis en vente dans les librairies du Bassin et donnera lieu à des séances de dédicaces et des lectures pour tous publics.
"ÉCRITURE EN IMMERSION"
Onze membres de l'association participeront au printemps 2026 (du 20 au 26 avril 2026) à une semaine d'écriture en résidence d'auteurs dans un lieu hors du Bassin. Les auteures écriront chacune un récit personnalisé qui sera mis en livre. Le groupe sera encadré par Jean-François pour l'accompagnement littéraire et Patricia pour la réalisation du livre. Ce projet sera reconduit en 2027. Chaque livre sera unique !
"Vous dites femmes !"
dans les coulisses du spectacle
Témoignages
Dans le cadre des Cinq à Sept du Baryton, les soirées culturelles du dimanche soir, nous avons eu le plaisir de recevoir en ce dimanche 16 Novembre, l'association "Les ateliers Littéraires de Lanton" qui nous ont proposé un spectacle original auquel un nombreux public (environ 60 personnes) a assisté. Il s'agissait de l'interprétation par 7 actrices et acteurs de textes de grands auteurs de la chanson française sous forme d'une pièce de théâtre. Ainsi a-t-on pu reconnaitre entre autres textes "Pénélope" de G. Brassens, "Quand reviens tu " de Barbara, "Déshabillez-moi" de J. Gréco, "Elle a fait un bébé toute seule" de JJ. Goldman. Un spectacle de qualité magnifiquement interprété. Cette soirée était organisée en partenariat avec les "Elles du bassin", association qui a pour vocation de lutter contre le cancer du sein par la pratique du sport, elle a permis de collecter 520€ de dons au bénéfice de cette association, le Baryton a contribué à cette collecte à hauteur de 100 €.
Le Café associatif le Baryton
Après le match de rugby direction le Baryton à Lanton, où nous attendaient les acteurs du spectacle « Vous dites Femmes » et un public venu nombreux. 7 femmes et un homme sur scène : acteurs talentueux s’il en est, une mise en scène ciselée, précise, émouvante, mêlée de réalisme, de poésie et d’humour. Quel belle manière de conclure cet octobre rose, un cadeau que nous avons tous et toutes savouré à l’aune de la pertinence du choix et de la beauté des paroles de chansons théâtralisées avec talent. Remerciements chaleureux à Jean-Francois qui nous a contactées il y un an et offert ce spectacle, à Pascale pour sa talentueuse mise en scène, et aux actrices qui ont mis leur âme au service des textes. Des amateurs pensez vous ? Que nenni ! Une belle équipe investie et prometteuse de biens d’autres pépites. Le public enthousiaste ne s’y est pas trompé ! Enfin à Cerise, du Baryton, qui a ouvert ses portes et la scène pour nous tous, un grand merci. Je n’oublie pas les bénévoles, importants et indispensables, qui outre le travail fourni, ont participé en nous offrant leurs pourboires. Une générosité et une bienveillance tous azimuts qui a suscité en moi une grande émotion. Grace à tous, cette salle chaleureuse et intimiste, a permis au chapeau de transformé en violon, de nous remettre une somme de 530€. Merci du cœur à tous pour ce moment de grâce qui restera gravé dans nos cœurs. Merci aux Elles du Bassin qui m’ont accompagnée. Et une belle occasion qui nous a permis de parler de notre action et de prévention. Nous nous retrouverons, c’est certain. Nicole Landrieux (présidente des EllesDuBassin)
Les Elles Du Bassin
"Vous dites femmes !"
de la Maison des Associations de Lanton le samedi 29 novembre 2025 devant plus de 90 personnes.
Cette deuxième représentation a recueilli un véritable succès.
La troupe se produira une troisième fois le vendredi 6 mars 2026 dans la salle du Café associatif de l'Estran à Saint-Médard-en-Jalles.
retour sur images
Retour sur images
retour sur images
retour sur images
au Baryton
Une initiative qui sera renouvelée en 2026.
Remerciements à Alain Leomant et toute son équipe du "petit Baryton"
du texte écrit au texte lu : faire vibrer les mots
Galerie
Galerie
Un moment de convivialité et d'échanges apprécié par tous y compris les promeneurs croisés sur le sable de la plage et les ruelles de Taussat.
Galerie de photos "déambulation de mots à Taussat"
Jusqu'à cet instant improbable où la plus ancienne des résidentes âgée de 100 ans a déclamé de mémoire et avec beaucoup de grace un poème du grand poète cubain José-Maria de Hérédia : "Comme un vol de Gerfaults".
Une expérience qui sera renouvelée en 2026 !
Retour en images lectures en Ephad
Le livre sera édité au printemps 2026 et disponible dans les librairies et médiathèques du Bassin.
Nouvelles extraites du recueil
Re-naissance Dos à la cheminée, un bol de ricoré en main, je me sens comme le paysage face à moi plongée dans un épais brouillard. Je n’ai pu trouver le sommeil après avoir travaillé une partie de la nuit. Je m’appelle Emeline, j’ai 35 ans, j’habite le village de Fontvieille depuis trois ans, un bourg niché dans un vallon tout près d’une rivière qui serpente un peu en retrait du bourg. J’ai souhaité revenir près des terres de mon enfance et me suis installée ici pour retrouver mes racines. Je suis aquarelliste. Depuis plusieurs semaines je travaille au portrait de ma mère disparue lors de mon adolescence d’une maladie rare, mais je m’aperçois que mes souvenirs s’effacent, je revois la rondeur de son visage, son nez retroussé et le grain de beauté posé sous sa lèvre inférieure. Toutes les esquisses que je produis ne sont pas fidèles à mon souvenir. Neuf heures sonnent au clocher. Comme chaque jour, Louis mon voisin, la soixantaine élégante, quitte son domicile. C’est le maire du village. Il passe la journée à écouter, échanger, aider ses administrés. Il porte la gentillesse en bandoulière. On se côtoie tous les jours, nos maisons se font face mais on ne se connait pas vraiment. L’année dernière, le conseil municipal m’a sollicitée pour faire le portrait de Louis comme il est de coutume pour tous les maires du village. Quelle marque de confiance !!! Très heureuse, je me suis alors précipitée pour lui demander de poser pour moi. À mon grand regret il a évoqué son manque de temps. J’ai alors ressenti une certaine gêne. Malgré son sourire plaqué sur son visage, je perçois une fêlure. Ses yeux reflètent une certaine mélancolie et sans plagier la maxime « les yeux ne sont-ils pas le reflet de l’âme » ! Mes insomnies m’épuisent et depuis de longues journées, assise devant mon chevalet, mon dos me fait souffrir. « Pourquoi ne pas me dégourdir les jambes et descendre au village aujourd’hui, c’est la fête de la St Jean ? », pensai-je au fond de moi. Sur le chemin, en longeant la rivière, je contemple une famille de canards qui glisse sur l’eau paisiblement, des oiseaux s’ébrouent en faisant pénétrer l’eau jusque sur leur peau. En arrivant sur la place du village, de la musique et des chants me parviennent. Certains jouent à la pétanque ou aux quilles, les enfants au chamboule-tout, d’autres préparent le feu pour le soir. Il règne un esprit bon enfant. Spectatrice, j’éprouve de l’indifférence à ce qui m’entoure, toute cette effervescence me perturbe. Je préfère retourner près de la rivière, la nature m’apaise. La voute céleste m’éclaire, je peux percevoir dans la pénombre la silhouette des cyprès. Mes pas me guident vers le petit pont de pierre. J’entends le doux bruit de l’eau qui ricoche sur les galets. En approchant, je découvre à quelques mètres de moi monsieur le maire inerte. Je lui soulève délicatement la tête, il essaie de parler mais ses paroles sont inaudibles, il ne peut bouger. Affolée, je repars vers le lieu de la fête, mes yeux sont embués, mon cœur cogne dans ma poitrine. En arrivant près de la fontaine, je m’adresse à tous les habitants présents et je crie : « s’il vous plaît, appelez les secours, c’est monsieur le maire ». Depuis bientôt quatre mois, monsieur Louis se remet doucement de son AVC. À l’hôpital, il est le patient idéal, préféré des infirmières et toujours d’humeur égale. Trois fois par semaine je lui rends visite, nous apprenons à nous connaître, on s’apprivoise un peu plus chaque jour. Je ne sais pourquoi, depuis son accident, je me sens investie d’une mission, j’aime lui raconter les potins du village et le rituel des visites m’oblige à sortir de mon antre. Avant de franchir le seuil de sa chambre, quelquefois je l’observe dans l’encoignure de la porte ; la barbe mal rasée, la chemise froissée, son regard est absent, mais dès que j’entrouvre la porte ses yeux pétillent. Machinalement il se recoiffe, remonte son col de chemise et retrouve de sa superbe. Je le soupçonne de progresser pour me remercier et me faire plaisir. Je me suis attachée à mon voisin, il est le père que je ne vois plus, le temps nous ayant éloignés. Depuis quelques jours, nous parcourons le parc, le dos courbé sur son déambulateur et le pas hésitant, il reprend des couleurs mais le gentleman-farmer d’autrefois a disparu !!! Dans une semaine, c’est le départ, adieu à l’hôpital. Une armada d’aides ménagères, kinésithérapeutes et infirmières lui simplifieront sa vie quotidienne. J’ai tout organisé et le dimanche je prendrai le relais, nous nous retrouverons autour du déjeuner, cela m’obligera à renouer avec la cuisine. Je me suis surprise depuis quelques jours à replonger dans mes recettes culinaires et de nouveau à chantonner le matin, j’ai l’impression que mon âme est moins grise. Aujourd’hui c’est le grand jour pour Louis, depuis plus d’un mois à sa demande je l’appelle par son prénom. Une fois sa maison aérée et les volets ouverts, sur la table du salon trône un bouquet de fleurs des champs à côté d’un gâteau aux noix, son péché mignon. Tout à coup, un bruit de pneus crissant sur les graviers de la cour se fait entendre. Avec une grande fébrilité je me précipite à la rencontre de Louis, je saisis sa valise d’une main et de l’autre son bras. L’ambulancier jovial s’exclame : - Je vous ramène votre papa, vous allez pouvoir prendre soin de lui. Un regard complice et Louis répond sans autre formalité. - Ça fait du bien de rentrer à la maison !!!! Plusieurs semaines se sont écoulées depuis le retour de Louis. Je ne sais pourquoi, tout est prétexte à lui rendre visite. Près de lui, je me sens apaisée et retrouve une certaine joie de vivre. Louis me raconte son passé de journaliste, ses voyages et moi mes études aux beaux-arts, mes interrogations et mes doutes. Ensemble, pendant des heures, nous échangeons nos points de vue, nous débattons. Très complices, nous rions aussi beaucoup. Depuis quelque temps, Louis a repris ses activités de maire en télétravail. C’est un défilé permanent : administrés, collègues, voisins viennent discuter et demander des conseils, les habitants se sentaient un peu orphelin, il est l’âme du village. Dans une semaine c’est noël, j’ai lancé l’invitation, Louis réveillonnera chez moi, ce sera l’occasion de lui faire découvrir mon univers. Depuis le décès de mes grands-parents, il y a quatre ans, je n’ai plus fêté noël. En ce qui concerne mon père, une fois par an, il me téléphone pour mon anniversaire mais nos échanges sont brefs. Nos chemins se sont séparés depuis longtemps. Je n’éprouve aucune tristesse, mon amitié avec Louis me comble et me satisfait pleinement. Nos discussions me nourrissent. J’ai dressé la table avec bonheur, préparé le repas avec délice et j’attends avec impatience sa venue toute excitée. Cette après-midi, une fine pellicule de neige recouvre la vallée. Le feu crépite, une odeur d’orange remplit la maison. Soudain la sonnette retentit et la porte s’ouvre. Louis droit sur sa canne, enroulé dans une veste en cachemire sourit et s’exclame : - Je crois que le père noël est passé un peu en avance ! Je m’approche du seuil et découvre cinq paquets entassés près de la porte. La gorge serrée comme une enfant j’ai hâte de découvrir mes présents, de défaire les rubans et d’ouvrir les paquets. Cartons à dessin, gouaches, pinceaux, livres sur la peinture et sur la cuisine s’éparpillent devant moi. Puis, j’aperçois un dernier petit paquet. Impatiente, je ne peux resister au plaisir de le découvrir : un flacon de parfum. Je souhaite immédiatemment le sentir et m’en asperger, je reconnais le musc et la mure, cette fragrance me replonge dans mon adolescence, mais la nostalgie n’est pas de mise, surtout aujourd’hui, il faut que je me ressaississe, je respire profondément et doucement déclare : - Merci Louis pour tous ses cadeaux. Nous passons à table. Après le foie gras, les escargots, la caille aux raisins et le brie aux truffes, je suggère de passer au salon pour déguster le dessert. Pour l’occasion, j’ai confectionné une bûche au chocolat et à la noix. Sur un plateau j’installe le gâteau, les flûtes de champagne et avec précaution, je me dirige vers le salon. - Merci encore Louis pour le parfum... c’était le parfum de ma mère. Louis est debout devant la cheminée et une larme coule le long de ses joues. Gênée, je dépose le plateau sur la table basse et m’avance vers lui. - Que se passe-t-il ? Il se dirige penaud vers le canapé, s’assoit doucement. - il y a plus de trente ans, lors d’un déplacement professionnel, j’ai rencontré une femme, un véritable coup de foudre. Elle portait ce parfum. Ses épaules se sont affaissées, il poursuit : - En accordant nos agendas respectifs nous pouvions nous retrouver une à deux fois par mois. Nous avons visité tout l’hexagone. Nous étions insouciants et tellement heureux. Puis, un jour, elle m’a annoncé qu’elle était atteinte d’un mal incurable et qu’elle partait vivre à la campagne. Alors j’ai démissionné, je suis venu m’installer ici, près d’elle, à seulement quelques minutes de son village. Je me suis rendu tous les jours à l’hôpital pendant des mois. Je l’ai accompagnée jusqu’à son dernier souffle. Un jour elle a émis le souhait d’être enterrée à Fontvieille. Nous sommes maintenant ensemble pour toujours, je l’ai aimée et l’aimerai toute ma vie. - Cette histoire Louis c’est un peu la mienne. Comment s’appelait-elle ? - Anne Mes mains se mettent à trembler, mon regard se trouble, je frissonne d’émotion. C’est impossible, soudain je comprends mon attachement, l’attirance que j’éprouve. - Louis, tu parles de ma mère ? - Ta mère ? - Oui, Anne Lafontaine. - Mon dieu, j’aurais dû me douter, ton nez retroussé, ton sourire... - Je ne t’ai jamais vu à l’hopital ? - Non, je savais que tu venais avec tes grands parents le mercredi alors je m’effacais pour respecter votre intimité. - Les fleurs fraiches sur sa tombe chaque semaine... - Oui, c’est moi. Je me précipite dans ma chambre, saisis le portrait de ma mère. - Voici mon cadeau de noël. Il regarde tendrement le tableau, pose délicatement sa main sur la toile, la se lit sur son visage. Les mains moites, la gorge serrée, je dépose sur ses mains un baiser. Tout doucement je lui murmure : - Ma mère nous réunit et j’en porte le parfum, je serai toujours là, tu peux compter sur moi, je veillerai sur toi comme tu as veillé sur ma mère. Les yeux rougis, Louis me regarde. - Je suis tellement heureux de te connaître. Joyeux noël Emeline. Au loin, les cloches sonnent la fin de la messe de minuit. Dans le salon, sous le regard bienveillant de ma mère, tous les deux nous sourions. C’est mon plus beau noël d’adulte, nous sommes désormais une famille, une vraie famille.
Pascale
Au bord de l'étang C’est quand ma mère a perdu sa première fille que j’ai décidé de naître. Oh ! Pas de gaîté de cœur ! Car la vie sur terre n’est pas toujours facile, je le sais bien... Je n’en suis pas à ma première incarnation. Non ! J’ai décidé de naître un peu comme on se suicide… par défaut. Je savais ce qui m’attendait. Mais les bébés c’est comme les mémés, ça perd la mémoire… nous en naissant, elles en quittant… ce que l’on appelle la vie. Pendant neuf mois, tout s’était bien passé. Mais voilà qu’au moment de naître, le bébé, envahi par un doute, n’a pas eu le courage d’aller plus loin. Il a préféré se pendre au cordon ombilical. Ma future mère était en grande souffrance. Du coup, j’arrive sur un lourd passif ! Ma maman s’inquiète de tout, et je reçois des ondes de tristesse qui se propagent dans ma baignoire amniotique. Tantôt ça picote, et tantôt ça m’oppresse. J’ai bien essayé de me caser dans un coin, mais rien à faire, je me développe harmonieusement et mon corps occupe presque tout l’espace dans l’utérus. Aucune échappatoire possible ! Alors ne soyez pas étonnés si je suis sortie de là comme une lettre à la poste. Je n’en tire pas de gloire. Il y avait urgence ! Heureusement la sage-femme avait de l’expérience, elle m’a rattrapée au vol. Et me voilà ! D’abord, je reçois une lumière aveuglante comme un flash photographique ! Saisie de terreur, je pousse un hurlement ! Quand je réalise que ce cri sort de mon corps, je réitère, un deuxième, un troisième ; finalement c’est très libérateur, il faudra que je recommence ! Et puis, c’est étrange la sensation que ça fait toutes ces mains sur mon corps, qui me palpent et me caressent. Je ne peux pas dire que ce soit très agréable ! Maintenant que ma vue s’accommode un peu mieux, j’aperçois des visages penchés au-dessus de moi. Ils ont l’air contents ; ça sourit, ça babille : - Oh ! Mais qu’elle est jolie ! - Elle a bien tous ses orteils ? - Regarde un peu ces yeux ! J’aimerais bien un peu de silence ! Là d’où je viens l’atmosphère était plus feutrée. Quand soudain une crampe terrible me tord le ventre. Hurlement. Maman me pose aussitôt sur une boule de chair d’où sort un liquide, délicieux ma foi. Récapitulons ! Je suis bien au chaud, bien nourrie… Jusque-là, tout se passe plutôt bien. Je commence à comprendre le mode de communication des humains. Surtout avec ma mère. Si je veux qu’elle s’occupe de moi, je hurle. Elle accourt aussitôt. Elle a très vite acquis l’oreille musicale. Elle sait déceler avec précision la tonalité qui signifie: « j’ai faim, je veux le sein » ; ou « je suis mouillée, c’est très incommodant, il faut changer ma couche» ou encore « je m’ennuie toute seule dans mon coin, je voudrais un câlin »… Jusque-là, tout se passe plutôt bien. - Il ne faudrait pas grandir ! - Mais comment résister à cette force surnaturelle qui, de jour en jour, me tire vers le haut pour que je grandisse, me pousse en avant pour que je marche, met des mots dans ma bouche pour que je parle ? Et par la même occasion, m’incite à l’aventure ! À goûter tout ce que je peux attraper dans mes menottes, à m’asseoir dans les flaques d’eau en riant, à courir, à tomber, à pleurer, à m’écorcher les genoux, à me cacher pour que l’on me cherche… -Victoire, où es-tu ma chérie ? Ils m’ont appelée Victoire. Quelque chose me dit que ce n’est pas judicieux ! Je n’ai pas encore l’âge de me poser des questions métaphysiques, mais à bien y réfléchir, elle est où la Victoire ? J’ai pour mission d’effacer la douleur de ma mère et la perte du premier bébé, celui qui a capitulé. La barre est haute. Bien que j’arrive en deuxième position dans la fratrie, je suis la première vivante. Celle qui a su vaincre tous les obstacles. Je suis estampillée... marquée au fer rouge de la réussite la plus glorieuse. Du coup, l’erreur ne m’est pas permise. Je dois remplacer ce fantôme qui habite chez nous. Comment ont-ils osé poser ce fardeau sur mes frêles épaules ? Au fil des jours, des semaines, des années qui passent, la pression s’accentue. « Victoire est la plus jolie des petites filles ». « Victoire est très obéissante ». « Victoire a les meilleures notes de sa classe ». Victoire... se coule dans le moule. Pour faire plaisir, pour être aimée. Victoire se perd, mais elle ne le sait pas encore. Ça viendra plus tard. Pourtant il y a des signes avant-coureurs. Victoire ne joue pas avec les autres enfants, elle parle peu, elle est sérieuse, s’enferme dans la solitude. Elle lit beaucoup pour s’évader d’elle-même, de cette Victoire bien pâlotte, qui rayonne autant qu’une bougie prête à s’éteindre. À dix ans, elle se pose déjà une foule de questions : « À quoi ça sert la vie ? Qu’est-ce que je fais là sur terre ? Je suis qui moi ? » Socrate lui répond : « connais-toi toi-même ». C’est un peu court. - Le glissement de terrain - Il se fait très vite. Presque du jour au lendemain. Plus rien n’intéresse Victoire. À l’école, c’est la dégringolade. Mais le pire c’est à la maison. Victoire devient une ombre. Elle cesse de s’alimenter. Ses parents, paniqués, ne comprennent pas, essaient de la forcer. Elle vomit tout, son corps refuse toute nourriture. Le médecin conclut à une anorexie et décide une hospitalisation. La première d’une longue série. Victoire n’a plus que la peau sur les os, de grands cernes gris soulignent ses yeux éteints, ses forces la quittent. Elle marche déjà vers le monde des ombres. Et pourtant Victoire se sent forte, invincible. Plus son corps s’allège, plus son esprit devient clair. Elle n’est pas de ce monde. Elle ne veut plus vivre enfermée dans les codes étriqués de la société humaine. Elle reprend le pouvoir sur elle-même, quitte à en mourir. Elle ne se soumet plus qu’à une seule loi, la sienne, qui lui dit qu’elle est libre, totalement libre. Mais qui la comprend ? Il y a cet homme à l’hôpital, ce psychologue qui lui dit : « Victoire, tu veux être libre, mais tu l’as toujours été, tu as toujours eu le choix ». Alors elle commence à comprendre qu’elle a elle-même forgé ses chaînes et donné la clef à ses geôliers. Puis elle comprend qu’il n’y a ni chaînes ni geôliers. Elle va au jardin : elle veut respirer le parfum du muguet, sentir le soleil sur ses chaussures pour sentir l’herbe fraîche sous la plante de ses pieds. Ce n’est pas grand-chose, pourtant elle a l’impression de sortir d’un long sommeil. Au début, remanger est une souffrance. Elle est allée si loin dans la négation de son corps ! Elle prend conscience de son extrême faiblesse, de ses muscles tétanisés, de sa démarche de pantin désarticulé. Il faudra du temps, du temps et de l’amour. L’amour de Soi… Vaste programme. Elle résiste encore, elle qui n’a appris qu’à se fondre dans le désir des autres, cette violence bien ordinaire. Invisible presque, mais tellement insidieuse ! Violence qui dépouille les êtres de leur identité, pour en faire des clones patentés. Victoire voudrait exister pour de vrai. Yohan lui apporte les devoirs pour qu’elle puisse étudier à la maison. Yohan habite à trois rues de là. Il l’appelle Bambi. Pour la première fois depuis longtemps, ça la fait rire. Bambi, avec toute sa maladresse, est tellement plus touchant qu’une Victoire coulée dans le béton. Ses parents, un peu outrés au début, vont finalement opter pour ce surnom léger et chantant. Victoire devient Bambi. Comme c’est reposant ! Quand ils ont fini leurs devoirs, Yohan reste un peu jusqu’à l’heure du dîner. Ensemble, ils jouent aux dames, aux cartes ou aux dés. Elle se sent revivre. Elle a un ami à qui raconter ses petits secrets. Yohan a un sens consommé de la dérision, et il aime bien amuser la galerie. Ils ont une grande complicité, et grâce à lui, sa vie reprend des couleurs. - Les parents de Bambi n’en peuvent plus - Oufff !!! Et même : Oufff !!! Oufff !!! Oufff !!! Ils ont laissé toutes leurs forces dans une bataille à laquelle ils n’ont rien compris. La mère est en dépression, le père est désemparé. Entre eux, ils ont frôlé le schisme. La violence de la situation les a frappés de plein fouet ! Ils ne s’y attendaient pas. Victoire était une si adorable petite fille, si sage et si gentille ! La tornade les a emportés. Le sol s’est dérobé sous leurs pieds. Qu’ont-ils fait au bon Dieu ? Portent-ils une faute originelle ? Sont-ils de si mauvais parents, pour que tous leurs enfants choisissent de disparaître ? Ils se reconstruisent péniblement et entourent leur fille de mille attentions. Ils lui demandent son avis sur tout, et la regarde vivre avec une légère distance, de peur qu’un geste, ou un mot peut-être vienne rompre un fragile équilibre. Elle remange. Mais pas de tout, et en très petites quantités. La mère est à la cuisine ; elle reprend sa fonction nourricière avec fébrilité. C’est une gymnastique compliquée. Il faut qu’elle apprenne à se prémunir des déconvenues. Inutile de passer une heure en cuisine pour un plat qui restera intouché ou à peine grignoté. Leur vie s’attache maintenant à de toutes petites victoires. Yohan a ses entrées à toute heure. Quand il est là, les parents de Bambi respirent un peu. Ils s’assoient sur le canapé, main dans la main, sans rien dire, et ils lèchent leurs plaies qui cicatrisent doucement. On les a tordus eux aussi depuis longtemps, mais ils l’ont accepté sans s’en rendre compte. Ils ont abdiqué leur liberté d’être qui ils sont vraiment. Leur fille vient sonner le tocsin du réveil ! « Il n’est plus temps de dormir braves gens ! Secouez-moi toutes ces toiles d’araignées ! Levez-vous et honorez la vie… Riez de tous vos rires ! Et répandez la joie autour de vous ». La tâche est immense. Il faut apprendre à inventer. À voir derrière l’épreuve le cadeau de la vie. Ils n’en sont pas encore là. - Victoire vient de fêter ses 17 ans - Elle est fine, élancée, un léger cerne ombre le pourtour de ses yeux gris ultra-maquillés, elle s’habille de façon très voyante, des bagues à tous les doigts, des piercings à la lèvre et aux oreilles. Bambi a appris à marcher. Mais pour aller où ? Alors comme prise de frénésie, elle part à droite, puis à gauche, ici, là, au milieu, se fait croire qu’elle est libre, mais se cogne dans tous les murs. Se montre pour être vue. Et ceux qui savent voir, pleurent. Sous la provocation, il y a un grand vide. Un manque de désir. Une surdité congénitale à l’appel de la vie. L’année dernière, elle s’est taillée les veines, comme ça, juste pour voir le sang couler. C’est hypnotique de voir le sang couler. Ça fait du bien. Elle ne saurait pas dire pourquoi, mais ça calme ses angoisses. On pourrait presque croire qu’il suffit de fermer les yeux pour que le monde cesse d’exister. Et redevenir une bulle de lumière dans un océan de paix. Oui c’est ça ! Faire cesser tous ces cris silencieux qui la déchirent de l’intérieur. Une saignée pour expurger tous ces démons. On lui demande ce qu’elle veut faire plus tard. Mais savent-ils, ceux qui lui posent la question, que plus tard ou le néant, pour elle, c’est pareil ? Elle est incapable de dire ce qu’elle veut maintenant. Elle s’étonne d’ailleurs que des gens continuent à lui parler. Ils ne voient donc pas qu’elle est déjà morte. Ou plutôt une morte vivante qui erre entre deux mondes, sans se décider à en choisir un. Ils l’ont faite interner dans une clinique psychiatrique... « pour ta sécurité ma chérie ». Ou pour la leur, car ils ne vont pas bien, eux non plus. La clinique, c’est un endroit où tous les gens qui se posent des questions sont invités à ne plus s’en poser. Les méthodes ont évolué. La violence aussi. Sourde, hypocrite, maquillée de sourires et de paroles faussement rassurantes. Encadrée par des professionnels dont le seul talent est de savoir distribuer les pilules. Les fameuses pilules ! Peu importe la cause du mal-être, qui d’ailleurs n’intéresse personne. Il faut endiguer les manifestations émotionnelles et les questions dérangeantes. Alors ils ont tout un panel de réjouissances à leur disposition : anti-dépresseurs, anxiolytiques, hypnotiques, neuroleptiques… « Au secours, j’attrape des tics », dit-elle au psychiatre. « Ce n’est pas grave, c’est juste un effet secondaire du médicament. On s’y fait très bien au bout d’un moment», lui répond-il. Victoire le détaille d’un peu plus près, il a un tic lui aussi. Quand il est gêné par une question, il hausse le sourcil gauche et pince un peu sa bouche en cul de poule. Il n’a pas l’air bien. Elle ne serait pas surprise que lui aussi prennent les fameuses pilules ! D’ailleurs, quand on vous demande ce que vous voulez faire plus tard, qu’est-ce qui peut pousser un individu normalement constitué à répondre « psychiatre » ? Ça n’existe pas ! Avec l’air de s’ennuyer à cent sous de l’heure, il lui repose la question fatidique : « Alors Victoire, qu’est-ce que tu aimerais faire plus tard ? » Là il lui tend une perche longue de trois mètres. Victoire répond du tac au tac : « psychiatre ». Pour le coup, il croise lentement les doigts sous son menton, la fixe d’un air pénétré et lui demande : « pourquoi ça ? » Victoire lui répond : « pour être du bon côté de la barrière ». Aussitôt son sourcil gauche se soulève, et le reste à l’avenant. Il n’est pas idiot ; il se sait démasqué. Il ne peut pas se permettre de garder dans ses murs quelqu’un qui le voit vraiment. Il signe un bon de sortie assorti d’une petite ordonnance pour faire sérieux, et d’un entretien avec ses parents pour leur assurer que, grâce aux bons soins prodigués dans l’enceinte de la clinique, son état s’est tout à fait bien stabilisé. Et on peut donc envisager une « remise en liberté. » - Mon séjour au pays des zombies - Ce séjour m’a poussé à réfléchir. Je comprends maintenant qu’il faut que je me prenne en main. Pour commencer, je décide de me sevrer des fameuses pilules ; avec pour effet immédiat de devenir complètement cyclothymique. Un jour, je me sens pleine d’énergie, j’entreprends mille choses ; le lendemain, j’ai grillé toutes mes cartouches, je suis au fond du trou. Il me faudra une année entière pour éliminer les tics. Je cherche de l’aide auprès d’une psychothérapeute qui m’annonce aussitôt la couleur : « ça peut prendre du temps »... la guérison bien sûr. Et justement, je n’ai pas tout mon temps. Chaque jour est une épreuve pour garder la tête hors de l’eau. J’accepte son aide malgré tout. Elle me fait dessiner. Et je dessine... des portes blindées, des portes cloutées et cadenassées, qui découragent toute volonté de s’échapper. Elle m’aide à refaire le chemin à l’envers, en m’éclairant à la loupiote. Mais je sens bien qu’il faut que j’aille déterrer une raison de vivre plus profonde. L’idée m’est venue en relisant la saga des « Chevaliers de la Table Ronde ». Et si je me transformais en chevalière pour aller mener une quête. Voilà qui me plaît bien ! Une quête qui verrouille ma tentation de mourir. Car chaque jour qui passe, le suicide m’apparaît comme la seule issue possible à cette affreuse comédie qu’est la vie. Alors c’est d’accord ! Je me donne le droit de mourir, mais uniquement quand... j’aurai trouvé le bonheur. Maintenant j’ai un objectif fort. Je n’ai pas la carte routière qui y mène, mais peu importe ! J’enfourche mon blanc destrier. Je pars désormais en quête du bonheur ! « Mais le bonheur ne se trouve pas sous le pied d’un cheval ! », ironise Yohan. Il n’a pas tort, il va falloir nourrir ma motivation ! Les parents de Yohan ont un magasin de prêt-à-porter. Ils me proposent un emploi de vendeuse. Cette proposition est sûrement le fruit d’une conspiration avec mes parents. Je les crois prêts à payer pour qu’ils me donnent du travail. Mais j’exagère. Je connais suffisamment bien les « Capucini » pour savoir que le père de Yohan, sous sa faconde méditerranéenne, a le sens des affaires. Il a tout de suite repéré le parti qu’il pourrait tirer de ma silhouette de mannequin famélique. D’ailleurs, dès que j’arrive au magasin, je me change pour enfiler une des tenues chics qu’ils ont en vitrine. Pour le reste, je connais la musique... « Qu’est-ce qui vous ferait plaisir, Madame ? ». Me couler dans le désir de l’autre. Ça c’est mon vêtement invisible. Je le porte sur toutes les autres tenues. Mais j’ai conscience de le faire. Je m’observe en train de le faire. Je sais que je suis sur la scène d’un théâtre où je joue le rôle que l’on m’a assigné. Au moins, je ne me mens plus à moi-même. - Le mariage - Une chose en entraînant une autre, me voilà mariée avec Yohan. Dans l’intimité, il m’appelle toujours Bambi, et ça commence à m’énerver. C’est très joli Victoire. Je ne veux plus être associée à un personnage hésitant qui tient à peine sur ses jambes. Je suis une chevalière que diable ! Je pourfends les ombres avec mon épée magique ! Il y met du sien. Aucun homme ne pourrait me supporter plus de cinq minutes, mais lui fait preuve d’une patience et d’une écoute exceptionnelles, sans jamais se départir de son humour. C’est ça qui me plaît tant chez lui. Cette facilité à prendre du champ sur les évènements de la vie, sur les relations quand elles deviennent trop lourdes. Et hop ! Pirouette ! Il sait encore me faire rire. Pendant les dix années qui suivent, je plonge sans retenue dans l’univers du développement personnel. J’y retrouve la petite Victoire qui se conformait à ce que l’on attendait d’elle au sacrifice de son être vital. J’apprends à me faire du bien, à chouchouter mon corps, à écouter mes désirs, à m’aimer enfin, telle que je suis, et non telle que les autres me veulent. Je commence à aller mieux. C’est là que tout s’est effondré ! Je ne voyais que moi, moi, moi. Mais lui !… l’avais-je bien regardé ? Ce blanc chevalier, ce sauveur, qui soudain n’avait plus personne à sauver. Et par effet de alancier se retrouvait face à lui-même. Ne m’ayant plus comme paravent, il s’en alla chercher ailleurs une autre victime derrière laquelle se cacher. Je n’ai pas eu la grandeur d’âme de l’épauler, de lui pardonner. Mon égo réclamait un holocauste. Nous avons divorcé. Allez savoir pourquoi, aujourd’hui, une tristesse sans fond s’empare de moi, à l’improviste ! La vague, la terrible vague que j’ai réussi à contenir toutes ces années revient m’engloutir, anéantissant tous mes efforts. Je ne suis plus très sûre d’avoir été juste avec Yohan. N’a-t-il pas été là pour moi depuis toujours ? Est-ce-que l’amour compte pour rien dans cette histoire ? Ne suis-je pas tout simplement une affreuse petite fille égocentrique ? Échapper aux injonctions des autres signifie-t-il ne pas s’intéresser à eux ? J’ai manqué une marche. Aujourd’hui je suis seule, à nouveau seule, enfermée dans cette solitude bien connue depuis si longtemps. Tant de chemin parcouru, pour en revenir à mon point de départ ! Je ne sais toujours pas qui est Victoire. Je sors en laissant la porte ouverte, ça n’a plus d’importance. Et je marche droit devant moi. Obéissant à une injonction secrète, je rends les armes. Je suis fatiguée de lutter. - Rencontre au bord de l’étang - J’arrive au bord de l’étang. C’est un petit étang recouvert par endroits de nénuphars roses et blancs, et bordé de peupliers, avec une berge sablonneuse qu’abrite un magnifique saule pleureur. Un martin pêcheur traverse dans un éclair bleu électrique. C’est toujours là que je viens rêvasser quand j’ai besoin d’évasion. Je m’assois au bord de l’eau sur la plage de sable, repliée sur mon chagrin. Je n’ai plus de larmes. Je suis aride, désertée. Malgré tout ce que j’ai pu faire, tout aura été inutile. Je suis au bout du chemin, prête à en finir. Quand soudain, j’entends près de moi un « croâ, croâ ! ». Je relève la tête. C’est une reinette « croâ, croâ ! » qui saute à l’eau. Et dans l’eau je vois le reflet des peupliers en magnifique miroir inversé. C’est si beau que mon regard se lève vers le ciel d’un bleu parfaitement limpide. Les arbres déploient leur aura, inondant l’étang d’une luminosité presque irréelle. Mon corps devient léger. Ma conscience se défroisse. Je perçois le battement d’ailes des libellules et le vol du martin-pêcheur ralentit devant moi. La grenouille, l’eau, les arbres, le ciel et moi. Tout semble se dilater et entrer en vibration. Je ne suis plus que le prolongement d’un grand corps vivant, unie au Tout. Je suis le petit doigt de l’Univers. Un sentiment total d’appartenance se glisse au cœur de mes cellules. Je me sens connectée à tout ce qui m’entoure. À cet instant, je sais avec certitude que la solitude n’existe pas, qu’elle n’a jamais existé. Je suis Victoire, et je suis une parcelle de la Vie. Je me rencontre enfin ! De retour chez moi ce soir-là, je prends mon téléphone et je l’appelle : « Allô ! Yohan ? »
Odile
Une maison bien ordinaire Avant de se coucher, Anne cherche au fond de son armoire l’album photos de sa famille. Avec précaution, elle soulève les petits supports cartonnés jaunis par le temps et libère la photo endormie depuis plus d’un demi-siècle. Anne est une vieille dame, ses cheveux gris sont rassemblés en un chignon très soigné, elle est toute menue et son regard est doux. Elle adore écrire. Ses mots sont choisis, ses textes sont intéressants et souvent pleins d’humour. Les mots deviennent de plus en plus les fils précieux qui lui permettent de broder sa vie de vieille dame. L’écriture enrichit son présent et lui permet de conjuguer son passé avec ses souvenirs et son futur avec ses rêves. Le thème de l’atelier d’écriture est « Construisez un récit autobiographique à partir d’une photo de votre enfance ». Doyenne de l’atelier, Anne partage ses écrits chaque mardi matin avec neuf écrivants. Ses écrits surprennent et font sourire parfois les plus jeunes dans le décalage de deux, voire trois générations. Ce matin, l’atelier s’agite autour des diverses photos apportées. Chacun montre sa photo et la commente brièvement. Anne garde la sienne bien cachée au milieu des pages de son cahier et refuse de montrer le petit format carré aux larges bords blancs dentelés. Devant la légère insistance du groupe elle résiste et se justifie avec une pointe de malaise et d’agressivité. - La photo que j’ai choisie est celle de ma famille, une famille très ordinaire. C’est la seule photo que je possède de ma toute petite enfance. Pendant la guerre, le milieu ouvrier et paysan était pauvre, l’appareil photo n’était pas encore un bien personnel très répandu. Cette photo résume toute l’histoire de ma petite enfance. Anne met la main sur son cahier comme pour protéger sa photo des regards trop curieux. - Une photo de famille est facile à nommer mais complexe à raconter, ajoute-t-elle avec un léger soupir. Chacun se met au travail, le crayon à la main, penché sur sa feuille, concentré comme un élève le jour d’une évaluation. Au bout de trente minutes, sans avoir pu tracer un seul mot, envahie par ses émotions, Anne rompt le silence et commence à bégayer : - Je n’y arrive pas. Je suis désolée. Je ne peux rien écrire. Elle pose son crayon, ferme son cahier et le serre contre elle pour tenir fermement sa photo prisonnière. Des décennies se sont écoulées depuis cet instant figé sur cette photo et en laissant surgir ce moment-là de sa petite enfance, Anne se sent submergée par des émotions si vives qu’elle en est déroutée. Pelote de souvenirs, petit fil à tirer et douleur impossible à partager. Elle bredouille quelques mots : - Les noirs sont grisés, les blancs ont perdu de leur clarté. Le menton tremble et une larme perle au coin de ses yeux bleus. Tous les crayons restent bloqués sur les feuilles. La singularité de chaque histoire renforce toujours l’universalité des émotions, des joies, des peines et des traumatismes. Le groupe fait silence, il attend. D’une main tremblante, Anne repose le cahier devant elle sur la table. Elle sait qu’elle ne pourra rien écrire de ce voyage qui remonte le temps jusqu’au seuil de sa mémoire. Elle ne peut dissocier la fascination de ce qu’elle voit imprimé en noir et blanc de ce qui jaillit du plus profond du puits de ses souvenirs. - La fiction m’est plus douce, ajoute-t-elle avec un faible sourire comme pour s’excuser. Mes personnages portent souvent quelques-uns de mes oripeaux, mais je peux les déguiser et les travestir. Dans le récit fictif, je dissimule, je prends, je traque parfois des points de réalité que j’habille de mots choisis pour qu’ils fassent moins mal. Ce que je peux écrire sur cette photo n’est que banalité et c’est une protection trop fragile pour ne pas pleurer. Anne a quatre-vingt-trois ans, elle a déjà travaillé l’introspection, beaucoup parlé de ses ascendants, de sa fratrie, de ses descendants, elle a raconté des rêves les plus étranges et livré des souvenirs les plus intimes, alors pourquoi écrire sur cette photo dite ordinaire l’inhibe et l’agite-t-elle à ce point ? Elle ouvre son cahier lentement, prend délicatement la photo et la pose à l’envers au milieu de la table. - Ce petit carré est une photo « réminiscence ». Je peux vous en faire une simple description. En arrière-plan, on aperçoit les branches d’un noisetier. Au premier plan, on y voit deux grands-parents paternels entourés par deux jeunes parents qui eux-mêmes entourent trois fillettes dont la plus petite est encore dans un landau. Le landau des années quarante, large et profond est posé sur quatre petites roues ridicules. Anne soupire et retrouve un peu de son sourire comme délivrée. - Enfant, je me suis très longtemps réfugiée sous ce noisetier pour lire et rêver. Cette simple évocation fait jaillir quelque chose d’enfoui et d’enfermé dans le corps et dans la tête d’Anne. Des larmes coulent sur sa joue ridée. Elle attrape son crayon, ouvre son cahier et d’une main tremblante écrit : Elles ne sont pas heureuses. - Vous nous avez dit qu’il y avait deux hommes, père et fils et cinq femmes, remarque Paul le plus jeune du groupe. - Sur cette photo, il y a trois générations de femmes, précise Anne en recouvrant le carré blanc de sa main fine et ridée. On sait parler à demi-mot, mais comment laisser le sens glisser dans un écrit pour qu’il puisse continuer à flotter et ne pas s’amarrer définitivement et douloureusement à la feuille blanche ? L’autobiographie et le roman sont des genres très différents. L’un se charge et se plombe de faits réels alors que l’autre s’allège en s’envolant dans l’imaginaire. Tous ont arrêter de tisser les fils de leur histoire et tous écoutent la vieille dame avec ces mots enfouis, tenus secrets. - Sur cette photo, je suis une petite fille de trois ans qui veut comprendre le monde qui l’entoure. J’essaie de construire mon arbre de vie. Je pense que mes grands-parents et mes parents n’ont jamais répondu au pourquoi de leurs jeunes enfants. Mes sœurs et moi devions nous taire à table et laisser les adultes parler entre eux. Ma famille a pris la pose pour cette unique photo et ce matin quelque chose de très douloureux a résonné du fond de ma mémoire. Anne fixe le carré aux bords découpés jaunis par le temps. Elle seule voit la scène. Elle seule voit l’envers du décor. Elle ressent le besoin de décrire ce moment si particulier. - Nous sommes à table. Les deux hommes parlent haut et fort. Ma grand-mère Marthe s’agite pour nous servir, ma mère fait manger ma petite sœur. Marthe est une femme inquiète, elle est un peu comme ces femmes siciliennes vêtues de noir au service des hommes, elle s’assoit peu et s’agite sans cesse dans l’ombre, en arrière-plan. Assise près de ma petite sœur installée dans une chaise haute en bois, ma mère se tait mais reste toute entière attentive à ses trois filles, à leur tenue à table et au contenu de leur assiette. Ma sœur ainée fait la maligne, elle pose sur le bord de son assiette de soupe les lettres de l’alphabet pour écrire des mots. J’aligne soigneusement un maximum de ces petites pâtes pour tracer le mot le plus long du monde. J’appelle ma grand-mère pour qu’elle lise mon mot et je sens son inquiétude car elle ne me répond pas. Ma mère me gronde et me demande fermement de me tenir tranquille. Elle prend ma cuillère et remet toutes mes lettres à tremper. « Mange et tais-toi », me dit-elle. « Je n’ai plus faim », lui rétorquai-je. Je crois que ni ma grand-mère ni ma mère aimaient quand les hommes lèvent le ton ou que les petites filles se montrent trop curieuses. Du bout des doigts, Anne caresse la photo si bien cachée. En levant ses yeux bleus sur les participants toujours attentifs et silencieux, elle explique : - À l’époque, rien de précis ne s’était vraiment révélé et imprimé pour la fillette de trois ans que j’étais. Je ne comprenais rien aux émotions, aux tensions des adultes qui m’entouraient, mais je les ressentais. Je savais que ma grand-mère et ma mère n’étaient pas des femmes heureuses. Jamais elles n’éclataient de rire, jamais elles ne jouaient avec nous. Leur tristesse était en partie due à cette guerre qui engluait et poissait tous les échanges et les relations, mais ce carré blanc familial révèle aussi l’injustice, la peur des pauvres gens qui se taisent et la violence de ceux qui ordonnent. Tout cela était resté là, tapi et intact. Anne montre d’une main sa tête et de l’autre son cœur et rapproche d’elle sa photo toujours retournée. Elle poursuit son histoire d’une voix plus assurée : - Marthe, est une vieille femme, une femme usée par une vie de dur labeur sans joie personnelle ni intimité. Elle sait à peine lire, elle parle peu comme si les mots lui manquaient. Elle et sa belle-fille s’épuisent aux tâches ménagères répétitives : cuisiner, repriser, nettoyer, laver, cuisiner, repriser, nettoyer, laver, éternel recommencement sans reconnaissance. Femmes au foyer, elles veillent et surveillent. Raymond, son mari, est un homme fort et courageux. Son travail de ferronnier ramène le salaire du ménage. À la débauche, il s’arrête au café devant l’église pour boire un ballon de rouge avec ses collègues puis il rentre à vélo, et attend l’heure de la soupe en écoutant la radio. Les allemands ont réquisitionné l’usine et il n’est plus payé. L’horreur des bombardements et l’ombre menaçante de la pauvreté s’insinuent au milieu des rayons chauds du soleil d’été. Les trois générations vivent sous le même toit depuis que Serge, le fils, a perdu son emploi de serrurier et que sa femme n’ayant aucun métier, n’a pu prendre la relève. Ce jour d’Août 1943, Marthe s’est levée tôt pour préparer le repas de famille dominical. Tout le temps du repas, le silence des cinq femmes résonne sur les voix fortes et remplies de colère des deux hommes. Père et fils parlent de boches, de chef collabo, de train bloqué sur les voies, d’usine occupée, d’un chômage qui dure, d’une mobilisation possible. En débarrassant la table, une fourchette tombe sur les genoux du fils. Sous le regard ébahi des trois fillettes, il casse la fourchette en deux ainsi que toutes celles de la table. « Il y en a marre de toutes tes fourchettes dont les dents sont si usées qu’on ne peut plus piquer le moindre morceau de viande » dit-il avec colère et rage. Raymond se lève et bouscule légèrement Marthe qui recule. Les deux hommes quittent la table pour aller fumer leurs cigarettes papier maïs sous le porche devant la maison. Anne s’interrompt un instant, les yeux fixés sur ce carré blanc, elle ne peut cacher la gravité de ces moments et l’émotion qui la saisit encore. - Dans le silence d’une modeste cuisine, deux femmes débarassent la table, font la vaisselle et nettoient le fourneau. Trois fillettes attendent sagement le moment où leur mère les habillera de leur robe du dimanche, attachera le ruban brodé sur leurs cheveux et glissera leurs petits pieds dans les chaussures de toile fraichement blanchies. Monsieur de Latouche, le propriétaire du petit château en bordure de Loire, vient acheter des œufs frais, il a promis de prendre une photo de la famille. Anne pose avec délicatesse sa main sur ce carré blanc. Le regard baissé, tout son esprit semble traversé par des questionnements que révèle cette simple photo. - J’aurais pu écrire : Août 1943, une gentille famille ; mais le « je » narratif m’était impossible à utiliser car je dois me protéger des fantômes et je ne veux pas revivre cette journée avec eux. Les femmes pauvres, sans éducation ni métier, craignaient la force et l’autorité de leurs hommes. Toute mon enfance, j’ai constaté que l’autorité était du côté masculin et l’obéissance du côté féminin. Mon grand-père et mon père n’étaient peut-être pas des hommes violents physiquement mais ils exigeaient violemment de leur femme et de leurs filles une conduite irréprochable, obéissante et silencieuse. Deux générations de femmes ont travaillé sans rien dire pour qu’une fillette de trois ans décide ce jour-là d’apprendre à lire tous les mots qu’ils soient courts ou qu’ils soient les plus longs du monde. Deux générations de femmes, que nous aimions, se sont sacrifiées pour que trois gamines engrangent tous ces mots qui ont coloré leur vie et qui leur ont permis de se tenir debout aux côtés des hommes, sans peur. Un sourire accentue les rides au coin de ses yeux bleus. Avec ses rides dites du bonheur, Anne vient de partager un peu de cet intime qui souvent frôle l’indicible. Lentement, elle retourne sa photo. Chacun découvre alors les branches d’un noisetier, les grands-parents, les parents, deux fillettes et au centre de la photo le fameux landau ridicule comme elle l’avait elle-même appelé. - Anne, pourquoi n’êtes-vous pas sur la photo ? - Tu es jeune Paul, tu n’as jamais joué avec les images d’Epinal. Dans ces images les enfants s’amusaient à chercher quelque chose de caché dans le dessin. Pour mieux regarder, Paul prend la photo dans ses mains. - Là, je vois une petite chaussure blanche cachée dans les branches du noisetier. Anne éclate de rire. - Ce jour-là, malgré la fessée et toutes les menaces paternelles, j’ai refusé de poser pour la photo. Un caprice d’enfant est souvent la mise en acte de ce qui ne peut se dire. Cette petite tache blanche au milieu du gris et du noir du noisetier est la trace de ce souvenir qui reste accroché au plus profond de moi. La photo d’Anne passe de main en main, puis elle la range avec soin au milieu des pages de son cahier d’écriture. - Il y a quatre-vingts ans, quelque chose m’a marqué au-delà de ce que je pouvais comprendre et, depuis, je reste fascinée par ces petites lettres alignées sur le bord de mon assiette. Je réalise aujourd’hui que le caprice de la petite fille que j’étais est le creuset dans lequel je plonge ma plume pour tisser la trame de mes émotions sur un carré blanc.
Annick
Quatre temps forts ont été animés par Laurence et Jean-François (les 16 et 23 mars) sous la forme d’ateliers d’écriture poétique et deux soirées lecture de textes par Pascale (les 22 et 23 mars). Ces ateliers « hors les murs » ont permis de faire partager des instants de création expressive et d'émotions vives. Ils auront permis de mieux faire connaître notre association auprès des élus et du public. La presse s’en est faite l’écho.
Ce partenariat avec la commune de Lanton en appellera d’autres sous des formes variées et auprès d’autres associations culturelles ou organismes d’utilité publique. Prochains rendez-vous en juin 2024 avec le « Café-jardin de Lanton » et à l’automne avec la Ligue contre le cancer dans le cadre du mois « Octobre rose ».
Textes écrits et lus par les participantes
La danse des voiliers
Couchés sur le sable, immobiles, ils attendent d’être enfin délivrés. Accrochés aux corps-morts, les bouts se tendent. Heureuses, les drisses cliquètent, et les voiliers réveillés se mettent à danser.
Ma crevette
Le capitaine a la raie au milieu. Le merlan ne l’a pas raté, tiens ! Il se sent ridicule, lui, bien dans le moule, qui ne se fait jamais remarquer d’ordinaire. Il a l’air d’un maquereau, coiffé comme ça. Il va être la risée des morues qui tournent en rond dans le marché comme des poissons rouges dans un bocal. Il s’efforce de les ignorer, elles ont un QI d’huîtres. Entre les bancs des poissonniers, on est serré comme des sardines. Comment va-t-il la retrouver ? Ah, la voilà, elle sort du bar, royale comme à son habitude. Il en est tout impressionné. Il lui tend son bouquet en lui disant timidement : « bonjour, Lisette, ma crevette ».
La mer dans la main
« Regarde, la mer tient dans ma main. » disait Grand-père pantalons relevés sur les mollets. Ses pieds de géant s’enfonçaient dans le sable que recouvrait régulièrement le va et vient de l’eau. Il ouvrait alors sa large paume et l’enfant accourait en faisant crisser le sable, la main en visière. Son émerveillement puisait alors dans cette minuscule flaque d’eau salée où se débattaient une ou deux crevettes qu’une fine algue verte ligotait. Parfois s’invitait un petit crabe prêt à en découdre ou bien un fragile coquillage nacré arraché à l’or du sable. Un jour le vieil homme avait glissé au creux de sa main une minuscule étoile de mer orangée et l’enfermant entre ses doigts d’où s’échappait un filet d’eau brillante avait dit en riant « oh, mais qu’est-ce qui me chatouille comme ça ? Voyons ! » Longtemps l’enfant avait cru que l’étoile était tombée du ciel pour s’installer sur la Terre, voyager un peu et avait trouvé le bonheur entre ces trois rochers à demi submergés, coiffés d’algues brunes et visqueuses. Même plus tard, à la relève des casiers à homards recouverts de grosses étoiles voraces, jurant, gueulant que ces bestioles resteront une plaie à tout jamais, il gardera la vive certitude presque douloureuse que le ciel et la terre se confondent intimement. Cet enfant breton était mon père et aujourd’hui j’ai puisé de l’eau au même rivage et ouvert ma main. Quelle histoire ont lu mes petit-fils au creux de ma paume dégoulinante salie de particules sombres ?
Seuls dans un monde parallèle
Nous avions passé une première nuit enchanteresse à observer les étoiles au son des clapotis de la mer qui venait s’échouer sur les rochers affleurants. Alors que le soleil se levait inexorablement sur l’horizon, je contemplais le rivage qui rétrécissait, laissant derrière nous le lagon et son épave habillée de coraux et coquillages, l’île n’ayant bientôt plus l’apparence que d’un rocher au milieu de l’étendue bleue infinie. Nous étions à présent seuls au milieu de la grande bleue, seuls en apparence car un monde parallèle existait sous la coque du voilier, mystérieux, merveilleux et plein de promesses.
Puis, aussi vite qu’elle était arrivée, la tempête s’arrête.
Je grelotte encore de froid et de peur. Le vent a chassé les nuages. La lumière m’éblouit. Les vagues se sont aplanies. Les goélands reprennent leur ballet dans le sillage moussant. Les passagers hagards se redressent. Les matelots retendent les drisses.
Au milieu des algues qui tapissent le pont, un scintillement attire mon regard. La tempête m’a laissé en cadeau un éclat de nacre. Je m'appuie au bastingage. La mer d’huile reflète le dégradé émergeant. L’air vibrant m’enveloppe et offre à mon regard enchanté, la côte accueillante.
LA Grâce
Texte 1
Gracieuse gambadait gaiement. Elle devait son nom à son allure vive, la ligne gracile de son corps élancé, son pelage soyeux si doux au toucher. Mais tout cela est terminé, remisé, rangé, oublié. C'est même tout le contraire. Gracieuse est maintenant trapue, lourde, pataude dans ses mouvements. Elle ne peut plus sautiller et gambader, elle se déplace lentement, avec gravité et dignité. La gardienne qui veille sur elle l'attend à la barrière comme chaque soir pour rejoindre son abri. Elle regarde la vieille ponette traverser le pré, et se sent touchée par la grâce qui émane toujours de sa protégée malgré les années.
Texte 2
Ses parents l’avaient prénommée Grâce, ils pensaient que ça la définirait: elle serait gracieuse à l’intérieur comme à l’extérieur. C’était trop demander à la providence : la nature n’exhaussa que la moitié de ce vœu. Grâce était la bonté personnifiée, elle était douce, généreuse, bienveillante mais son apparence physique contrastait avec tant de bonté d’âme : on ne peut pas dire qu’elle était laide, au moins aurait-on eu de quoi dire, non, elle était quelconque, les traits sans charme, le corps sans formes qui semblait s’excuser d’être né femme, ses cheveux étaient ternes et raides, tombant lourdement sur ses épaules, elle n’était ni grande, ni petite, elle était... Cependant, sa beauté intérieure était tellement éclatante, que cette « moitié » de grâce l’emportait largement pour en faire une personne magnifique, unique, bien nommée.
Texte 3
La silhouette gracile apparaît derrière le rideau de velours rouge. Le poignet et les doigts suspendus dans l'infini. Le port de tête aérien couronné d'un chignon perlé. La cheville enlacée d'un satin rose. Le pied en apesanteur sur sa pointe. Le buste élancé vers les notes de violon. La corolle de tulle s'ouvre dans une arabesque. Tu t'envoles au dessus des planches, petite fée d'un conte. Tu illumines de ta grâce la scène, petit rat d'Opéra.
juin 2024
Le groupe composé de Vessela, Martine B., Frédérique et Martine M. sous la baguette magique de Pascale a ensoleillé le Café-jardin de Lanton. Les textes déclamés ont enchanté les spectateurs de passage par la qualité de la mise en voix et la mise en scène des récits
Une fois encore la magie s'est opérée entre les lectrices et le public prouvant s'il en était besoin encore que les mots peuvent prendre leur envol dans des lieux les plus improbables.
Galerie
Galerie
octobre 2024
Les 5 lectrices (Martine M. ; Martine B. ; Vessela ; Corinne et Frédérique) ont ravi le public venu nombreux par leur présence thâtrale et la qualité de leur lecture. Tous les textes avaient été écrits dans le cadre des ateliers d'écriture animés par Jean-François le mardi.
Galerie
Textes lus au Café Jardin de Lanton
Adrien est tout excité en rentrant de l’école ; cela ne lui ressemble pas, d’habitude les journées lui paraissent INTER….MINABLES mais aujourd’hui, Mademoiselle Rose, sa maîtresse, les a emmenés dans une sacré aventure : un jardin EXTRAORDINAIRE peuplé de drôles de créatures. Il y avait des citrouilles ÉNORMES. Attiré par leur belle couleur orange, Adrien se pencha pour en toucher une mais celle-ci recula d’un bond : - « Ne me touche pas ; je dois me préparer ; ce soir, je me transforme en carrosse pour transporter une princesse et ce n’est pas une mince affaire, crois-moi ! » - « Une princesse, tu connais une princesse ? Et...je pourrais être son prince ? - « Elle est déjà promise à un grand prince mais je ne peux pas t’en dire plus ; c’est TOP secret. » Adrien ne dit plus rien mais il est déterminé à en savoir plus quand tout à coup un cri l’alerte ; un drôle de chat avec de grandes bottes à ses pattes file à tout allure puis s’arrête net ; devant lui, un petit rat, pétrifié, cherche où se cacher. Adrien bondit pour faire fuir le chat botté. - « Ouf, merci, j’ai eu tellement peur. Comment t’appelles-tu ? - « Adrien et toi, tu es… » - « Ratatouille, c’est mon nom. Qu’est-ce que je peux faire pour te remercier ? Une bonne ratatouille te ferait-il plaisir ? » L’odeur du plat commence à chatouiller les narines d’Adrien, son estomac fait de drôles de bruits ; soudain il entend : - « Adrien, à table, c’est l’heure de manger. » Il ouvre les yeux… il n’en revient pas, il s’est endormi dans sa petite cabane au fond du jardin. Il se précipite dans la cuisine. Pour le dîner, sa maman a préparé pour toute la famille un repas incroyable : soupe à la citrouille, citrouille farcie à la ratatouille, tarte à la citrouille ! Hum ! Quel délice ! Demain, il en aura des choses à raconter à Mademoiselle Rose !
Claire
Comme par enchantement l’été indien envahit mon jardin !! Ici l’automne explose en couleurs. Tout flamboie, s’embrase autour de moi. Rouge les mille églantines, Orange les courges qu’entre les larges feuilles vertes je devine. Un tapis jaune le gingko étale en douceur, Invitation à la flânerie et à la lenteur. Là-bas, bien au chaud sous leur labyrinthe de dentelle, Les voici enfin lumineuses, généreuses, presque irréelles. Émerveillement garanti aux douze coups de minuit !
Aurélie
To be or butternut to be… C’est un peu court-je na sais qu’ajouter. Mais si je reste sans voix Si trac m’envahit Si trouille me submerge Comment vous parlerai-je de celle de Cendrillon ? Un petit autobus bien rond Qui fait le transport en commun des graines de l’apéro. Vous les avez goûtées, grillées au four ? Arrimée au grillage, Où on la confondait parfois avec le feu orange du croisement, Elle se pavanait devant les concombres verts de jalousie. Elle n’a pas vu arriver les passagers clandestins, Rampants, baveux et cornus, Qui l’ont mise au pillage. De mon histoire il ne restera qu’un morceau minuscule de cucurbitacée Pas plus gros qu’un poti-marron.
Martine Mazure
TEXTES LUS AU CAFE JARDIN DE LANTON
Il était une fois une courgette qui voulait devenir citrouille. « courgeons, courgeons « s’écriait-elle à tout bout de champ. Carottes, navets et poireaux se fendaient la poire de la voir courgir ainsi en tous sens, d’autant qu’avec ses allures de tuyau d’arrosage, elle n’avait aucune chance de s’arrondir comme la citrouille. Celle-ci la regardait avec dédain, exposant ses rondeurs cucurbitacées, d’un orangé vif et brillant. Cette belle courge qui pesait 20 kgs bon poids faisait beaucoup d’envieux. Les potimarrons, butternut et autres potirons faisaient pâle figure à ses côtés dans le potager, cependant elles arguaient de l’excellence de leurs bonnes graines oléagineuses. Cette citrouille avait visiblement été boostée aux engrais, elle pouvait toujours faire sa belle, elle finirait découpée en lanterne par de petites mains malhabiles pour la Toussaint. Certes elle illuminerait l’entrée de la maison, mais ses qualités gustatives finiraient sans doute par pourrir. Notre pauvre courgette continuait à courgir, courgir….elle épaississait quelque peu, mais ressemblait toujours à un spaghetti. Elle se rendit compte un jour que le jardinier la traitait avec beaucoup d’amour et que jour après jour, il la regardait avec fierté. La citrouille perdait de son éclat, ayant atteint sa pleine maturité depuis quelques temps déjà. Lors de la fête du potager, la courgette fut mise à l’honneur . Elle réalisa alors que rien ne sert de courgir, il suffit avec amour d’être cultivée.
Cécile
Dans le jardin de Minouche Comme tous les mercredis Edwige accompagnait sa grand-mère Minouche dans son potager. La petite fille attendait ce moment avec impatience, elle n’avait pas le droit de s’y rendre seule. Minouche lui avait expliqué qu’il était dangereux de s’aventurer seule sur le petit pont de bois, elle avait aussi ajouté, avec un petit sourire au coin des yeux, qu’Edwige ne connaissait pas la formule magique pour demander aux fées de débloquer la serrure de la cabane. L’enfant avait insisté pour que sa grand- mère lui apprenne ces mots magiques, mais cette dernière s’était contentée de lui tendre un papier plein d’écritures « Minouche, tu sais bien que je ne sais pas lire, enfin pas encore ! » « Alors, tu devras attendre et apprendre, l’école c’est fait pour ça » La grand-mère et la petite fille entrèrent dans le potager, et Edwige se précipita dans la cabane en bois que Minouche venait d’ouvrir en marmonnant. A l’intérieur, l’enfant prit une grande inspiration et sembla se délecter des parfums de menthe, de romarin et de thym qui séchaient en bouquets accrochés à une poutre. Dans un angle, un nain en céramique était couché dans une cagette, de vieux chiffons en guise de matelas. Edwige s’empara prestement de la figurine : « Bonjour Arthur, tu as bien dormi ? » Elle sortie et s’apprêtait à placer le gnome au bonnet rouge sur une souche, quand elle remarqua une forme orange, qui ressemblait au coussin de yoga de sa grand-mère : « Minouche, c’est quoi ? » « C’est une citrouille, mais il faut attendre, elle doit encore grossir. » « Ça c’est sûr, elle va même beaucoup grossir » répliqua la petite fille d’un air entendu. Edwige plaça alors le nain devant la courge et lui déclara : « Tu vois Arthur, bientôt ici nous aurons un carrosse » La formule magique qu’il faut marmonner aux fées à l’automne : Tu me fous la frousse citrouille J’en ai six des trouilles : Les tapouilles, les clés à douille Les fripouilles, les embrouilles Les hommes- grenouille et les andouilles (La suite est facultative pour les enfants, mais indispensable pour les adultes si vous souhaitez vraiment que la serrure se débloque) Alors avant que je ne parte en couille Citrouille je t’occis dans ma tambouille !
Catherine
La citrouille qui avait la trouille... Chaque année, la compétition est féroce au potager. D'abord il y a Tonton Jacques qui peaufine son costume de corsaire ventripotent et se pratique à brûler d'un feu 'bougie d'intérieur' particulièrement maléfique. Puis Lisa, sa cousine divine, travaille son personnage depuis des mois. Boursouflée à souhaits, elle se pâme dans un feuillage inspiration "été indien". Elle sera ce soir la plus belle des boîtes à surprises, sous sa calotte découpée avec amour se cachent déjà 1000 et une merveilles fondantes, pétillantes et sucrées. - De quoi attirer les bouches les plus voraces du quartier ! se dit Tibout en frissonnant. Quand a Grand-père Georges il a, cette année encore, accepté de se faire cuire au court-bouillon pour la préparation des tartelettes magiques. Il ne reste plus que Gigi, sa tata farcie, qui a son grand désespoir, lui a piqué son idée de citrouille-vomi avec sa bouche dégoulinante de chair effilochée gluante. L'effet est tel qu'il en a le cœur tout ratatiné ! Tibout en est là de ses réflexions lorsqu'une petite coccinelle se plante devant lui et prend racine. D'un air amusé, elle demande : Pourquoi tu caches tes yeux ? Tu as peur, petite citrouille ? - Ouille ! pense la citrouille, en plein dans le mille. Ma chair si tendre ne résistera pas aux attaques de ces petits monstres, je vais me prendre une bonne raclée ce soir. - Et bien je ne les aies pas encore dessiné mes yeux ! répond courageusement Tibout. Je n'ai pas trouvé de crayon voilà tout ! Mais prépare toi petite coccinelle...tu vas avoir à faire au plus terrible monstre méchant de tout le potager ! - hihi, mais tu ne fais pas du tout peur, tu es juste un... riquiqui ! La citrouille rougit de honte comme une tomate. (ce qui n'arrange rien à sa situation). Et la coccinelle d'ajouter : - J'aimerais te faire un bisou, tu es si mignonne ! La citrouille en reste bouche bée, (déjà qu'elle n'y voit rien, voyez-vous) C'est alors que sans prévenir la coccinelle soulève son nouvel ami dans les airs et le bombarde de baisers 'rouge à lèvres' totalement in-dé-lé-biles. Et c'est ainsi que Tibout, la citrouille qui avait la trouille de ne pas faire assez peur, se transforma en citrouille à bisous et fit fureur ! Tout de baisers vêtus, le cucurbitacé fit le bonheur des plus douces abeilles, libellules, et araignées du quartier. La soirée fut un succès !
Emilie
TEXTES LUS AU CAFE JARDIN DE LANTON
Une soirée paisible Nous sommes au salon, bien installés dans la quiétude d’un samedi soir, mon mari et moi. Mais déjà une ébullition invisible monte en moi. La respiration qui bondit et que je dois brider, comme le fait d’un cheval fougueux, le dresseur impavide. Puis les entrées imprévues qui claquent, tels des feux de bengale : Maryse, ma fidèle. « Tu es venue ! » Daniel. « Oh, et toi aussi . Mais, vous êtes tous là ! » S’exclame Bernard, mon conjoint. Les copains de toujours prennent place petit à petit, seuls ou par couple, autour de nous. C’est l’anniversaire de celui qui partage ma vie et j’ai organisé à son insu une fête surprise. Je partage sa joyeuse stupeur tout en m’occupant à sortir plats et bouteilles préparés auparavant en secret. Tout en m’affairant, je redoute le moment de me mettre vraiment en scène, de m’impliquer. Oserai-je ? J’hésite encore… La passion qui domine ma vie en ce moment est le chant. Comme tout ce que j’entreprends, je me donne à fond. Je prends des cours. Je vocalise, j’écoute admirative des chanteurs connus, je m’enregistre. Bref je travaille à améliorer ma voix. Et Je me suis mise en tête de chanter ce soir devant tous. Mais je doute. Pour bien chanter, il faut se livrer, affronter le regard des autres. -Je ne suis pas capable. Je vais être ridicule. -Tant pis, ça ne tue pas. - il faut que je me concentre et puise au plus profond de mes émotions. - mes amis vont me trouver prétentieuse. - si je chante avec mon cœur alors ils l’entendront et seront touchés. - mon amour, mon binôme sera fier de moi. J’écoute les bribes de conversation qui s’entremêlent. Je regarde Bernard. Comme je voudrais lui offrir un moment « cadeau » qui l’émeuve. Comme je voudrais lui rendre un peu de toute cette patiente attention, de cet amour muet dont il me fait jour après jour un cocon douillet. Peut-être s’exotérisera-t-il enfin, lui le taiseux. J’ai travaillé « I still loving you too much ». Entendra t-il le sens de ce choix ? Bon. Je me lance, je demande le silence. Il faut y aller, ma fille… Ce moment est resté gravé dans ma mémoire car ce soir-là, j’ai eu le sentiment de dévoiler à mes proches un peu de mon moi profond. Je me suis mise en danger de vérité. Aurais-je une si haute idée de moi pour m’être donnée ainsi en spectacle ? Bien sûr, non. J’ai juste tenté de faire entrevoir mon goût pour les belles choses. J’ai essayé de montrer mes efforts pour tendre vers un idéal de beauté. Le résultat fut si dérisoire, si peu à la hauteur de mes rêves, si piètre que d’y penser me fait encore un peu mal. Mais ça c’est une autre histoire…
Anne
La citrouille qui avait la trouille... Chaque année, la compétition est féroce au potager. D'abord il y a Tonton Jacques qui peaufine son costume de corsaire ventripotent et se pratique à brûler d'un feu 'bougie d'intérieur' particulièrement maléfique. Puis Lisa, sa cousine divine, travaille son personnage depuis des mois. Boursouflée à souhaits, elle se pâme dans un feuillage inspiration "été indien". Elle sera ce soir la plus belle des boîtes à surprises, sous sa calotte découpée avec amour se cachent déjà 1000 et une merveilles fondantes, pétillantes et sucrées. - De quoi attirer les bouches les plus voraces du quartier ! se dit Tibout en frissonnant. Quand a Grand-père Georges il a, cette année encore, accepté de se faire cuire au court-bouillon pour la préparation des tartelettes magiques. Il ne reste plus que Gigi, sa tata farcie, qui a son grand désespoir, lui a piqué son idée de citrouille-vomi avec sa bouche dégoulinante de chair effilochée gluante. L'effet est tel qu'il en a le cœur tout ratatiné ! Tibout en est là de ses réflexions lorsqu'une petite coccinelle se plante devant lui et prend racine. D'un air amusé, elle demande : Pourquoi tu caches tes yeux ? Tu as peur, petite citrouille ? - Ouille ! pense la citrouille, en plein dans le mille. Ma chair si tendre ne résistera pas aux attaques de ces petits monstres, je vais me prendre une bonne raclée ce soir. - Et bien je ne les aies pas encore dessiné mes yeux ! répond courageusement Tibout. Je n'ai pas trouvé de crayon voilà tout ! Mais prépare toi petite coccinelle...tu vas avoir à faire au plus terrible monstre méchant de tout le potager ! - hihi, mais tu ne fais pas du tout peur, tu es juste un... riquiqui ! La citrouille rougit de honte comme une tomate. (ce qui n'arrange rien à sa situation). Et la coccinelle d'ajouter : - J'aimerais te faire un bisou, tu es si mignonne ! La citrouille en reste bouche bée, (déjà qu'elle n'y voit rien, voyez-vous) C'est alors que sans prévenir la coccinelle soulève son nouvel ami dans les airs et le bombarde de baisers 'rouge à lèvres' totalement in-dé-lé-biles. Et c'est ainsi que Tibout, la citrouille qui avait la trouille de ne pas faire assez peur, se transforma en citrouille à bisous et fit fureur ! Tout de baisers vêtus, le cucurbitacé fit le bonheur des plus douces abeilles, libellules, et araignées du quartier. La soirée fut un succès !
Janine
Célébrer Imaginer Trop Ronde Orange Unir Inviter Large Lumière Eclairer Comme par enchantement l'été indien envahit mon jardin Ici l'automne explose en couleurs Tout flamboie s'embrase autour de moi Rouge - les milles églantines Orange - les courges qu'entre les larges feuilles vertes je devine Un tapis jaune le gingko étale en douceur Invitation à la flânerie et à la lenteur Large Lumineux Est mon cœur
Vessela
dans tous ses états
les écrivants élaborent en atelier un récit à partir d'une thématique sur plusieurs séances en décortiquant tout ce qui constitue la trame narrative d'un récit :
l'entame ; l'élément déclencheur ; les mises en situations (péripéties et rebondissements) ; la catharsis ; le dénouement ; la chute.
Une autre façon de continuer de se faire plaisir en écrivant.
Récits sur le thème "se raconter"
J’incarne son propre rêve, pourtant je croque la vie à pleine dents sans en laisser une miette. De toute façon je ne peux maintenant que manger des miettes mes dents sont en attente. J’incarne son propre rêve en apparence mais dès que je le peux, je suis Zorro, princesse, immor-telle et joyeuse. Je cours, je marche, je rêve dans ce paysage aligné sans aucune fantaisie à priori. Ce paysage est le mien, j’en connais tous les endroits et surtout un en particulier que je visite tous les jours sauf le dimanche. Régulièrement le mercredi, je quitte la table avant le dessert, j’avale ma mimolette, invente une explication et sors. Ce mercredi la pluie menace, l’orage rode, j’aime ces temps incertains, je jubile intérieurement. Je vais à la tour 6, ma tour, au dernier étage une trappe de sécurité permet d’accéder à la ter-rasse. Une trappe faite à ma taille je m’y faufile aisément maintenant. Je traverse le temps, je traverse la vie et arrive dans une forêt métallique dense, les antennes à râteaux offrent un paysage hors du commun c’est ma forêt, mon domaine, mes arbres. Ici je suis châtelaine, bergère, princesse, sor-cière et fée d’un instant à l’autre, suivant la seule logique de mes rêves et jeux d’enfants. Je suis au sommet de la tour de ce gigantesque château, je suis sœur Anne, je suis celle qui a terrassée Barbe bleu et je contemple mon univers. En bas des douves, des fossés, des geôles mais le savent-ils ? Soudain un grondement sourd, le ciel s’obscurcit, quelques gouttes de pluie. Voici venue le temps de l’épreuve et des preuves. Ne pas céder à leur peur de grand rester là face au monstre de nuages qui s’avance vers moi crachant des éclairs aveuglants. La pluie se fait piqures, le ciel devient cauchemard. Je sens sur mes joues la morsure de l’eau, mes vêtements sont devenus armure froide qui empêche tout mouvement. Je suis là seule face au tonnerre, face aux éclairs sous ce déluge et, je ris, je crie mon bonheur de pouvoir apostropher les éléments du haut de mes dix ans. Je suis immortelle et hors la loi. L’orage s’éloigne il va falloir que je retourne chez moi en inventant une belle excuse. Je me dirige vers la trappe la pousse, pas de mouvement elle est bloquée semble-t-il… Un ins-tant de panique cela n’était pas dans mon histoire. Je re-essaie toujours rien… Et toujours cette petite voix qui me parle de ma mère… Humiliée la princesse, sans baguette la fée ! Ne pas pleu-rer attendre un peu, recommencer. Ma grand-mère me dit toujours que le calme recout beaucoup de chose. Je pousse en douceur mais avec force la trappe et elle cède ! Merci je soupire, je ris, je retombe dans mon jeu, je rede-viens moi. Rentrer maintenant effacer de mes yeux les bonheurs et les peurs. Ma mère m’attend inquiète, en colère mais je suis devenue experte en fabrique d’alibis, le sport annulé et une averse soudaine. Dans ma famille on ne m’appelle pas, on me surnomme parfois, je suis son rêve, son enfant sage et docile. Gentille et souriante dit-elle à ses voisines. Saura-t-elle un jour qui je suis derrière celle que l’on nomme sa fille. Je suis gaie et pleine de vie, j’aime la vie les bêtises pas graves et par-dessus tour être dehors. Je parle aux nuages je chante avec les oiseaux je danse dans le vent je me cache dans le brouil-lard. Je compromise, je dis oui, je me libère de ses souhaits pour accéder aux miens. Une chute me vaut un sourire édenté que j’oublie, j’ai dix ans et porte autour du coup une chaîne qui me le rappelle et au poignet gauche une montre pour ne plus être en retard. Toujours en jean je m’habille pour de vrai dans le locale poubelle me délestant de la robe obliga-toire pour ma tenue naturelle. Le monde autour me parle et m’inquiète, mon sourire me protège et évite des réponses, j’ai be-soin de bouger pour apprivoiser mes peurs, pour les perdre en route aussi. Comme tous les ans depuis que j’habite au milieu des tours, dès le 30 juin, je suis envoyée en vacances chez mes grands-parents qui habitent un petit hameau perdu en Dordogne. Pas de télévision, pas de boulangerie pas d’amis (es) non plus. Je passe sans transition d’un univers bruyant, rythmé, rapide, changeant à un autre paisible, serein, empli des sons de la nature et de son silence. C’est mon cadeau, ma récompense après dix mois de ville et d’école. Chaque année elle m’attend, toujours la même, toujours de la même manière, sur l’escalier en vielles pierres patinées creusées, appuyée sur une pseudo-rampe mainte fois réparée par mon grand-père. Deux vieux piquets une branche qui les relie et cela fera l’affaire. J’ai l’interdiction absolue de m’appuyer sur cette rampe voir même de la toucher. Pourtant je suis bien plus légère que Marie ma grand-mère. Encore un mystère d’adulte ! Elle m’attend avec impatience et appréhension, mon arrivée va encore bouleverser leur routine. Il va falloir avoir un œil sur moi ! J’ai beau faire des efforts, elle a beau en faire aussi parfois ça dérape. Je l’appelle Marie car j’aime par-dessus tout son prénom qui lui confère force, autorité et dou-ceur. Elle est toujours habillée de noir et semble porter une multitude de vêtements. Ce qui me fascine le plus, est la couleur de ses cheveux. Quand je lui demande pourquoi cette blancheur uniforme, elle me parle de sa vie. C’est notre mot de passe, notre code secret, notre complicité. Je n’ai qu’à poser la question et son regard quitte le présent, son visage retrouve des airs de jeunesse et Marie raconte. Ses cheveux sont sa seule coquetterie, elle les attache chaque matin avec soin avec deux peignes en corne, un de chaque côté, quelques barrettes en métal argent le reste. Elle s’active toute la journée, le dos courbé, résignée mais heureuse, du potager à la cheminée et se redresse parfois en se tenant la taille, cachant difficilement une grimace derrière un sourire d’excuse, de lassitude. Elle m’appelle toutes les dix minutes pour être sûre que je ne suis pas en train de faire n’importe quoi dit-elle. Elle est souvent seule mon grand-père Léonard est dans les champs et ne revient que pour les repas. La ferme est austère, une pièce à peine éclairée, pas d’eau courante, une ampoule au plafond heureusement pour mes yeux d’enfant la cheminée lui donne des allures de château. Je m’adapte vite à ce manque de confort remplacé par un surplus de tendresse. Notre moment de la journée était tacitement choisi. Tous les jours vers 13h au soleil, quand Léonard mon grand-père va se reposer, je m’assois sur la troisième marche de l’escalier qui mène au grenier, elle reste sur sa chaise au coin de la chemi-née éteinte. « - Dis, Marie pourquoi tes cheveux sont si blancs ? - C’est la vie et sa poudre de soucis, de peurs, de bonheurs, de joies c’est la vie et ses années qui s’y sont déposées. - Tu avais quel âge quand tu as vu les premiers, moi aussi j’en aurai ? - Je ne sais pas j’ai toujours eu des cheveux blancs je crois, tu sais je suis née en 1900, la vie n’était pas simple il n’y avait pas tout ce que tu as aujourd’hui. - Bah ça n’a pas beaucoup changé, même aujourd’hui tu n’as pas l’eau courante ! - Non petite fille je n’ai pas l’eau courante mais j’ai une petite fille qui ne comprend pas pour l’instant qu’il y a plus important que l’eau au robinet. - C’est quoi le plus important que ça ? - Le plus important, petite fille, c’est ce que j’ai construit avec ton grand père, c’est notre fa-mille, nos enfants et petits-enfants et toi avec toutes tes questions. - Tu as aussi des cheveux blancs à cause de moi ? - Non mais parfois je ne comprends pas pourquoi tu es toujours en train de partir dans les champs où les bois toute seule. - Tu sais où j’habite je fais pareil. - Tu ne te mets pas en danger au moins ? - C’est quoi le danger ? - Tu demanderas à ta mère. - Tu viendras me voir un jour là où j’habite ? - Non je suis trop vielle maintenant je suis bien ici avec ma campagne et mon potager, mon si-lence. » La porte s’ouvre sur notre discussion, mon grand-père traverse la pièce avec un sourire es-piègle, sur la pointe des pieds. Le charme est rompu, ma grand-mère se lève, elle me dit que l’on doit aller au lavoir. Je prépare la brouette et attend devant les escaliers. « - Marie, c’est quoi ton silence ? Pour moi le silence c’est une punition qu’on donne à l’école mais je sais bien qu’il n’est pas que cela. - Voyons le silence n’est pas une punition, qu’est-ce qu’on vous raconte ! Le silence petite fille c’est un espace immense et rien qu’à toi. C’est l’endroit où tu es vraiment avec toi simplement tranquillement. C’est l’espace dans lequel tu peux entendre les sons de la nature, le vent, dans lequel tu sais qui tu es pour de vrai, c’est ta seule liberté petite fille le silence est ta seule liberté. - Alors on essaie d’être dans le même silence pour que je t’entende bien pour de vrai. » Marie a posé sa brouette s’est agenouillée et m’a longuement prise dans ses bras. Cet automne, il y a beaucoup de murmures et de secrets qui circulent. Mes parents sont venus me chercher avant la fin des vacances. Marie a dû s’aliter car très fatiguée. J’avais le droit de lui porter son repas à midi mais souvent elle dormait. Aujourd’hui mes parents vont arriver, je lui porte son repas, je veux lui dire au revoir, elle dort. Ses cheveux sont défaits, blanc sur blanc plus de peignes. Son tiroir de table de nuit et entre-ouvert, les deux peignes en corne sont là. Je ne réfléchis pas j’en prends un et le glisse dans ma poche. Elle dort. Ce n’est pas un vol c’est juste une façon de la garder auprès de moi. Il est toujours avec moi ce peigne comme un bijou comme un trait d’union. À midi ils se sont tus quand je suis entrée dans la cuisine mais j’ai eu le temps d’entendre « de quoi est-elle morte ? » puis un silence d’adulte. Avant le dessert je suis partie il fallait que j’aille dans ma forêt dans mon paysage je suis sûre qu’ils ne veulent pas me le dire, Marie est morte vu leur tête et leur silence. Une fois la trappe passée, je me calme, je me pose c’est ce que m’aurait dit Marie. Une envie de pleurer mais au de cela je crie de toute ma force je crie dans les nuages, je crie à l’univers, je crie au monde entier « Marie je t’aime c’est moi qui ai ton peigne… » Je le dépose dans un petit trou entre deux antennes et le recouvre de mon mouchoir préféré celui que j’ai brodé maladroitement. Une poignée de gravillons pour sécuriser le tout. Marie je t’aime je ne t’ai pas volé ce peigne je l’ai pris pour rester avec toi, je le confie à ma forêt métallique, d’en haut tu peux le voir. De retour à la maison des valises sur la table, pourtant, nous ne partons jamais pour la Toussaint ! « -Tu vas chez ta grand-mère pour la semaine, nous sommes obligés ton père et moi d’aller sur Bordeaux. - Je sais très bien qu’elle est morte je vous ai entendu pourquoi tu me dis cela. - Mais elle n’est pas morte ce n’était qu’une grippe que racontes -tu encore ! - Alors pourquoi je vous ai entendu - Ce n’était pas de ta grand-mère dont nous parlions mais de la marraine de ton père. » Une respiration qui ouvre un arc en ciel, un sourire intérieur, Marie je vais chez Marie… Elle m’attend sur les vieilles marches de l’escalier en pierre, appuyée à la rampe… « Marie, Marie si tu savais ce que j’ai cru, il est là ton peigne c’est moi qui l’ai. » Encore une fois front contre front partager nos silences.
Laurence
Je quitte Londres. Après trois années passées au Consulat général de France, en tant que vacataire au service des visas, j’ai décidé de rentrer en France, provisoirement, car ma prochaine destination sera l’Espagne, bien que je ne parle pas un mot d’espagnol. Je dois partir. Mon contrat au consulat n’a pas été renouvelé, j’ai pourtant trouvé un poste chez Eurostar, mais l’envie de découvrir d’autres horizons, apprendre une autre langue fourmille en moi, je sais que j’aie des choses à vivre, je veux reconfigurer le schéma rassurant mais répétitif de ma vie. Ce soir, j’ai réuni mes amis pour fêter mon départ. Nous avons improvisé un barbecue dans le jardinet, quelques pierres pour y allumer un feu au centre. Je suis heureuse et triste. J’ai noué tant de relations au cours de mon séjour, j’ai tellement aimé ce mode de vie, un endroit où l’on t’appelle « darling » à la moindre occasion, les bus à deux étages, les pubs, les restos indiens, le marché de Notting Hill Gate… Et surtout, je me suis amusée, instruite, découverte et émancipée d’un cadre de vie aux codes stricts et limitants. Je me suis acheté une robe pour l’occasion. J’ai conscience de laisser une empreinte, je veux qu’elle soit la plus positive possible. Assis en cercle autour du feu, il y a William, l’écossais, dont l’accent prononcé a toujours été un obstacle dans nos conversations, Pascale, ma copine des tout débuts, une fille avec un cœur d’or et une façon très personnelle de s’habiller, mais à Londres, tout est permis, Myriam et Marc, le couple le plus mal assorti que je connaisse et qui partage le « basement flat » avec Alain et moi. Je n’oublie pas la petite morpionne Valérie et d’autres, dont je ne me souviens pas ou que je ne connaissais pas. Mon séjour en Espagne se transformera en « château en Espagne » puisque je resterai en France, accrochée par le cœur à mon premier amour. Je ne savais pas encore à cette époque que je ferais tout pour le retrouver. Je reportais pourtant, années après années, ses anciennes coordonnées téléphoniques, sait-on jamais ? Il avait laissé une marque indélébile, je vivais avec ce fantôme d’amour, en arrière-plan de mon cœur et de mon esprit. Je l’avais connu jeune. Au café que nous fréquentions à la sortie du lycée, toutes les filles lui tournaient autour. Il se dégageait de lui une séduction particulière, un détachement inhabituel, une indifférence totale à l’admiration qu’il provoquait. Dans son visage s’ouvraient deux yeux bleus magnifiques, où l’on décelait pourtant une ombre. Il lisait Nietzche, parlait Nietzche, vivait Nietzche. Il écrivait des textes complètement allumés et incompréhensibles que je trouvais d’une beauté rare. Son intelligence me fascinait, je la découvris dangereuse par la suite. C’est le jour J. Mon avion est dans 3h, je suis chargée d’un énorme sac de marin et d’une valise, et je n’ai pourtant pas pu tout emporter. Alain ne m’accompagne pas, il n’approuve pas du tout ma décision de partir. Il est vrai que notre vie commune était tout à fait confortable, nous vivions au jour le jour, mais j’avais peur de m’endormir dans une douce torpeur ronflante. J’ai appelé un taxi. Je sais que je reviendrai, il y a le concert des Pink Floyd dans un mois, évidemment, rien ne me fera manquer ça. Et puis, j’ai laissé mes marques dans la salle de bains, des fringues dans l’armoire… J’arrive à Paris en plein été. Je squatte provisoirement chez ma sœur et mon beau-frère, puisque je ne dois rester que deux mois, voire trois tout au plus. Pas de cours d’espagnol durant cette saison estivale, « zut, je n’avais pas envisagé ça » Peu à peu s’infiltre en moi l’idée de savoir. Vit-il toujours à Paris, seul, en couple avec des enfants, je dois savoir. Je contacte un de nos anciens amis communs avec qui j’avais gardé des relations et de fil en aiguille, j’obtiens son numéro de téléphone et apprends qu’il vit en couple. Qu’à cela ne tienne, des amis anglais doivent me rendre visite, mon beau-frère et ma sœur sont en vacances, je vais inviter le couple maudit. Au téléphone, j’apprends qu’il viendra seul, il vient de rompre avec sa compagne. Pour couronner le tout, mes amis anglais se décommandent à la dernière minute ; je sais, ça sent le rencard prémédité, pourtant je suis totalement innocente. Soirée de retrouvailles sobre, après 12 ans, nous n’allons pas nous sauter dans les bras. Les rendez-vous suivants augureront de la relation à renaître. Je vais renouer avec des émotions sur le volcan, raviver cette passion tellement fantasmée au fil du temps. Je n’oublie cependant pas le concert à Londres, je ne perds pas la raison à ce point-là. Il est très contrarié de me voir repartir. Nous n’en sommes pourtant qu’au balbutiement de notre nouvelle histoire. Le concert est magique, au sens propre du terme, même si quelques substances le rendent extraordinaire. C’est le plus magnifique concert auquel j’ai assisté, et j’en garde un souvenir très précis et vivace. J’avais prévu de passer quelques jours à Londres, mais un télégramme vient chambouler mon programme. « Un billet payé pour Paris t’attend à l’aéroport, reviens ! » La raison me fait défaut, bien sûr, se sentir attendue à ce point me donne le vertige. Je me précipite à l’aéroport, à nouveau chargée de lourds bagages. En arrivant à Paris, personne ne m’attend. Je passerai 25 ans de ma vie avec cet absent, négligeant la petite voix intérieure qui m’interpelle. Je me quitte.
Cécile
« Moi, jamais ça ! » Le matin exhale sa fraîcheur ; la campagne alentour éclate de verdure ; au loin, un coq chante ; une petite fille humblement vêtue, d’un bon pas, emprunte l’allée de tilleuls fleuris ; un peu plus loin derrière elle, un chien la suit lentement. La fillette, qui tient un bidon et un panier à chaque main, se dirige vers le village. La première maison passée, la petite s’arrête à la suivante et toque à la porte ; une dame en tablier sort et s’écrit d’une voix forte « oh, c’est la petite Nine ! » La petite murmure un bonjour, dépose le bidon de lait et sort une motte de beurre du panier, entouré d’un beau tissu blanc. Puis timidement, elle reprend sa route en direction d’une seconde maison ; elle est déjà lasse, la route est longue depuis la ferme, pour ses petites jambes. Mais joyeusement le chien la rejoint ; elle peut enfin s’égayer, afficher sa joie ; elle le caresse, il lui lèche les joues, les mains, en sautant autour d’elle ; elle rit aux éclats, elle n’est plus seule ! La petite Nine est la fille des fermiers du château de Fontenille, situé en Auvergne, proche du Puy de Dôme. La famille est très pauvre, et vit difficilement dans cette ferme. Ici, vit le grand père, taiseux depuis la « Grande guerre » de 1914 ; le père et la mère, travailleurs, aiment leur famille mais parlent peu, ne se plaignent jamais ; la tante, sœur du père est célibataire et vivent aussi deux enfants, JC le garçon le plus âgé et la petite Nine de 5 ans déjà. La propriété et sa ferme sont isolées de la petite ville de Luze, proche d’un petit groupe de maisons éloigné d’un petit kilomètre. La ferme est grande pour des yeux d’enfant. Le confort y est inexistant ; à gauche des bâtiments, se trouve la maison d’habitation ; à droite jouxte l’étable, où vivent les vaches et veaux, Bijou, le cheval de trait, puis suit une grande cour avec une belle fontaine assortie d’un grand bac où boivent les animaux, le jardin potager, une grange plus loin où est entassé le foin. Et derrière, la bassecour où picorent poules, canards... se situe la partie habitation constituée d’une grande pièce centrale, une longue table de bois au milieu avec des bancs de chaque côté ; un seau d’eau posé sur une étagère près de la petite fenêtre, avec une cuvette proche servant d’évier ; au fond de la pièce un grand four de boulanger entouré de bois coupé, quelques chaises empaillées, sert de cuisinière et de chauffage, et derrière se trouve la souillarde. À droite, une porte mène à la chambre du grand père, en bas, et plus loin, un escalier de bois monte à l’étage et dessert deux chambres, celle de la tante et celle de la famille, les enfants dormant avec les parents. À l’étage, à côté des chambres, se trouve le grenier grand ouvert, où s’étalent les immenses tas de grains ; une petite fenêtre permet de sortir les sacs, grâce à l’échelle posée contre le mur. La famille est très pauvre, travailleuse, très occupée par tous les travaux de la ferme et du château. La petite Nine vit là, dans cette ferme triste et isolée, une vie peu facile, et pauvre de tout ! Elle a son frère, qui la bouscule souvent, et qui ne joue pas avec « les filles » lui... plus grand, il va déjà à l’école de la ville et est bon élève. La petite fille ira bientôt à l’école aussi, à la rentrée prochaine de cette année 1955. Elle s’ennuie beaucoup, joue peut, elle n’a pas beaucoup de jouets. Elle aide sa maman dans tous les travaux de la ferme ou de la maison. Elle garde les vaches aussi, les mène dans les près voisins, tricote en veillant sur elles, comme appris par sa maman, rêvasse, s’ennuie. La tante, lit souvent les journaux donnés par la voisine, elle est instruite, elle ! Le grand père, plutôt âgé et vouté, s’occupe de son vieux cheval et de son chien qui le suit pas à pas. La Nine, petite fille, aux joues rondes rehaussées de deux yeux brillants, est menue, timide, gentille, obéissante, appliquée, rêveuse, têtue et volontaire parfois rebelle, et elle s’ennuie souvent. Elle répète à sa maman « maman, je m’ennuie », la réponse est toujours la même ... « occupe toi ». La fillette court chaque fois se consoler près de la chaleur et les caresses des chats de la maison. Les parents sont toujours au travail, le frère refuse de jouer avec elle. La maison est triste et sombre ; la misère entoure cette petite ; il faut aller chercher l’eau à la fontaine, les chambres ne sont pas chauffées et l’hiver, le givre maquille les vitres des fenêtres ; la terre battue recouvre la pièce principale, le « couvert » n’est pas riche non plus, mais la famille ne meurt pas de faim... les femmes de la maison se débrouillent au mieux pour cuisiner devant le feu. Déjà, la petite ressent la misère de la vie dans cette maison. Elle rêve à autre chose, mais ne sait pas à quoi ! Elle sent, elle sait, qu’il existe d’autres vies. Elle voit bien que les propriétaires du Château font des fêtes, reçoivent des gens bien habillés et mangent de bons repas ; sa maman va parfois servir les invités ; elle met alors une jolie robe noire assortie d’un petit tablier rond en dentelles ; elle est belle et revient toujours avec des gâteaux et friandises inconnus de tous et mangés avec gourmandise. La petite sait qu’une autre vie existe ! Timide, oui, elle l’est, secrète aussi, malicieuse et toujours l’œil vif ; l’esprit n’attend que les mystères et les déclics de la vie pour se révéler. Et ce jour-là, pas tout à fait comme les autres, Petite Nine, assise près de son grand-père, les deux poings sur les genoux, les yeux fixes et rebelles, lui dit : « Moi, jamais ça ! ». Le ton est volontaire, le verbe haut ! Le grand père hoche la tête, serre l’enfant dans ses bras ; le chien tout près lèche le visage de la fillette, et la moustache du pépé frémit. La petite touche sa moustache blanche, l’embrasse sur ses joues ridées, et dit : « - Pépé, je veux plus ça » - Oui c’est bien dur pour une petite fille ! - Oui, Pépé je veux m’en aller - Mais où veux-tu aller ? quand tu seras grande, tu feras ce que tu voudras. - Mais je suis petite encore... - Tu as de la chance, tu vas aller à l’école, j’y suis allé autrefois un peu… et tu vas apprendre, à lire, à écrire, compter ; tu écouteras bien ta maitresse d’école, et apprendre, apprendre, oui apprendre... - Apprendre quoi ? - Tu verras ma petite fille, tu feras ta vie, pas comme nous. » La moustache humide du grand père se frotte sur la joue de la petite qui sourit enfin. Un petit espoir entre dans son cœur ; son grand père est là, rassurant, la douceur et l’affection du chien aussi. Elle n’est pas seule, il y a un ailleurs, son pépé lui a dit et elle croit son pépé ! C’est la rentrée scolaire pour la Nine ; son frère retrouve le chemin de l’école ; il y a deux kilomètres à faire pour aller à la ville, et l’école est à coté de la mairie. Sur le chemin, son frère lui fait peur « t’es qu’une fille, l’école c’est pas fait pour les filles ! » Volontaire et affirmée, la Nine est sûre du contraire ; l’école sera pour elle, elle le veut ! Et en ce jour de rentrée des classes, elle prend fièrement le chemin de l’école, confiante et heureuse. Cette journée lui apporte quelques peurs, un peu de panique parfois, mais des nouveautés, des surprises... un nouveau monde à découvrir ! Les filles de la classe toutes bien habillées l’impressionnent. La maitresse, elle aussi, porte une jolie blouse bleu clair ; elle a les cheveux bruns, une bouche rose, elle est bien maquillée, sur ses talons hauts, elle est souriante et elle sent si bon ! Quelle jolie maitresse ! Elle fait chanter les enfants, récite des poésies ; la première récréation permet de rencontrer d’autres petites filles, certaines pleurent, et la maitresse les console, les embrasse. Quelle gentille maitresse ! Pour le retour, le chemin est long, mais la petite Nine revient contente de sa première journée, joue avec son frère, content aussi, sur la route du retour. Les jours se suivent, et chaque jour d’école, la petit Nine chante et sautille sur le chemin de l’école. Souvent son grand-père vient les chercher, après avoir pris « son canon » à la petite épicerie, et acheté une grosse fraise en sucre ou un rouleau de réglisse... Au printemps, ce seront les premières violettes qu’il ramassera pour elle ! Petite Nine aime bien son grand-père. L’école ? une fuite, une évasion, une source de découvertes, de connaissances : les autres filles toutes différentes, les jeux, les apprentissages... et... la maitresse ! Qu’elle est jolie Mademoiselle M ! La Nine aime quand elle parle aux élèves, qu’elle raconte des histoires, quand elle passe derrière son épaule, guide sa main pour dessiner les lettres, les mots...elle aime son rouge à lèvre, différent chaque jour et...le parfum de son rouge à lèvre ! Melle M est si douce, si gentille avec toutes les fillettes. La Nine n’oubliera jamais le parfum du rouge à lèvre de Melle M ; Bien des années plus tard, elle cherchera dans les rayons du prisunic proche, celui des précieux tubes pour les ouvrir et retrouver ce parfum inoubliable ! « Petite Nine aime sa maitresse. Petite Nine joue à la maitresse, avec ses camarades de classe. Petite Nine imite sa maitresse ! Petite Nine aime aller à l’école, et apprendre ! » Et la petite fille va poursuivre sa scolarité à l’école de la ville, trois ans avec Melle M, deux avec Mme G, puis le collège, puis le Lycée, puis... plus tard, encore des formations, des apprentissages divers... Apprendre, toujours apprendre, on l’appelait même, quand elle était plus grande « Madame, je veux savoir » ! Mademoiselle M n’a sans doute jamais su vraiment tout ce qu’elle avait offert et permis de croire à cette enfant et à bien d’autres sans doute ! Elle lui a donné sa pédagogie, son savoir, sa patience, son affection, et le gout du travail, des études, de la transmission, pour la guider sur le premier chemin d’un monde encore inconnu et l’espoir d’un monde meilleur, d’une autre vie.
Janine
récits sur le thème "se raconter"
A la lecture de cette lettre que j’écris à une petite fille de trois ans, c’est une partie de mon enfance qui tient dans ces quelques lignes. Lettre à cette petite fille de 3 ans : « Tu sais, ton grand-père t’offre un des plus beaux cadeaux qu’il te soit donné de recevoir dans la vie : l’amour inconditionnel, celui qui perdure malgré les épreuves, le temps qui passe. À 55 ans, une partie de lui-même est restée derrière lui. Dans le futur il aura peur de perdre ce qu’il lui reste mais il gardera toujours intacte cette capacité à aimer très fort et à le montrer. Ça te rendra forte dans les épreuves de la vie et tu apprendras que l’amour ne meurt jamais, non jamais. Tu garderas aussi en toi cette capacité à t’émerveiller de la beauté sous toutes ses formes : un paysage, un tableau, une musique … tu as de la chance, ton père aussi te transmettra cette capacité d’enchantement. Avance dans la vie avec ce don et transmets-le à la fille que tu mettras au monde, ta petite merveille. » J’étais cette enfant. Pour mon grand-père, mon papi, j’étais sa première petite fille et j’allais le rester quelques années. Ma mère était la seule de la fratrie à ne plus vivre dans le petit appartement du 10ème arrondissement. Mes jeunes parents partaient parfois en escapade amoureuse et me laissaient dans la famille rue de Rocroy. C’était loin d’être une punition pour moi ! J’adorais me réveiller le dimanche matin quand la petite famille était au complet. Je prenais mon petit déjeuner avec mon oncle, mes deux tantes et mes grands-parents. Par jour de beau temps, mon grand-père prenait ma petite main et m’embarquait à pied jusqu’au point culminent de Paris pendant que ma grand-mère préparait le déjeuner dominical. Comme j’étais fière de me promener avec mon papi ! Je devais avoir trois ans, en pleine décennie disco. Ma mère m’habillait de petites robes courtes et fleuries. Mon grand-père, styliste, mélangeait les genres : il pouvait combiner un pantalon « patte d’eph. » avec une chemise bien boutonnée jusqu’en haut. Son éternelle moustache grise en disait long sur son propriétaire, c’était son accessoire de charme. Nous voilà partis ! nous croisions la rue de Dunkerque, parcourions le boulevard Magenta jusqu’à Barbès-Rochechouart. Après un quart d’heure de marche nous arrivions au pied de la Butte Montmartre. Je trépignais en attendant que le funiculaire ait fait sa rotation. Puis nous montions dedans, c’était mieux qu’un tour de manège, il grimpait la pente raide en une minute trente et nous propulsait tout en haut, sur le toit de Paris. La vue était à couper le souffle ! Au loin, les toits formaient un patchwork de nuances beiges et grises. La Seine serpentait à travers la ville, ajoutant une touche de fluidité au tableau. Plus près, les jardins, les ruelles pavées ainsi que les terrasses animées de cafés et de peintres ajoutaient une touche « so frenchy » au panorama ; les parisiens eux-mêmes ne pouvaient s’empêcher de jouer les touristes devant un tel décor. Mon grand-père s’improvisait guide touristique : « - Tu vois, pointait-il du doigt, la grande tour pointue c’est la Tour Eiffel, je t’y emmènerai un jour. - Et ça c’est quoi ? - Ça c’est Notre Dame de Paris et tu vois le grand bâtiment là-bas ? c’est le Louvre, le plus grand musée du monde ! » J’ouvrais de grands yeux, consciente malgré mon très jeune âge de vivre un privilège. Je contemplais la beauté intemporelle de notre architecture nationale. Mon grand-père regardait sa montre, le temps filait, il ne fallait pas être en retard pour le déjeuner. Il me tendait le sac de pain rassis : « Tu prends une petite poignée de pain et tu la jettes par terre devant nous ! » Je jetais donc les morceaux en pluie et une nuée de pigeons descendait en rafale, leurs ailes battaient l’air au point que je pouvais les ressentir sur mon visage. Leurs mouvements semblaient désordonnés mais en fait ils étaient très coordonnés, comme une danse frénétique où chacun tentait de s’accaparer un morceau de pain. À cette époque, il n’était pas interdit de les nourrir, ce n’était pas encore un fléau urbain. J’éclatais de rire face à ce spectacle. Mon grand-père était heureux de vivre ces moments précieux avec sa petite-fille, il était beau, c’était MON papi. Je sentais intensément son amour, j’étais chanceuse, je le savais. Il se tenait droit, il avait bravé le danger tant de fois, avait connu le désespoir plus qu’un seul homme ne pouvait le supporter, mais l’amour des siens était intact, ça, rien ni personne n’avait réussi à lui enlever. Des années plus tard, lors d’une « cousinade » entre les neuf petits-enfants devenus adultes, je relatai ces escapades en tête-à-tête. J’eus la grande surprise alors d’apprendre que j’étais la seule à avoir vécu ces moments privilégiés avec lui. Le monde extérieur s’était petit à petit refermé, devenant de plus en plus hostile. À la retraite il ne sortait plus que très rarement, et jamais pour se promener. Mon frère, ma sœur et mes cousins ne l’ont connu pour ainsi dire que chez lui ou à de rares occasions chez eux pour des événements tels que des anniversaires. En revanche, il leur a donné le même amour, son cœur avait de la place pour tout le monde. Mon grand-père, Paris et moi, c’est ma Madeleine de Proust, rien qu’à moi. Lui aussi avait sa Madeleine, c’était sa femme, ma mamie Mado, avec qui il aura tout vécu, le meilleur comme le pire, jusqu’au bout. Elle aussi avait un cœur énorme avec de la place pour tout le monde, leur union avait tout d’une évidence.
Véronique
Le modeste pas-de-porte de Suzanne et René ouvre sur la grande rue près de la place de l’église du petit village de Touraine. L’odeur suave du bois se mêle aux effluves acres du détergeant utilisé pour nettoyer le carrelage rouge et blanc du « Le soleil levant ». Le miroir du petit café reflète les bouteilles entamées qui attendent d’être vidées et remplacées et les chaises juchées sur les tables dominent le zinc plein de traces impossibles à effacer tant les clients ont raclé leur verre dans l’empressement de les vider. Dans le coin, près de la fenêtre, un petit tas de buches de bois tendre, des outils sur un établi, un tablier de cuir jeté sur le tabouret. 9 Avril 1936, Ce sont les élections législatives et dès la sortie de la messe de dix heures, les hommes viennent parler politique dans le seul café de Monnaie. Comme tous les matins de la semaine, après avoir bu son café au percolateur du bar, René allume la radio et s’installe dans son atelier. Suzanne est partie avec leur fille à la messe de huit heures. Dès son retour, il faudra ouvrir le café. René noue son tablier de cuir sur sa grande blouse noire, s’assoit et commence à travailler. Depuis dix ans, il creuse avec application et sérieux cet objet indispensable pour qui veut avancer. Ses sabots sont un peu à son image, sans fantaisie, ils se doivent d’être légers, solides et confortables. René est un taiseux, il a des convictions et aime les tenir secrètes. Il est libre penseur et ne met jamais les pieds dans une église. Et ce matin, il espère fortement la victoire du Front Populaire. Ses mains plongées dans le bois du sabot et sa tête attentive aux nouvelles données par la radio grésillant, il sursaute. La porte du café s’ouvre bruyamment sur l’entrée de Suzanne et de la petite. « Monte de suite enlever ta robe du dimanche et redescends vite pour m’aider. N’oublie-pas de mettre une blouse. » La gamine s’approche de son père. « Bonjour ma princesse. » René éteint la radio et attrape sa fille pour l’asseoir sur ses genoux et l’embrasser. Le bruit de la rue couvre les premiers mots de Suzanne qui s’avance vers son mari pour être entendue. « -Le prêtre a fait un excellent sermon ce matin. Il a osé dire ses craintes et a affirmé son désir de nous mettre en garde dans des choix difficiles. -Pas besoin d’y être pour savoir ce qu’il a dit. » René lève la tête pour regarder sa femme et dépose l’enfant au milieu des copeaux qui jonchent le sol. Et comme pour remplacer les mots qu’il veut garder en lui, il est pris d’une forte quinte de toux qui résonne dans le café encore désert. Suzanne, les mains sur les hanches, ne veut voir ni le teint blafard, ni les spasmes qui agitent son mari. Elle noue son tablier serré autour de sa taille et se faufile derrière son comptoir. « Il nous a mis en garde sur le peu de foi de tous ces communistes qui veulent diriger le pays. J’ose espérer qu’il ne parlait pas de toi », ajoute-t-elle d’une voix presque inaudible. La cloche de l’église sonne la sortie de la messe de dix heures. Quelques hommes entrent dans le café en parlant haut et fort. Un voisin s’approche de René en levant son verre. « Santé à nous et à Monnaie qui a bien voté ». Suzanne sourit légèrement à l’évocation du nom du village où René et elle se sont installés au début de leur mariage. Le mouvement de son cœur est en diapason avec l’équilibre monétaire de la France, ils sont fragiles et prêts à se rompre. « A ta santé Paul », répond René en reprenant son travail sans plus se préoccuper des conversations qui fusent au gré des entrées et des sorties des hommes endimanchés. Sa moustache soignée couvre légèrement ses lèvres. Nul ne peut percevoir ou deviner le moindre sourire chez cet homme penché sur une pièce de bouleau ou d’aulne, René choisit parfois un bois fruitier, pommier, poirier ou cerisier. Les crissements de l’herminette et du racloir couvrent mal les rires et les cris des clients accoudés au comptoir quand Suzanne leur sert les ballons de rouge ou de blanc. 19 septembre 1936, Après le départ de son dernier client, Suzanne, accrochée à son balai pour ne pas s’écrouler, se sent au bord du gouffre. Le silence et le calme du café contrastent avec la tempête qui gronde et s’agite en elle. Pourquoi cette fichue réalité est-elle venue mordre un avenir qu’elle espérait simple et rassurant ? Son regard fatigué et triste se dirige vers le coin de l’atelier assombri par les volets fermés. Ce matin, le corbillard tiré par un cheval a emmené René vers sa dernière demeure. Elle soupire, demain elle fermera son café définitivement. Tout le temps de la longue maladie de René, elle a cherché une autre réponse à sa vie mais ce soir, elle sait. Une femme jeune, veuve et pauvre ne peut élever seule son enfant. 7 Mai 1960, lettre à Suzanne. « Chère grand-mère, Aujourd’hui, ma mère et moi te rencontrons par hasard chez des cousins. Tu as l’air très heureuse de me connaitre. Du haut de mes dix ans, cet « avoir l’air » m’embarrasse. Le peu d’histoire que m’a raconté ma mère, ta fille, est un filtre si serré que ta gentillesse d’aujourd’hui ne peut m’atteindre. Comment me laisser aller à t’aimer sans trahir l’amour que je porte à ma mère ? J’ai dix ans et je ne prends en compte que les faits. En 1936, tu as abandonné ta fille de six ans dans un orphelinat à Amboise. Quels mots, moi ta petite-fille, aimerais-je entendre pour combler ce trou que tu as creusé. Chez nos cousins, tu es avec ta deuxième famille, rien ne se dit, tout le monde fait semblant. Au milieu de leur salon, ma mère reste ce brouillon que tu n’as pas hésité à déchirer, à jeter et à oublier. Crotte de bique, je suis en colère et je te déteste. Ta petite-fille qui ne veut pas t’aimer. » Suzanne n’a jamais reçu cette lettre. La vie offre un bouquet de gâchis, de désordre, de pagaille et aucune déchirure ne peut se réparer, se repriser sans les mots. 6 Octobre 2024, Qu’aurait pu dire Suzanne ce jour-là, pour apaiser la tristesse qui, malgré toutes ses années, continue à noircir le cœur de sa fille, ma mère ?
Annick
Tout pourrait commencer comme ça : et au milieu coule une rivière. Cette rivière, c’est le Thouet. Elle s’allonge le long des prés en contre-bas de notre jardin. Jadis, elle alimentait le moulin qui aujourd’hui est devenu muet, figé dans le temps comme ce petit village du Poitou, le bien nommé Chillou. De vieux murets, entourent les jardins potager, l’odeur âcre du fumier, vous pique le nez. J’aime cette odeur de campagne profonde, moins qui n’ai que quatorze ans et qui découvre le monde rural et la vie avec Francine. Ce changement de vie, de famille, je l’ai choisi. Du plus lointain que je me souvienne, j’ai aimé me transformer. Cela m’a pris une après-midi de 1978 après avoir découvert un tailleur dans une armoire de la maison. Ma maison au bord du Thouet dans cette campagne Deux Sévrienne. Le Jardin explosait de couleurs, beaucoup de rouge comme ce tailleur. L’air léger faisait danser les feuilles des peupliers. Plus bas, derrière moi un troupeau de parthenaises transformait le pré en un damier noir et blanc. Ma mère Zouzou est derrière l’objectif et Francine est le metteur en scène. Mais d’où me vient ce besoin profond de vouloir être autre chose que moi. Je me pose souvent cette question. L’instant se fige par le « clic » de l’appareil photo mais la photo continue à s’exprimer bien au-delà des années. Je suis encore dans mes pensées existentielles lorsque Francine me ramène à la réalité. « Bon, tu te réveilles, lève la tête, écarte le bras, bouge, toi… » Zouzou intervient en lui, demandant d’être moins agressive. « - Francine soit plus douce, moins directive, bon sens !… - Oui, mais elle veut toujours se montrer la plus grande, être devant, et d’abord, tu n’es même pas sa mère. - Ça suffit, tu ne penses pas ce que tu dis. » Je prends ses mots en pleine figure comme un violent coup de poing. Est-ce que je rends le coup ? Je savais qu’un jour cela arriverait. « Désolée, je suis désolée, mais tu m’as tellement énervé. » Je reprends la pose et la photo est enfin dans la boîte mais ce moment de vérité, lui, est dans ma boite crânienne. D’où viens-tu ? Mais pourquoi cette phrase te parle-t-elle ? Quelle est cette personne qui s’accroche à toi ? Est-ce ton reflet dans le miroir ou est-ce ton imagination qui te joue des tours ? Il y en a tant d’autres comme toi, tu n’es pas unique. Je sais que tu es fracturée, mais tu as franchi des murs, tu as créé ta bulle de survie dans laquelle tu as découvert que le berceau n’était pas si étroit, et qu’un monde nouveau pouvait naître. Ose être toi, lui ou moi. J’ai donc choisi de vivre ailleurs. L’adolescente que j’étais a choisi de vivre avec son père. Francine est ma petite sœur, sans demi, tout entière. Nous avons fait connaissance lorsque j’avais cinq ans et sa mère est devenue ma mère. Les sentiments qui coule dans nos veines sont bien plus puissants que le mélange sanguin qui fait battre nos cœurs. Il n’y a pas de demi-mesure, de demi-mot, mais des sœurs à part entière.
Carole
récits sur le thème "se raconter"
La représentation terminée, ils retournèrent à l'hôtel, puis au lit, pour la dix-septième fois en trois semaines. Il l'avait choisie, elle, parce qu'étant en tournée avec lui, il l'avait à portée de la main ; et aussi parce que, étant mariée, elle avait déjà rogné les ailes à un mâle et ne pouvait donc exiger de lui davantage que ce qu'il était disposé à donner. Pourquoi elle l'avait choisi, lui, il n'en savait rien et n'en avait cure. Le soleil d'ouest filtre à travers les persiennes, ses rayons zèbrent le plancher de bois blond, malgré l'heure tardive. Un orage gronde au loin dans la torpeur estivale, apportant des effluves d'embrun. Allongés sur le lit, les corps si justement liés, ils reprennent leur souffle sans un mot. Les dialogues, ils les laissent aux répétitions et représentations. Seul le rythme des vagues qui s’écrasent sur les rochers, en contrebas, rythme le silence. Lui, jubile intérieurement de l'avoir d'un seul regard, sans explication, capturée dès le premier jour. Victorieux que cette magnifique jeune femme lui porte allégeance depuis le début de la tournée. Surpris de ne pas être lassé après trois semaines. Il la souhaitait, attiré par sa beauté discrète et désarmante, s’humiliant presque à la valoriser exagérément auprès de l’équipe alors qu’il ne connaissait que son professionnalisme, il n’avait signé qu’à cette condition. Sa présence lui était devenue très rapidement indispensable après chaque représentation, un prolongement de l’intimité de la scène, conscient qu’elle était la seule personne à le maintenir au bord du gouffre, à panser ses anciennes morsures, il ne pouvait s’expliquer pourquoi mais sentait cette nécessité s’accroître, une dépendance s’installait, dangereuse, tout ce qu’il combattait jusqu’à présent, Elle respire calmement, apaisée, puis lui revient ce premier rendez-vous, sa surprise d’être retenue par lui, alors qu’elle l’avait tant espéré, n’y croyant plus, sa présentation à l’équipe déjà constituée, mais surtout cette sensation incontrôlable ressentie, ce paradoxe entre attirance et crainte, était-ce le passé qui ressurgissait si violemment ? Ses premières impressions la figent encore d’appréhension. Elle le revoit lors du casting, Il semblait ne pas tenir compte de l’univers qui l’entourait, détaché des personnes et des objets, tout en lui respirait la distance, malgré tout il se dégageait de cette belle gueule une séduction qui n’était pas seulement due à ce que nous savions de lui mais à son physique même, à ce que ce physique exprimait : le charisme et le respect accentués par une stature imposante et sécurisante, un corps musclé entretenu par une activité sportive régulière, mais aussi, plus subtilement, une attirance retenue, était-ce la combinaison de son intonation et de sa gestuelle mesurées, étudiées ou l’expression d’une sensibilité refoulée ? De son visage mat aux traits réguliers jaillissaient deux émeraudes, éclatantes et froides, atténuées par de fines étoiles sur leur pourtour extérieur et des lèvres pleines, Il plaisait au premier contact, Mais alors pourquoi ne lui connaissait-on ni femme ni amie à la cinquantaine passée ? La sonnerie de son téléphone interrompe leurs pensées respectives, d’un accord tacite ils se rhabillent et se séparent en silence. Elle se dirige vers sa chambre pour une nuit solitaire. Dès son réveil, le lendemain, elle descend nager dans la crique, en contrebas, qu’elle avait rejointe par la trentaine de marches en vieilles pierres, avant l’effervescence touristique. De retour dans sa chambre rafraîchie par sa baignade et une douche, installée sur son balcon, elle entame son petit déjeuner avec gourmandise, la viennoiserie fond dans sa bouche, le jus de fruits juste pressé explose d’arômes exotiques, la brise matinale souffle dans ses cheveux. Elle savoure cette parenthèse, prémices d’une magnifique journée, et déguste son thé parfumé aux agrumes en admirant le scintillement du soleil sur cette palette bleue qui s’offre à ses yeux. C’est jour de relâche aujourd’hui, elle hésite entre rester à l’hôtel et profiter de l’environnement calme et magnifique, à l’écart des vacanciers, pour nager et lire à l’ombre des palmiers ou visiter le village de son enfance qu’elle n’a pas revu depuis si longtemps. Quand un plongeon interrompe ses pensées, elle le reconnaît aussitôt, son crawl est toujours aussi sportif, le rythme est aisé dans une synchronisation parfaite. Elle se laisse happer une fois encore, comme cet été-là, il y a quinze ans, alors qu’elle était une jeune adolescente pleine de vie, heureuse de partager ses vacances, sur cette même côte méditerranéenne, avec ses frères ses parents, leurs amis et leurs enfants, Cette tribu qui se reconstituée chaque été depuis huit ans dans la joie et l’insouciance d’un été interminable, Ils étaient tous si proches si gais si liés qu’elle croyait au bonheur éternel, Que c’était ça la vie, Elle n’avait rien vu venir quand le drame surgit la propulsant dans le monde réel des adultes, sale et mensonger, la laissant brisée pour de longues années, Chassant ses pensées importunes, elle termine son thé et décide de s’octroyer cette ballade, Elle rassemble sa serviette de plage, son livre, sa crème solaire dans son grand cabas, Met son chapeau, ses lunettes de soleil et chausse ses sandales. Sa robe en lin blanc virevolte autour d’elle, Elle quitte sa chambre et rejoint l’arrêt de bus devant l’hôtel. Une fois arrivée dans le village elle choisira, assise à l’ombre des platanes de la place centrale, en buvant son café, le lieu qui l’apaisera pour la journée, surtout s’éloigner de lui aujourd’hui, Ne plus subir sa domination. Une fois de plus dans ses pensées elle a relâché sa vigilance et se laisse surprendre, « Bonjour Mademoiselle Adèle. » Elle se fige un instant avant de se retourner en colère contre elle de ne pas avoir été assez rapide, Pourquoi m’interpeller avec le prénom de mon personnage se dit-elle. « Bonjour Marc. » Les mots se bloquent dans sa gorge. « - Je suis très content de te trouver, hier soir nous n’avons pas parlé de cette journée de repos, je voulais te proposer la visite de Calval une pause déjeuner dans une paillote puis profiter de sa crique et ses eaux cristallines, j’ai même pensé à louer un bateau pour nous deux, je voudrais très sincèrement partager ce lieu avec toi. - Avec moi ? Tu veux être avec moi toute la journée ? - Oui je veux mieux te connaître et te faire découvrir cet endroit magnifique qui m’est précieux, j’y ai vécu de merveilleux moments, et j’aime y retourner dès que je le peux, toujours seul, Mais aujourd’hui je veux le partager avec toi car tu comptes beaucoup pour moi, tu m’attends je reviens avec mon sac et mes clés de voiture. » Ébahie, elle le regarde, jamais il ne lui avait parlé aussi longtemps et ses paroles si personnelles la troublent, confiant il retourne à sa chambre. Le bus arrive à cet instant, elle s’y engouffre pour échapper à son emprise. Elle rentre le soir tard pour l’éviter. Il n’osera rien dire le lendemain matin à la répétition devant l’équipe. Consciente que cet évitement ne peut durer, inquiète de sa réaction, elle ne peut trouver le sommeil, et descend à la plage sous ce soleil couchant. De nombreux promeneurs marchent dans la tiédeur de la soirée. Les conversations sont discrètes et rythmées par les clapotis de la mer. Quelques éclats de rire sporadiques parviennent des restaurants lointains. Demain se joue la finale, elle s’éclipsera après la soirée de clôture pour ne pas avoir à l’affronter seule. Elle remonte rapidement vers sa chambre pour lui écrire ces mots enfouis depuis tant d’années. Dans l’obscurité du couloir elle n’a pas aperçu l’ombre qui la guettait. C’est l’odeur de ce parfum qui la met aussitôt en alerte. Trop tard ! Il s’impose devant elle. « Que m’as-tu fait ? Je t’ai cherchée toute la journée. Tu devais m’attendre. Pourquoi as-tu disparu ? Où étais-tu ? Imagines-tu mon inquiétude ? Ma peur ? Pourquoi t’es-tu enfuie ? » Les mots la percutent la déstabilisent. Elle ne l’a jamais vu dans cette état, il était toujours souriant, posé même le jour fatidique. Furieux il ne se contient plus et laisse exploser sa colère, ses sentiments. « Dis-moi, parle-moi, explique-moi, je tenais tant à cette journée, tu n’as pas compris ? Je tiens tant à toi, ta présence m’est vitale, ne t’éloigne jamais plus de moi, je ne veux plus. » Interrompu par un couple sortant de leur chambre devant eux, ses derniers mots s’évanouissent dans sa bouche, elle profite prestement de cette pause pour rentrer dans sa chambre, et s’écroule derrière la porte, les mots, les images se bousculent dans sa tête, tout se confond : les paroles qu’il continue à lui proférer derrière la porte, les images qu’elle conserve de la journée du drame. Repliée sur elle-même, la tête au creux de ses bras, les larmes noient ses yeux inondent ses joues, elle redevient la jeune adolescente apeurée, perdue, brisée par la violence des adultes, dans l’incapacité de bouger elle s’endort après plusieurs heures de lutte contre ses démons. Aux premiers rayons de soleil matinal elle se réveille ankylosée, rejoint la plage pour un dernier bain. Elle étire ses membres, libère ses tensions dans cette étendue turquoise. L’eau dissipe la noirceur de la nuit. La nage l’apaise. La mer est son refuge, tels les bras de sa mère quand elle était enfant. Dans ce cocon enveloppant elle se retrouve, se renforce, l’énergie que lui transmet cet élément s’infiltre par chaque pose de sa peau, circule dans tout son organisme et vitalise son esprit. Sereine, elle est prête pour cette dernière représentation, elle consacre une partie de la journée à terminer ses bagages et écrire la lettre qu’elle lui laissera en guise d’adieu. La finale est un triomphe, plus détendue que pour les dix-sept précédentes représentions elle rayonne. Lui, n’a jamais autant donné que ce soir, déployant toutes ses qualités de comédien. La jouait-il ou la vivait-il ? Rien n’était plus authentique ni l’équipe ni le public ne s’y méprenait. Il assurait sa réputation et bien au-delà pour les années à venir. La soirée se déroula dans une convivialité et une chaleur oppressante pour elle, Elle prenait sur elle pour paraître détendue et heureuse, jonglait avec les uns et les autres pour l’éviter. À plusieurs reprises elle crût ne pas lui échapper mais fût miraculeusement dégagée de sa présence par des admiratrices. Elle put s’éclipser à l’heure prévue. Elle rejoignit rapidement le taxi qui patientait après avoir laissé sa lettre sur le lit de cette chambre qui l’avait accueillie pendant dix-sept nuits. Sans regrets, aucun, uniquement un soulagement intense, libérateur. Il la chercha un long moment, depuis qu’il l’avait perdue de vue une bonne demi-heure s’était écoulée. Pris de panique, il se dirigea vers la porte devant laquelle il avait si longuement parlé cette nuit, frappa à plusieurs reprises, appela, attendit sans réponse. Il comprit que son silence serait définitif ce soir. Détaché de son succès, meurtri par son indifférence, alors que son souhait le plus profond était de la tenir dans ses bras, il rejoignit sa chambre il se résigna à attendre le lendemain. Il prit conscience qu’il l’aimait, ce qu’il se refusait depuis quinze ans, son cœur lui accordait. Ce n’était pas l’osmose qu’il avait vécu avec Hélène mais des sentiments tendres et précieux. Pourquoi cette femme le fuyait-elle alors qu’elle s’était abandonnée pendant ces trois dernières semaines ? Il se déshabilla hâtivement, se doucha longuement pour effacer les tensions accumulées tout au long de cette journée et ne remarqua l’enveloppe posée sur son lit qu’une fois couché, Il comprit aussitôt qui l’avait déposée. « Souviens-toi, nous étions heureux, nous les enfants dans la naïveté de notre jeunesse, vous les adultes dans l’insouciance de votre bonheur, nous vivions les prémices d’un drame en toute inconscience. Est-ce que l’un d’entre nous aurait pu penser que tout aller basculer en quelques heures ? Tu as été le déclencheur, tu as tout gâché, détruit, tu m’as tout volé, tu as brisé ma vie et celle de notre entourage, anéantissant mon existence pour toujours, fracturant des amitiés, démembrant des familles, important l’horreur dans la douceur. C’était il y a 15 ans aujourd’hui. » Il marqua une pause dans sa lecture. Toute cette journée se déroula à nouveau dans sa tête, comme des milliers de fois depuis, comme s’il avait pu l’oublier. Il vivait avec depuis. Il vivait avec l’absence d’Hélène chaque jour depuis 15 ans, il vivait dans la souffrance depuis 15 ans, il n’avait jamais oublié son amour. Comment oublier cette dernière journée où ils s’étaient aimé si passionnément qu’ils avaient décidé de fuir aussitôt leur famille et leurs amis ? Comment oublier la stupéfaction, les cris et les larmes des uns et des autres, petits et grands quand ils ont démarré la voiture pour fuir cet étau qui les étouffait depuis trois ans ? Comment oublier le regard désespéré de son meilleur ami le mari d’Hélène ? Comment oublier l’accident trente kilomètres plus loin ? Comment oublier Hélène ensanglantée, morte sous ses yeux ? Mais qui était-elle cette femme pour le lui rappeler ? Qui était-elle celle qui osait lui écrire ces mots. Il repensa à tous ceux qui avait fait partie de sa vie pendant si longtemps, il les avait tous aimés ses amis, leurs enfants, sa femme, ses filles, et ne comprenait toujours pas qui lui avait écrit. Qui cette si fragile et belle jeune femme avait été à cette époque ? Peut-être la jeune fille au pair qui s’était jointe à eux la dernière année à l’initiative d’Hélène. Oui c’est ça ! Cette petite belge, Mais non ce n’était pas possible ? Il repensa à ces dix-sept dernières nuits et ne pouvait envisager cette réponse, Alors qui ? « Tu as ôté la vie d’une femme exceptionnelle, d’une maman merveilleuse qui n’était que douceur et bonheur. As-tu pensé à ceux que tu as privé d’elle pour toujours ? Comment pouvaient-ils continuer ? J’ai survécu, il m’a fallu dix ans pour remonter à la surface, et depuis cinq ans je renoue avec la vie, pas celle d’avant, la vie sans, sans elle. J’étais une petite fille de 12 ans émerveillée par la vie et sa maman, j’ai tout perdu le même jour, tu as tué cette petite fille et tué sa mère, « Aurore ».
Frédérique
Une soirée paisible Nous sommes au salon, bien installés dans la quiétude d’un samedi soir, mon mari et moi. Mais déjà une ébullition invisible monte en moi. La respiration qui bondit et que je dois brider, comme le fait d’un cheval fougueux, le dresseur impavide. Puis les entrées imprévues qui claquent, tels des feux de bengale : Maryse, ma fidèle. « Tu es venue ! », s’exclame Daniel. « Oh, et toi aussi. Mais, vous êtes tous là ! », s’exclame Bernard, mon conjoint. Les copains de toujours prennent place petit à petit, seuls ou par couple, autour de nous. C’est l’anniversaire de celui qui partage ma vie et j’ai organisé à son insu une fête surprise. Je partage sa joyeuse stupeur tout en m’occupant à sortir plats et bouteilles préparés auparavant en secret. Tout en m’affairant, je redoute le moment de me mettre vraiment en scène, de m’impliquer. Oserai-je ? J’hésite encore… La passion qui domine ma vie en ce moment est le chant. Comme tout ce que j’entreprends, je me donne à fond. Je prends des cours. Je vocalise, j’écoute admirative des chanteurs connus, je m’enregistre. Bref je travaille à améliorer ma voix. Et je me suis mise en tête de chanter ce soir devant tous. Mais je doute. Pour bien chanter, il faut se livrer, affronter le regard des autres. Je pense au fonde de moi-même : « Je ne suis pas capable. Je vais être ridicule. Tant pis, ça ne tue pas, il faut que je me concentre et puise au plus profond de mes émotions. Mes amis vont me trouver prétentieuse. Si je chante avec mon cœur alors ils l’entendront et seront touchés. Mon amour, mon binôme sera fier de moi. » J’écoute les bribes de conversation qui s’entremêlent. Je regarde Bernard. Comme je voudrais lui offrir un moment « cadeau » qui l’émeuve. Comme je voudrais lui rendre un peu de toute cette patiente attention, de cet amour muet dont il me fait jour après jour un cocon douillet. Peut-être s’extériorisera-t-il enfin, lui le taiseux. J’ai travaillé « I still loving you too much ». Entendra-t-il le sens de ce choix ? Bon. Je me lance, je demande le silence. Il faut y aller, ma fille… Ce moment est resté gravé dans ma mémoire car ce soir-là, j’ai eu le sentiment de dévoiler à mes proches un peu de mon moi profond. Je me suis mise en danger de vérité. Aurais-je une si haute idée de moi pour m’être donnée ainsi en spectacle ? Bien sûr, non. J’ai juste tenté de faire entrevoir mon goût pour les belles choses. J’ai essayé de montrer mes efforts pour tendre vers un idéal de beauté. Le résultat fut si dérisoire, si peu à la hauteur de mes rêves, si piètre que d’y penser me fait encore un peu mal. Mais ça c’est une autre histoire…
Anne
La voiture garée près du restaurant laisse échapper les enfants aussitôt partis explorer une fois de plus les lieux. Hélène se dirige vers l'extrémité du parking qui surplombe le paysage grandiose. C'est le point de vue qu'elle préfère sur cette île tropicale qu'elle doit quitter prochainement. Son regard suit un porte-conteneur qui se déplace lentement à l'horizon sur l'océan scintillant. Elle se demande un instant si les caisses de leur déménagement y sont. Puis elle scrute tout en bas la petite ville où ils habitent, bordée de sa plage de sable noir. Elle repère leur maison et remonte ensuite le fil de la route étroite qui serpente, jusqu'à ce lieu-dit bien nommé « Les colimaçons ». Quelques cases dispersées dans les champs de canne se laissent deviner. Un peu plus haut, la végétation se raréfie avec l'altitude. On est déjà dans les « Hauts », qui dévoilent plus loin les pentes des sommets volcaniques et des remparts qui abritent les trois cirques. Depuis leur décision de « rentrer », elle est envahie par un doux sentiment de sérénité après ces années d'attachement à cette terre d'outre-mer qui se mêle à l'inquiétude à l'idée de partir à nouveau. Quitter son nid, ses liens, sa maison, ses routines, la renvoie au point de départ de cette aventure qui fut pour elle une traversée personnelle, identitaire pourrait-on dire. À leur arrivée, douze ans auparavant, tout lui paraissait un gouffre d'étrangeté. Elle ne pouvait donner aucune explication à son malaise, et elle s'étonnait des réflexions d'arrivants, qui eux jubilaient, en faisant allégeance au discours sur les attraits touristiques de cette île magnifique. Justement, rien de cela pour elle. La découverte de la maison attribuée à son mari l'avait dérangée. Imperméable à la beauté du bâtiment, elle la voyait massive, murs trop hauts, lino sale même nettoyé et re-nettoyé, pièces trop grandes... seuls, le jardin luxuriant et la varangue la rassuraient. Au fil des mois, elle s'est accrochée à un quotidien à organiser autour de sa jeune famille. Son profond souhait de s'adapter eut raison de ses orages intérieurs. Sans se lasser, elle avait entrepris de sillonner l'île dans tous les sens et de partir à l'assaut des cirques, aux parois lisses comme de la mimolette passée à la crème dépilatoire ! L'arrivée du déménagement avec le déballage fébrile des cartons, fut une étape heureuse et elle a pu rendre l'oreiller que lui avait prêté l'épouse d'un collègue de son mari ! Hélène continue à laisser défiler les souvenirs des débuts de leur séjour... Elle se réveillait toujours très tôt, bien avant le reste de la famille. Elle s'accordait quelques minutes sans bouger en écoutant les bruits étouffés de la rue déjà animée. Avant de s'endormir, elle avait passé en revue la journée à venir, comme dans une anticipation qui se prolongeait. Elle lisait ce qui traînait, revoyait un cours, rassemblait ses listes de choses à faire, ou laissait son esprit divaguer en sirotant un café, puis un autre. Le moment de grâce dans ce temps suspendu, entièrement à elle prenait fin avec l'arrivée du fils traînant un doudou improbable. La spirale de la journée commençait. Mardi 24 septembre, Hélène s'est assise sur le rebord bétonné du parking. Sous ses pieds, une pente herbacée s'amorce doucement puis c'est une verticale rocheuse qui tombe et s'étale jusqu'au rivage. Au loin, vers le sud, la crique qu'ils affectionnent particulièrement se laisse deviner. Très vite après la randonnée, l'océan a pris toute la place dans leurs loisirs, venant proposer une confrontation avec ses rouleaux puissants s'écrasaient sur le sable noir. Chaque weekend, le même scénario se répète. Arrivés sur le site de la crique des « Trois bassins », qui accueille en douceur l'avancée de la houle, il faut d'abord franchir un amas de roches. Ces vestiges de très anciennes coulées de lave s'amenuisent et forment une avancée qui marque la limite du lagon. Les rochers enserrent quelques nappes de sable coralien à cet endroit, et des flaques d'eau de mer à leur base. La matinée à peine entamée, les nuages sont déjà descendus des sommets, à présent complétement masqués. Elle revoit le fils aîné se précipiter pour être le premier, puis sa planche sous le bras, s'avancer prudemment dans l'eau, en prenant soin d'éviter les oursins et les coraux. Les rires et le chahut des enfant interrompent sa rêverie. Son mari sort du café avec un plateau de boissons. Hélène ne bouge pas. Elle aime écouter leurs échanges sans y participer. « - Mais enfin papa, pourquoi on ne peut pas aller surfer ? - Je t'ai déjà expliqué les raisons plusieurs fois, il me semble que tu avais compris, non ? - C’est injuste, c'est notre dernier weekend avant de partir ! - Oui, je sais mais on ne doit prendre aucun risque depuis cette attaque de requin dimanche... D'ailleurs, la préfecture a interdit la baignade sur plusieurs plages. - Pas à Trois bassins, c'est le bout du lagon... et je suis sûr qu'il y a du monde en ce moment. - Mais c'est non, pour nous c'est non... Tu verras, comme promis, là où nous allons, il y a aussi de très belles vagues et nous irons surfer dès que possible. » Et il ajoute d'une voix théâtrale et enjouée : « C'est un engagement ferme que je prends ici à Colimaçons ! Allez, tu viens Hélène, on trinque ! » Son mari est très inquiet. En rejoignant la famille, elle repense à cet homme qui avait en vain tenté de sauver le pêcheur entrainé vers le large par le requin... Il avait été secouru mais ne s'en était pas sorti. Mardi 1er octobre Ce fut ensuite le retour en France, comme disent certains iliens réfutant la connotation dominante que l'on peut entendre dans le mot « métropole ». La famille agrandie a élu domicile au bord du Bassin d'Arcachon. Dès l'arrivée, les changements de vie, de cadre, de rythme... ont heurté les ados et préados qui pendant plusieurs mois ont copieusement incendié leur père coupable de cet exil forcé : « c'est trop nul ici, y'a même pas la mer, y'a qu'un tas de boue... ». Puis quelques mois passés, le Bassin a pu être regardé et perçu autrement au fil de la cicatrisation des ruptures obligées et des nouvelles amitiés qui se sont fait jour. Les années ont passé... Hélène découvre un jour d'automne un carnet de voyage dans les Mascareignes. Elle s'y plonge avec ravissement mais très vite elle ressent qu'elle ne reconnaît pas tout à fait l'île qu'elle a connue. Déstabilisée, elle a du mal à définir exactement pourquoi elle ne partage pas tout à fait le regard de l'auteur, elle décide de lui écrire. « Cher JF, D'abord intriguée, puis très intéressée, je me suis plongée dans la lecture de votre carnet de voyage dans les Mascareignes. C'est un hymne à la beauté et au merveilleux que vous nous proposez. On vous imagine en prendre plein la vue, au sens propre et figuré au fil de votre déambulation. J'ai bien reconnu certains lieux et j'en ai découvert d'autres. Mais pourquoi ai-je ressenti un certain décalage avec ce que j'ai vécu dans ces îles, essentiellement à La Réunion ? En suivant votre périple, j'ai recherché des cartes, ressorti mes albums photos, interrogé mes proches sur leurs souvenirs. En dehors des dates et des noms des lieux qui ponctuent chaque épisode, les Mascareignes prennent le dessus pour une immersion quasi totale. Il y a une écriture des paysages qui les saisit dans l'immobilité toujours poétique de la contemplation. La nature a une telle intensité que tout paraît plus grand, et surtout, tout semble à portée de main et de regard, les animaux, les plantes, les orchidées sauvages, les poissons... Dans mon souvenir, c'est une île de contrastes et de démesure qui se présente avec ses pentes impressionnantes dont la verticalité des à pic défie les randonneurs, quand elle ne pose aucune difficulté aux habitants des cirques qui semblent survoler les sentiers. C'est l'île de tous les déchainements, avec les éruptions du Piton de la Fournaise, les tempêtes tropicales et les cyclones, l'océan qui peut s'emporter et depuis quelques années, les attaques de requins... Mais c'est aussi, un île plus apaisée qui se laisse découvrir, avec le charme fascinant des couchers de soleil que vous décrivez si bien cher JF, la fraicheur des alizés, la douceur humide les plaines qui nous font passer de l'univers des coulées de lave à la forêt primaire. Dans mon souvenir, c'est surtout la rencontre avec les hommes et les femmes de cette société complexe qui occupe la plus grande place. C'est l'île des questionnements identitaires qui nécessitent de se faufiler dans les nouages de l'histoire issue de la colonisation. C'est l'île du métissage réussi, qui arbore une cohabitation des populations d'origines, de leurs cultures et de leurs religions dans un mouvement de créolisation riche et fécond. Certes, il y a un heureux brassage, mais qui n'exclut pas les aspérités du vivre ensemble cristallisés autour de questions humaines, sociales, économiques... La pauvreté qui côtoie le luxe, un alcoolisme dévastateur, une cohabitation linguistique longue à se résoudre entre le créole, langue du dedans, et le français, langue du dehors etc. Dans le télescopage de la modernité et des traditions, « l'île à grand spectacle » vendue par les agences de tourisme couve un volcan social qui se cache derrière l'Eden. En fait, cher Jf, je me demande pourquoi je vous écris, toute cette réflexion, n'est-ce pas plutôt à moi-même que je l'adresse ? » « Hélène, lors de ton séjour, tu as commencé par percevoir ce qu'il y avait de plus fort, de plus intense sur cette île. Tu as ressenti de l'hostilité, une dureté, de la violence latente, que ce soit dans les paysages, le climat, les gens, les enfants de l'école dont la langue t'était étrange que tu as fini par comprendre. La beauté, la grâce des lieux et des personnes se sont dévoilées « petit peu par petit peu » comme on dit en créole. Alors que l'auteur du carnet de voyage a traversé les trois îles des Mascareignes envoûté dans un enchantement, tu étais dès le début dans le désenchantement. Il t'a fallu découvrir, apprivoiser et construire ce lieu dans une expérience humaine et culturelle, au final tout aussi belle. »
Martine B.
Récits sur le thème du "trésor enfoui"
Dans un salon, un feu de cheminée crépite Marie et son petit-fils Adrien sont réunis comme tous les soirs pour un moment de partage. Marie : Adri, as-tu découvert le lavoir dont nous avons parlé hier ? Adrien: Oui mami, l’endroit est très beau et apaisant. Marie : Les gens du village connaissent beaucoup d’anecdotes le concernant et ils organisent chaque année un spectacle pour retracer les récits des années 1900. Adrien: J’aimerai beaucoup y assister. Marie : Reviens en août. Adrien: Tu accepterais que je revienne pour bousculer encore ton quotidien. Marie : Tu ne bouscule rien au contraire cela me sort de ma routine et m’enchante mais ne tarde pas trop car bientôt je ne serais plus là. Adrien: Ne dis pas ces choses-là. Marie : Mon enfant j’ai 98 ans et j'ai décidé de rejoindre un foyer pour personnes âgées cet automne. Adrien: Personne n'est prévenu, ici tu es bien, entouré de tous tes souvenirs. Marie : Au crépuscule de ma vie, mes forces s’amenuisent, il est temps pour moi de partir, j'ai trouvé une colocation avec des personnes adorables et plus jeunes cela me permettra de terminer mes jours sereinement. Adrien: Mami, je ne connais rien de ta jeunesse Marie : Tu sais il n'y a rien à en dire. Adrien: Mais où vivais tu ? Marie : Dans un petit village du nord de la France. Adrien: En zone occupée durant la guerre, tu as dû connaître des jours très difficiles. Marie : Privations, humiliations, tragédies telle était notre quotidien Adrien: peux- tu un peu me raconter ? Elle se recroqueville et d’une voix chevrotante Marie : Mon père est mort au début de la guerre en 40 et ma mère s’est laissée mourir. Je me suis retrouvée seule avec mes deux sœurs, je n'avais que 16 ans et aucun argent. Adrien : qu'as-tu fait ? Des larmes coulent le long de ses joues Marie : J’ai abandonné mes sœurs. Adrien : Que veux-tu dire ? Marie : Je me suis rendue au couvent du village et j’ai confié mes sœurs à l’orphelinat. Adrien : Tu as fait ce que tu croyais juste. Marie : Oui sûrement mais ensuite je suis partie en zone libre et je me suis mariée et je n’ai jamais cherché à les retrouver. J’ai essayé d’oublier mais c'était impossible la honte me submergeait. Le silence s’installe Adrien : C'est pour cela que tu n'as jamais eu d'enfant. Marie : Je ne devais pas donner la vie, je n'en avais pas le droit. Je suis devenue maman avec ta mère, la fille de ton grand père et je l'ai aimée de tout mon cœur comme ma propre fille. Adrien : Pourquoi n'as-tu jamais évoqué l'abandon de tes sœurs, tu dois être aujourd'hui en paix et ne plus porter le poids de la culpabilité. Il faut levez le voile de ce trésor enfoui, le drame de ta vie. Marie pose un regard apaisé sur son petit-fils et un sourire illumine son visage. Marie : Je suis enfin délivré de ce poids qui me pesait depuis plus de 70 ans. Merci Adrien.
Pascale
Dans le rêve qu’elle affectionne depuis son adolescence, une locomotive fumant et crachant, le sifflement des pistons et un nuage de fumée l’enveloppent. Serrée dans une capeline de velours au col de fourrure douce du renard argenté, elle est suivie d’un porteur accroché à ses gros sacs de cuirs souples et manufacturés. Anne-Lise sait que l’imagination voile souvent la réalité et peu lui importe aujourd’hui, sa valise à roulettes, son blouson North Face et le silence d’un train qui a perdu sa cheminée fumante, elle part. Assise dans le salon de l’inter rail SJ en gare de Stockholm, Anne-Lise attend le départ du train de nuit et profite du wifi. Cabine vingt-huit du wagon neuf, après avoir difficilement glissé sa valise sous sa couchette et suspendu son manteau pour éviter qu’il ne soit froissé le temps de ce long voyage, un homme légèrement vouté, sort et se dirige vers le salon de la première classe. Ses pas sont ralentis comme ceux des personnes âgées qui conjurent ainsi la chute fatale qui stopperait définitivement leur avancée vers un avenir encore prometteur. Paul s’assoit, sort un cahier d’écolier du cartable de cuir usé et patiné qu’il tient à la main. Il tire ensuite quasi religieusement de la pochette de sa veste de velours brun un stylo noir serti d’une bague dorée et ose alors, un regard vers la passagère qui lui fait face. Les cheveux frisés formant un véritable casque d’une douceur incroyable autour de son joli minois, le regard aux yeux de jais et un léger sourire aux lèvres, la jeune fille semble se moquer des préparatifs conventionnels, un peu surannés d’un vieux monsieur, elle dont les deux doigts s’agitent sur le clavier de son smartphone. Sachant que leur tête-à-tête durera, Paul engage la conversation afin d’alléger une promiscuité qui pourrait s’avérer pesante si elle restait silencieuse. « Bonjour Mademoiselle, je m’appelle Paul et je vais jusqu’à Narvik. » Simple présentation formelle mais en bon pédagogue, Paul sait que si la parole rapproche, elle permet aussi de mettre une distance entre deux inconnus. Les mots sont alors de légères protections contre l’intrusion des regards en coin parfois trop insistants. Anne-Lise, se contente de répondre la jeune fille surprise par une approche aussi directe. Elle est si habituée aux transports en commun où personne ne se voit ni ne se parle, chacun restant accroché à son téléphone pour éviter toute intrusion du regard des autres ! Comme pour soulager un début de relation un peu intimidante, le train démarre obligeant les deux passagers à détourner leur regard vers le quai déserté par les voyageurs montés dans les wagons et par ceux qui, ne faisant pas partie du voyage, sont repartis vers leur occupation. Anne-Lise soupire, ce voyage attendu comme peut l’être un rêve, ne devait se faire ni dans la solitude ni dans ce temps marqué du sceau d’un maintenant ou jamais. Anne-Lise sait que la réalité peut plonger définitivement toute imagination et espoir dans un puits sans lumière. Paul, discret, attrape la petite larme qui brille au coin des jolis yeux noirs de la jeune fille. « - J’ai une cabine mais je suis une vieille personne insomniaque qui passe ses nuits à lire et à écrire et je crois que je vais rester à cette table bien agréable. -J’ai un siège très inconfortable, répond Anne-Lise en faisant une grimace enfantine et soulagée comme peut l’être une petite fille rassurée par la présence d’un père protecteur. » Elle ajoute surprise par l’immédiateté de ses propos face à ce vieux monsieur si accueillant : « Je serais flattée Monsieur que vous m’acceptiez à votre table moi qui n’ai qu’un billet de seconde. » Il est dix-sept heures, la nuit est totalement tombée et le train glisse sur les rails. Paul écrit, il lève parfois la tête pour regarder à travers la vitre un paysage invisible qui défile pour chercher dans son propre reflet l’inspiration qui lui manque. Lasse des visios sur son téléphone, Anne-Lise attrape un livre dans le sac à dos qui traine à ses pieds. « - Anna Karénine, bravo Mademoiselle, Tolstoï est un auteur qui mérite qu’on le lise encore. - Le hasard m’a fait prendre ce bouquin laissé sur un fauteuil dans la bibliothèque de mon quartier et la seule première phrase m’a décidé à l’emprunter. » Anne-Lise tourne les quelques pages déjà lues : « Les familles heureuses se ressemblent toutes ; les familles malheureuses sont malheureuses chacune à leur façon ». Je n’avais jamais pensé le bonheur universel alors que le malheur reste unique et individuel mais depuis quelques jours, je suis convaincue qu’un malheur quel qu’il soit ne peut se partager, le « je me mets à ta place » est une foutaise, une supercherie, une fumisterie. Ses sourcils se froncent sur un regard noir et sa bouche se pince sous la colère de ses propos. » Paul sent qu’il n’est pas en droit de forcer cette limite intime que vient d’édifier sa voisine de voyage, il laisse donc le professeur prendre le relai de la conversation. « - En littérature, Mademoiselle, les premières phrases d’un roman constitue l’incipit, c’est une véritable porte d’entrée qui invite et accroche le lecteur. Ce roman merveilleux va vous embarquer tout au long de ce voyage, c’est la force des grands auteurs comme Tolstoï. -Lire est un moyen de ne pas sombrer quand la vie devient trop douloureuse, mais la fiction ne peut modifier la réalité et l’effet de soulagement est bien trop éphémère, conclut sèchement Anne-Lise. » Paul n’ose insister et reprend son écriture. Anne-Lise attrape son téléphone, se lève et s’éloigne vers « la plateforme dédiée aux appels » comme l’a conseillé le personnel au départ du train. Le plus naturellement possible, la jeune fille revient et reprend sa place en face de Paul qui sommeille le stylo à la main. Elle boit une gorgée du café chaud qu’elle a acheté dans le wagon restaurant et reprend sa lecture. Anna Arcadiévna Karénine vient de faire la connaissance de Vronski. « Ce roman vous plait-il ? » Réveillé depuis un petit moment, Paul observe Anne-Lise. La tête appuyée contre la vitre obscure du compartiment, la jeune fille oriente son livre vers la lampe posée sur la table offrant ainsi au regard du vieil homme un magnifique clair-obscur, la liseuse à la fenêtre de Vermeer revisitée. « Permettez-moi de vous inviter à diner Mademoiselle, un vieil homme comme moi serait flatté par la compagnie d’une jeune et belle jeune fille. » Tout au long du repas, Paul parle littérature et Anne-Lise en étudiante passionnée, l’écoute. « - Laissons tous ces auteurs et dites-moi pourquoi ce voyage en Norvège ? -Simplement pour me réveiller un petit matin d’hiver dans le grand nord sous la magie des aurores boréales ! répond-t-elle en riant mais elle ajoute plus sérieusement : Je dois prendre une décision qui va changer le cours de ma vie et je veux le faire sous ce tableau céleste qui sera pour moi le cadeau inespéré d’un ultime voyage. Je cherche et je lutte pour ne pas comme dans le roman que je suis en train de lire, pour ne pas succomber à ce « pourquoi ne pas éteindre la lumière quand il n’y a plus rien à voir, quand le spectacle devient odieux. -J’ai l’âge qui convient pour parler de cette fin qui approche et elle me fait peur mais pour vous jeune fille, la vie est un bien trop précieux pour que vous l’abrégiez volontairement. » Paul est horrifié par la détresse que lui renvoie Anne-Lise. Quels mots pourrait-il trouver pour l’apaiser sans l’obliger à révéler son secret ? « Dans ce cas, si mes sensations n'existent plus, si mon corps est mort, il n'y a plus d'existence possible ? » se contente de lui répondre Anne-Lise en reprenant les mots de Kitty, la belle-sœur d’Anna. Paul une fois de plus n’ose insister tant il sent la fragilité de cette jeune fille. Maladroit et démuni, il se contente de lui proposer de choisir un dessert. Anne-Lise retrouve son sourire et reprend un bavardage qui le distrait et le fait beaucoup rire. Il écoute et sent que ce bavardage futile n’est là que pour amorcer une terrible confidence. « Savez-vous que je me suis décidée à ce voyage en cinq minutes. J’étais venue passer une soirée chez des amis avec Damien. À un moment dans cette fichue soirée, Damien est venu devant moi et a fait tomber son verre. En femme prévenante, je me suis baissée pour le ramasser et essuyer le sol. En me relevant, j’ai vu le geste et le regard de connivence de mon amoureux avec ses amis qui rigolaient derrière nous. Interrogé, Damien s’est contenté de me répondre qu’il avait parié que ses amis verraient ma petite culotte avant la fin de la soirée. Le monde s’est écroulé pour moi. Le féministe nous a-t-il fait sortir de cette place d’objet ? Sommes-nous toujours ce fardeau qu’il faut attacher dans le dos pour que l’homme ait les mains libres ? » Anne-Lise fond en lourds sanglots et murmure pour elle-même mais aussi pour partager le poids de son secret avec ce vieil homme qu’elle ne connait pas : « Je suis enceinte de cet homme et cela me fait horreur. » Anne-Lise se lève et retourne résignée dans son compartiment sur son siège inconfortable. Resté seul, le vieil homme attrape le roman d’Anna Karénine laissé sur la table, il l’ouvre sur la page cornée et écrit dans son cahier d’écolier : « Une belle rencontre dans un train filant vers le Grand-Nord. Laissons-la rester juge de la situation. Elle en comprend la bassesse et l’horreur, mais il n’est pas aussi facile d’y rien changer, de prendre une décision. Laissons la libre d’agir à son heure et ne lui parlons plus jamais de cela… Laissons la partir seule vers un ailleurs et y trouver ce trésor enfoui qui s’appelle espérance. »
Annick
Nous sommes le 20 juin 2000, Leny, deux mois, est désormais pupille de l’Aide sociale à l’enfance, ainsi en a décidé sa mère. Il va heureusement être adopté d’ici quelques jours par une famille qui l’attend, l’espère, depuis des années. Pour tout bagage un mot de sa mère : « Tu t’appelles Leny, je suis Nely, cela sera notre seul lien. » Quand il a eu six ans ses parents adoptifs ont jugé honnête de lui dire la vérité, sa vérité avec beaucoup d’amour, de précautions et des mots simples qui devaient rendre cette situation tout à fait normale ! Leny n’a manifesté aucune émotion, n’a posé aucune question et, est reparti jouer. Le lendemain il n’y voyait plus « ne pouvait plus voir » disait -il. Aujourd’hui Leny a 20 ans, il a toujours sa canne blanche et aucune explication scientifique quant à cette perte de vision. C’est une incompréhension teintée de tristesse et de colère. Il traverse seul ce chemin bordé d’amour d’un côté et d’abandon de l’autre. Toujours en équilibre, toujours hésitant Leny ne connaît pas l’unité, telle est sa quête, être un et c’est tout. Être un sans toutes ces questions, sans cet abandon incompréhensif, sans ce rejet. Il sait bien que son obscurité est le mélange, l’addition, de tout cela mais le savoir n’est pas suffisant pour vivre avec. Ce matin alors qu’il se prélasse sur la terrasse, il surprend des murmures, des chuchotements, ses parents sont dans le séjour, il entend « Nely et le Loupio à Biarritz ». À cet instant précis il sait que le moment est venu, il faut comprendre, trouver, il lui faut partir. Une fulgurance vitale il doit savoir. Lény a toujours vécu dans ce village du Périgord vert, d’où les habitants sont partis les uns après les autres, les plus jeunes pour des raisons financières et les plus âgés ont été les uns après les autres conduits au cimetière. Il en garde quelques images, celle de l’église sans particularité, une fontaine esseulée, deux places inutiles désormais. La plupart des volets sont fermés, non à cause de la chaleur mais par abandon. Lény habite une grande et vielle bâtisse du 17 siècle… les murs sont épais, solides, protecteurs ses parents adoptifs l’ont achetée et rénovée quelques mois avant son arrivée. Tout ce qu’il sait de cet endroit lui a été maintes fois répété par sa mère, depuis son handicap elle prend soin régulièrement de lui faire toucher les murs, les plantes, lui explique longuement avec détails tous les changements qui adviennent au fil des années. Ses souvenirs, les balades en sa compagnie lui ont permis de ne jamais oubliéer complètement les alentours et ses chemins favoris. Ces chemins qu’il parcourt sous le soleil sous la pluie, sous la neige, dans la boue et dans le vent, qu’il parcourt comme un forcené pour oublier ou pour comprendre pour exister pour respirer. Ses souvenirs sont devenus des odeurs, celles des vielles pierres humides, des peupliers qui bordent le lavoir, des moissons quand vient la saison. Des odeurs et des sons, des chants d’oiseaux, le train au loin qui indique l’heure, les poules de Georges le voisin irascible. Leny retrouve ses paysages quotidiennement, s’en nourrit, s’en console, il déambule sans problème depuis des années la canne dans la main droite et le portable dans la main gauche. Il est chez lui c’est son village, son endroit, son repère. Aujourd’hui il ira un peu plus loin il ira au bout de ses forces pour alléger son esprit, pour trouver dans l’épuisement physique une réponse, des convictions, des décisions. Il fonctionne ainsi depuis tout petit. Il se perd dans cette nature, écoute, ressent, attend. Souvent quand il rentre son esprit est plus claire et ses pensées sans doute. Son esprit aujourd’hui est tout entier focalisé par ces mots surpris ce matin sur la terrasse. Biarritz ! ainsi sa fausse mère c’est ainsi qu’il la nomme serait à Biarritz, elle y serait revenue pour chanter d’après ce qu’il a entendu… « le Loupio » tel est le nom dont parlaient ses parents ce matin. Le nom du cabaret. Il ira c’est décidé, il ira, il est temps de sortir de cette double histoire. Il ira, il va demander à Camille son amie de toujours d’organiser cela, il ira le week-end prochain, avec ou sans Camille d’ailleurs, c’est un impératif ! De retour chez lui il fait part de sa décision à ses parents qui échangent un regard complices leur ruse a fonctionnée il a entendu leurs chuchotements ! Camille l’a accompagné jusqu’au début de la ruelle, son GPS sera son guide jusqu’au cabaret « le Loupio ». Cette ruelle débouche sur l’océan il le sent, son odorat ressuscite un bleu qui s’est estompé au fil des années. Dans cette ruelle, des odeurs, des odeurs de tous côtés, des odeurs exotiques qui en se mélangeant invitent à des voyage lointains et sans danger. Les rues pavées le rappellent à l’ordre sans arrêt. À cent dix mètres à partir du premier croisement sur la droite une marche et une lourde porte cloutée. C’est là qu’il se rend. Une inspiration essayer de déglutir, se composer un personnage sûre de lui presque indifférent ! En poussant la lourde porte il est saisi par l’odeur forte, lourde, pesante, un mélange d’alcools de parfums de tabac froid… Il ne sait pas trompé ! L’imprésario du lieu vient l’accueillir, se présente, oui c’est bien lui qui a répondu au téléphone l’autre jour oui ils ont bien rendez-vous aujourd’hui. Ils font ensemble le tour du cabaret lentement pas à pas, là, les canapés rouges et les trois fauteuils assortis, plus loin la piste de danse et ses trois marches au fond à droite la scène qui accueille régulièrement des artistes souvent inconnus. Le bar aux mille bouteilles, et cet endroit plus cosy trois tables rondes entourées de fauteuils. « Vous le sentirez c’est le seul endroit où il y a de la moquette » ajoute l’impresario. Son handicap ne sera plus s’il s’installe dans cet endroit. Lény imagine les jeux de lumière en entendant le rythme de cette musique trop forte. Cette musique de consommation et d’oublis. C’est la première fois qu’il entre dans un tel endroit… Le repérage est fait, il pourra demain soir revenir seul sans autre préoccupation que celle de sa quête. Ils s’installent dans les fauteuils rouges, Leny impressionné, sans voix, ne sait plus quels mots avancés. Heureusement, Claude, l’impresario qu’il a déjà eu au téléphone, prend la parole le sauvant d’un mutisme maladif et maladroit « - Leny ? c’est cela Leny ? - Oui, bonjour et merci d’être venu. - Vous êtes le fils de Nely si j’ai bien tout compris. - Il paraît mais je ne la connais pas. Il sourit en montrant sa canne et ses lunettes noires. Je sais juste qu’elle a longtemps chanté dans ce cabaret et qu’il existe un enregistrement. Peut-être en savez vous plus. - Oui, j’ai plusieurs enregistrements datant d’époques différentes. - Pourriez-vous m’en faire une copie, je veux juste entendre sa voix pour essayer de comprendre. - On se voit ici demain vers 22h30, je vous en donnerai un ou deux. - Je serai là. » Leny quitte le cabaret, joie et peur impatience et colère l’habitent. Pendant qu’il se débattait avec cette vie compliquée, celle qui en était à l’origine chantait. Comment peut-on chanter en ayant quelque part un enfant en errance. Tout se mélange trop de questions Leny est sauvé par Camille qui l’attend là juste à la sortie du cabaret. Il repère son parfum et devine un sourire. Il raconte son entrevue, son rendez-vous, sa quête, ses espoirs qui semblent devenir réalistes. La journée du lendemain est interminable malgré tous les efforts de Camille pour le divertir l’occuper le rassurer. Il est fiévreux, nerveux, impatient et incapable de gérer toutes ces émotions qui s’invitent, s’imposent lui qui se croyait fort serein et capable de maîtriser ! La même ruelle, la même porte, les mêmes odeurs ? Il entre du bout de sa canne refait le chemin expliqué la veille. Le même fauteuil, la même appréhension. « - Bonsoir Leny tu es ponctuel ! - Le moment est important comment ne le serai-je pas. - Je ne t’ai pas apporté d’enregistrements on ira les chercher à la caisse du cabaret en partant. » Leny ne dit rien mais un énorme sentiment de trahison lui donne envie de pleurer, une déception de plus comment a-t-il pu se fier à cet homme qu’il connaît à peine. « - Mais… - Doucement Leny, je t’ai promis un enregistrement, tu l’auras ne t’inquiète pas, je te laisse un moment j’ai une artiste à rencontrer. Attends-moi, je reviens. » À peine Claude l’imprésario est -il parti qu’une personne s’approche de sa table vêtue d’une longue robe noire moirée, longiligne et élégante elle semble caresser le sol. Autour du cou un collier de perles noires semble aimanter toutes les lumières du cabaret. Elle tire un fauteuil vers elle doucement, délicatement. « Bonsoir je peux m’asseoir ? » Une odeur, un murmure de présence et cette voix, Leny déconcerté ne peut qu’acquiescer. « - Je vous en prie - Vous buvez quelque chose je vous l’offre, je vais commander ? - Comme vous alors merci. - Je chante ici, Claude, mon impresario m’a dit que vous auriez quelques questions à me poser. J’avoue qu’il ne m’a rien dit de plus que c’est une énigme. - Je ne sais pas si c’est vous que je désire rencontrer, je m’appelle Leny, la personne que je cherche a chanté ici c’est certain. Cette personne a abandonné son fils il y a une vingtaine d’année dans une pouponnière de l’ASE. Elle doit se prénommer Nely si elle n’a pas changé de pseudo. » Nely se recroqueville sur sa chaise, toute son élégance s’effondre, elle devient bloquée de stupeur et de souffrance, elle devient amas de honte et de peine. Elle voudrait disparaître encore une fois, elle en vient à penser qu’heureusement que ce jeune homme est aveugle. Tout ce qu’elle a pu ériger au fil des années pour tenir, tout ce qu’elle a composé s’écroule à cet instant précis. Elle hésite entre fuir encore une fois ou affronter, assumer, avouer. « Alors, vous voulez me rencontrer ?, dit-elle dans un murmure. » Le choc est violent, Leny n’a pas le temps de se composer un visage, une attitude, une réponse il est anéanti par une vérité qui lui est assénée là dans un cabaret. Il en avait écrit pourtant dans sa tête des histoires de rencontres, des excuses, des scénarios de retrouvailles, des instants de bonheurs et de pleurs. Il est là en face d’une femme qui dit être sa mère parce qu’il a posé la question. Un sentiment d’injustice, de colère comme celui qu’il avait éprouvé quand la vérité lui avait était annoncée. Il a six ans et refait le chemin et revit cette béance. Un choc, une fin de quête, une réalité qui s’impose, elle est là devant lui. Des larmes, enfin les premières larmes depuis sa cécité, des larmes indéfinissables, bonheur ou tristesse, rancune ou colère, joie ou soulagement il ne le sait mais des larmes. Ne rien montrer se dit-il. « - Alors c’est vous - Tu peux me tutoyer, je vais t’expliquer. - Alors c’est bien vous ! Tout en réalisant cela Leny, perdu dans ses réactions, submergé, ne sait pas, ne sait plus… Au-delà des larmes, une forme semble se dessiner, une forme sombre floue qui se dévoile par instant, une forme qui alterne entre illusion et réalité. Puis un visage dans lequel il reconnait son propre regard, celui d’avant, un collier noir, des lèvres maquillée. Ce qu’il voit maintenant ne peut pas s’inventer son cœur en est certain c’est elle - Je ne veux pas d’explication, un tel geste ne s’explique pas, je voulais juste vérifier, je voulais entendre votre voix pour y trouver une réponse. Ma vue s’est retirée de mes yeux le jour où j’ai appris mon adoption et donc mon abandon, Savez-vous ce que cela signifie de ne pas exister dans les yeux d’une mère ? Savez-vous la souffrance, la douleur, les moqueries ? Savez-vous la canne blanche, l’hôpital ? non ! vous chantiez. - Pardon. - Je ne veux pas de pardon ou de regret j’ai trouvé ce que je cherchais et surtout je sais maintenant que ma vue est légitime que je ne dois pas me priver de cela, mon abandon m’a fermé les yeux, le comprendre aujourd’hui m’ouvre d’autres horizons. Vous m’avez emmuré dans le noir d’un monde sans amour de votre part. Vous m’en délivrez aujourd’hui je n’en veux pas plus. Ce soir c’est moi qui vous laisse, nous n’avons madame aucun lien malgré vos lettres épelées et mélangées. » Leny se lève prend sa canne par habitude et se dirige vers la sortie. Il ne prendra pas les enregistrements, il n’appellera pas Camille pour qu’elle vienne le chercher il lui fera la surprise. Comment est-elle Camille ? Est-elle aussi jolie que sa voix ?
Laurence
Récits sur le thème du "trésor enfoui"
Une bouffée d’enfance me submergea lorsqu’entrant dans le grenier, je découvris un morceau d’étoffe soyeuse dépassant d’une malle. Celle-ci contenait les effets personnels de ma grand-mère Andréa, décédée depuis longtemps. J’extirpai précautionneusement l’ample peignoir de soie, bleu clair à pois noirs. Il avait gardé le lustre d’antan. Je le dépliai lentement et le caressai rêveusement. Il était un peu de mon âme d’enfant. Chaque fois je l’endossais face au miroir de l’armoire, dans la salle de bain de la maison de ma grand-mère, la magie s’installait. Je m’incarnais aussitôt dans des personnages que j’admirais au point de susciter des vocations inaccessibles à ma condition de petite fille de milieu modeste. Jusqu’au jour où ce jeu cessa brutalement. Nous arrivons dans la 4L un peu déglinguée de ma mère. Nous nous garons à Caudéran, dans ce quartier huppé de Bordeaux, traversons la teinturerie encombrée par des alignements de vêtements suspendus sur des cintres qui empestent le perchloréthylène et débouchons dans l’appartement de ma mamie. Ma grand-mère gère d’une main de fer un dépôt de teinturerie sur les boulevards. J’entends souvent qu’elle bataille avec les différents teinturiers et blanchisseurs qui travaillent pour elle. Après les embrassades, je file par l’escalier, entre dans la salle bains, entrouvre le battant de la garde-robe en acajou massif qui grince comme chaque fois. Le luxueux déshabillé de soie est là. Je le décroche du cintre sur lequel il repose, inanimé. Je m’en drape le corps ; Je deviens aussitôt « Maria Callas » en personne. Je me mets à chanter très aigu. Je ferme les yeux et revois le visage sublimement maquillé de la grande diva. J’ose des effets de manches, des mimiques expressives et dramatiques face au miroir. Je virevolte et décuple la puissance de mes arpèges. Soudain par la porte restée entrebâillée, me parvient la voix de mon aïeule : « Tu verras le diable ! ». Et quelques instants plus tard : « C’est l’heure ; il faut partir ». Je reprends contact brutalement avec la réalité. Ma grand-mère me fascinait. Elle se faisait appeler Andréa ; Elle trouvait cela plus chic que son véritable prénom, Andrée. Son visage soigneusement poudré était encadré par des cheveux blancs aux reflets bleutés, savamment mis en plis chaque semaine par son coiffeur. Elle portait des habits confortables, bien coupés, de marques prestigieuses. Son loden en poils de chameaux si doux m’émerveillait. Moi, qui étais souvent habillée avec des tenues, données par la voisine. Une autre fois, je monte l’étroit et sombre escalier qui mène à la salle d’eau. Je revois la pièce claire où trône la baignoire énorme, trapue, avec ses pattes de lion dorées. J’entends à nouveau le grincement du battant de l’armoire où je prends le fameux peignoir à pois noirs et instantanément je suis transformée. Je suis Alice Sapritch, la grande tragédienne. Je sens même son bandeau emplumé enserrer mes cheveux. Je déclame des tirades enflammées en resserrant mes mains pudiquement sur le décolleté du vêtement soyeux. Mon visage grimace de la douleur d’un amour interdit lorsque résonne la maudite phrase rituelle : « Tu verras le diable ! ». Me voilà abruptement revenue dans la banalité de ma vie. Je suis une petite fille sage, un peu boulotte. Un visage quelconque, adouci par de longs cheveux châtain clair, je porte des lunettes à monture d’écaille qui renforce le sérieux avec lequel je mène ma vie d’écolière. Souvent perdue dans mes rêves, je m’évade comme je peux d’une vie trop étroite. Les seules fenêtres vers d’autres mondes sont la télévision, les livres et les rêves. Lors d’une autre visite, après avoir gravi en courant les marches, je me précipite vers la penderie qui couine bien sûr comme toujours. Le vêtement enchanté est à sa place. Je le décroche avec hâte de son porte manteau. Je le revêts avec gourmandise. Cette fois-là, je me sens pousser des ailes. Je pivote sur la pointe des pieds, les bras en couronne, aussi légère qu’une ballerine. Arabesque, pas de bourrée, je danse libérée de mon corps un peu pataud. Je salue mon public sous les bravos d’un public émerveillé par ma prestation. Les hourrahs fusent lorsque retentit la phrase fatidique : « Tu verras le diable ! Allez ! dépêche-toi ; Il est temps de dire au revoir ». Tout en me hâtant de remettre tout en place, je reprends pied, à regret, dans la vie ordinaire. Je me souviens trop bien de l’ultime et dramatique séance. Je monte les degrés de l’escalier. Un orage tonne au loin mais se rapproche. J’entends avec appréhension les coups de tonnerre qui claquent juste après les zébrures qui illuminent le petit boudoir sombre à cause du lourd ciel d’encre et d’ardoise. Le gémissement habituel de l’armoire prend une tonalité particulièrement lugubre. Je me saisis de l’envoûtant peignoir et m’apprête à l’endosser pour me rêver en une autre, lorsqu’un flash fulgurant enflamme mon reflet dans le miroir. J’entrevois mon visage qui se craquelle en mille fines ridules. Mes cheveux dressés autour ont blanchi dans la lueur aveuglante. Quelle horreur ! Je suis une vieille femme, une espèce de sorcière ! Mon cœur bat à se rompre... Je reste longtemps immobile à écouter la tourmente qui déjà s’apaise et la pluie battante qui martèle le toit. Ai-je vraiment vu cette créature hideuse qui me ressemblait tant ? Cette apparition est-elle un avertissement ? Je n’ai pas le souvenir, cette fois-là, d’avoir entendu la voix des adultes criant la phrase habituelle : « Tu verras le diable », mais néanmoins elle a résonné dans ma tête. J’ai vraiment vu LE DIABLE cette après-midi-là !
Anne
« Quand nous avons de grands trésors sous les yeux, nous ne nous en apercevons jamais. Et sais-tu pourquoi ? parce que les hommes ne croient pas aux trésors » Paolo Coelho L’Alchimiste La solution est là ! C’est ce que se dit Alice en rentrant de l’aéroport. Pierre, son enfant tant chéri s’était envolé pour l’Australie où Gérard, son père, lui avait trouvé un poste dans une agence de son laboratoire pharmaceutique. Son mari, qui d’ordinaire approuvait la plupart de ses projets, s’était opposé à ce qu’elle organise rapidement un séjour au pays des Kangourous. Ce refus avait fait naître en Alice un sentiment jamais éprouvé. Cette femme si mesurée qui contrôlait la moindre de ses émotions, était habitée d’une irrépressible rage. Devant le pavillon en meulières de sa banlieue chic, Alice eut une révélation, la solution était là dans cette cage dorée dont elle avait elle-même érigé les barreaux. Assise sur le banc du porche de l’entrée, perturbée par les sentiments qui l’agitaient, Alice décida de se donner un peu de temps avant de reprendre la posture que chacun lui connaissait. En effet, cette femme pensait que son physique était d’une grande banalité, une espèce de base neutre qu’il fallait bonifier. C’est pourquoi, elle veillait à ce que son maquillage soit discret mais efficace, œuvrait quotidiennement pour que sa silhouette se maintienne, choisissait avec soin ses vêtements, afin de rester élégante au golf comme au cocktail. Son entourage s’accordait pour lui concéder une prestance discrète qui lui valait l’approbation systématique des épouses et une certaine invisibilité au regard des hommes. Au début de son mariage, Alice avait parfois manqué d’assurance devant son statut d’épouse de cadre supérieur. D’origine modeste, alors qu’elle n’était qu’une simple vendeuse en confection aux Galeries Lafayette, une collègue l’avait entrainée au concert du Gala de fin d’année de l’école Centrale. C’est là que son chemin avait croisé celui de Gérard. Quand ? Comment ? et pourquoi ? l’avait-il remarquée elle n’en savait toujours rien. Mais flattée par le regard admiratif que lui portait ses parents et ses collègues, depuis la demande en mariage de ce jeune homme à l’avenir prometteur, elle avait rapidement accepté de l’épouser. De ces cinq années aux galeries, elle avait gardé le goût de la décoration ainsi qu’un certain sens de l’observation de ses congénères. Méthodique et volontaire, Alice s’était construit un emploi du temps assez efficace qui ne laissait que peu de place aux imprévus. Seules les maladies infantiles et les grèves des enseignants de son fils unique avaient parfois perturbé une routine dédiée à l’accomplissement des missions qu’elle s’était fixée. Elle était ainsi passée, sans trop de difficulté, de la petite vendeuse à la femme d’intérieur accomplie et irréprochable. Pourtant, aujourd’hui, elle se sentait totalement perdue et démunie, son enfant parti que lui restait-il ? Une maison dont l’essentiel de la décoration avait été élaborée à partir des « trouvailles » que son mari lui offrait au retour de ses voyages professionnels. « Alice, ma chérie que fais-tu assise là ? Tu ne te sens pas bien ? », l’interpella Gérard depuis la fenêtre de son bureau. Il l’observait depuis quelques minutes, intrigué presque inquiet par l’expression tendue de son visage. Alice était sa plus belle « trouvaille ». Fils unique d’un couple d’antiquaires brocanteurs, Gérard était un chineur expérimenté, son père disait à qui voulait l’entendre que son fils avait un don, qu’il avait « l’œil ». En effet dès son plus jeune âge, Gérard avait été capable de repérer une pièce rare au milieu du bric-à-brac des greniers et des caves qu’il visitait avec ses parents. C’est donc tout naturellement, qu’il avait remarqué Alice, au milieu de la foule de cette soirée de fin d’études. Son instinct lui avait soufflé que cette jeune fille était la perle rare. Désireux d’échapper à l’esprit bohème de son enfance, Gérard aspirait à une vie familiale qui aurait le parfum rassurant du confort bourgeois. Avec le temps son attachement pour son épouse ne s’était en rien émoussé, au contraire, il s’était teinté d’une sincère admiration. L’énergie déployée par sa femme pour gérer le foyer qu’il retrouvait toujours avec plaisir, ne lui avait en rien échappé. Malgré une vie professionnelle chargée, Gérard continuait à chiner dans les brocantes des villes où le conduisaient ses obligations professionnelles. Au fil des années, il avait ainsi glané de nombreux objets, sa femme les avait agencés avec un certain talent dans toutes les pièces de la maison. « Au cas où », Alice avait même fini par constituer un catalogue de ce qu’elle appelait « leur petit trésor ». Pourtant avec le temps, tous ces voyages avaient fini par lui peser, il envisageait sérieusement d’accepter la proposition d’un poste sédentaire en télétravail, il perdrait des primes mais sa situation était suffisamment confortable pour que cela n’affecte pas leur niveau de vie. Il ne s’était pas encore vraiment décidé, c’est toutefois, pour cette raison qu’il avait refusé le voyage en Australie que lui proposait sa femme. Il avait remarqué qu’Alice avait accusé le coup, elle savait pourtant que leur fils reviendrait plusieurs fois par an aux frais du laboratoire et que l’idée des vingt heures d’avion qu’il leur faudrait subir, lui était pénible. Constatant soudain que son épouse se levait pour rentrer dans la maison, Gérard se remis à l’analyse des bilans qui l’attendaient sur son ordinateur. Assise dans le canapé en cuir du salon, son ordinateur portable sur les genoux, Alice consultait le catalogue de ce qu’elle considérait maintenant comme « SON petit trésor » Elle transféra des photos sur son smartphone, et envoya une demande de rendez-vous sur l’adresse électronique qu’elle avait relevée quelques jours plus tôt. Elle reçut rapidement une réponse lui fixant une entrevue pour le surlendemain. Avec un petit sourire en coin, Alice confirma sa venue en pensant que Gérard serait à Londres et qu’elle n’aurait pas à se justifier. Le surlendemain, Alice pris le train pour la gare Saint Lazare, elle aimait retourner dans ce quartier. Elle s’engagea dans le passage du Havre et s’arrêta devant une petite porte en bois. Entre, le marchand de trains électriques et la petite parfumerie « l’opéra », une plaque en bronze indiquait : Maître RETEMYS Négociant en objet rares et insolites Au fond du couloir à gauche Contact@retemys.com Alice sonna et la porte s’ouvrit immédiatement, elle traversa le couloir et arriva dans une cour particulièrement lumineuse, à sa gauche une petite véranda portait la mention « espace salle d’attente ». Alice s’assit sur l’une des deux chaises scandinaves et s’étonna du style épuré de la pièce, seule dans un coin, posée sur un socle une énorme pomme sculptée dans le marbre attirait le regard du visiteur, sur une ardoise au bas de la colonne on avait écrit « AUTOPORTRAIT ». Intriguée Alice examina la sculpture et s’aperçut avec amusement que les veines du marbre dessinaient les contours de deux yeux, d’un nez et d’une bouche. Plus on fixait la pomme, plus le visage apparaissait nettement, il changeait même d’expression si l’on inclinait légèrement la tête. Plongée dans la contemplation de la pomme en marbre, Alice sursauta à l’arrivée de Maître Retemys. Quand elle le vit, elle se dit que cet homme avait lui aussi un physique « rare et insolite ». Bien que de très petite taille, le tee-shirt moulant qu’il portait sous son blazer en velours bordeaux révélait un physique d’athlète. Son visage imberbe était auréolé d’une crinière blanche et on devinait son regard derrière de petites lunettes rondes aux verres fumés bleus. L’homme s’inclina, la main gauche sur le cœur et lui dit : « Madame, je suis enchanté, si vous voulez bien me suivre » Alice se leva et fût une fois de plus interloquée par la physionomie de son hôte. Il ne devait pas mesurer plus d’un mètre cinquante et semblait sautiller à chacun de ses pas. Elle n’avait jamais croisé pareil personnage et se dit qu’il était grand temps qu’elle change d’horizons. Ils empruntèrent un escalier en colimaçon en haut duquel se trouvait une pièce très spacieuse, aux murs blancs. Ce n’est pas l’absence de tout élément décoratif qui sidéra Alice mais le fait que l’ensemble du mobilier de bureau flottait au-dessus du sol. En effet bien qu’à une hauteur convenable, la simple planche en teck et les deux fauteuils voltaires en damassé bleu, semblaient en apesanteur, dépourvus de pieds. « Installez- vous, je vous en prie », l’invita Maître Retemys en lui désignant l’un des sièges. Devant l’hésitation d’Alice, il poursuivi sur un ton amusé : « N’ayez aucune crainte ceci n’est qu’un effet d’optique, j’ai acheté ce mobilier à un vieux magicien qui prenait sa retraite, c’est un peu déroutant, je l’admets, mais j’aime à me rappeler que la plupart du temps tout n’est qu’affaire de point de vue. » Alice finit par se décider et s’asseyant elle constata avec un certain soulagement que le fauteuil possédait bien des pieds posés sur le damier noir et blanc du carrelage qui couvrait le sol. Rassurée elle déclara : « - Comme je vous l’expliquais dans mon message, je possède un certain nombre d’objets, dont j’aimerais me séparer le plus discrètement possible, ils viennent des quatre coins de la planète et sont donc assez atypiques, j’ai pensé que cela pourrait vous intéresser. -La discrétion est une seconde nature chez moi. Avez-vous un « book » ? pour que je me fasse une idée, lui répondit maître Retemys » Alice lui tendit son téléphone et lui dit : « J’ai pris quelques photos ». De son index parfaitement manucuré, l’homme se mit à faire lentement défiler les clichés enregistrés sur l’appareil. Alice l’observait avec une certaine fascination, le mouvement de cette main lui évoquait les figures d’une patineuse sur glace. Bien qu’il semblât examiner chaque photo avec minutie, le visage de Maître Retemys restait totalement impassible. Alice se dit qu’il devait être un redoutable joueur de poker et que le port de verres fumés n’était pas étranger au fait qu’il s’applique à ne rien laisser voir de ses pensées. Enfin sans lui rendre son appareil, Retemys déclara : « Vous possédez effectivement quelques beaux objets, mais ils ne correspondent pas aux attentes de ma clientèle, vous devriez contacter un de mes confrères antiquaires » Alice ne put cacher sa déception et expliqua dans un soupir : « C’est exactement ce que je veux éviter, mes beaux-parents sont antiquaires, et connaissent la plupart des professionnels de la région, ma démarche ne passera pas inaperçue ». Maître Retemys sembla réfléchir une demi-seconde et se redressant sur son fauteuil il murmura : « Je comprends mais dans ce cas, seriez- vous disposée à vendre celui-là ? » Il tourna alors l’écran du smartphone vers Alice qui vit s’afficher une photo de Gérard en tenue de Golf.
Catherine
La légende du Cacafuego L’antan est une notion vague. Il évoque un passé enfoui sous les plis du temps. Il suscite un regard nostalgique sur ce qui fut et qui désormais nous regarde tous de loin pour nous rappeler que nous sommes tous les héritiers d’un avant. Débordements disparus auxquels nous sommes reliés par un devoir de comprendre et d’aimer non pas seulement ce que les autres furent mais encore ce qu’ils sont devenus. Ce présent tire du passé pour tisser la toile des jours comme une araignée au bout de sa patience. Et c’est en cela que ces photos vieillies entre ses mains tenues, ne sont pas des plongées inertes dans un temps révolu mais désirs qui révèlent sur lui-même le sens de ces profondeurs. Lui, c’est cet homme assis sur sa chaise à bascule, une pipe à la bouche et l’élégance fière, obsédé par la nomination des choses. Aventurier et explorateur acharné, quelque chose en lui de rebelle murmure entre ses lèvres : la recherche inassouvie d’une existence, d’une manière d’être, un art de vivre malgré les arrogances et les ruses du colonialisme, les révoltes des gens sans terre en qui la vie pouvait tenir assise. Pour lui, dans les quelques lignes qui accompagnent les photos jaunies par le temps, le verbe lu doit être prononcé avec solennité et respect. Mais pour cet homme, il y a dans ces photos quelque chose d’insondable qui se veut une idée folle, une posture de conquête. L’idée d’un énième combat que nul ne peut acheter à sa place : le poids d’un destin assumé. C’est tout ce que ces photos lui révèlent par-delà ce qui est figé, fixé, suspendu parfois par des tragédies. Cette sorte d’en dessous qui soutient le désir, cette sorte de minerai qui tient jusqu’à l’envie. Ces photos, il les regardent longuement, avec gourmandise, comme des masques qui traversent des murs pour lui apporter la force et l’évidence même d’un autre parcours, d’une nouvelle épopée à venir. Il les regarde à la manière d’un miroir dans lequel se reflètent les empreintes d’un autre temps. Lui, c’est Thomas J. Beale, découvreur à sa manière des contrées lointaines, des mers et des ports où les voiles se dressent vers le grand large, où les sons évoquent des arrivées et des départs, où les lentes aiguilles du temps cousent une à une et la brise et la patience des pêcheurs. D’aujourd’hui à hier, ces lots de fleur de lumière ont toujours bercé sa vie, immersions de la terre à la mer dans cet archipel des Caraïbes, parfumé, riche de fruits et de fleurs. Par le passé, il y a de nombreuses fois découvert les douceurs des épices, du sucre, du café, des saveurs tropicales et tout ce que les îles des Caraïbes suscitèrent de convoitises pour ces conquistadores espagnols qui ne juraient que par l'attrait des filons d'or. Cet immense archipel qui inventa le mythe de Robinson Crusoé. Ces fructueux métissages qui donnèrent naissance à une culture authentique, mêlant le génie africain à la beauté des anses et des jardins créoles. Aujourd'hui, cinq siècles après les premiers découvreurs, il savoure les charmes de l'art de vivre caraïbe qui ont conquis bien avant lui d’autres aventuriers par-delà les heurts d'une histoire coloniale mouvementée. C’est dans ces coulées de sable blanc, où bouillonnent les blocs de pierres comme empilés, à la fois torturés et apaisants dans lesquelles Thomas J. Beale aime à retourner. Ici, les lagons bleus, calmes et tranquilles, incitent à la rêverie pareille au ruissellement des cascades qui s’enivrent de rayons de soleil entre les branches torturées d’arbres séculaires et une végétation dense et exotique. Mais pour cet homme, ce décor n’est point un décor ! C’est pour lui une sorte d’intimité volée et violée par son regard d’explorateur. Il y a dans cette vision des choses l’emprise d’une suggestion, presque d’un commandement, auquel il se laisse volontiers emprisonner, sans doute par impatience. Ses mains délaissent un moment les photos pour glisser lentement sur la couverture d’un livre ouvert sur ses jambes. Ce livre, il l’a maintes fois parcouru dans la distance et toujours avec la même gourmandise, s’invitant à chaque page pour mieux s’imprégner d’une nouvelle aventure. Son regard se pose encore une fois sur les photos de cette île de Cuba. Il s’enivre de ces nombreux récits émaillés de légendes qui rapportent l’histoire de ces navires qui y ont fait naufrage. Chaque fois, avec la même impatience fièvreuse, son attention se porte sur celle du « Cacafuego », héritée de cette époque où des flottes entières chargées de trésors traversaient les mers entre l’Espagne et l’Amérique. La légende dit que son périple se serait terminé en plein cœur d’un ouragan où d’immenses vagues auraient aspiré ce bateau dans les profondeurs marines de la baie de San Ensenada. Personne à ce jour n’est parvenu à récupérer cette cargaison perdue qui sommeille toujours au fond de l’océan et dont l’emplacement exact reste encore énigmatique. À la lecture de ce récit, maintes fois parcouru, se précise en lui un désir profond d’une nouvelle quête qui le tressaille comme la cicatrice d’une possible découverte. Cette légende du « Cacafuego », celle du naufrage d’un galion espagnol et d’un trésor enfoui sur cette île, le persécute. Il lui faut recoudre le déchiré de cette mémoire jusqu’à l’extase. Après un long voyage, Thomas J. Beale débarque un jour de juin sur le quai du vieux port de La Havane. La cité havanaise s’offre à lui avec ses vestiges bigarrés, témoins privilégiés des fastes des époques coloniales et les occupations militaires. Il décide de s’installer dans un de ces hôtels situé dans l’une des plus belles avenues : le Malecón. L’hôtel est entouré de palmiers et des plus admirables fleurs tropicales. Comme beaucoup de demeures coloniales sur l’île, celle-ci est décorée de dentelles de bois, et de très hauts plafonds. Un style original alliant son imposante apparence à la fantaisie de l’exotisme. Témoignage du passé, l’hôtel, peint de couleurs chaudes délavées par le temps, est enjolivé de corniches, de colonnes et de fières balustrades. Aux murs de l’imposant escalier d’entrée sont suspendues les photos d’habitations coloniales ayant appartenues aux riches armateurs venus d’Europe. Depuis le balcon de la chambre, la vue s’ouvre sur le port. Les arbres majestueux du jardin veillent sur cette vieille demeure datant de l’aube du siècle dernier. Pour Thomas J. Beale, La Havane a de la profondeur et du caractère, on ne l'apprivoise pas du jour au lendemain, elle est mystérieuse jusque dans ses ultimes retranchements et elle est passée maître dans l'art de la séduction. Ville complexe, lieu d’insouciance et de douleur, de nostalgie et d’utopie, de renaissance et de perdition, La Havane n'est pas une ville tropicale ordinaire, une de ces villes qui vous donnent l'impression de regarder une carte postale en deux dimensions. Cette ville au destin tumultueux, lié à celui de l’Europe, de l’Afrique et de l’Amérique n’a jamais cessé d’inspirer les voyageurs et les artistes. Aujourd’hui encore, de jolies fontaines en marbre blanc de Carrare rappellent les siècles fastes de beaux palais. Même les rues les plus pauvres de La Havane conservent une certaine dignité, faites de cabanes fabriquées avec de vieux bidons à essence aux toits recouverts de ferraille empruntée au cimetière de voitures abandonnées. Le quartier du Vedado, où se dressent encore des baraques en bois, est le témoin de cette époque où les habitants, majoritairement des esclaves, des cimarrones, travaillaient à l’extraction du bois destiné à la construction des beaux quartiers. Il pleut rarement durant la journée sous les tropiques où les saisons varient à peine. Thomas J. Beale profite de ses premières journées pour découvrir, à bord d’une vieille américaine, les splendides édifices architecturaux de style néoclassique ou art déco. Un jour, en arpentant une ruelle, il s’attarde devant une maison où, pense-t-il, on aime lire et écrire, car par les carreaux, il peut apercevoir du papier et des crayons traînant ça et là… quant aux livres, ils envahissent l’espace, s’empilent partout sur des étagères arrivant au plafond. Tout semble avoir été précieusement conservé : des maquettes, des carnets, des lettres, des manuscrits d’explorateurs et leurs mémoires aussi. Il se décide à entrer. Ici les objets extraits de vieux navires rivalisent d’originalité, là des livres en pagaille s’amoncèlent dans un désordre apparent. Le propriétaire des lieux arbore une longue barbe et un visage creusé par le temps, il semble naviguer à sa manière dans un flot de vieilleries toutes aussi hétéroclites que surprenantes. Le personnage est intriguant. Rapidement, une conversation s’installe entre eux autour du récit de cette fameuse légende. Thomas J. Beale se laisse rapidement séduire par sa connaissance de l’île et les récits qui jalonnent son histoire. « Savez-vous étranger, que j’ai là beaucoup de livres qui relatent des faits d’histoire datant de l’époque de l’invasion de l’île par les troupes espagnoles. J’ai moi-même un livre précieux qui relate cette histoire de la légende du « Cacafuego », un galion espagnol qui a fait naufrage au sud de l’île dans un lieu maudit. Attendez, je crois que je l’ai rangé sur cette étagère. » Le vieil homme se saisit d’une échelle en bois et se hisse à hauteur des plus hautes étagères. Il extrait soigneusement le livre et souffle énergiquement sur sa couverture pour la débarrasser de la poussière qui s’y était déposée avec le temps. Puis, il le frotte avec la manche de son veston et feuillette les premières pages avec beaucoup de précaution comme on le ferait d’une précieuse relique. Se retournant vers notre explorateur, il ajoute : « Le voici, je le tiens moi-même d’un vieil armateur, il a été écrit par un auteur chilien Luis Sepúlveda dans lequel il retranscrit l'histoire d'un marin, le Capitaine Jörg Nilssen. En réalité, ce récit serait inspiré de l’histoire d’un des galions espagnols le « Calueche de la Concepcion » qui aurait sombré en 1715 avec trois autres navires emportant avec lui sa précieuse cargaison. C’est d’ailleurs à cet écrivain que l’on doit le surnom de Cacafuego à ce navire. » Thomas J. Beale écoute avec un vif intérêt le vieil homme, puis à son tour, il feuillette l’ouvrage, y découvre quelques gravures et des cartes. Son attention est attirée par ces quelques lignes : « … Le principe est le suivant : tout appartient à tous ; mais ce sont les officiers qui détiennent le pouvoir de décision et de distribution. Ainsi, si la nourriture est commune, les honneurs restent le privilège des officiers ce qui signifie aussi qu’il n’est pas possible de s’approprier quoi que ce soit sans leur accord... ». Thomas J. Beale découvre fiévreusement le reste du livre puis, relevant la tête, il interroge le vieil homme. - Vous me semblez bien connaître cette histoire. Qu’avez-vous appris de ce fameux navire ? - Je vois que cela vous intrigue, mais je comprends votre curiosité. La légende du « Cacafuego » serait celle d’un vaisseau fantôme, croisant la nuit, dans les eaux entourant l’île de Cuba. Elle raconte que sa cargaison précieuse chargée d’objets et de pierreries en argent et en or seraient encore cachée au fond d’une des criques de la baie de San Ensenada. Pour certains, cette légende prétend que ce trésor serait enfoui dans les méandres d’une grotte sous-marine, pour d’autres qu’une partie de ce trésor serait encore cachée sur l’île de la Juventud par les premiers habitants de cette île, les indiens siboneyes. Qui dit vrai ? On ne le saura sans doute jamais. Tenez, je possède moi-même quelques-unes de ces pépites d’or rejetées par la mer. Regardez… À la vue de ces pierreries, Thomas J. Beale paraît troublé. Le vieil homme dit-il la vérité ou s’aventure-t-il dans une histoire dont lui seul a le secret ? Ces pépites serait-elles celles du « Cacafuego » ? Il n’en faut pas davantage pour que notre visiteur se mette en quête d’ajouter son nom à la liste déjà longue des explorateurs. - Sauriez-vous m’aider dans mes recherches ? C’est pour cela que je suis ici et que j’ai fait ce long voyage : découvrir ce trésor enfoui. - Vous voilà bien prétentieux mon ami pour vouloir relever un tel défi. Des récits circulent aux quatre coins de l’île de Cuba voulant que tous ceux qui s’y aventurent n’en reviennent jamais et que leur dépouille reste à jamais engloutie par les eaux des Caraïbes. Mais puisque vous y tenez, il vous faudra d’abord rejoindre la ville de Batanabó, et de là-bas vous pourrez vous embarquer pour faire la traversée, si un pêcheur est assez fou pour vous y emmener. Avant que Thomas J. Beale ne prenne congé du vieil homme, ce dernier lui lance comme un avertissement : « N’oubliez pas, je vous aurai mis en garde, mon ami, vous êtes encore trop jeune pour rejoindre le monde des morts ! » En quittant la capitale pour les routes du sud qui le mèneront à Batabanó, Thomas J. Beale garde le sentiment de ne pas avoir encore percé tous les mystères de cette île. À Batabanó, les marchés sur le port résonnent de bruits et de cris qui proposent cigares, corail noir, statuettes et bibelots divers. Au milieu de l’agitation, le regard de Thomas J. Beale est attiré par la silhouette d’un pêcheur affairé à préparer son embarcation. « Bonjour, vous allez là un beau bateau, s’exclame Thomas J. Beale en apostrophant le pêcheur. » Le pêcheur surpris se retourne et dévisage un long moment notre explorateur avant de s’exclamer : - Vous n’êtes pas d’ici ! - En effet, je suis américain, je viens d’arriver. Cela se voit tant que cela ? - Un peu oui. Et que venez-vous faire ici, lui demande le pêcheur d’un ton inquisiteur. - Je suis explorateur et je souhaite me rendre sur l’île de la Juventud. Je suis à la recherche du trésor du Cacafuego. » Le pêcheur le toise de haut en bas et laisse échapper un rire rocailleux ne tardant pas à lui faire comprendre qu’une telle entreprise pourrait faire resurgir de vieux démons. - Encore un de ces touristes en quête d’aventure qui croit trouver l’introuvable. Savez-vous que certaines nuits, les lueurs du vaisseau fantôme hantent toujours les eaux de cette partie de l’île. Mais, personne ne l’a jamais aperçu et son immense trésor resterait maléfique à qui voudrait le découvrir. - C’est ce que l’on m’a dit, mais je suis prêt à tenter l’aventure. - Et vous pensez arriver là où beaucoup d’autres ont échoué et n’en sont jamais revenu ? lui répond le pêcheur en riant aux éclats. - Je ne le pense pas, j’en suis sûr, rétorque Thomas J. Beale d’un ton assuré, avant d’ajouter : Accepteriez-vous de me transporter jusque dans la baie de San Ensenada ? Je suis prêt à vous payer grassement. - Si vous êtes si riche que cela, alors pourquoi prendre tant de risque pour chercher ce qui n’existe pas ? Mais bon, c’est vous qui décidez. Revenez ici même demain, si vous êtes assez fou pour tenter l’aventure, je vous y emmènerai. Mais, je crois bien que ce sera la dernière fois que nous nous reverrons ! Le jour se lève à peine, dévoilant avec majesté les eaux turquoise du port. Thomas J. Beale n’aurait pour rien voulu manquer ce rendez-vous. Depuis l’aube, il est posté à l’endroit de la veille cherchant du regard le pêcheur affairé à préparer son accastillage. Les deux hommes embarquent pour rejoindre la pointe extrême de l’île bravant la houle de cette partie du golfe du Mexique. Après une longue traversée, Thomas J. Beale pose enfin le pied sur l’île de la Juventud, ou plus exactement à Nueva Gerona souvent appelée la « capitale de l’île au trésor ». C’est un véritable voyage à travers le temps qui l’attend, un de ces voyages qui transporte les âmes curieuses vers un lieu où le passé réside fièrement dans le présent. Christophe Colomb l’avait nommé « La Evangelista » en 1494 lors de son second voyage aux Amériques. Nueva Gerona s’étend lascivement au soleil face à la baie de Batanó avec ses ruelles pittoresques, ses bâtiments colorés et son atmosphère empreinte de nostalgie. Chaque pavé et chaque regard semblent raconter une histoire. La ville déborde de mystères et de charmes, elle promet une aventure où l’histoire des pirates et des révolutionnaires se mêle à la vie quotidienne des habitants, créant ainsi un mélange vivant de récits et de cultures. Ce petit bout de territoire cubain fut longtemps appelé « l’île prison », car il a hébergé très longtemps l’un des pénitenciers les plus inhumains de la planète : « El Presidio Modelo » où furent détenus de nombreux révolutionnaires. Son histoire révèle les récits bouleversants des captifs qui y étaient enfermés et témoigne du passé tourmenté de Cuba. Aujourd’hui abandonné, cet édifice, autant gigantesque que lugubre, contraste avec le spectacle merveilleux des lacs qui l’entourent aux teintes variées et énigmatiques d’une beauté naturelle saisissante. Nueva Gerona semble avoir été oubliée par l’histoire tout comme les quelques peintures témoins de l’existence passée des indiens siboneyes qui occupèrent cette île les premiers. C’est dans le petit village de Punta Sucia, situé au sud de Nueva Gerona et face à la baie de San Ensenada, que Thomas J. Beale décide de s’installer. La côte, bordée par ses nombreuses mangroves, s’offre aux visiteurs de passage, étalant généreusement son sable fin à la blancheur exceptionnelle ou la beauté et la richesse de ses fonds marins. Ici, grottes immergées et tunnels marins rivalisent de mystères aux abords de parois abruptes et de barrières de corail dans lesquels les lamantins et les tortues à écailles aiment à se cacher. Dans ce décor de rêve, les lieux sont peuplés d'une multitude d’espèces d’oiseaux et de mammifères : colibris, iguanes, chauve-souris et autres tortues. Les anciens des villages leur prêtent des pouvoirs étranges. Ce sera là son camp de base à l’ombre des palmiers face à la baie, lieu supposé du naufrage de ce galion dont les eaux abriteraient encore son fantôme et le fameux trésor. Entre deux explorations des excavations sous-marines, Thomas J. Beale décide de découvrir une région plus sauvage à l’écart de la baie dans la partie occidentale de l’île. Ce lieu possède une histoire fascinante, il a été le refuge pour les premiers habitants des îles de Cuba, les indiens siboneyes, et témoin des visites de célèbres corsaires. Nombre de ces lieux font référence à ces époques où des pirates venaient mouiller dans les criques pour s’approvisionner en eau et en fruits, ou mettre leurs précieuses cargaisons à l’abri des cyclones. Thomas J. Beale aime à mettre en scène, lors de ses voyages, toutes les formes de paysage entre emprise d’une suggestion de douleurs vibrantes et de malheurs surgies de nombreuses persécutions et la lumière qui jaillit par des trouées dont l’éclair fait briller cette mémoire dans la distance qui le sépare de ces temps anciens. Le sabre de l’immensité turquoise lui semble parfois adoucir les cicatrices laissées là par le temps. À flanc de montagne, le roulis d’une lave végétale se déroule en sculptures de feuilles d’arbres, en balancement de branches en voltige. Ces intensités végétales s’opposent brutalement dans un tourbillon de pente massive, fière et hautaine face au lacis lumineux de la baie. Son regard se range au défi d’une découverte en attendant celle de la victoire. Derrière lui, sans aucune forme de mouvement, un homme se tient là, raidi dans son costume et sous une coiffe d’apparat. Un instant surpris, Thomas J. Beale prend conscience qu’il est face à l’un de ces indiens descendants siboneyes. Sa venue ne semble pas effrayer l’indien dont le regard laisse deviner une sociabilité douce évoquant un paradis perdu. Paré de coquillages en guise de pendentif, il semble surgir de la nuit des temps que le calme rustique des lieux apaise dans un jour serein et limpide. Issu des racines amérindiennes, l’indien présente un visage crevassé qui enveloppe un regard lumineux malgré son âge. Durant un long moment, chacun dévisage l’autre avec la même curiosité. L’indien, fait plusieurs fois le tour de notre explorateur qui se hasarde alors à engager la conversation. « Je suis américain. » L’indien semble ne pas comprendre et pour toute réponse adopte un long silence. Puis, il l’invite à entrer dans sa hutte et lui fait découvrir quelques ornements sacrés, culture héritée de ses ancêtres. Ce sont deux mondes qui se sont découverts et qui se sont affrontés, pense alors Thomas J. Beale. « Je suis américain, et je suis à la recherche d’un trésor qui appartenait à un navire espagnol qui a sombré dans la baie il y a très longtemps de cela. » À cette évocation, l’indien semble effrayé et devient nerveux. Il s’agite puis saisit un masque, le porte à son visage et prononce des incantations. Dans un mouvement brusque, l’indien lui demande de le suivre jusqu’à une grotte au fond de laquelle subsistent encore quelques ossements d’un squelette. De part et d’autre sont disposés des coquillages. Leur disposition au sol semble indiquer une direction. Thomas J. Beale n’ignore pas que les espagnols ne connaissaient pas les canaux qui irriguaient cette île à l’époque. Ils étaient peut-être terrorisés par les descriptions des monstres et des créatures de cauchemar qui étaient supposer habiter les lieux. Seuls les indiens siboneyes occupaient cette partie de la petite île de Cuba à l’écart de toute autre civilisation. Notre explorateur se souvient que le vieil homme lui avait dit qu’il existe, pour ces descendants des premiers habitants, des centaines de légendes qui racontent que les navigateurs jetaient l’ancre dans la baie pour y vider les cales de leurs précieuses cargaisons avant de les cacher dans des parties hostiles de l’île à l’abri de tout inquisiteur. Peut-être est-ce à l’un de ces lointains ancêtres que l’on doit le récit selon lequel aurait été aperçu une nuit un bateau dans le brouillard épais de la baie, les voiles en lambeaux, à l’approche d’une violente tempête. Thomas J. Beale imagine cette longue silhouette marine naviguant lourdement, cherchant vainement à retrouver la liberté en pleine mer. En pareille circonstance, le capitaine du navire aurait fait tirer le canon en quittant la baie, sa flottille se serait alors perdue dans les brumes qui montaient de la mer des Caraïbes. Les membres d’équipage auraient montré les premiers signes de panique. Et puis, la nuit s’avançant, elle fut sans doute crevée d’un bruit sourd, inattendu, inquiétant, un bruit qui roula jusque dans les entrailles de la mer. Ce bruit de fin des temps. Thomas J. Beale croit le ressentir encore sous ses pieds. Celui là-même du plancher du pont qui trembla, une odeur caustique monter puis des explosions se répéter en s’intensifiant telle une canonnade. Le bateau venait de sursauter sans doute, et des cris fusaient de partout à mesure que l’obscurité envahissait le bateau et l’espace. Et ce fut le chaos. Le temps s’était alors arrêté. Les matelots se faisant happer par un grand souffle de vent et plus jamais on ne devait les revoir. Disparus. Comme évaporés dans cette mer aussi sombre. Sans doute était-cela que les ancêtres de cet indien avaient vu ! Personne ne sait si le « Cacafuego » a pu mettre fin à cette malédiction et tirer ces pauvres diables hors de leur enfermement. Mais la légende assure que des matelots auraient vidé leurs cales de leur précieux chargement et seraient revenus à bord toujours à la recherche de la liberté en pleine mer. Peut-être que le « Cacafuego » est le « Calueche ». Thomas J. Beale se décide à poursuivre dans la direction indiquée par ces coquillages laissés sans doute là par un de ces malheureux matelots. Dans un long tremblement, il entend l’indien hurler en s’enfuyant loin de ce que le récit désigne comme « la piste de l’abîme ! ». À cet instant, le cri des oiseaux qui les survolaient lui fait relever la tête. Des oiseaux de toutes les espèces et de toutes les tailles. Mais ceux-là avaient brusquement fait irruption dans le décor, effrayants par leurs robes écarlates et leurs cris qui rappellent celui de messagers lugubres. Ils tournoient dans le ciel à la manière des vautours ayant repéré une proie. Ce fut, pour un court instant, un contraste saisissant avec la quiétude des lieux. Les jours, les mois passent. Thomas J. Beale consigne méticuleusement, dans son carnet de voyage chaque étape de ses recherches. Aucun lieu n’échappe à ses descriptions, il cartographie, mesure, dessine, rédige. Pas un instant, son esprit ne se libère de cette quête. Cent fois repassant par les mêmes chemins. Chevauchant les racines gigantesques des palétuviers qui peuplent ce lieu captivant et terrifiant à la fois tandis que l’océan s’étend au-delà du champ de lumière qui rayonne sur la baie et s’orne parfois d’un long fil d’argent que beaucoup de ces indiens suspectent être le passage rapide de monstres marins. Au bout de l’obscurité, apparait parfois une nappe brillante tel un million d’étoiles qui scintillent ! Voilà maintenant des mois que Thomas J. Beale n’a plus revu la silhouette de l’indien se dresser hors des fougères tropicales et autres plantes recouvrant l’épais manteau de végétation. Il est gagné par la conviction qu’il ne le reverra jamais plus. Pour lui, il y a des nuits tendres, douces où se mêler pour se mesurer sans fin à la rondeur de l’extase d’une conquête, en être l’unique héritier et l’unique gardien. Goûter jusqu’au secret et se blottir dans sa propre mémoire, et pourtant parvenir au bout du plaisir jusqu’à se perdre, et se laisser surprendre parfois au risque d’être soi-même englouti. Des côtes brumeuses des Amériques aux rivages ensoleillés des Caraïbes, chaque histoire est unique, mais toutes font allusion à de précieux trésors qui attendent que le chanceux ou le sage les découvre. L'idée même qu'une partie de ce trésor puisse être toujours dissimulée quelque part, attendant d'être découverte, continue d’enflammer son imaginaire. Mais, pour lui, plus que le trésor lui-même, c'est la passion, l'anticipation et l'aventure pure et simple qui le dominent. La quête de l’héritage de ce trésor n’est pas seulement une question d'or, de bijoux ou de richesses, pour Thomas J. Beale il s'agit de faire partie d'une énigme historique, d'une histoire qui s'étend sur plusieurs siècles et de l'indescriptible frisson de la chasse. L'espoir est l'essence même de sa quête. Pour Thomas J. Beale le temps est précieux. Son esprit est parfois hors d’atteinte de certaines émotions, comme si, dépendant du moment, certaines fonctions étaient chloroformées devant des impressions perçues comme dissonantes, un peu à la manière dont on se protège des effets sonores ou des effets d’ondes. Il s’était longtemps refusé ce voyage avant de laisser le désir se creuser, le menant sans calcul, sur les chemins de l’île aux écueils façonnés par l’oubli, effleurée de chiens maraudeurs et de chats blancs migrateurs d’un îlot à l’autre. Ce désir avait accouché d’autres formes, se réclamait d’autres forces, d’autres ressources insaisissables, s’incrustant dans l’absence puis dans l’envie. Pourquoi les choses se font-elles si facilement par moments comme la rivière qui suit l’inclinaison naturelle de la pente, alors que d’autres fois, tout devient si difficile. Il lui semble que le chemin est balisé d’événements étranges qui défient la logique et le raisonnement et qui ne paraissent justifier leur existence, que pour attester des attributs idiosyncratiques en réaction à ces événements. Soudain, arpentant plus que nécessaire certains lieux, ce qui lui paraît être l’indicible trésor se révèle enfin à lui. Comment comprendre qu’il soit passé si souvent à cet endroit sans jamais y trouver la moindre parcelle d’indices ? Il y trouve enfin l’énergie nécessaire pour cogner au même endroit, hier infranchissable, et trouver une fissure, jusque-là invisible. Pourquoi ne put-il pas la voir avant ? Y avait-il dans son esprit, quelque chose d’équivalent aux intermittences du cœur, pour expliquer les absences de lucidité et de clairvoyance dans le processus de ses recherches ? Il était là face à lui, enfin, somptueux, admirable, presque insolent de beauté, comme un gisant, piégé par les années et la haute et luxuriante végétation qui l’avaient conservé. Thomas J. Beale se défait de ses vêtements trop lourds et entreprend de l’extraire de son antre, mais le coffre trop chargé lui tire maintenant sur les épaules. Il lui faut se défaire de tout cela. Trouver un endroit idéal, à l’écart de tout passage, où cacher ce trésor après en avoir extrait autant de pépites que pouvait contenir son sac. Il reviendra, plus-tard rechercher le reste du précieux butin. Machinalement, il sort de sa poche son carnet de voyage. Il a l’idée de consigner sur un feuillet l’endroit exact du lieu de sa découverte en dissimulant les coordonnées dans un message énigmatique composé d’une succession de nombres empruntés à des pages du roman qui ne l’avait jamais quitté. Personne, à part lui, ne serait en mesure de retrouver l’endroit exact. Du moins le pense-t-il. Assis sur un bloc de pierre, il scrute l’horizon s’assurant que personne ne puisse le surprendre. L’arrondi de pierre, les aplats de roches, le vertical des arbres restent en suspens accrochés par son regard. Ces nombres ininterrompus, énigmatiques, recouvrent maintenant la page de son carnet dans une succession ordonnée comme autant de codes insondables. Le trésor venait d’être enfoui une deuxième fois. Le corps tendu vers un furtif éclat de mystère effleuré, ses yeux le portent instinctivement vers les collines alentour, guettant une dernière fois la présence de silhouettes furtives. Puis, il reprend sa marche, soulagé du précieux fardeau. En écartant les branches, en appuyant sa main sur les lourdes racines des palétuviers, il s’applique à réduire les battements sourds de son cœur qui semble chercher, haleine sifflante, une fin de course. Tout s’arrête brusquement, il entend son sang s’éloigner, se blottir comme un bruit d’enfance. Recroquevillé, fripé, il gémit à hauteur de sa poitrine, parcouru d’un tremblement d’oiseau sous son gilet sombre. Son visage d’enfant le regarde avec un sourire aux lèvres, une bouche épargnée des rides qui viennent de se replier, amassées sur ses joues presque maigres. Elles forment là un réseau impénétrable de lignes creuses, se chevauchant, se croisant, se recoupant, se nouant autour de trois grandes taches brunes, lisses et veloutées. Moins dense, le front porte également de longues et fines parallèles sous un foisonnement de mèches blanches dont les yeux devinent la douleur. Son regard, longtemps immobile, surgit une dernière fois comme une île, d’un bleu d’acier brumeux, brûlant sous le voile que les années y avaient déposé irrémédiablement. Des images furtives lui parlent de sa vie. Des ombres immuables aux couleurs et aux effluves du temps, anéanties dans l’oubli. D’autres temps déjà lointains si merveilleusement retrouvés, ramenant les instants heureux d’hier. Devant lui, éparpillées, les notes contenant les points essentiels qui l’aideraient à retrouver plus tard cette précieuse découverte, se laissent piéger par le vent qui monte depuis les collines. Elles prennent le chemin de la liberté avant de disparaître par-delà les mamelons de végétation. Toutes ces lignes découlant si vite, qu’à peine il arrivait à retenir ! Puis, une faim de sel le saisit, tout son corps tendu. Il est maintenant seul, face à lui-même et son fardeau avec lui à l’heure où le reflet décalé des vagues s’égare, s’affole, cherchant vainement à se fixer sur celui d’où s’évade l’inaccessible étoile. Immobile maintenant, tenaillé par ce désir fou qui l’avait fait conquérir ce que d’autres n’avaient su avant lui découvrir, son visage de terre durable que le temps allait désormais harceler, ces traits-là le prolongeraient jusqu’à l’oubli et l’île seule s’en souviendrait. Elle s’ouvre toute entière engloutissant son corps à jamais, retenant pour toujours un secret dans ses flancs. Un dernier craquement bref. La branche d’os blanchi d’un corps mort venait de dégringoler de la pente dans un entrelacement de racines au fond du marécage. L’air avait fraîchi. Quelques oiseaux des mers passèrent en criant au-dessus de formes immobiles qui monteraient la garde dans ce lieu pénétré d’une atmosphère vague de tragédie. On aurait pu entendre un vaste murmure qui se changeait, se révélant finalement un grondement composite fait de gémissements, puis de cris sporadiques, puis… plus rien. Le silence avait tout englouti ! L’île venait de s’abandonner une fois encore à ce sursaut de fin d’été tropical. Ce dernier bond de chat mauve et meurtri de la saison. Cet orgueil, cette obstination avait eu raison de toute forme de courage. La légende venait d’enfanter un autre fantôme.
Jean-François
récits sur le thème du "trésor enfoui"
Mes grands parents d’origine Charentaise arrivent à Bordeaux Bastide en 1933 et s’installent quai des champs avec leurs deux filles, ma mère et ma tante. La rive droite, c’est le Bordeaux ouvrier avec ses odeurs, ses fumées noires que crache la Ciemeté grosse entreprise de sidérurgie. Les rues sont sombres, les caniveaux dégueulent d’eaux saumâtres. Puis il y a la Garonne, frontière fluviale entre le Bordeaux des pauvres et le Bordeaux des bourgeois. La rive gauche fleure bon l’argent, les grands magasins, les grands hôtels 18eme et la culture. Mon grand-père a arrêté l’école après son certificat d’études et travaille comme forgeron à la Ciemeté. C’est un grand curieux Auguste il dévore les revues Historia et avec son précieux poste de TSF il découvre le monde. De son coté ma grand-mère s’occupe du quotidien comme beaucoup de femmes à cette époque et a ses heures perdues est couturière. Elle est gaie et coquette malgré ses problèmes de santé. Tous les dimanches matins Auguste prend le journal qu’il décortique religieusement avant le repas dominical. Un jour lors d’un de ces repas, un ami de mon grand-pèreMr André professeur de musique de son état, il habite rive gauche, lui propose de donner des cours de solfège à ma mère Mireille et des cours de chants à ma tante Colette. Mes grands-parents sont ravis car ils souhaitent donner leurs filles l’instruction dont ils ont été privés. Nous sommes en 1937 et tous les samedi matins les futures musiciennes traverse la Garonne à bord du bus qui les dépose devant l’école de Mr André, Cours de la Marne. Ma mère décide d’apprendre le violon et Auguste se met rapidement en quête pour trouver l’instrument. Il apprend par un de ses collègues d’usine que sur les hauts de Florian le château Ledoux vend divers meubles, objets, vaisselle et instruments en tout genre dans un but caritatif. Auguste décide de se rendre à la vente le dimanche suivant.Il enfourche son vélo et grimpe la côte pentue de Mon Repos. En arrivant il y a déjà beaucoup de monde dans la cour et le hall d’entrée du château. Il joue un peu des coudes (mon grand-père fait de la lutte) pour se frayer un chemin et finie par se retrouver dans une petite pièce qui est sans aucun doute une bibliothèque. Des vitrines pleines à craquer de livres, des étageres bancales prêtent à s’écrouler sous le poids des encyclopédies. Des journaux empilés pareils à des pyramides et sur une table en acajou, des cendriers, des encriers. Tout cela crée une joyeuse pagaille. Soudain les yeux de mon grand-père se pose sur une boite en cuir remplie de poussière. C’est un étui pour violon. Il l’attrape, l’ouvre et vérifie si l’instrument est à l’intérieur. Son visage s’illumine, il a trouvé le violon pour Mireille, ma mère.Il dévale la cote de Mon Repos en 3 coups de pédale et arrive à la maison. En voyant l’étui et devinant ce qu’il contient ma mère éclate de joie. Le samedi, comme tous les samedi, les filles montent dans le bus pour se rendre chez Mr André. Celui-ci est ravi de voir que ma mère a enfin son violon. Très fière Mireille lui présente l’étui. Mr André prend l’instrument délicatement et l’inspecte sous toutes les coutures. Tout à coup il manque de perdre l équilibre. Au fond de la caisse du violon une étiquette quelque peu défraîchie attire son attention il est inscrit : "Stradivarius Cremonensis. faciebat Anno 1731". Avec une intense émotion, il caresse le précieux bois du violon, fait danser l’archet sur les cordes. Il se ravise et dit d’un ton clair : « le son n’est pas terrible mais une fois accorder tu vas faire des miracles ! » Un dimanche matin, l’oreille collée au poste de TSF, ce dimanche là il n’y avait plus de journaux dans les kiosques, le visage d’Auguste s’assombrit, il serra ses poings et dit d’un ton grave : « les allemands sont à nos portes les filles doivent partir chez ton frère à Saintes ». Le lundi 10 juin 1940, les sirènes et les cloches annonçaient le début de la guerre, les bottes allemandes claquaient sur les pavés bordelais. Il a urgence, il faut fuir on prépare les valises à la hâte. Sur le quai de la gare on sent l’inquietude, la peur. Dans un brouhaha incessant, ma mère et ma tante, les yeux rougis embrassent une dernière fois leurs parents. Elles s’installent dans le wagon qui les mène vers la liberté. Elles seront à l’abris des bombes et mangerons à leur faim. Ma mère serre contre elle la boite à violon. le train s’ébranla dans un effroyable bruit de ferraille et disparue enveloppé d’une épaisse fumée. L’arrivée à la ferme fut longue et fatigante. Mon arrière grand-mère, Suzane, personnage d’un autre siècle, attendait les filles devant la porte. Elle était tout de noir vêtue, la jupe de gros drap lui couvrait les sabots, un chignon laiteux trônait sur sa tête tel un point sur un i. Les poings sur les hanches dit d’un ton sec : « ha ben vous vla ! les bourgeoises … ». En l’espace d’une seconde les filles avaient compris que leur vie allait changer. Fini la musique et le chant d’ailleurs Suzanne les mis vite au diapason : « Ici si on veut manger faut travailler! ». Les semaines et les mois se ressemblaient. Mener les vaches au champs, tirer le lait, nettoyer les étables. Quelques fois, le soir ma mère prenait son violon et s’évadait un peu grâce à la musique. Un soir, des soldats allemands arrivèrent jusqu’à la ferme pour requisionner des vivres. L’oncle de ma mère, Guy se mit en travers de la porte une fourche à la main. le plus gradé des soldats fit aligner tout le monde contre le mur de la grange et dans un très mauvais français cria : « Je veux de la nourriture et le violon, sinon ». Il braqua son révolver en direction de ma mère et ses autres acolytes mirent en joue les autres membres de la famille. C’est comme ça que le Stradivarius disparue tragiquement. La vie n’a pas de prix, même pour un trésor.
Carole
A la recherche d’un monde perdu Fort Landerdale, Floride, 1999. Henry L. se prépare pour un pèlerinage familial important pour les quatre-vingts ans de son père ; ils partent en Pologne dans la ville où ses parents ont vécu jusqu’à l’invasion allemande. Kalisz est probablement la plus vieille ville de Pologne, elle serait mentionnée par les Romains au IIème siècle avant JC. Elle n’a pas été touchée par les bombardements allemands, elle fut très vite occupée puis annexée par le Reich car elle se situe non loin de la frontière allemande. La population, qui était en grande partie juive, fut exterminée et expulsée de Kalisz. C’est là que l’histoire de la famille L. prend un tournant tragique. Au commencement de la guerre, le père et la mère de Henry, Léon et Junia, sont très jeunes et ne sont pas encore mariés. Ils s’enfuient vers la seule destination qui s’offrait à eux : la Russie. Ils s’enfoncèrent loin dans le pays jusqu’à Petrovsk située au bord du lac Baïkal. C’est au fin fond de la Sibérie, en 1944 dans un camp de réfugiés, que le petit Henry a vu le jour. Dans les années 1920-1940, le grand-père de Henry était l’heureux propriétaire du théâtre juif de Kalisz où se produisaient bon nombre de comédiennes et comédiens célèbres. La famille L. faisait partie de la bourgeoisie Polonaise et vivait dans un bel appartement d’un immeuble cossu du centre-ville. La vie y était douce, ce milieu d’intellectuels n’aurait jamais pu imaginer ce qui allait arriver. En 1945, Léon et Junia, mariés, leurs deux très jeunes enfants sous les bras, décidèrent de faire l’exode en sens inverse, direction Kalisz afin de retrouver leur vie d’avant. La ville avait tenu debout mais était devenue une ville fantôme dépourvue de ses habitants. Les L. n’y trouvèrent que le néant : ni famille, ni amis, plus âme qui vive, tout l’ancien monde avait disparu à jamais dans les ténèbres. La Pologne d’après-guerre était très embarrassée de tous ces juifs errants. Ils prirent alors la décision de partir pour toujours de ce pays, laissant leur passé derrière eux. Ils décidèrent de s’embarquer dans une épopée de plusieurs mois à pied à travers l’Europe, puis en train et s’arrêtèrent à Paris. Ils posèrent donc leurs maigres bagages en France, terre d’asile, où ils vécurent pendant dix ans avant de partir définitivement pour vivre le rêve américain. En 1999 la famille L. décide de revenir en Pologne. Et voici trois générations d’une famille américaine en vol long-courrier en partance pour Varsovie : Léon et Junia, Henry et Elvira leurs enfants, ainsi que Silva la fille de Elvira. À leur arrivée, les L. prennent un guide qui leur fait visiter Varsovie. Ils sentent qu’ils ne sont pas les bienvenus en Pologne, la réticence des habitants à leur donner quelque information que ce soit en rapport avec la seconde guerre mondiale est palpable. Ils visitent la seule synagogue encore épargnée, entourée de barbelés pour des raisons de sécurité. Ils trouvent la liste des déportés de la ville et apprennent que la mère de Léon, grand-mère de Henry, est morte dans le ghetto de Varsovie et a été enterrée dans une fosse commune du plus grand cimetière juif local. Les trois générations de L. se rendent au cimetière. Ils allument et posent une bougie puis Léon récite le Kaddish, la prière aux morts, afin que sa mère repose enfin en paix. Après deux jours passés à Varsovie, le guide les conduit jusqu’à Kalisz à deux cents kilomètres de la capitale. La ville n’a pas changé, l’architecture est la même, seule la destination des monuments est différente. Cinquante-cinq ans se sont écoulés ; quel mélange de sentiments contradictoires, quelles émotions doivent-ils ressentir ? nostalgie ? désespoir ? colère ? Comme à Varsovie, ils ne sont pas les bienvenus, pire, il ne reste plus rien des cent ans de culture juive, la synagogue est devenue une église, le cimetière juif a été vandalisé, tout est cassé, tout n’est que ruine. La ville est certes restée exactement la même mais seulement en apparence, en vérité son âme a changé, elle n’existe plus dans les yeux des L. Néanmoins, après si longtemps Léon et Junia ne parviennent pas à s’orienter vers leur quartier car les noms des rues ont changé. Ils vont à la mairie et tombent enfin sur des personnes d’une grande humanité qui leur donnent accès au plan cadastral. Ils retrouvent l’immeuble intact, le seul endroit qui soit resté figé dans le temps et leur mémoire. Ils sont devant l’immeuble où Léon avait vécu. Il le reconnait immédiatement, la façade est restée inchangée. Les parents décident d’y monter seuls. Ils sonnent à l’appartement et une vieille femme leur ouvre la porte. Léon lui explique que cet appartement a longtemps appartenu à sa famille. La vieille femme leur permet de rentrer. Quel choc de voir que tout est resté en l’état, tout, même les meubles : le beau vaisselier, la haute armoire en bois massif, tout y est, mais alors si rien n’a changé... En 1939, la peur avait envahi l’Europe comme une lente gangrène qui commençait à accélérer son irrémédiable travail de pourriture ; les jours heureux étaient révolus. Les troupes allemandes étaient dans la ville, leurs exactions obligèrent la famille à prendre la seule décision qui s’imposait : fuir. Le père de Léon réunit sa famille et leur montra où il avait décidé de cacher de l’argent, les bijoux de famille ainsi que le fameux violon qui lui avait été transmis par son père. Il monta sur un escabeau et ouvrit une trappe invisible à l’œil nu qu’il avait confectionnée dans le mur en pierre au-dessus de la cheminée, pensant qu’ils pourraient survivre quelques temps une fois la guerre terminée en vendant les seuls biens matériels qui leur resteraient probablement. Il reboucha alors la cachette sans se douter qu’elle renfermerait pour très longtemps le trésor familial et qu’il ne jouerait plus jamais de son violon. ...si rien n’a changé dans cet appartement, alors le trésor est en toute probabilité toujours enfoui au-dessus de la cheminée ! Au-delà de sa valeur pécuniaire, c’est une valeur sentimentale inestimable qu’ils aimeraient maintenant récupérer. Le seul moyen de le reprendre est de racheter le logement, même si racheter est un terme biaisé puisque les L. ne l’ont jamais vendu. Après de vaines tractations, le propriétaire refuse de leur vendre l’appartement car la vieille dame veut y finir ses jours. A l’évidence ils n’ont pas pu expliquer au propriétaire pourquoi ils tiennent tant à racheter ce bien. Les L. repartent aux Etats-Unis le cœur gros. Ce pèlerinage leur aura laissé un goût amer même si pour Léon il fut nécessaire pour boucler la boucle. Un voyage transgénérationnel pour ne jamais oublier. Léon décède en 2003 sans avoir récupéré le trésor familial. Les années passent et en 2024, Henry séjourne à Paris auprès de son plus vieil ami. Un autre Henri né dans le même camp de réfugié en Russie, immigré à Paris après la guerre et que la France a adopté pour toujours. Ils se remémorent leur prime jeunesse passée ensemble à Belleville puis Henry raconte son voyage en Pologne. La famille de Henri le presse de questions, passionnée par son récit. De retour chez lui en Floride, Henry a quatre-vingts ans, le même âge que son père Léon lors de leur voyage en Pologne. Son séjour à Paris l’a replongé dans ses souvenirs. La vieille femme doit être morte depuis longtemps. Pour lui le temps est peut-être venu de récupérer le trésor.
Véronique
Je suis une petite fille sage, un peu boulotte. Un visage quelconque, adouci par de longs cheveux châtain clair, je porte des lunettes à monture d’écaille qui renforce le sérieux avec lequel je mène ma vie d’écolière. Souvent perdue dans mes rêves, je m’évade comme je peux d’une vie trop étroite. Les seules fenêtres vers d’autres mondes sont la télévision, les livres et les rêves. Ce jour-là notre voyage dans la 4L un peu déglinguée de ma mère. nous amène à Caudéran, dans ce quartier huppé de Bordeaux. Nous traversons la teinturerie encombrée par des alignements de vêtements suspendus sur des cintres qui empestent le perchloréthylène puis nous débouchons dans la rue où se situe l’appartement de ma mamie. Ma grand-mère gère d’une main de fer un dépôt de teinturerie sur les boulevards. J’entendais souvent dire qu’elle bataillait avec les différents teinturiers et blanchisseurs qui travaillaient pour elle. Ma grand-mère me fascinait. Elle se faisait appeler Andréa ; Elle trouvait cela plus chic que son véritable prénom, Andrée. Son visage soigneusement poudré était encadré par des cheveux blancs aux reflets bleutés, savamment mis en plis chaque semaine par son coiffeur. Elle portait des habits confortables, bien coupés, de marques prestigieuses. Son loden en poils de chameaux si doux m’émerveillait. Moi, qui étais souvent habillée avec des tenues, données par la voisine. Après les embrassades, je file par l’escalier, j’entre dans la salle bains, et entrouvre le battant de la garde-robe en acajou massif qui grince comme à chaque fois. Une bouffée d’enfance me submerge alors lorsque, entrant dans le grenier, je découvre un morceau d’étoffe soyeuse dépassant d’une malle. Celle-ci contenait les effets personnels de ma grand-mère Andréa, décédée depuis longtemps. J’extirpe précautionneusement l’ample peignoir de soie, bleu clair à pois noirs. Il avait gardé le lustre d’antan. Je le déplie lentement et le caresse rêveusement. Il reflétait un peu mon âme d’enfant. Je l’endosse face au miroir de l’armoire dans la salle de bain de la maison de ma grand-mère. La magie alors s’opère s’installait. Je m’incarne aussitôt dans des personnages que j’admire au point de susciter des vocations inaccessibles à ma condition de petite fille de milieu modeste. Jusqu’au jour où ce jeu cessera cessa brutalement. De nouveau au domicile de ma mamie, je reprends possession du luxueux déshabillé de soie ! Je le décroche du cintre sur lequel il repose, inanimé. Je m’en drape le corps ; je deviens aussitôt « Maria Callas » en personne. Je me mets alors à chanter d’une voix très aigue. Je ferme les yeux et je revois le visage sublimement maquillé de la grande diva. J’ose des effets de manches, des mimiques expressives et dramatiques face au miroir. Je virevolte et décuple la puissance de mes arpèges. Soudain, par la porte restée entrebâillée, la voix de mon aïeule parvient jusqu’à moi : « Tu verras le diable ! ». Et quelques instants plus tard : « C’est l’heure ; il faut partir. » Je reprends brutalement contact avec la réalité. Une fois encore, je monte l’étroit et sombre escalier qui mène à la salle d’eau. Je revois la pièce claire où trône la baignoire énorme, trapue, avec ses pattes de lion dorées. J’entends à nouveau le grincement du battant de l’armoire où je prends le fameux peignoir à pois noirs et instantanément je suis transformée. Je suis « Alice Sapritch », la grande tragédienne. Je sens même son bandeau emplumé enserrer mes cheveux. Je déclame des tirades enflammées en resserrant mes mains pudiquement sur le décolleté du vêtement soyeux. Mon visage grimace de la douleur d’un amour interdit lorsque résonne la maudite phrase rituelle : « Tu verras le diable ! » Me voilà soudainement revenue dans la banalité de ma vie. Lors d’une autre visite, après avoir gravi en courant les marches, je me précipite vers la penderie qui couine bien sûr comme toujours. Le vêtement enchanté est à sa place. Je le décroche avec hâte de son porte manteau. Je le revêts avec gourmandise. Cette fois-ci, je me sens pousser des ailes. Je pivote sur la pointe des pieds, les bras en couronne, aussi légère qu’une ballerine. Arabesque, pas de bourrée, je danse libérée de mon corps un peu pataud. Je salue mon public sous les bravos d’un public émerveillé par ma prestation. Les hourrahs fusent lorsque retentit la phrase fatidique : « Tu verras le diable ! » ; « Allez ! dépêche-toi ; Il est temps de dire au revoir ». Tout en me hâtant de remettre tout en place, je reprends pied, à regret, dans la vie ordinaire. Puis, ce sera cette ultime fois et cette dramatique séance. Je monte les degrés de l’escalier. Un orage tonne au loin mais se rapproche. J’entends avec appréhension les coups de tonnerre qui claquent juste après les zébrures qui illuminent le petit boudoir sombre à cause du lourd ciel d’encre et d’ardoise. Le gémissement habituel de l’armoire prend une tonalité particulièrement lugubre. Je me saisis de l’envoûtant peignoir et m’apprête à l’endosser pour me rêver en une autre, lorsque un flash fulgurant enflamme mon reflet dans le miroir. J’entrevois mon visage qui se craquelle en mille fines ridules. Mes cheveux dressés ont blanchi dans la lueur aveuglante. Quelle horreur ! Ma silhouette est devenue c’elle d’une vieille femme, une espèce de sorcière ! Mon cœur bat à se rompre... Je reste longtemps immobile à écouter la tourmente qui déjà s’apaise et la pluie battante qui martèle le toit. Ai-je vraiment vu cette créature hideuse qui me ressemblait tant ? Cette apparition est-elle un avertissement ? Je n’ai pas le souvenir, cette fois, d’avoir entendu la voix des adultes criant la phrase habituelle : « Tu verras le diable » mais néanmoins elle a résonné dans ma tête. J’ai vraiment vu LE DIABLE cette après-midi-là !
Anne
Récits sur "la bouteille à la mer"
Chapitre 1 Georges est arrivé au village au début de l’été 1924. Il venait de Saintes pour annoncer à ses grands-parents maternels la grande nouvelle : il venait d’être reçu haut la main au concours des « indirects ». Ce n’est pas rien, les « indirects » ! ça veut dire une situation, la sécurité de l’emploi. La chose s’était faite presque à son insu quand son meilleur ami Damien lui avait demandé de l’aider à préparer ce concours. De fil en aiguille il s’était dit, moi aussi je l’ai préparé ! Et il s’y était inscrit sans rien en attendre… La vie est joueuse ! Il avait été reçu, au grand dam de son père Lorédan, un colosse aux mains comme des battoirs, tatoué par la nature d’une tâche rouge en forme de demi-lune sur le biceps. Il conduisait des locomotives à vapeur et annonçait déjà à tous que son aîné prendrait sa suite. Il s’en était suivi une discussion très houleuse entre le père et le fils qui s’étaient quittés en froid. Mais loin de Saintes et de son ogre de père, Georges entendait profiter de ce bel été avant son entrée dans la vie active. Sa grand-mère Lina le gâtait en confectionnant de délicieux petits plats et tous les après-midis, il descendait à la rivière avec son grand-père Gustave ; en chemise avec un simple gilet et un canotier sur la tête, ils allaient taquiner la truite, la carpe ou le brochet… Georges était bel homme, avec ses cheveux noirs qui ondulaient sur le dessus du crâne, séparés par une raie parfaite, un sourire avenant, se découvrant poliment lorsqu’il croisait des gens du cru. Toutes les jeunes filles à marier lorgnaient sur lui, même Jeannette se serait bien laissé conter fleurette ! Mais allez savoir pourquoi il jeta son dévolu sur Jeanne… Ce n’était pourtant pas une beauté Jeanne ! Ronde de partout, elle avait au milieu du visage un grand nez qui certes lui donnait du caractère, mais jurait avec l’ensemble. Elle lui avait été présentée, ainsi que sa mère Madame Veuve Dumas lors d’un pique-nique au bord de l’eau un dimanche après-midi comme il s’en faisait souvent. Il avait d’abord été charmé par son rire ; cette jeune femme débordait d’énergie, de verve et avec elle, on ne s’ennuyait pas. Elle lui avait confié que depuis la mort de son père, elle gagnait sa vie en donnant des cours de piano chez elle. Aussi il s’enhardit à aller la voir. D’abord il lui apporta quelques truites, puis presque chaque jour, en fin d’après-midi, il traversait la rue son violon sous le bras. Elle l’attendait, et pendant une heure ou deux, ils jouaient ensemble autant du Chopin que des airs à la mode. Ces deux -à s’étaient trouvés ! Et à la fin de l’été, ils étaient fiancés. Georges obtint par connaissance un poste dans la région. On déposa les bans. Il fallut bien avertir la famille... La colère du père fut homérique. Il avait nourri d’autres projets pour son fils, notamment un mariage avec la fille d’un nobliau désargenté de Saintes, désargenté mais enfin de bonne souche ! Georges l’affronta bravement, pour l’amour de Jeanne. La date du mariage fut fixée au mois de juin 1925. Georges espérait que la colère de son père serait retombée d’ici là ; que Maria sa mère saurait trouver les mots qui l’apaiserait ; et cela lui laissait aussi le temps de mettre de côté la somme nécessaire à un beau mariage. Pour Jeanne et pour sa mère Clotilde, ce mariage était une aubaine ; car enfin la situation financière des deux femmes, qui fut autrefois aisée, était devenue difficile depuis la mort du père, à même pas cinquante ans, brutalement emporté par un infarctus que nul n’avait vu venir. Il ne leur restait que cette grande maison où elles vivaient à deux, et où il faisait un froid de canard en hiver, car elles ne pouvaient pas se payer le bois nécessaire pour tout chauffer. Elles se repliaient au rez de chaussée, devant l’âtre de la cuisine en tricotant des vestes et de bonnes chaussettes de laine. Finalement Lorédan céda. Il vint au mariage, pour la plus grande joie de sa femme qui nourrissait pour Georges une forte affection et approuvait en secret le choix qu’il avait fait. Car c’était une femme généreuse Maria, et tout ce qu’elle voulait pour ses enfants, c’était qu’ils soient heureux. Et justement ce fut une très belle cérémonie. Tout le village était là, et c’est en robe de mariée que Jeanne dirigea la fanfare. Il y avait tant de monde que le maire fit décorer le jardin public avec des lampions comme pour le quatorze juillet. Les victuailles étaient posées sur des tréteaux, le vin coulait à flots, on dansait des valses et des quadrilles. La fête battait son plein quand Lorédan, s’approcha de Jeanne pour lui murmurer à l’oreille « viens, j’ai quelque chose à te dire ! » Elle le suivit un peu à l’écart dans un coin du jardin où l’on pourrait mieux s’entendre. En son for intérieur, elle se félicitait que la brouille avec Georges soit enfin oubliée. Quand brusquement, il l’agrippa de toute sa puissance, la bascula au milieu d’un parterre de fleurs et en envoyant voler les jupons de sa robe blanche, la viola brutalement. Les bruits de la fête couvraient les cris de Jeanne, impuissante. Le brouillard envahit son esprit. Il lui sembla mourir. Et lorsqu’il se retira d’elle, elle l’entendit qui disait : « On est quitte maintenant ! Tu as pris mon fils, et moi j’ai pris ta fleur ! » Et il en riait encore en reboutonnant sa culotte, tout heureux de sa blague de brute avinée. Comment survit-on à un tel séisme ? Jeanne avait perdu toute notion du temps, tout était flou en dedans. Elle n’arrivait plus à penser. C’était comme si son corps n’existait plus, ne lui appartenait plus... Puis une image, un mot « Georges ! » Comme une bulle qui remonte à la surface, elle pensa à Georges. Et une espèce de terreur l’envahit. Il ne doit pas savoir. Personne ne doit savoir. Il faut à tout prix éviter un scandale, pensa-t-elle. Où trouva-t-elle la force de se relever, de se réajuster ? Elle trouva Georges un peu éméché qui voulait l’emmener danser. Alors mentir, il fallut mentir. « Je crois que j’ai trop bu mon chéri ; j’ai une migraine terrible ; danse, je vais me reposer ». En voyant que Jeanne quittait la fête en courant, Jeannette la suivit, intriguée, et la trouva pleurant à chaudes larmes dans un fauteuil du salon, recroquevillée sur elle-même comme un petit animal blessé. Elle crut d’abord à une querelle d’amoureux… Cela fait déjà trois mois que Georges s’est installé dans la grande maison de Clotilde et Jeanne. Au début, ça a été un peu difficile avec Jeanne. Elle riait moins qu’avant, et se laissait toucher avec réticence, il le sentait bien. Comme il manquait un peu d’expérience pour les choses de l’amour, il crut d’abord que ça venait de lui, mais en voyant le ventre de Jeanne s’arrondir tout devint plus clair. Sa mère lui avait expliqué que sous l’influences des hormones, les femmes ont parfois des réactions inattendues. Alors il redoublait de tendresse et ne la forçait en rien. Il embrassait le ventre de Jeanne avec dans le regard, la même vénération que pour sa fille, quelques mois plus tard. On la nomma Yvonne, le prénom à la mode parce que « Printemps », la célèbre artiste du moment. Elle avait les yeux et les cheveux noirs de son père, et une demi-lune sur le bras, qui faisait dire à Georges « Celle-là, elle est bien de la famille ! On ne peut pas la renier ! » Jeanne était au supplice ! Elle tomba en dépression. « Post-partum » traduisit le médecin de famille appelé à la rescousse. Sans qu’on sache trop ce que c’était, le mot rassurait, car au moins on connaissait la cause : « Post-partum ». Aux amis, aux voisins qui demandaient des nouvelles : « Post-partum ». Et on se répétait le mot, de bouche à oreille, comme s’il s’agissait là d’une formule magique. Jeanne gardait la chambre et pleurait à longueur de journée. Clotilde prit la maison en main, et une nourrice pour le « petit printemps », tendre surnom que papa Georges donnait à sa fille. Puis au bout de quelques mois, comme Jeanne semblait aller mieux, Il fut question du baptême d’Yvonne. Georges y avait pensé...ce serait très intime ...Juste ses parents et eux trois. Jeanne défaillit. L’idée même de se retrouver face à son...elle n’arrivait pas à dire « beau-père », lui était insupportable. Alors de guerre lasse, elle raconta à Georges l’épouvantable l’innommable violence qu’elle avait subie, qu’elle subissait encore. Georges sentit la terre trembler...ses jambes se dérober sous lui...il n’était pas prêt à entendre une telle confession ! Lui d’ordinaire si doux et mesuré changea de physionomie : écarlate, les yeux exorbités, il hurlait comme un fou « je vais le tuer, je vais le tuer ! » et ponctuait violemment ses paroles en jetant au sol et sur les murs toutes les pauvres porcelaines qui lui tombaient sous la main. Quand soudain, il vit Jeanne, terrorisée, qui s’était réfugiée dans un angle de la chambre, se protégeant comme elle pouvait des éclats qui volaient en tous sens avec un oreiller plaqué contre elle. Dans une fraction de seconde, Georges se vit pareil à son père, et cela le dégoûta. Parce que la victime, c’était Jeanne, pas lui. Il voyait tout le courage de cette femme, sa femme, qui s’était tue pour le protéger. « Pardon, pardon ! » supplia-t-il. Calmant comme il pouvait les battements désordonnés de son coeur, il s’approcha doucement d’elle et l’enserra fort dans ses bras « Je t’aime ma Jeanne ! » Ils pleuraient et s’aimaient ensemble, et c’est cet instant, plus que tout autre, qui scella entre eux un lien indestructible. « Si tu y vas, lui dit Jeanne, il t’écrasera comme un moucheron, et il saura qu’il a gagné ! Tuons-le en l’ignorant, en faisant comme s’il était déjà mort ; et en étant heureux malgré lui !» C’est ainsi qu’Yvonne ne connut jamais ses grands-parents paternels, pas plus que Damien « NT » pour « number two » qui naquit l’année suivante. On inventa un accident qui les auraient tués sur le coup. Clotilde constata, un peu surprise, que Georges ne s’était rendu à aucun enterrement. Mais comme elle aimait qu’on lui fiche la paix, elle ne se mêlait pas des affaires des autres. D’autant que la vie familiale était beaucoup plus gaie depuis un certain temps. Georges aimait son travail et Jeanne avait repris les cours de piano ; ce qui leur permettait de partir en « week-end » tous ensemble de temps à autre, à Royan, Arcachon ou sur la Côte Basque. Et l’hiver, on invitait des amis. Damien, l’ami de jeunesse de Georges venait souvent. Il était bien sûr le parrain de Damien « NT », et appréciait particulièrement la cuisine de Jeanne, qui était un fin cordon bleu. Elle concoctait des vol-au-vent aux cèpes, du coq au vin, du lapin à la moutarde...et toutes sortes de desserts, dont son fameux baba au rhum qui partait à la nage, tant il était bien arrosé. Mais toute la tendresse de Georges n’avait pas suffi à réparer Jeanne. Alors ils avaient conclu un pacte : il prendrait une maîtresse, mais sa priorité resterait toujours sa femme et sa famille. Parfois, quand il arrivait en retard pour le repas du soir, Clotilde persiflait « il est encore allé voir sa pute ! ». Elle ne comprenait pas que sa fille puisse accepter une telle situation… Mais il rentrait, embrassait tendrement sa femme, un regard, et ils se comprenaient. Chaque dimanche, après le repas dominical, Georges s’offrait le luxe d’un cigare ; puis il attrapait son violon, Jeanne se mettait au piano, et tout le monde chantait en chœur. La petite Yvonne surtout faisait la fierté de ses parents, car elle chantait « plaisir d’amour » d’une voix pure et claire, et jouait du piano avec une grande facilité. Bien qu’un peu timide, toujours dans l’ombre de son père adoré, elle était vive, intelligente et apprenait bien à l’école ; on l’envoya jusqu’au Brevet. Son frère au contraire était plutôt indolent, mais farceur comme pas deux, il arrivait à mettre tout le monde dans sa poche. Il entra à la banque par piston, et y resta car la place était bonne et pas fatigante. Jusqu’à sa mort en 1961, jamais Georges ne fit défaut à Jeanne. Il mourut à quelques mois de la retraite, emporté par un cancer du foie, qui est, dit-on, la maladie de la colère. CHAPITRE 2 CLOTILDE Sous la véranda de mamie Jeanne, le temps s’est arrêté. Dans la mémoire de Jeannette, c’est le film d’une vie qui vient de défiler. Et elle est, comme moi, envahie par les émotions. Ses yeux brillent de larmes contenues, et elle me serre la main très fort. « Il y en a des souvenirs dans cette maison tu sais ! De la cave au grenier ! » J’entends du remue-ménage dans le salon, c’est la levée du corps, le moment d’y aller. De la messe d’envoi à l’enterrement au cimetière, les larmes coulent à flot. Tous ces gens qui sanglotent, ça crée comme une communion d’âmes ; on pleure ensemble, et ça fait moins mal que de pleurer tout seul. Ma mère est effondrée, mon oncle Damien est à ses côtés. Mon père un peu en retrait, il a toujours mis un point d’honneur à contrôler ses émotions. Je ne l’ai jamais vu craquer, même pour le décès de son propre père. Et je sais que tout cela l’agace un peu ; il est pressé d’en finir. Même s’il aimait bien mamie Jeanne, quand c’est fini, c’est fini ! Pourquoi en faire tout un plat ? Retour à la maison de Mamie Jeanne. On découpe le jambon, il y a du pain, du fromage, on remonte quelques bonnes bouteilles de la cave. Et comme elle aimait bien lever le coude Jeanne, on lui sert un verre, du Saint-Emilion, c’était son vin préféré ! Il faut se souvenir ! Garder la trace d’une vie ! On se rappelle les dimanches et tous ces bons moments passés ensemble ! Mais l’heure tourne, certains sont venus de loin et pensent à repartir ; d’autres qui ont un peu forcé sur les élixirs de joie vont rester dormir sur place. Moi qui ne suis ni pressée, ni soûle, je vais dormir ici aussi. Car j’entends résonner en moi la petite phrase de Jeannette : « Il y en a des souvenirs dans cette maison tu sais ! De la cave au grenier ! » De la cave au grenier ! Au grenier ! Mon enfance remonte à la surface… J’ai une prédilection, un attrait irrésistible pour les lieux chargés d’histoires et de mystères. J’avais 10 ans, et le grenier était mon royaume. Je décide d’y retourner dès le lendemain. Bizarrement, il faut traverser la salle de bain, au fond de laquelle se trouve une porte basse. La clef est sur la porte. Il suffit d’ouvrir et je me retrouve en bas d’un étroit escalier de bois. On comprend très vite en voyant l’escalier que ce lieu n’est pas fréquenté depuis longtemps, et que la démarche est périlleuse. Mais il en faut plus que ça pour me faire reculer. D’ailleurs il n’y a qu’une dizaine de marche que je monte avec précaution. Arrivée en haut, ma lampe-torche fait défiler toute une galerie de portraits noirs et blancs de gens sérieux, dans leurs habits du dimanche ; Il y a là un drapeau français oublié depuis la fin de la guerre ; laquelle ? Allez savoir ! des piles de livres de classe sagement ficelés ; des romans aussi ; un fauteuil à bascule un peu fatigué ; des toiles d’araignées en veux-tu-en voilà ; et quantités d’objets devenus inutiles et remisés là à une époque où on ne jetait rien. Une bonbonne en verre toute culottée de poussière avec un gros bouchon de liège attire mon attention. Je trouverai bien moyen d’en faire quelque chose ! Et je redescends ...attention !... ma bonbonne à la main. Je la passe sous l’eau pour lui redonner un air respectable, et c’est là que je vois à l’intérieur plusieurs rouleaux de papier, un peu jaunis que j’extraie par le goulot. Je les déroule, cœur battant : ils sont datés du 14 octobre 1980. Je lis : « Je viens d’avoir cent ans... » Mon Dieu ! Ce n’est pas possible ! Je me rends à la fin de l’écrit. C’est signé : « Clotilde Veuve Dumas » Et cette écriture un peu maladroite comme celle d’un enfant… C’est bien elle ! Mon arrière-grand-mère. « Je viens d’avoir cent ans ...et j’ai bien assez vécu. Je vais mourir bientôt, je le sens, et c’est tant mieux ! parce-que depuis le temps que mon Albert est parti, je traîne ma vie comme une croix. Bien sûr, là où il est, il sait tout ce qu’il y a à savoir. Mais quand même, j’aimerais bien lui demander pardon ! Je suis née à la ferme. « Encore une fille ! » hurla mon père, désespéré. On peut le comprendre… j’étais la cinquième...Et les filles, c’est une ruine ! Il faut les doter si on veut les marier ! Ma mère ne dit rien, elle connaissait son homme ; grande gueule, mais grand cœur. Dès que j’ai pu marcher, j’ai commencé à travailler. C’est comme ça à la campagne ! Tu dois gagner ton pain. Moi je m’occupais des poules : je leur donnais le grain, je ramassais les œufs, et je devais faire très attention à bien fermer le poulailler, rapport au renard qui traînait dans le coin. Puis on m’a confié les canards aussi...enfin à dix ans, c’est moi qui leur mettais la tête sur le billot pour leur couper le cou, et je démaillotais aussi les lapins. Tous les samedis, j’accompagnais ma mère au marché. J’étais mignonne et pas farouche, ça nous attirait des clients. Moi je voyais toutes ces belles dames et ces messieurs bien habillés qui marchaient entre les étals comme si le monde leur appartenait. C’est là, vers l’âge de dix ans, que j’ai pris ma décision : moi aussi un jour, je serai une dame ! A dix-sept ans, j’avais tous les hommes à mes pieds ; ma bouche, mes seins, mon cul, tout leur plaisait ! Mais pas question de dilapider « mon petit capital » comme disait mon père. En ce temps-là, la virginité des filles était une chose sérieuse ! Pas comme aujourd’hui… Et puis moi, j’avais toujours mon idée en tête… Le samedi, au marché, il y avait un monsieur qui m’achetait toujours une poule ou un canard. Il disait qu’il n’en avait pas mangé de meilleurs, et il avait toujours un mot gentil pour moi ; mon sourire agréable, mes yeux pétillants, mes boucles comme de la soie. Dans son regard, je me sentais plus que belle, vue, reconnue, unique. Je l’appelais « Monsieur Albert », il m’appelait « Mademoiselle Clotilde ». « Mademoiselle Clotilde », m’accorderez-vous cette danse ? C’était au bal du quinze août 1898. Je ne l’oublierai jamais. Il m’entraîna dans une valse. C’était un très bon danseur. J’avais la tête qui tournait, et je sentais la chaleur de son corps à travers les vêtements. J’étais intimidée et troublée à la fois, mais je tâchais de faire bonne figure, sachant que ma mère nous épiait, assise avec ses commères au bord de la piste de danse. En vrai gentleman, à la fin de la valse, il me raccompagna, salua ma mère, et me baisa les doigts avec délicatesse. Les poils de sa moustache me chatouillèrent un peu. Mais la chaleur de ses lèvres resta imprimée là où ils les avaient posées. Un bonheur indicible me soulevait de terre. Je le revis au marché le samedi suivant. Il arriva au moment où je pliais mon étal, me proposa son aide, et m’invita à boire un chocolat au café de la place. Je ne savais pas quoi dire d’intéressant, mais lui parlait avec passion de toutes les nouvelles technologies : l’aviation, le téléphone, le cinéma, l’automobile...Il en parlait avec enthousiasme : « Nous vivons une époque passionnante « Mademoiselle Clotilde » ! ». Je l’écoutais, fascinée, même si je ne comprenais pas tout. Je comprenais l’essentiel. Il se commettait ici, au regard de tous, avec une fille de rien, qu’il traitait comme une reine. Et cette fille, c’était moi. Inutile de vous dire que cela fit scandale ! Ses parents, les Dumas, pourtant partis de pas grand-chose, avaient fini par accumuler un bon pécule dans la boulangerie. Et Albert, qui avait le sens des affaires, plaçait l’argent où cela rapportait. Pour son plaisir, il avait acheté une librairie à Bordeaux, sur le cours d’Albret, où il vendait des ouvrages spécialisés dans la médecine, le droit, la culture, la politique ; il s’intéressait à tout. Alors pour les Dumas, cette « fille » ! Cette paysanne ! Quelle horreur ! Il n’en était pas question ! Leur fils méritait mieux, et ils se chargeraient de le ramener à la raison. Peine perdue ! Je revois mon Albert, ce jour-là, très chic dans son costume de chasse qui mettait en valeur sa belle stature. Je le revois avec ses yeux clairs comme une eau de source, et ses moustaches en guidon de vélo. Il avait mis ses bottes pour venir à la ferme mon père et lui demander ma main. On les laissa ensemble. Il y eu conciliabule. Puis ils se tapèrent dans la main : l’affaire était faite, comme pour la vente d’une vache. Mais femme ou vache, à cette époque, une promesse était un engagement sur l’honneur. Albert habitait une grande maison proche de la boulangerie de ses parents, et généreusement, c’est lui qui se chargea d’y organiser nos fiançailles. Moi je vivais en apesanteur. Albert me couvrait de cadeaux ; il m’emmena un jour à Bordeaux faire les boutiques, et choisir des robes, des corsets, des bas, des souliers, des sacs...Je me reconnaissais à peine dans le miroir ! Mon rêve, mon beau rêve se réalisait. Lui me disait : « Tu n’as pas besoin de tout ça pour être la plus belle ! Mais tu sais, pour certains, c’est l’habit qui fait le moine. Ils te respecteront. Ce ne sont que des moutons ! » « Ils », c’était bien sûr ses parents, mais aussi le comité de village, ce cercle mystérieux de langues bien affûtées, qui avaient pour mission de me traîner dans la boue et de m’humilier. C’était l’envers de mon rêve. « Ils » me faisaient payer de réussir là où eux-mêmes n’arriveraient jamais. On me reprochait de « péter plus haut que mon cul ». Alors je pris l’habitude de les ignorer, même si, au fond, leurs réflexions me blessaient. Je mettais des talons pour me grandir, et je passais au milieu d’eux la tête haute, fière, comme si de rien n’était. J’avais un talisman, la bague d’émeraude qu’Albert m’avait offerte, parce qu’elle se mariait à la couleur de mes yeux. Depuis nos fiançailles, nous nous voyions presque chaque jour. Albert avait entrepris de m’apprendre à lire ; car si je savais compter, plutôt bien d’ailleurs, je ne savais ni lire, ni écrire. Il me dit : « Tu dois être capable de signer ton nom » Alors quelle joie le jour où, pour la première fois, j’écrivis, sans trop trembler CLOTILDE DUMAS. Il m’emmena fêter l’évènement au « Restaurant du Lac ». J’avais des étoiles dans les yeux. C’était un endroit très chic. Et comme il faisait beau, les tables étaient dressées dehors, au bord de l’eau. Nous passâmes un moment délicieux cette journée-là. Je dois dire que je me suis vite accoutumée aux privilèges que procure l’argent. Nous nous sommes mariés le 10 avril 1900 car, pour notre voyage de noce, Albert tenait à me faire découvrir Paris. Mais plus que tout, il voulait que nous soyons présents à cette date historique, le 14 avril, au Grand Palais, pour l’inauguration de l’Exposition Universelle. Je ne peux pas décrire toutes les merveilles que nous avons vues. Albert se passionnait en particulier pour les nouveautés techniques, dont l’électricité qui, disait-il, allait changer nos vies. Nous sommes montés sur la Tour Eiffel, nous avons pris le bateau sur la Seine. Et c’est sous une magnifique verrière que nous avons assisté au discours de notre Président. Le retour fut pénible. Tout me paraissait étriqué. « Ils » m’insupportaient tous. Albert, compatissant, loua un appartement à Arcachon. Et pendant quelques mois la vie fut très douce. Nous faisions de longues promenades en amoureux, et quand le temps était assez chaud, nous prenions des bains de mer. Enfin l’amour c’est une chose ; mais il y a aussi les affaires. Il fallut rentrer chez nous. C’est là que j’ai commencé à comprendre ce que l’on attendait de moi. Bon gré, mal gré, les Dumas me toléraient. Mais leurs regards de plus en plus appuyés sur mon ventre plat disaient assez clairement que je n’étais pas une bonne pouliche, et que leur fils s’était fait avoir sur toute la ligne. En clair, je n’étais qu’une aventurière intéressée par l’argent ! Les années passaient...toujours rien ! Je commençais à soupçonner que l’un de nous deux était stérile. Mais lui ou moi ? Il fallait que j’en ai le cœur net. Alors il m’est venu une idée dont je ne suis pas fière. J’ai prétexté que mon cousin Gaston, qui habitait près d’Agen, était bien malade. Il risquait de passer, il fallait que je me rende près de lui au plus vite. Je savais Albert pris par ses affaires. Il me déposa donc à la gare de Bordeaux. A la vérité, mon cousin Gaston se portait comme un charme. Il fut cependant ravi de me voir, et me proposa de rester quelques jours à la ferme. C’est ce que j’avais espéré. On était en juin au début de la fenaison, et à cette époque de l’année, Gaston employait des journaliers pour l’aider. Dès le premier jour, j’en repérais un qui respirait la santé, jeune, musclé, plutôt beau garçon ! Et assez bête pour se laisser aguicher...J’avoue quand même avoir pris du plaisir à la chose, tous les jours de la semaine. Et pour étouffer ma culpabilité, je me disais que je le faisais pour Albert. Mais je sais bien qu’au fond je le faisais pour moi. Albert ne m’ayant jamais fait le moindre reproche à ce sujet. Enfin tout passa comme une lettre à la poste. La foudre ne s’abattit pas sur moi. Et lorsque mon ventre commença à s’arrondir, je savourais enfin ma revanche. Désormais je serai une Dumas de plein droit. Du droit que donne l’enfantement. J’avais presque oublié ce que j’avais du faire pour en arriver là. Seul comptait le regard plein d’amour qu’Albert posait sur moi. Cet enfant serait notre enfant. Et lui serai son père. Qui pourrait dire le contraire ? Notre petite Jeanne naquit le premier avril 1904. Sûrement un clin d’œil du destin ! Albert, avec sa passion des affaires, nous permettaient de vivre bourgeoisement. Il investissait dans des titres, comme ceux du canal de Panama, dont le percement était entrepris par un grand ingénieur français, Ferdinand de Lesseps. Savoir qu’il participait à une telle entreprise le rendait fou de joie. Mais il était aussi en affaires avec les gros fermiers et les viticulteurs du coin qui lui faisaient des emprunts à tempérament. Il m’expliquait tout cela, comme si j’étais son associée. J’étais fière. Maintenant je lisais le journal tous les jours, et j’écrivais des lettres. Je tenais mon rang. Ses parents avaient cessé de me toiser à la naissance de Jeanne. Et ils reconnaissaient que je savais tenir une maison. Nous avions un couple de domestiques : elle pour le ménage et la cuisine, lui pour l’entretien du jardin et les travaux de la maison. Je me réservais la roseraie qui était mon domaine et ma création et se déployait tout le long du mur mitoyen avec mes beaux-parents. A la belle saison, le parfum des roses envahissait leur jardin, ce qui faisait dire à ma belle-mère « elle est bonne à quelque chose au moins ! » Mais surtout, je m’occupais de Jeanne, mon petit pinson, qui fredonnait du matin au soir. Elle avait une gaîté naturelle très communicative, qui envoûtait même mon beau-père. Je veillais à ce qu’elle ait une bonne éducation. Nous lui avions pris un précepteur pour les matières principales, et un professeur de piano, comme cela se fait dans les bonnes familles. Elle apprenait sans rechigner, consciente, je le lui avais bien expliqué, que toutes les femmes n’avaient pas sa chance. Les fins de semaine, son père nous emmenait promener, voir des expositions, écouter des concerts. La complicité entre Jeanne et Albert était ma plus belle réussite. Albert fut mobilisé « en quatorze ». Mais grâce à ses relations, il resta à l’arrière, et on employa ses talents pour gérer les achats et les stocks de l’armée française. Il avait été envoyé à Tours, d’où il nous écrivait chaque semaine une longue lettre, à laquelle nous répondions avec autant d’optimisme que possible. Mais les temps étaient durs. Nous étions rationnées, et les rues du villages peuplées de femmes en noir. On portait le deuil. Pas une famille qui n’ait perdu un père, un frère ou un mari ! Je dois reconnaître que pendant tout le temps que dura la guerre, mes beaux-parents furent d’un grand secours. Certains évènements de la vie nous amènent à changer de regard. La farine était dure à trouver, mais il y avait chaque jour un pain pour Jeanne et moi. Jeanne continuait à jouer du piano. Tout glissait sur elle. Son père lui manquait, comme à moi, mais elle savait enchanter le quotidien par sa musique et ses rires. C’était mon rayon de soleil ! Quatre ans c’est long... Il avait laissé une enfant. A son retour « en dix-huit », Albert retrouva une jeune fille de 14 ans. Nous laissions exploser notre bonheur dans l’intimité pour ne pas blesser tous ceux qui étaient dans la peine. Deux de mes sœurs avaient perdu leur mari à la guerre. Je m’estimais très chanceuse par rapport à elles, et les invitais aussi souvent que possible. Quant à Albert, je sais que sans rien me dire, il les aidait matériellement. Nous ne savions pas que nos jours de bonheur étaient comptés… Le premier avril 1922, c’était un samedi je m’en souviens, et nos deux familles était réunies pour fêter les dix-huit ans de Jeanne. On s’affairait en cuisine, et comme le temps était encore un peu frais pour la saison, la table était dressée à l’intérieur, argenterie, porcelaine et cristal. Ce matin-là, Albert s’était levé un peu plus tard que d’habitude, il était fatigué. Mais tiré à quatre épingles pour faire honneur à sa fille et à la compagnie, il s’occupait de servir les apéritifs au salon. Le repas fut très gai. Les affaires reprenaient timidement après une perte sèche sur les emprunts russes. Les hommes un peu grisés, racontaient des anecdotes grivoises. Et les exclamations fusaient, suivies de rires en cascade. Ce fut une très belle journée. Jeanne nous interpréta des valses au piano. Albert me prit dans ses bras et me fit danser. Cette valse nous en rappelait une autre...bien des années plus tôt. Dans l’après-midi, il partit s’allonger un moment. Et ne se réveilla jamais. Épargné par la guerre, Albert succomba à un infarctus. Il avait 47 ans. Je ne me souviens de rien. Juste un trou noir. Pendant des mois, je sombrais dans une espèce d’inconscience. Mon esprit refusait d’affronter la réalité. C’est ma Jeanne qui, du fond de son chagrin, a pris les choses en main, aidée par ses grands-parents. Elle trouva les livres de compte de son père, et s’en alla à travers la campagne recouvrir les créances de ceux qui voulaient bien payer. Elle vendit la librairie. Et commença à donner des cours de piano. Nos domestiques allèrent se louer ailleurs. Mais Jeanne qui avait hérité de son père le goût de la bonne chère, se mit en cuisine où elle se révéla particulièrement douée. Petit à petit, elle me ramenait à la vie. Son énergie, son courage, sa force intérieure m’aspiraient vers le haut. Et bien que jusqu’à aujourd’hui je n’ai plus porté que du noir, j’ai recommencé à voir les gens autour de moi, à m’occuper du poulailler que Jeanne avait aménagé au fond du jardin. Je retrouvais les gestes de mon enfance, le grain, les œufs, attention au renard ! C’est l’arrivée de Georges, puis son mariage avec Jeanne, qui m’animèrent un peu. La présence d’un homme dans notre famille me rassurait. Il s’est sûrement passé entre eux quelque chose que j’ignore. À la naissance d’Yvonne je crois…Jeanne a été très mal pendant un bon moment. Je me suis beaucoup inquiétée pour elle. Et puis tout est rentré dans l’ordre. Mais je reconnais que mon gendre a toujours été respectueux envers moi. Afin de ne pas les déranger, je m’étais installée dans deux pièces aménagées en studio au rez-de-chaussée. Leur laissant ainsi la jouissance du reste de la maison. Je secondais ma fille pour toutes les tâches du foyer. Je m’occupais de mes petits-enfants quand Jeanne donnait ses cours. Et cette vie, plus monotone que celle que j’avais menée avec Albert, me suffisait. Je n’ai jamais envisagé de me remarier. Je préférais garder dans un endroit secret de mon cœur le souvenir de notre grand bonheur. Et quelquefois, je regardais Jeanne, et je pensais que la vie nous fait prendre parfois des chemins bien étranges …. Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Suis-je vraiment la fille de mon père ? Bientôt, je sais que j’aurai toutes les réponses à mes questions. » Clotilde Veuve Dumas J‘ai les feuillets dans les mains...le temps est suspendu ! Je me sens si proche, si reliée à Clotilde que j’ai du mal à la quitter. Je serre les feuillets dans mes mains comme un trésor. Je dois retraverser le miroir du temps, mais je n’y arrive pas. Je suis en plein décalage horaire. Une partie de moi reste coincée dans les années 1900, où une évidence se fraye un chemin surprenant. Il y est question d’un secret de femmes, qui voyage de l’une à l’autre, et se reproduit au-delà du temps et de l’espace. Ma mère, ma grand-mère, aucune d’elle n’a connu l’homme qui leur a donné la vie. Et oui milliards non non non pas du tout été au magasin Ce fil tiré d’une génération à l’autre, comme si une logique mystérieuse présidait à nos vies, me plonge dans un certain malaise. Se pourrait-il que celui que j’ai toujours appelé « papa » ne soit pas en réalité mon père ? Et que l’histoire continue sa marche en bégayant, en se jouant de nous ? CHAPITRE 3 YVONNE - Jacques ! J’ai mamie Jeanne au bout du fil. Elle demande si tu peux passer après ton travail ; il y a une fuite d’eau dans la salle de bain de mémé Clotilde. - Pas de problème ! Dis-lui que je passerai tout à l’heure pour l’apéro ! » Ça, c’est mon Jacques ! Toujours prêt à rendre service ! Moi je n’ai rien à dire ! Si nous nous sommes rencontrés, c’est grâce à mamie Jeanne... et à son petit vin d’orange bien sûr ! C’était l’année qui a suivi le départ de papy Georges. Je m’en souviens parce que mamie aussi portait le deuil. C’était impressionnant de voir ces deux femmes en noir quand on entrait dans la maison ! En plein mois de janvier, un samedi, alors que nous étions réunies toutes les quatre, Clotilde, mamie Jeanne, maman et moi, voilà que la chaudière tombe en panne ! On avait beau enfiler les pulls, les chaussettes de laine et les mitaines, on claquait des dents en se croisant dans les couloirs, et une petite fumée se dandinait dans l’air à la moindre parole. Mamie téléphona à une entreprise de plomberie qui nous dépêcha un de leurs ouvriers en fin de journée. Celui-ci s’attela à la tâche, cerné par quatre générations de femmes habillées comme des ours polaires. La situation semblait beaucoup l’amuser ! Mais lorsque la chaudière se remit en marche, au soulagement général, notre sauveur ne put pas échapper au vin d’orange de mamie Jeanne. D’ailleurs, qui parle d’échapper à une telle merveille ? Vingt ans d’âge, totalement madérisé... il se déguste les yeux fermés, pour mieux laisser fleurir son doux parfum en bouche. Jacques est repassé le lendemain pour vérifier que tout allait bien... et re vin d’orange. De toute évidence, il était avec nous comme un poisson dans l’eau. Il nous abreuvait d’anecdotes drôles et même un peu chafouines en rapport avec son métier de plombier. Les endeuillées pleuraient de rire. Même maman Yvonne, d’habitude si réservée, pouffait en douce. C’est donc par vin d’orange interposé que nous échangeâmes nos premiers regards. Le sien, noir et pénétrant provoquait déjà en moi un sacré remue-ménage ! Pendant que Jacques s’active dans la salle de bain de mémé Clotilde, je laisse errer mon regard sur les photos de famille, toutes alignées dans des cadres argentés, sur le buffet du salon. L’une d’entre-elles retient en particulier mon attention ; on y voit ma mère assise au jardin, jouant du clavier au milieu des roses. « Yvonne est une femme de passion, me glisse dans l’oreille mamie Jeanne », et de poursuivre « Toute petite déjà, elle suivait sa grand-mère dans la roseraie comme son ombre. Pas vrai, maman ? lance-t-elle à l’adresse de Clotilde, qui fait semblant de dormir dans son fauteuil à bascule. C’est toi qui lui as tout appris : la taille, le bouturage, les différentes variétés »... À cet instant Clotilde ouvre un œil et dit : « Oui, je lui ai transmis pour les roses, mais la musique, c’est toi. Ce qu’elle aimait plus que tout, c’était leur jouer Beethoven, Haendel, Liszt, Bach,... et « les regarder pousser ». Elle prétendait que ses roses en raffolaient ! Elle n’a jamais été comme les autres ; toujours secrète, toujours à part, mais très déterminée ; elle a toujours su ce qu’elle voulait. Son autre passion tu la connais, elle en a fait son métier. C’est Georges qui lui a offert son premier appareil photos, et qui lui a appris à les développer. » Tout en parlant, elle désigne deux portraits en noir et blanc placés côte à côte sur le buffet ; un portrait d’Yvonne pris par son père et un portrait de Georges pris par sa fille. Mamie Jeanne les regarde avec tendresse. Et Clotilde d’ajouter : « Yvonne c’est une artiste ! Elle est douée pour tout. D’ailleurs elle a très vite trouvé du travail chez Monsieur Valot, le photographe, tu sais, celui de la grand’rue ! C’est elle qu’il envoyait faire les photos de mariage ou de première communion, parce que les clients revenaient enchantés. Quant à Madame Valot, c’était la spécialiste de l’évènementiel. Elle organisait les cérémonies comme personne ! Mais pour le choix des fleurs, elle s’en référait toujours à Yvonne. À cette époque, Etienne aidait son père à la pépinière... Il m’a raconté qu’il guettait toutes les apparitions d’Yvonne, subjugué par cette femme à l’élégance naturelle, qui connaissait les roses aussi bien que lui et restait parfois de longs moments les yeux fermés à humer leurs parfums. C’était écrit d’avance, ces deux-là devaient s’aimer. Mais comme ils étaient aussi timides l’un que l’autre, ça a pris un peu de temps. Le temps pour Etienne de créer un rosier délicatement parfumé, rose vif au calice crème, qu’il baptisa « Yvonne je t’aime ». Il avait su trouver le chemin de son cœur. Et ce n’est un secret pour personne que j’ai été conçue dans la vallée du Dadès, la fameuse « vallée des roses ». Mon père en avait ramené quelques plants qu’il a bouturé par la suite, jusqu’à se faire une petite réputation en tant que producteur de la « rose de Damas ». Quand je dis « mon père », je pense à celui qui m’emmenait le dimanche sur les chemins, ma main serrée dans sa main. Il était grand et fort, et moi j’étais fière d’avoir un papa comme lui. Il me racontait les arbres, les fleurs sauvages, les papillons, les oiseaux... avec lui, j’entrais dans le monde magique de la nature. Ma mère nous capturait dans son objectif. Elle aussi aimait cet homme, à sa manière, un peu détachée. Et on sentait bien qu’il existait entre eux une sorte de complicité secrète, faite de regards, de sourires, de signes discrets ; un monde comme une île mystérieuse où eux seuls pouvaient accoster. Oui d'accord d'accord mais n'importe quoi j'ai ce qu'il fautNous sommes tous les deux Jacques et moi, sous notre véranda. Il aime beaucoup ma famille, mais il prétend que s’il habitait la maison de Jeanne, il deviendrait vite alcoolique ! Il aime son indépendance, alors nous avons acheté un vieux pavillon qu’il rénove doucement, pas trop loin, mais pas à côté non plus ! Parfois il y a des silences qui s’installent entre nous, comme ce soir... je les reconnais à une qualité particulière de l’air ambiant, une vibration, une densité… je me tais… j’attends. Plus de petites rides coquines au coin de ses yeux, il réfléchit, sérieux puis me dit « Je ne t’ai jamais parlé de mon père. » Un silence s’installe alors. Ses yeux noirs prennent l’eau. J’ai toujours senti qu’il y avait là une porte à ne pas ouvrir, de peur de réveiller des ombres malfaisantes aux doigts crochus. C’est lui qui doit pousser la porte, pas moi. « Non, c’est vrai, tu ne m’en as jamais parlé..., lui répondis-je ». Il se reprit alors et poursuivit : « Mon père, il aurait pu être quelqu’un ! Il était majordome dans une grande plantation. Il était respecté. Mais quand ma mère l’a quitté pour un autre, il est devenu fou, il s’est mis à boire comme un trou. Moi, j’avais dix ans. Il me battait comme plâtre, à coup de ceinturon. Je me cachais pour essayer de lui échapper, mais quand il me retrouvait, c’était pire ! Il a perdu son travail, on était dans la rue, tous les deux, et il m’obligeait à mendier pour apitoyer les passants. Alors, je me suis enfui. J’ai travaillé comme mousse sur des bateaux, puis barman dans des hôtel à touristes, j’ai fait tous les métiers, jusqu’à ce que j’aie suffisamment d’argent pour venir en France. J’ai fait ma vie, je t’ai rencontrée, mais j’ai toujours vécu avec la peur, la peur que tu me quittes, la peur surtout d’être un mauvais père. C’est pour ça que je n’ai pas voulu d’enfant. » Il s’en suivit un blanc… Chacun de nous voyage avec ses émotions ; lui, traversé par un soulagement inquiet ; et moi, le cœur ouvert en grand pour accueillir cet homme en entier, enfin ! Il sait que c’est trop tard, même si mon cancer est guéri. Nous n’aurons plus jamais d’enfant. D'accord passer tout à l'heure bisousCette nuit, j’ai fait un affreux cauchemar. Ma mère me racontait une histoire que j’ai déjà entendue de sa bouche, mais dans mon rêve, tout était amplifié. Elle était à la maternité, elle venait d’accoucher en même temps qu’une autre femme avec qui elle partageait la chambre. Elles étaient heureuses toutes les deux et riaient ensemble de la bonne blague que la vie leur faisait ! Leurs deux petites filles portaient le même prénom : Rose. Je me suis réveillée en panique, mon cœur battait la chamade, un affreux doute s’était insinué en moi. Je les entendais rire... même prénom... Rose. Il me semblait reconnaître la marque du destin, celui qui peut tout inventer pour que le sens de l’histoire se perpétue à notre insu. Nous sommes en 1977, je viens d'avoir 30 ans. Tant de choses se sont passées ces deux dernières années ! Quand je dis "tant de choses", on pourrait croire que la terre a cessé de tourner autour de son axe. Au contraire ! Il y a bien quelques remous sociaux, des guerres ici ou là, des chiens qui se font écraser... mais pour Jacques et moi c'est une révolution qui s'est produite. Jacques a suivi une psychothérapie, et aujourd'hui, il n'en veut plus à son père, qui était un homme fragile et désespéré. Il connaît maintenant sa propre force, celle qui l'a poussée à l'âge de dix ans à prendre son destin en main. À retourner le gant du bon côté. Quant à moi... ai-je été échangée ou non à la maternité ? Cela n'a plus d'importance. Je ne voudrais pas avoir eu d'autres parents que les miens. Grâce à eux, j 'ai confiance dans la vie, je me sens épanouie. C'est bien eux que je choisis pour être mes parents. Il y a deux ans, nous avons adopté une petite fille, Anika. Elle est merveilleusement belle avec ses cheveux tout frisés, ses yeux brillants, ses sourires, sa peau dorée. Elle enchante notre quotidien. Elle est réunionnaise... comme son père. Aujourd'hui c'est spécial ! Nous avons posé un acte magique ! Il faisait un peu froid avec un beau soleil. Une belle journée de décembre. Nous sommes allés à l'océan tous les trois. Jacques serrait sa fille dans ses bras. J'ai dessiné un grand cœur sur le sable avec nos trois prénoms à l'intérieur : Jacques, Rose, Anika. Le vent jouait dans nos cheveux, il a emporté mon cœur. J'ai pris la bouteille, nous avons glissé le message à l'intérieur ; nous l'avons remis à la mer. Un jour nous en sommes sûrs, quelqu'un le trouvera. C'est Jacques qui a écrit : « Le vrai père, c'est celui qui aime son enfant et qui l'élève... le plus haut possible ! » Anika s'est endormie avec une histoire que lui a lu son père. Jacques me rejoint. Nous avons un rituel, Quelle que soit la saison, chaque fois que le temps le permet, nous allons faire quelques pas dehors à la nuit tombée, pour regarder le ciel. Cela m'apaise de penser que nous sommes une petite parcelle de cet Univers infini, que nous appartenons à ce grand corps vivant. Il me semble que nous sommes des bouteilles nous aussi sans le savoir. Plongées dans la mer immense de la vie... nous portons de bien mystérieux messages au creux de nos cellules.
Odile
et "Elles s'accomMODEnt" publié aux éditions Spinelle
a décidé de passer de l'autre côté du miroir, pour pénétrer l'univers du "passeur de mots".
Elle propose des ateliers d'écriture - en résidence - dans sa villa "Pierre Raphaël" située près du port à Andernos Les Bains. À ceux qui veulent franchir cet univers si fécond en lecture et écriture, elle ouvre ses portes le temps d'un stage où les participants pourront se livrer à l'exercice d'une écriture sous conduite autour de la notion essentielle des souvenirs : "se raconter" ; "raconter".
Se ressourcer dans un lieu apaisant, prendre quelques jours et attraper ses souvenirs, tel est l’objectif de cette résidence d’écriture. Être ce passeur qui fait lien entre les générations, écrire pour soi ou pour les siens, écrire seul(e) ou en groupe. Cette expérience vous embarquera dans une aventure pleine de mots et de promesses.
"le souvenir a le même pouvoir que l'écriture", - nous le transportons partout où nous allons - aime ajouter Annick à cette citation d'Amélie Nothomb.
site : https://leporteplume.org
Romans écrits par Annick Julliard
« Tu accoucheras dans la douleur... » Quelle faute une femme doit-elle expier si elle souhaite trouver sa place parmi les hommes ? Angélique, modeste garde-barrière dans les années cinquante, est brisée par les violences que la vie lui inflige. Pour survivre, elle cherche dans les livres la plume qui lui permettra de retrouver cette sensation ou l'espace rassure et ou le temps qui passe n'a plus d'importance, car il devient infini. Emmaillotée dans la chaleur des mots, la vie lui revient peu à peu. Après une vie professionnelle d'orthophoniste consacrée à réparer les « mots cassés », « les mots tordus » et les « mots qui manquent ». Depuis la parution de ce premier roman publié en novembre 2021 aux éditions Vérone, Annick Julliard continue de s'investir dans l'animation d'ateliers d'écriture en résidence.
En savoir plusDans le milieu de la mode, trois femmes créent leur costume singulier. Hanna imagine le caraco original à porter sur une robe de littérature. Benny opte pour une dangereuse liberté créative en accord avec son homosexualité. Quant à Jeanne, son choix d’un justaucorps sado-maso de cuir s’avère être une tenue douloureuse à porter. L’entrelacs des fils et des mots est souvent harmonieux, parfois discordant. Mais, peu importe, les vêtements, comme le langage, réchauffent et aident à faire face aux évènements que la vie réserve. Après une vie professionnelle d’orthophoniste, Annick Julliard continue de cultiver sa passion pour l’écriture en signant ce nouveau titre dans lequel elle fait résonner la sensibilité de chacun de ses personnages.
En savoir plusAprès avoir obtenu une maîtrise à l’École Supérieure des Arts et Industries Graphiques de Paris et un master en communication visuelle à Birmingham, en Angleterre, elle débute sa carrière en graphisme avec un stage chez Magnum Photo.
Cinq ans plus tard, ayant émigré au Canada, elle décide de se réorienter vers la céramique et se passionne pour la lithographie sur argile aux côtés de l’artiste Linda Swanson, combinant dès lors sa passion pour la photographie, l'imprimé et l'argile. Son travail a été présenté dans plusieurs galeries et événements en Amérique du Nord et en Angleterre. En 2021, elle reçoit le Prix d'excellence en céramique lors du Toronto Outdoor Art Fair, la plus grande foire d'art au Canada.
Nous sommes heureux de la compter parmi nous et de sa contribution à cette diversité artistique qui traverse tous les membres des l'association.
site : https://www.emiliecoquil.com
toutes les photos et illustrations de la galerie sont protégés par le code de la propriété intellectuelle et les lois internationales sur le droit d'auteur.
Processus de fabrication
Mon processus créatif...
... débute par une errance photographique, où je m'attache à cadrer tantôt les êtres, tantôt les architectures qui, marquées par le temps et la vie, se dérobent au regard. Puis vient le temps de l'atelier, où les images sélectionnées prendront une nouvelle dimension poétique. Mon support d’impression est une matière vivante et exigeante : l’argile crue. L'étape de l'encrage de la plaque d'argile façonnée est décisive.
À la manière des pictorialistes...
... mon objectif n’est pas de décrire fidèlement le réel, mais de me l’approprier. J'interviens librement sur la matière même de l’image lithographiée à la main. Je gratte, grave et laisse les pigments se répandre, jouant avec le hasard. J’exploite les imperfections et les erreurs inhérentes à cette technique pour déconstruire, épurer, puis reconstruire l’image, jusqu’à ce qu’émerge une œuvre singulière, empreinte des gestes de sa fabrication.
Finalement...
... chaque plaque sera séchée avec attention, cuite, émaillée, puis cuite à nouveau pour atteindre son caractère inaltérable.
Galerie
au service du texte
site : https://www.lucileberanger.com
toutes les photos et illustrations de la galerie sont protégés par le code de la propriété intellectuelle et les lois internationales sur le droit d'auteur.
Galerie
explorer toutes les techniques pour une plus grande satisfaction...
2023
le mardi 12 décembre 2023
à la Médiathèque d'Andernos les Bains une lecture publique des trois nouvelles primées à l'occasion du concours de nouvelles 2023.
Premier prix :
"la troisième veilleuse"
Hélène Pont
(Andernos-les-Bains)
Deuxième prix :
"Clair de mer"
François Testut
(Le Vignon en Quercy)
Troisième prix :
"Grain de sable"
Jacqueline Thouement
(Epinay sur Orge)
Le public venu nombreux a pu apprécier la qualité des textes déclamés et les projections de lumière sous la direction de Pascale Billard pour la mise en scène.
Lecture Publique 12 décembre 2023
Les 6 lectrices ... (de gauche à droite : Vessela, Martine, Fabienne, Corinne, Annick) et Pascale Billard pour la mise en scène et la conduite d'acteurs
L'équipe au grand complet avec André Copin responsable des lumières et du son
Nouvelles
Il est encore bien tôt à Andernos-les-Bains en ce matin d’octobre et pourtant toutes les chambres de la « Villa Suzy » sont déjà éclairées, même celles de l’étage. Dans la cuisine, les adultes s’affairent et l’odeur du café gagne bientôt la salle à manger, où la table a été dressée depuis la veille. Chez Suzanne et Yvan les petits déjeuners sont toujours joyeux et copieux. Au milieu des bols bretons, où chacun cherche - et trouve - depuis des années son prénom, trônent les incontournables confitures de la maîtresse des lieux, entourées par des fruits et du pain frais. Rapidement, la tablée est au complet. Quatre générations réunies ! Toutes les rallonges sont de sortie et comme chaque année, la grande nappe étale ses rayures colorées. Pourquoi changer les habitudes après tout ? Pour la première fois, pourtant, tout le monde avait participé aux préparatifs. « Allez zou ! » S’exclame Yvan en frappant ses mains. « C’est le moment d’y aller. La marée sera haute à 10 heures 45 et je voudrais être au port au moins deux heures avant la pleine. » Agitation autour de la table, brouhaha de rangement et derniers préparatifs de départ. On y est presque. Comme chaque année c’est le « grand coup de feu » avant le départ ...un peu plus même, peut-être. Il avait été convenu que les arrières petits-enfants ne viendraient pas. Ce matin, ils seraient donc huit adultes à bord : eux, leurs deux filles, les gendres et les petits fils, qui étaient dans la trentaine maintenant. Lucie, une nièce andernosienne avait proposé de venir garder les plus jeunes, et elle était déjà à pied d’œuvre. Les petits avaient râlé, pour le principe, puis avaient regardé partir les grands, en envoyant de leurs doigts, milles baisers mouillés. Les derniers détails de la sortie avaient été réglés pendant le dîner : « Il ne pleuvra pas demain » avaient annoncé les gendres en confirmant un joli coefficient de 89. De leur côté, les petits-fils avaient vérifié la force du vent sur l’application dédiée, que leur grand-père ne se résolvait toujours pas à installer, arguant du fait que son exemplaire de Sud-Ouest lui révélait exactement la même chose ! Pas de tempête à l’horizon, juste une brise légère. Ce serait donc la journée idéale pour s’en aller saluer, en grande pompe, les Cabanes Tchanquées. Suzanne les avait toujours aimé ces deux-là. Elle les nommait indifféremment « les gardiennes du Bassin » ou encore « les veilleuses à talons ». Au fil des années, les gendres avaient fini par s’habituer à cette incontournable organisation. Depuis leur mariage avec les sœurs Quéménec, ils savaient qu’ils ne pouvaient y couper. Impossible de manquer les traditionnelles retrouvailles et cette fois-ci encore moins ! Suzanne et Yvan Quéménec avaient en effet inscrit ce second week-end d’octobre sur du marbre blanc. En été, disaient-ils, « Andernos est bondé et puis vous avez tous des programmes de ministres. A Noël, il faut bien partager les filles avec les belles familles ! » Donc Suzanne avait décrété que le weekend autour de son anniversaire serait indiscutablement « son » weekend et que toute la tribu était priée de venir l’aider à passer son cap annuel. Elle le disait sur le ton de la plaisanterie, mais personne n’aurait songé à surseoir. Depuis le temps, chacun désormais dans la famille, connaissait sa partition sur le bout des doigts. Il y avait certes de la fantaisie, et des surprises dans cette famille mais tout était quand même réglé comme du papier à musique ! Et tant pis si Yvan et Suzanne racontaient invariablement les mêmes histoires. Ce matin, d’ailleurs, les beaux-fils ne purent échapper à la énième narration d’Yvan, le Breton de Belle-Ile. « Vous savez », leur dit-il en se servant un second café, « Cela n’a pas été simple de quitter mes rochers de granit, ma côte déchiquetée et mes tempêtes d’anthologie ! Tout larguer et venir me poser sur ce Bassin, où il y a plus de sable que d’eau ! » C’est vrai qu’il avait fallu à Suzanne une belle rhétorique pour le convaincre de venir à Andernos. A l’époque, le fiancé avait trouvé le coin bien plat et beaucoup trop vaseux. Mais elle y avait déjà une très bonne situation, une maison de famille et un florilège de bons arguments. Et puis surtout, comment résister à Suzanne ? Au fil des ans, Yvan s’était habitué à ce paysage qui encerclait l’eau de ses deux grands bras. Il s’y était laissé bercer et il y était désormais comme chez lui, ou plutôt ils y étaient chez eux. Aussi sûrement que la Noël, chaque année revenait le rituel d’octobre. Quel que soit l’horaire de la marée, et quel que soit le temps, on allait en famille saluer les « gardiennes du Bassin » et souhaiter à Suzanne son anniversaire en pleine mer. Comme elle adorait le champagne, à bord, il était de coutume de trinquer à sa santé. Ensuite la famille rentrerait à la Villa, qui avait été rebaptisée « Suzy » après leur mariage, pour y partager un colossal plateau d’huîtres. Le couple avait ses habitudes sur la dernière darse, chez Julien, le fils de Jacques, qui se disait retraité mais que l’on voyait souvent trainer à l’atelier. Après quoi, dans la salle à manger, toute la famille s’extasierait sur le merveilleux Saint-Honoré de Suzy, dont les choux accueillaient chaque année davantage de bougies. L’une des deux filles lancerait alors leur air préféré. Dès les premières mesures, le vieux couple, un peu grisé, esquisserait alors les pas d’une fameuse valse gasconne pleine d’allégresse et de mélancolie. Voilà, ils sont tous prêts et la tribu, peut enfin quitter la Villa ! En arrivant devant Saint-Eloi, les trois générations observent entre les troncs noueux des pins et le clocher blond de l’église, que l’eau est déjà bien haute. Pas de problème de stationnement ; les touristes de l’été étaient partis depuis longtemps et ceux de la Toussaint n’arriveraient qu’à la fin du mois. Avec leurs salopettes cirées, les ostréiculteurs étaient déjà à l’ouvrage. Les plates avaient rejoint les parcs depuis que l’eau s’était engouffrée dans le chenal. De part et d’autre des quais, toute la cacophonie d’un port au petit matin : le cliquetis mécanique d’antiques tapis roulants, le jet continu des bassins, le claquement des tuyaux sur les casiers, le vacarme des cribleuses, les éclats de voix d’une cabane à l’autre, le ronronnement des moteurs qui s’échauffent avant le départ. On se saluait. Les mains sortaient des poches pour un signe discret ou pour de grands gestes. Au coin des bouches des sourires, des grimaces, un gobelet de café ou quelques cigarettes roulées. La vie du port, toujours et encore. La vie qui bat son plein et qui vous éclabousse. En rang serré, Les Quéménec traversent en silence cet espace saturé de mouvements et se dirigent vers La Chamade. Quelques mouettes, posées à l’avant du bateau s’envolent à l’arrivée de la famille. On se prend la main, on se tient le bras, on enjambe. Chacun veille sur l’autre prenant garde à une chute, qui viendrait tout gâcher. La glacière est posée avec précaution dans la cabine, que Gabrielle vient d’ouvrir. De façon naturelle, les deux filles Quéménec prennent les choses en main. Elles sont entièrement habitées par l’organisation de cette journée. Aujourd’hui, Yvan leur fait suffisamment confiance pour les laisser manœuvrer et piloter. Il faut dire que Gabrielle et Gaëlle sont allées à bonne école : avec ce père bellilois, difficile de ne pas avoir le pied marin ! Elles ne comptaient plus leurs heures de stages de voile et elles avaient eu leur permis bateau bien avant leur Bac. Du côté de leur mère, l’héritage « marin » était plus mitigé. Certes Suzanne aimait l’eau mais elle adorait aussi la terre ferme, qu’elle parcourait indifféremment à pied ou sur son vieux vélo. Enfin, comme elle aimait à le rappeler, « dans cet environnement de sable, de lagunes, de marais, et de fleuves saumâtres, la notion de fermeté reste toute relative... Ici on est toujours dans un entre-deux, vaguement mouvant ». Depuis toujours, à bord, Yvan regardait vers le large et Suzanne vers la côte. Une fois installés, Yvan prend sa femme tout contre lui. A partir de là, ils ne bougeront plus. C’est ce qui a été convenu hier. Chacun est à sa place. Tous les objets sont bien calés. Gabrielle met le contact pendant que Gaëlle ouvre les coffres et largue les bouts. L’air est limpide mais l’eau, encore lourde de vase, garde sa couleur de plomb. Presque sans un bruit, La Chamade quitte son emplacement. D’un signe de la main, Yvan répond aux saluts de quelques-uns de ses « collègues du port ». Des prénoms fusent, suivis de francs sourires. A l’embouchure du chenal, Gabrielle accélère. La fraîcheur de la brise s’impose alors à tous. Ce n’est pas comme si Suzanne ne l’avait pas répété cent fois : « En mer, il faut une tenue légère pour le port et puis une plus chaude pour le Bassin ». Ils se sourient et commence alors la valse des bonnets et des casquettes. Cabans bien croisés et marinières boutonnées, personne ne songe pourtant à rentrer dans la cabine. D’un geste attentif, Yvan entoure Suzanne de sa grande écharpe rouge ; sa femme a toujours été un peu frileuse. A bord, chacun retrouve le plaisir immuable de « rentrer dans le Bassin ». Être une fois encore abasourdi par la rotondité parfaite de ce giron aquatique, scruter les oiseaux en équilibre sur les pignots, regarder disparaître les zostères, sentir l’air salin prendre le dessus sur l’odeur des pins, reconnaître les maisons et les désigner tout en les commentant. Revoir ce même spectacle pour la énième fois et toujours s’en émerveiller : c’était ça la magie du Bassin ! Transportés par les petits chevaux vieillissant de cette Chamade, qui les avait vus grandir, ils accomplissent ensemble leur pèlerinage annuel. L’horizon est dégagé ; en dehors de quelques plates autour des parcs, le Bassin est à eux. Au loin, sur la plage, les petits « voileux » des classes de mer préparent optimistes et dériveurs dans une joyeuse pagaille. Ils auront du mal à prendre le large si le vent les boude. A tribord les passagers laissent filer non sans nostalgie l’Ile aux oiseaux. Combien de pique- niques et de goûters sur cette lande rase, posée sur la vase ? Petites, les deux filles Quéménec adoraient cette île et la plage de Saint-Brice, qui lui fait face. Plus que tout, les sœurs adoraient les endroits où elles pouvaient « jouer à l’aventure ». Gabrielle et Gaëlle, que leur père surnommaient affectueusement les « Ga-Ga », avaient vraiment été élevées comme deux petits gars. Aujourd’hui encore, en croisant au large de l’île, elles se souviennent, comme chaque année, des histoires fabuleuses inventées par leurs parents. En pleine nature ou sur l’eau, l’imaginaire d’Yvan et de Suzanne était sans limite. Yvan aimait à répéter qu’il était fils de l’océan. Il connaissait sur le bout des doigts le nom de tous les poissons, des oiseaux, des insectes et des rongeurs. Il imitait leurs cris et mimait leur déplacement. Il faisait tout à la fois le clown et le cuistre. Jeune papa, Yvan avait inventé pour ses filles tout un monde de légendes, où l’animal régnait en maître. Dans ses histoires merveilleuses, les chasseurs les plus malins, malgré leurs attirails couteux, capitulaient devant l’intelligence supérieure de la faune de l’île. Lorsque leur père s’était suffisamment fatigué la tête et la bouche de ses grandes épopées iliennes, les petites se tournaient vers leur mère. Suzanne posait alors l’un des nombreux romans qu’elle avait en cours et elle embarquait ses filles dans ses histoires. Elle en appelait aux contes du Sud-Ouest et à la mémoire de sa ville. Elle évoquait tour à tour les fées des dunes, les dames des lagunes et les esprits des forêts. Elle racontait la vieille Sarah Bernhardt, devenue unijambiste et promenée par ses gens sur une chaise à porteurs Louis XV. Elle décrivait ses tenues extravagantes, ses rituels et ses frasques comme si elle l’avait intimement connue. Pour ses filles, Suzanne convoquait ce qui avait été et qu’on ne voyait plus : le Casino de la jetée, les belles demeures disparues, les marais, les sources et les pierres ancestrales. Elle était native et comme elle le disait souvent, l’eau du Bassin coulait dans ses veines. Les « Ga-Ga », biberonnées par les histoires locales réelles ou farfelues, gardaient avec ce territoire, autant qu’avec leurs parents, une relation fusionnelle. L’île aux oiseaux est maintenant derrière eux. Les cygnes, indifférents, continuent de glisser sur les flots avec un profond dédain pour l’équipage. Gaëlle prend le relais de sa sœur aux commandes et c’est à présent au tour de Gabrielle de venir s’asseoir auprès de ses parents. Personne n’a envie de se presser. Le temps s’étire, comme suspendu. Finalement, La Chamade arrive enfin à hauteur des « grandes veilleuses ». La marée cache déjà une partie de leurs échasses. A l’approche, les deux cabanes paraissent toujours plus imposantes. Au loin, se devine la porte par laquelle l’océan remplit et vide le Bassin dans son éternel mouvement répétitif. Gaëlle ralentit. Les gendres et leurs fils savent qu’ils sont presque à destination et ils se préparent eux aussi à entrer dans la danse. C’est en effet toujours ici, un peu à l’écart du clapot du chenal, que les Quéménec viennent mouiller. On ne badine pas avec les traditions dans cette famille et c’est au plus jeune qu’il revient de jeter l’ancre. Aujourd’hui, c’est donc à Alexandre d’accomplir cette tâche, pendant que les autres s’occupent de la glacière, des coupes et du champagne. Le ciel est bien dégagé. A gauche, Arcachon apparaît nettement et à droite la presqu’île se dessine derrière son épaisse verdure. Les rumeurs de la terre se sont étiolées, le moteur s’est tu. Seul le clapotis des vaguelettes ricoche contre la vieille coque blanche et verte, La Chamade tangue légèrement. Comme prévu pourtant, avec précaution, et dans le silence mouvant de la mer, ils se lèvent tous, un peu chancelants. Les flutes ont été servies et les bulles calent leur mouvement sur celui du roulis. Les filles entourent leurs parents. Doucement les gendres et leurs fils entonnent la veille ritournelle landaise, qu’ils tiennent de Suzanne et qu’ils ont répétée la veille. Ils veulent la chanter avec le cœur et à l’unisson. C’est une très vieille histoire de terre qui tremble et de colère qui gronde. C’est une histoire où les éléments, les choses et les gens restent mystérieusement et éternellement reliés. Le froid, soudain, leur semble plus mordant et Yvan ajuste l’écharpe autour de sa femme. Puis délicatement, aidé par ses filles, il se détache enfin de Suzanne et pivote avec elle vers la mer. Dans un geste simple et très beau, il esquisse un pas de danse et la renverse dans l’eau. Les cendres de Suzanne rejoignent alors, en petites vaguelettes paisibles, les gardiennes du Bassin. Non loin des cabanes, la troisième veilleuse vient de prendre place ; pour la famille Quéménec, elle restera, de loin, la plus visible.
Hélène PONT
La troièsme veilleuse
Debout derrière d’immenses baies vitrées, Luc Daubin, tasse de thé fumante en mains, regardait le Bassin. Au loin, les éclairs écorchaient le ciel. Si leur installation dans cette somptueuse maison d’Andernos permettait de rapprocher son épouse de ses parents vieillissants, c’était pour lui aussi un retour aux sources pimenté d’un challenge. Luc était un ambitieux, avide d’hégémonie. Il s’était fait les dents à Paris. Cette nouvelle situation avait de quoi lui donner du mordant et de quoi grignoter quelques degrés supplémentaires sur la pyramide du pouvoir. Il avait rapidement été remarqué pour son entregent par les notables du coin. La vivacité de son regard magnétisait ; son intelligence séduisait ; ses connaissances rassuraient. Et demain, lundi 9 octobre 2028, il rencontrerait le président de la région Nouvelle Aquitaine et lui présenterait son plan pour le renouveau industriel du Bassin. Il était temps d’agir. Déjà, le trait de côte avait reculé ; la bande entre Le Cap Ferret et Claouey avait disparu ; la réserve naturelle nationale des prés-salés était définitivement sous l’eau et le front d’Arès à Andernos, sévèrement atrophié. En quelques années, c’était tout un pan de l’économie du Bassin qui était passé de l’éventuelle-possibilité-d’un-insignifiant-déclin-de-l’activité-économique-et-touristique à un délabrement quasi incontrôlable de sa richesse d’antan. On se rappelait avec amertume la flambée des prix de l’immobilier huit ans auparavant que le peu de biens disponibles sur le marché avait justifié ; le tourisme hôtelier florissant ; l’acmé de l’activité ostréicole et la construction de trois nouveaux chantiers navals pour répondre à la demande grandissante de plaisanciers français et surtout étrangers, envoûtés par le charme et la beauté du Bassin. Tout avait périclité avec l’inexorable montée des eaux, la pollution du Bassin dû à la densification de la population et à l’emploi de pesticides, l’extinction des herbiers de zostères, la désertion de l’Ile aux Oiseaux, la mise à l’arrêt des chantiers navals, la contamination de l’ensemble des parcs à huîtres, première richesse du Bassin. Tout cela avait disparu ; des Arésiens aux Arcachonais en passant par les Gujanais et les Testérins, tous pleuraient un passé prospère dans un cadre de vie précieux. L’Île aux Oiseaux ne servait plus de reposoir. La démarche singulière du limicole côtier et la délicatesse du gravelot à collier interrompu n’était plus qu’un vague souvenir immortalisé dans l’atlas de la biodiversité. Luc était un ponctuel. Il arriva rue François de Sourdis à 8h45. Paul Vinsac venait d’être élu à la tête du Conseil Régional. Il l’imaginait enclin à quelques largesses en son début de mandat. Luc avait studieusement et stratégiquement préparé le dossier qu’il voulait soumettre au président. Il avait peaufiné ses arguments. Son idée était simple. Il se demandait pourquoi personne, à sa connaissance, ne l’avait encore mise sur la table. Puisque le message martelé par le gouvernement était de tout axer sur la transition énergétique, et puisque le Bassin était devenu impropre et inexploitable, il convenait de lui trouver une nouvelle vocation. L’idée lui était venue alors qu’il lisait dans la presse en ligne un article sur le stockage des énergies renouvelables en Gironde par batterie lithium-ion. La société qui s’était lancée dans cette activité dès 2020 cherchait toujours des nouveaux terrains pour construire des entrepôts de stockage de plus en plus vastes pour ces fameuses batteries qui, elles-mêmes, stockaient de l’énergie. Du stockage de stockage, en somme. Son activité était prospère. D’autres grands noms de l’Energie lui avaient emboité le pas. Le besoin était exponentiel et, curieusement, il n’y avait pas de concurrence. Des études scientifiques plus récentes faisaient miroiter des ressources illimitées en lithium grâce à l’eau de mer. Il n’y avait pas que dans le Grand-Est ou en Auvergne où l’on avait trouvé des gisements d’importance mondiale. Le lithium ne se trouvait pas exclusivement dans la croûte terrestre mais également dans les mers. Le Bassin avait là une opportunité de tirer son épingle du jeu et de devenir leader français dans l’exploitation lithinifère. Elle était là, la revanche du territoire ; dans l’eau de mer qui grignotait inexorablement le littoral. Convertir le Bassin en pôle d’exploitation du lithium n’était plus une utopie ; il fallait simplement qu’un dirigeant de région audacieux s’en saisisse. Une production de lithium on ne peut plus locale, voilà qui devrait séduire les élus ! Pour couronner le tout, on pouvait sérieusement envisager à proximité une usine de retraitement des batteries. L’apogée du circuit court ; on produit, on stocke, on retraite sur le même territoire. Tout cela promettait le rejaillissement du Bassin et de donner à la France un statut de leader d’un empire industriel européen voire mondial. Luc jouait gros mais il voulait convaincre le président de région de signer un contrat avec le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) afin de procéder sans délai à des premiers sondages et analyses des ressources du Bassin. Il fallait être réaliste, ne plus se voiler la face. Non, les touristes ne reviendraient pas. La page de la carte postale des cabanes tchanquées, des pinasses rutilantes repeintes chaque année et de l’Île aux Oiseaux avait été tournée. On n’en était plus là. C’était une question de souveraineté énergétique avant même d’évoquer une question de survie. Tout le monde voulait bien recharger sa voiture, sa trottinette ou son vélo ainsi que ses innombrables objets connectés dont l’utilité était bien souvent plus que douteuse mais de là à exploiter du lithium au cœur du Bassin, il y avait une distance à ne pas sous-estimer, une ligne rouge à ne pas franchir. Il faudrait donc convaincre et s’attendre à une levée de boucliers de la part des écologistes déjà bien remontés face à la déchéance de leur territoire. Mais côté industrie il y avait fort à parier que l’Europe encouragerait le projet et le financerait ; surtout avec le millier d’emplois à la clé et le rajeunissement de la population qui en découlerait. Un véritable renouveau du Bassin ! Luc utilisait savamment ses charmes de fin négociateur auprès du président et présentait les uns après les autres ses imparables arguments. Il finirait de le convaincre au Chapon Fin réputé pour son excellence culinaire accompagnée d’une bouteille de Château Phélan Ségur …même deux s’il le fallait. Son concept n’était pas saugrenu. Après la deuxième bouteille de Phélan Ségur il devenait déraisonnable de s’opposer à une idée si novatrice et si prometteuse. De retour à son bureau, le président tenterait d’appeler le directeur du BRGM (un ami, disait-il) ; au besoin, Luc se proposerait pour composer le numéro à sa place au cas où le président aurait la main peu assurée. Plus tôt les analyses commenceraient, plus tôt on aurait une idée du potentiel d’exploitation du Bassin…si potentiel il y avait. La journée avait été épuisante. Malgré toute l’énergie qui le caractérisait, Luc vivait comme une compétition d’athlétisme chacune de ses démarches de lobbying. Il en ressortait rincé, vidé de sa vigueur et de son enthousiasme. Rien de tel, pour se reconstituer, qu’un tour sur la dune du Pilat. Alors il configura sa Tesla 8.0 en mode autonome, modifia son siège en position relax, ordonna à Juliette, son ordinateur de bord personnalisé, de lancer The Dark Side of the Moon de Pink Floyd et de le transporter jusqu’à la dune. Voilà des mois qu’il ne s’y était rendu alors que son épouse et ses filles le tannaient tant elles aimaient ce lieu. Plus petites, dès que l’escalier était mis en place début avril, elles escaladaient la montagne de sable en une course effrénée ; l’une par l’escalier, l’autre s’enfonçant à mi mollets dans le sable tiède à en hurler de rire jusqu’à atteindre le sommet et être la première à lancer son cri de victoire. Elles répétaient le défi à l’envi jusqu’à épuisement. Elles s’auto-congratulaient de leurs performances puis se récompensaient en se gavant de dunes blanches, d’exquises chouquettes garnies d’une onctueuse crème framboise-chocolat blanc. Luc s’était assoupi au cours du trajet. Juliette le réveilla de sa voix sensuelle, sans le brusquer. En cette fin d’après-midi, le ciel était dégagé et une belle et douce lumière s’étendait plein ouest. Bientôt le soleil sombrerait dans la mer puisque le Banc d’Arguin n’affleurait plus et napperait l’horizon de gomme-gutte. Luc se redressa de son siège. Et ce fut un choc. Les pelleteuses s’activaient autour de la dune en une étrange chorégraphie. Le spectacle était écœurant. Les poignes d’acier mordaient dans la dune déjà dramatiquement entamée par l’érosion, arrachant à chaque passage de gargantuesques bouchées de sable qu’elles dégueulaient aussitôt au-dessus des remorques qui se présentaient en un convoi continu telles les chenilles processionnaires. On en était donc arrivé à ce point ! Aveuglé par sa folle idée d’exploitation de lithium dans le Bassin, Luc avait minimisé inconsciemment l’autre défi de taille auquel le pays faisait face : la montée des eaux, le recul du trait de côtes. Tout autour du Bassin l’étendue des dégâts était pourtant déjà sensible. Plusieurs centaines de maisons et de logements collectifs avaient disparu sous les eaux. D’autres avaient été évacués et seraient démantelés dans les mois prochains. Sa propre maison était située dans le quartier Lalande à Andernos, en sursis. Quand devraient-ils à leur tour renoncer à leur superbe demeure dont la terrasse suspendue offrait une vue sur le Bassin à vous couper le souffle ? Luc était dans le déni alors que le relogement était une priorité pour la région. Pourtant, pour construire, il fallait du sable en déficit dans le lit des rivières. Forons local ! Puisons local ! Dégradons local ! Massacrons local ! Telle pouvait-être la devise du pays. On s’en prenait à la dune de son enfance avec le gourbet, la linaire à feuille de thym et le diotis maritime ; tout ce qui l’avait animé étant enfant ; toute cette richesse qui l’avait nourri. Et puis quoi ! On construirait quelque part du côté de Blagon ou de Marcheprime là où les feux de forêts répétés de ces dernières années avaient laissés des étendues dévastées à perte de vue ; et tant pis si l’on sacrifiait un morceau du parc régional ?! Et quel projet voulait-il imposer à présent ? Dégénérer plus encore le Bassin ! Il se dégoutait. Soudain le vin harcela ses tempes et son ventre se crispa. Il n’eut pas le temps de commander à Juliette de libérer l’ouverture de la portière. Il soulagea ses entrailles sur le siège passager. Lorsqu’il rentra enfin chez lui, il était déjà tard ; les filles dormaient. Il n’avait pas répondu aux appels répétés de son épouse qui devait être morte d’inquiétude. Elle le connaissait mieux que personne. Elle savait sa fragilité psychique derrière ses airs de conquérant. Elle sentait ses failles. C’était son Don Quichotte à elle. Elle redoutait de le retrouver chaque fois qu’il avait un projet à défendre, qu’il croyait dur comme fer avoir rallié son auditoire et que, quelques heures ou quelques jours plus tard elle le récupérait brisé, anéanti parce qu’on lui avait dit « non ». Ce soir-là, il était différent, torpide. Il était rentré vers 22h alors qu’elle faisait les cent pas entre la cuisine et le séjour. Elle remarqua aussitôt sa chemise fripée qui ressortait négligemment de son pantalon ; les souillures sur sa chemise qui dégageaient une horrible odeur aigre. Il avait pleuré ; ses joues affaissées étaient marquées comme celles d’un enfant tombé dans la poussière et qui aurait essuyé son visage de ses mains sales. Elle ne dit rien. Elle le prit simplement par la main et le guida jusqu’à la salle de bain. D’un simple mot elle commanda la douche connectée. Elle lui ôta ses vêtements ; il se laissa faire ; s’avança sous le jet. L’eau chaude ruisselante sur sa peau sembla l’extraire progressivement de sa prostration. Après un instant, elle le laissa et s’en retourna lui préparer un thé blanc de Thaïlande, son préféré. Elle ne lui poserait pas de questions ; elle le laisserait venir à elle ; ça prendrait peut-être un peu de temps mais il finirait par se libérer du tourment qui l’avait gagné. Et elle s’assurerait qu’il prendrait bien son traitement, un thermorégulateur à base de sel de lithium. Qu’elle ironie ! Depuis la cuisine, elle regardait par la fenêtre les éclairs dans le lointain. En cette saison, il était fréquent de passer d’un ciel clair à une chape de nuages sombres déchirés par des flashs aveuglants. Elle compta ; l’orage se rapprochait à grands pas. L’eau de la bouilloire était à température. Elle la versa sur le thé. Dans trois minutes, l’infusion serait à point. Elle irait le retrouver dans la salle de bain ; elle l’envelopperait de toute sa tendresse dans son peignoir chaud et moelleux. Puis elle le conduirait dans le salon où elle avait ménagé une ambiance feutrée et relaxante, allumé quelques bougies parfumées et commandé à la chaine hifi de diffuser les plus belles voix du jazz. Lorsque le tonnerre fracassa la nuit et que l’électricité crépita et vacilla dans la maison, elle n’entendit pas le coup de feu en provenance de leur chambre à coucher.
Jacqueline THOUEMENT
Grain de sable
Dès les premières lueurs de l’aube, il lui tardait de se lever. Elle s’était pourtant astreinte à rêvasser un moment, tranquillement allongée, le temps de bien se réveiller. Puis, avec énergie, elle était sortie du lit et s’était dépêchée à s’habiller. Prenant son son sac apprêté la veille au soir, elle quitta l’appartement, traversa le jardin et enjamba le petit portail en bois. Le chemin étroit et tout d’abord herbu s’offrait à elle. Accompagnée par les senteurs matinales des herbes sauvages, elle allait d’un bon pas. Native de ce coin de terre, elle ne se lassait pas de sillonner l’endroit qu’elle parcourait avec sa sœur, depuis leur plus tendre enfance. L’herbe se fit plus rare. Le sol s’amollissait sous ses pas. Finalement c’est le sable qui l’accueillit. Encore un lacet, et le voilà devant elle. Il agissait sur elle comme un aimant. En cette fin d’hiver, jour de grand coefficient, la marée continuait à monter. Elle était impatiente d’être mordue par la fraîcheur de l’eau. Ralentissant le pas, elle regarda autour d’elle et dédaignant le banc, choisit de déposer son sac sous le pin. Elle étendit sa natte et en quelques secondes se présenta en maillot de bain. Attachant ses cheveux, prête à se baigner, elle courut jusqu’à l’eau. Ce matin elle était d’autant plus contente d’être là qu’elle avait eu des nouvelles de sa sœur la veille. Partie pour ses études, celle-ci avait la nostalgie de ces moments de baignade que les deux sœurs avaient toujours partagés, du plus lointain qu’elles s’en souvenaient. C’est vrai que le bain leur apportait une satisfaction telle qu’il leur était difficile d’y renoncer. C’est donc en pensant à sa sœur qu’elle fit ses premiers pas dans l’eau. S’aspergeant d’abord les bras, puis la nuque, elle piqua une tête et se mit à nager parallèlement au rivage. Elle nagea longuement. Enfin, elle se redressa et s’aperçut qu’elle avait pied. Le jusant était déjà à l’œuvre. Au loin, elle distingua la présence d’un pêcheur et un chien qui vagabondait à son gré. Elle sortit de l’eau, ruisselante, voulut courir et arriva essoufflée près de l'arbre. Encore tôt, le soleil ne dardait que ses premiers rayons. Sa peau était toute hérissée. Elle défit ses cheveux, commença à les peigner et se faisant, de lourdes gouttelettes aspergèrent le sable. Puis elle enfila ses vêtements secs qui lui procurèrent une douce chaleur. Regardant sa montre, elle sut qu’il était l’heure de partir. Pensant encore une fois à sa sœur, elle inspira profondément l’air iodé et alors, avec empressement, elle enfourna ses affaires dans son sac et rebroussa chemin précipitamment. Dans sa hâte, en le jetant sur son épaule, son sac s’entrouvrit et elle ne vit pas le peigne tomber. Sans bruit, celui-ci atteignit le sol et resta là. Le temps passait. Après le départ de la jeune fille, rien ne vint perturber la quiétude du lieu. En ces heures matinales, aucun autre promeneur ne s’aventura dans cette partie isolée de la presqu’île. Impassiblement, le soleil poursuivait sa course. La fraîcheur avait fait place à une tiédeur agréable qui laissait présager une belle journée et peut-être même l’arrivée d’une forte chaleur. Le varech rejeté par la mer séchait, exhalant une odeur caractéristique. Un homme surgit du sentier. Les mains dans les poches de son pantalon, l’allure décontractée, c’était d’un pas décidé qu’il approchait le rivage. Il s’arrêta net et portant la main en visière à son front, scruta l’horizon : pas un nuage mais de la brume sur l’eau qui masquait les villes avoisinantes. La forte luminosité lui faisait cligner des yeux. Il abaissa son regard pour reposer sa vue. Quelque chose au sol attira son attention. Se baissant, il reconnut un peigne et après une seconde d’hésitation, décida de le laisser par terre au cas où son propriétaire repasserait. La vision de ce peigne lui créa un trouble. Avec une grande netteté, il revit sa femme et ses longs cheveux qu’elle peignait vigoureusement après chaque bain. Qu’ils étaient beaux ses longs cheveux dorés ! Il aimait la délicatesse avec laquelle elle prenait soin d’elle-même, sans excès, avec naturel, simplement pour se rendre digne des atours que la nature lui avait prodigués. C’est alors qu’en cet instant, il eut aimé qu’elle soit près de lui. Lui vint une folle envie de l’envelopper de ses bras et de la soutenir en contemplant ce paysage marin. Cela le rendit nostalgique. Elle s’était absentée pour des raisons professionnelles. Lui, retraité, avait plus de temps libre. Il s’évertuait alors à découvrir de nouveaux sites qu’il lui narrait avec moult détails pour peupler son imaginaire de pensées photographiques afin qu’elle songe à lui lors de ses soirées solitaires. Son épouse lui communiquait une force bienfaisante. Délaissant le panorama, machinalement, il poussa du pied le peigne et se faisant, réalisa qu’il était heureux. En son for intérieur, il remercia secrètement le propriétaire du peigne pour cette bévue. Redressant la tête, arborant un léger sourire, il se retourna et à vive allure disparut sur le sentier. Le temps s’écoulait toujours. Ayant dépassé son zénith, le soleil cognait fort maintenant. À ces heures-là, bien souvent abruti par la chaleur, on aimait se délasser. Tête enrubannée d’un foulard blanc, lunettes de soleil noires vissées sur les yeux, vêtue d’un pantalon court et d’un chemisier écru, une jeune femme se baladait sur le layon. Tenant à la main ses sandales, pied nu, elle foulait lentement le sable chaud. Un peu égarée, dévisageant les alentours, elle avisa le banc et s’y assit avec satisfaction. Nonchalamment appuyée sur son coude, sa main soutenant sa tête, elle ferma les yeux. Dans la lumière crue du jour, ce corps alangui au milieu de ce décor naturel formait un ravissant tableau. Les minutes s’égrenaient. Sous l’effet d’une brise légère, libérés du chapeau qui le protégeait, des petits cheveux flottaient autour de son visage. Soudain, sans avoir le temps de le retenir, il s’envola, ce qui lui fit ouvrir les yeux et courir pour le rattraper. À son retour, elle le vit. Elle ramassa le peigne et s’installa à nouveau sur le banc. L’objet avait emmagasiné la chaleur du soleil et il lui était doux de l’avoir dans la main. Comme par enchantement, elle fut transportée auprès de sa grand-mère et ses écheveaux de laine. C’était une femme laborieuse qui cardait la laine de ses moutons avec différents peignes ressemblant très peu à celui-ci, bien trop fin. Petite, elle adorait la regarder faire, toute entière absorbée par sa tâche. Émue par ce souvenir, elle retourna une dernière fois le peigne poli dans ses mains et le reposa tranquillement sur le bois tandis qu’elle portait son attention sur la plage. Invisible, l’eau s’était complètement retirée, révélant un sable couleur bronze contrastant avec le sable blanc de la plage. C’était l’étale de basse mer. Il faisait vraiment chaud. Nullement incommodée par la chaleur, la jeune femme décida de longer l’estran jusqu’à la jetée et négligeant l’objet, se leva et quitta l’endroit par la baie. L’après-midi s’étirait sous ce soleil de plomb. Des personnes le bravaient à l’abri sous leur parasols, multiples points colorés s’éparpillant çà et là. Des groupes, munis de casquettes et d'outils de pêche tels que le seau et l’épuisette, se déplaçaient avec lenteur, pliés en deux, à la recherche de divers mollusques et crustacés. Enfin le soleil décrût d’intensité. Les heures les plus chaudes étaient passées. Devant l’anse, l’eau encore éloignée de la grève miroitait, promettant déjà le flot. S’aidant avec sa canne, affermissant ses pas, une vieille femme avançait précautionneusement. Elle savait qu’un banc l’attendait, où elle pourrait se reposer. Cette perspective la rassurait. Habitant tout près, elle avait la chance de pouvoir marcher jusqu’ici. Cette marche représentait son labeur quotidien. Elle n’y dérogeait quasiment jamais, quelque soit le temps qu’il faisait. Enfin elle l’atteignit et s’y affaissa sans précipitation. Abandonnant sa canne, elle arrangea sur ses genoux sa longue jupe évasée en toile légère et rajusta son bustier. Sous le coup de l’effort, des gouttelettes de sueur perlaient à son front et au-dessus de sa lèvre supérieure. Tirant de sa poche un mouchoir, elle s’épongea le visage et souhaita retirer sa benaise. Descendante d’une lignée d’ostréiculteurs, elle tenait cette coiffe de sa mère. Rouge et blanche, ourlée avec soin et plissée sur le sommet, cet accessoire était sans pareil pour protéger la nuque et les oreilles. De ses doigts toujours agiles, elle fit coulisser le ruban et, nu-tête, apprécia le menu souffle qui vint la rafraîchir. Le cillement de ses yeux trahissait son état de bien-être. Ses bras longilignes retombaient mollement sur le banc lisse et tiède qu’elle se mit à effleurer de la paume des mains. À sa gauche, ses doigts se refermèrent sur l’objet dont elle ne discerna pas tout de suite la signification. Un peu apeurée, retirant sa main, elle regarda mieux. L'identifiant, elle se reprocha sa poltronnerie. La peur malheureusement avait trop souvent accaparé sa vie. Comme le jour où elle n’avait pu s’empêcher de fuir, devant des faits qu’elle ne comprenait pas. Terriblement dépitée, de rage, elle avait rasé sa chevelure pendant plusieurs mois. Et puis la vie avait repris le dessus en lui donnant de nouveaux gages d’espérance. Des années plus tard, découvrant par hasard une photo d’elle prise à cette époque, son compagnon de route ne la reconnut pas. Il crut alors qu’elle était gravement malade. Il chercha à savoir mais face à son mutisme, n’insista pas. Tout au plus, il lui caressa délicatement les cheveux et quelque temps plus tard, lui offrit un joli peigne en corne. Ce présent l’avait amusée et rajeunit de plusieurs années. Au contraire, à l’époque, l’amère expérience l’avait fait grandir. Aujourd’hui, il était rare qu’elle repensât au passé. C’était drôle qu’un simple objet trouvé vînt lui rappeler cet épisode de sa vie. Soupirant, prête à un nouvel effort, la canne bien en main, les pieds ancrés au sol, elle prit le parti de rentrer à son domicile. Courageusement, elle procéda de la même façon qu’à l’aller, avec beaucoup d’application pour ne pas tomber, et une calme respiration. « Qui soigne sa monture va loin » se disait-elle. Au départ de la grand-mère correspondit la disparition progressive des parasols qui s’éclipsèrent de la plage les uns après les autres. Le soleil amorçait sa descente. Il faisait encore bien chaud. Dévalant le raidillon, un homme juvénile, drap de bain sur l’épaule, torse nu, un sac à dos en bandoulière, arriva sous le pin. Fin connaisseur des heures de marée, il savait que c’était jour de grand coefficient. S’étirant, il jeta son équipement sur le banc et sans préliminaire, fonça à l’eau. Des navires voguaient dans le lointain, toutes voiles dehors. Après une journée de travail, rien de tel qu’une baignade pour ressourcer l’animal. Tête renversée, il s’ébroua comme un chien et resta un instant debout, droit, à fixer l’horizon. S’asseyant, il fut gêné par un objet dur qui l’obligea à se relever. Constatant un peigne, il l’observa attentivement. Cet instrument-ci était en plastique foncé, avec d’un côté une rangée de dents serrées et de l’autre des dents plus écartées. Pris d’une lassitude, s’allongeant, le peigne posé sur son torse, il plissa des yeux et rêva d’une chevelure châtain emmêlée qu’il chercha à peigner. Les nombreux nœuds parsemés dans les cheveux empêchaient la distinction des traits du visage. Ses efforts restaient vains. Toutefois il s’assoupit dans cet entrelacement imaginaire de fibres soyeuses. Le peigne glissa le long de sa poitrine. Ouvrant brusquement les yeux, il sursauta. Il n’aurait pas dû s’attarder ainsi car il était attendu. Maintenant un beau coucher de soleil embrasait le ciel. Il se détourna des magnifiques reflets rosés qu’émettait l’eau à peine ondulante et s’en alla énergiquement. Une lumière crépusculaire se répandait sur le pin, le banc, le sentier, le sable, la mer, fonçant progressivement leur teinte naturelle. En provenance de la terre se dessina un corps aux contours flous. Grossissant à mesure de son approche, d’une démarche chaloupée, il gagna le banc. Habillé en noir, doté d’une capuche, se confondant à la pénombre, il balançait souplement les jambes et peignait ainsi d’avant en arrière le sable avec ses pieds, seuls visibles. Ceux-ci rencontrèrent le peigne. Avec grâce, la silhouette le saisit. En dodelinant de la tête, un chuchotement musical à peine perceptible naquit. Il émanait de ce tableau une grande paix. L’eau toute proche était noire. Des nuages bas contrariaient l’éclairage de la lune. Sur la rive, n’étant tout d’abord qu’un point à l’horizon, se devinait une nouvelle ombre flottant d’ici à là, se rapprochant de la crique au ralenti. À proximité, sans hésiter, elle bifurqua et s’attela à gravir la dune qui menait au banc. À cette distance, se distinguait une vareuse en lin blanc qui détonait sur le fond de la nuit. Elle s’arrêta une fois, semblant sonder l’épaisseur de l’obscurité, sans doute pour mieux discerner ce profil sombre présent là aussi. Celui-ci eut un geste furtif. Accomplissant les derniers mètres qui la séparaient du siège, d’une voix polie, calmement, elle demanda : « - Vous permettez ? » - Si vous voulez. » Après quelques minutes de silence : « C’est à vous ? » Interdite, ne sachant que répondre, l’ombre noire hocha la tête de droite à gauche. « J’utilise parfois un outil semblable. En peignant, j’obtiens des effets intéressants. » Nouvel hochement de tête cette fois d’acquiescement.<br>Encouragée, la voix ajouta : « Quelle belle nuit ! » Un clapotis accompagnait ce monologue. C’était l’étale de la marée montante. Pas un souffle d’air ne venait percer l’atmosphère nocturne. « Bonsoir ! ». Dégringolant la butte, la tâche blanche s’éloignait déjà. L’autre personne restait immobile. À ses côtés, gisait le peigne et... un petit carton rectangulaire de couleur claire. Le retournant, elle découvrit une écriture dactylographiée et des coordonnées. C’était une carte de visite. Subrepticement, elle la glissa sous sa tunique. Le manteau bleu de la nuit enveloppait le paysage. La lune était haute dans le ciel. Le hululement d’une chouette se fit entendre. Alors, l’ombre s’anima et devint évanescente.
Noëlle SANZ
J'ai peur de te manquer
Nouvelles
Il est des paysages qui ne s'oublient pas, Comme des visages ou des voix... Quand je t'ai rencontré, Il y a vingt années, Je t'ai tout de suite aimé, Sans retenu, et avec sincérité ! Tu te nommes Bassin d'Arcachon, Tes paysages sont multiples, Tes habitants accueillants, et sans prétention... Des lignes, des courbes, de l’eau, puis pas ! Ce jeu-là me séduit, Tu joues au chat et à la souris ! Que tu sois plein ou vide, Ton charme est unique, tes odeurs aussi... Ton mélange est subtil Et le rythme de la vie ralenti... On prend le temps, De regarder la Vie, les Hommes, la Nature, On prend le temps, D'écouter le silence, Son cœur qui bat... Il est des paysages que l’on n’oublie pas Terre d'accueil et authentique Sauvage et touristique Le Bassin d'Arcachon a des couleurs uniques Qui donnent de la joie…
Nadège AURIEL
Bassin des Lumières
L’occupant descend de l’engin. En l’occurrence, il est de sexe féminin. Il est affublé de tatouage, d’une longue chevelure colorée blonde et rousse, de collants résilles à grosses mailles qui, volontairement, ne cachent pas la générosité de la chair de ses cuisses. Le personnage, riant selon certains de façon communicative, pour d’autres de façon hystérique voire pathologique, parle français avec un accent américain, il prononce d’ailleurs même des jurons merveilleusement bien dans langue des Gaulois, insistant sur les gaffes que la traduction peut induire… Sarah McCoy, LA musicienne de blues, de jazz, de soul américaine se produit à Arès !!! Sarah McCoy ! Est-ce possible de rester indifférent à cette chanteuse phénoménale, cette furie scénique, cette tempête d’émotion ?! Est-ce imaginable de pouvoir assister à son concert à Arès ?!! Je suis complètement dépitée : le concert est complet. Moi LA fan de Sarah McCoy, j’aurais dû être inscrite sur la liste des VIP sans déconner ! Je languis pendant des jours devant sa trombine rieuse placardée sur les panneaux d’affichage de la ville, je suis déconfite de n’avoir pu choper une place… Bah, ça doit être une machination : l’organisation a dû se dire que j’allais crier trop fort « Sarah I love You ! ». Je m’inscrits sur la liste d’attente, sans grand espoir. Je finis par me résigner. Par faire mon deuil. Je prévois donc de dîner à Bordeaux. L’heure de départ pour la métropole approchant, je me sens de moins en moins en forme pour faire la route. Je me décommande. Alors que j’aurais été sensée être au volant de mon bolide 4 chevaux en direction de la métropole, 30 minutes avant le concert, oui 30 minutes avant, je reçois un appel selon lequel 1 place pour le concert se serait libérée. 1 place !!!!!! Je suis abasourdie. Instantanément, ma forme revient illico presto ! J’ai eu le nez creux ! Je file à l’espace Brémontier, j’achète donc ma place : 17.50€ (ce tarif est absolument démentiel pour une telle géante de la musique américaine !) Et là, que vois-je ? L’affiche, la même que je zyeutais avec dépit sur les panneaux de la ville, en grand et moyen format. « A combien sont-elles s’il vous plaît ? » demandé-je « Elles sont gratuites » me dit-on, le plus naturellement du monde. Là, je suis vraisemblablement dans une autre dimension… Ou bien suis-je piégée par une caméra cachée ? Non… Je dois être en train de dormir et de rêver… Il n’y a pas de siège derrière le comptoir pour que je puisse m’assoir ? J’ai la tête qui tourne. Me voilà munie de la plus grande affiche, comme une gamine fière d’avoir la plus grosse barbapapa dans une fête foraine. J’entre dans l’arène plongée dans le noir, on me désigne une place en or, en bout d’un des premiers rangs. Je suis aux anges. J’arrête là ma logorrhée de fan hystéro et je tâche d’être plus objective : On attend la bombe musicale, la tempête du diapason, la bête de scène, aussi grosse qu’elle est explosive (oui, je m’autorise à écrire grosse !) … Et, là elle se faufile comme une technicienne dans le noir pour faire je ne sais quoi, accroupie, « à l’arrache » comme diraient les jeunes. Je suis dans l’incompréhension : c’est elle ? C’est pas elle ? Et bam ! Le concert commence. Le concert commence et j’en prends plein les yeux. L’éclairage est bien pensé, cohérent avec le sens des morceaux, j’en prends plein les écoutilles : Sarah Mc Coy a un coffre de malade, précis… Mais surtout, j’en prends plein les tripes : d’une part grâce aux fréquences parfois inattendues et surtout, disons-le même, tout le temps : ce n’est pas un simple concert auquel j’assiste, c’est un « melting pot », un mélange biographique, psychologique et philosophique. Je m’expliquerai plus tard : il ne s’agit pas d’employer ces mots pour « en jeter ». Les morceaux s’enchaînent et heureusement que je suis assise, mon corps tout entier est ébranlé, je ne sais plus comment le placer, croiser les jambes, les décroiser, m’assoir de travers, bien droite ? Mes mains s’accrochent à mes cheveux, mes yeux sont écarquillés, je respire profondément, j’expire… Je crois que je vais perdre la tête. Je crois que je n’arriverai décidément pas à décrire cet instant en restant objective ! Non, je suis résignée, je ne pourrai pas écrire que c’était un « bon » concert… Un « bon » concert… Vous plaisantez ou quoi ?! C’est un concert démoniaque ! A propos de l’adjectif « démoniaque », un des titres m’a particulièrement marqué, il s’intitule « Prière » : Petit-à-petit, nous sommes entraînés, comme si de rien n’était, dans une forme d’incantation mystique. On ne s’aperçoit de rien au début puis de proche en proche, la musique nous captive, nous envahit, puis nous étourdit. Sarah, derrière son piano à queue est comme possédée, démoniaque, ses cheveux se balançant de haut en bas, de droite à gauche, ébouriffés par les accords et la puissance de sa voix. Elle est violente, perturbante, puissante et si juste. Rien à voir avec ses vidéos que je dévorais sur le net. Là, je prends en pleines tripes une puissance inimaginable, extraordinaire. Attention, je tiens à le préciser : extraordinaire, là, ce n’est pas l’exclamation du genre « wahou !», extraordinaire signifie bien ici « au-delà de l’ordinaire ». Entre autres morceaux où je suis désormais incapable d’écrire, Sarah McCoy me fascine en évoquant le « Boogie Man » : il s’agit, aux Etats-Unis, d’un personnage imaginaire, qui effraie les enfants en se cachant sous leur lit. Ben ! Enfin je connais le nom de cet enfoiré ! Parce que oui, le boogie man sautait sous mon lit moi aussi et je me réfugiais dans celui de ma grande sœur qui était témoin d’ailleurs ! Si j’avais su parler anglais avant, j’aurais pu l’envoyer se faire *** balader (oui ça passe mieux pour le grand public). Donc, ce petit clin d’œil un peu magique me touche oui ! Précédemment j’évoquais l’aspect hautement biographique, psychologique et philosophique des prestations de Sarah McCoy, car en effet, outre la puissance et la présence haute en couleur de la bonne femme, elle évoque, ici et là des idées profondément intimes, qui sont les siennes et peuvent être les nôtres… Comme l’envie, parfois que l’on pourrait avoir de se cracher dessus dans le miroir, « de supporter ses imperfections », « d’accepter sa médiocrité », « d’accepter sa fragilité » et parfois de devoir accepter que se reconstruire prend tant de temps… Un temps si lent. A certains moments, choisis avec une extrême pertinence, l’ensemble des spots s’allument violemment sur le public, c’est une impression très puissante et troublante selon moi, et hautement symbolique : j’y ai vu plusieurs significations philosophiques : « et si on inversait les rôles », « si vous preniez ma place, exposée de plein fouet au regard des autres », ou, « voyez comme c’est violent d’être soi » ou bien encore « que choisir : la violence de la vérité, quite à en être ébloui ou le confort de l’illusion » Ces spots intensément lumineux prennent à leur tour le devant de la scène, avec leur lot de messages et, avec le sourire, je pense bien-sûr aux lumières étranges que l’on attribue souvent aux ovnis. Enfin, et c’est peut-être cela le passage le plus philosophique, le dernier morceau s’intitule « La mort ». Un morceau où elle crie qu’elle n’a pas peur de la mort : elle ne la nie pas, elle ne la fuit pas, elle n’en a pas peur, de tout son corps elle vit, de tout son corps elle vibre, de tout son corps elle se joue de la mort. Promis Sarah… Je l’ai bien senti : toute ta voix, tout ton corps, toute ta musique, toute la lumière nous l’ont bien dit ! J’aurais tant à dire encore pour le prouver encore et encore ! Sarah McCoy, tu es bel et bien vivante. Merci de n’avoir pas peur. Allez va ! On arrête avec nos standing ovations. Ton carrosse t’attend à l’Ovniport !
Stéphanie CALATAYUD
De nombreux témoins l’attestent : Un OVNI a atterri à Arès vendredi 24 mars 2023
Hédoniste repenti de frasques libertines, il se lassait désormais des plaisirs de la chair et, Cupidon déconfit, ne visait plus de son arme les nymphes alanguies. Il ne destinait son corps qu’aux agapes lascives d’une belle tablée. Les fruits du fond des mers excitaient son palais, livrant à l’amateur un florilège de coquillages salés, qu’ils fussent brachiopodes ou bivalves déclarés. Mais un jour, fatigué des saveurs inégales des mollusques de tous ordres, il tomba en extase sur une huître du banc d’Arguin. Certes, il avait longtemps pratiqué celles d’Arcachon et du Cap-Ferret dont les saveurs, bien plus qu’honorables, conféraient à son palais encore bien des émois… Mais, ce matin-là, il crut déceler une vigueur un peu particulière, un goût plus prononcé, une couleur différente. Il était conquis. Désormais, il la classerait première au palmarès de ses préférences. Le lieu dans sa quête gourmande avait une importance. Il lui fallait trouver, tout en longeant la côte, une cabane de pêcheur où l’on pût déguster les belles en livrée d’aigue-marine tout en écoutant la plainte des cigales. Il s’attablait alors, tous les sens en alerte, et savourait les providences de la mer, sachant désormais le Graal à portée de sa main. L’air iodé décuplait sa voracité de gourmet et les vertes naïades se succédaient les unes après les autres. Mais il ne pouvait s’interrompre ; il accroissait la finalité, la quintessence de son savoir et son expérience s’en trouvait complétée, raffermie. Il discernait enfin le pourquoi de sa présence terrestre. – Oui, décidément j’aime le Bassin, songeait-il en écaillant d’un geste fiévreux le coquillage favori. Il s’imposait le rituel immuable qui sied au véritable connaisseur. Soupeser, en premier lieu, l’huître de son choix, afin de juger si, de par son poids, la plénitude intérieure correspondait bien au volume observé. Éprouver, d’une main se voulant badine, la texture des algues et des petits parasites collés sur la coquille, renseignant sur la profondeur, la culture, la qualité et les soins prodigués au cours de son élevage. Écailler, d’une dextérité toute chirurgicale, presque une cœlioscopie, le muscle préhenseur. Il ne devait pas y avoir de débris de coquille, ce qui en eût gâté l’absorption. Contempler ensuite, d’un regard caressant, les douces et frémissantes ondulations de la sirène de nacre. Jouir enfin de la belle, à petits coups de dents, et la garder un peu en bouche avant de l’engloutir. Une marée paisible se mourrait à ses pieds, berçant ses dévotions d’un ressac fatigué. Les restaurateurs, de ses assiduités ravis, ne s’étonnaient plus de le voir pratiquer, tel un dévot ermite le culte ostréicole. Mais le destin tapi dans les replis de la destinée, veillait sur cet homme gourmand et son doigt implacable se posa sur sa vie. Un incident mineur et de banale importance vint troubler le cours de ses appétits. Un inspiré en robe blanche fit irruption dans la salle, à l’endroit même où se dégustaient les mets les plus subtils dont l’appréciation ne souffrait aucun dérangement. Une fin bien singulière. Bousculant sans vergogne les clients attablés, il se mit à glapir : – Croyez en la métempsycose ; repentez-vous ! Les temps sont arrivés ! Respectez les manifestations de la vie animale et songez au futur dont déjà vous dépendez ! Le patron ulcéré se jeta sur le prophète et sans ménagement, le poussa hors de l’établissement. Notre gastronome, choqué de tant d’irrévérence s’ébroua un instant. Quelle impertinence ! L’émotion fit place à la colère : – Patron ! Une nouvelle visite de cet illuminé et je change d’endroit ! – Ne craignez pas ! Fit ce dernier ; j’y veillerai. Un client comme vous est une bénédiction pour notre maison ! Une large rasade de vin blanc acheva de le rasséréner. Il fallait qu’il compense, car intérieurement il était bouleversé. Il éprouva le besoin de se remettre en bouche et interpella le serveur qui vaquait de table en table, essuyant çà et là d’hypothétiques taches. – Garçon ! La même chose, s’il vous plaît, mais des plus grosses ! Le plateau arriva. L’incident était clos, la vie recommençait. Le vin blanc, en tout point identique au premier, transpirait sous la moiteur de la température ambiante. Il observa, ravi, le ballet charmant des gouttelettes de buée glissant sur la bouteille. Une fine saucisse, cuite sans excès montrait d’appétissantes rondeurs ; il la subodorait légèrement truffée ; il est des traces qui ne mentent pas. Son regard se posa sur le vaste aréopage crénelé. Serties d’une garniture d’algues et de citrons, douze énormes huîtres emplissaient le plateau. Il contempla sans rien dire son trésor de calcaire et son estomac émit un grognement ; Il était temps d’agir ! Ce ne fut pas très long ; en deux temps et trois mouvements, il saisit la plus grosse. Cette dernière eût sans doute volontiers laissé passer son tour, quoique… D’une main mal assurée, devant l’amplitude de la bestiole, il s’arma de son outil personnel, car personne à part lui ne devait les ouvrir. Il trancha, non sans difficultés le pivot musculeux. D’un geste vainqueur, il déposa le couvercle qui c’était bien battu. Point ne serait besoin pour ce vaillant-là, de s’aller souiller dans une obscure poubelle. Non, il contemplerait la dégustation aux places réservées. Le réceptacle nacré abritait une pensionnaire mafflue, globuleuse à souhait. Un monstre laiteux, mais ô combien attrayant ! Des flots de salives humectèrent son palais impatient. Il se tourna, face au soleil et son esprit se vida des pensées importunes. Il tendit haut dans le ciel le vase de ses plaisirs. Le trajet descendant se fit en un seul trait ; en un clin d’œil, la bête pantelante s’abandonnait dans les abysses du Gargantua. Cependant, tout à sa précipitation d’absorber le mollusque, il ne prit garde à la taille exceptionnelle et l’animal égaré vint se loger simultanément à l’entrée de l’œsophage et du tube digestif. Rapidement asphyxié, il trépassa sur-le-champ ; la bouche ouverte et les traits convulsés. Une interrogation se lisait dans ses yeux ; sans doute celle d’avoir été trahi par des animaux de compagnie. Mais une nouvelle épreuve attendait le vorace… Lorsqu’il reprit conscience, au-delà la mort, il se vit entouré de nombreux personnages qui n’avaient pas l’air de plaisanter. Ils savaient tout de lui et lui n’en savait rien. – Vous n’avez pas été très charitable envers les animaux ! fit remarquer l’un d’eux. Une fin bien singulière. – Vous n’avez recherché sur terre que votre propre assouvissement et cela au mépris des personnes que vous auriez pu aider ! Un troisième sage prononça la sentence : – Devant une telle existence, vouée à l’égoïsme, vous serez puni, mais vous nous reviendrez bientôt, car dans l’immédiat, vous avez besoin d’une bonne leçon ! Il perdit conscience ; ébranlé par les émotions d’une rude journée. Son réveil fut pénible. Il ressentait un balancement continu qui lui soulevait le cœur. Une saveur saumâtre persistait dans sa bouche. L’endroit était obscur, sauf de temps à autre, quand il bâillait… Un monde glauque lui apparaissait alors et les images entrevues manquaient de netteté… Parfois, des sons étranges traversaient le silence, il imaginait un régiment de jardiniers ratissant sur sa tête. Il se sentait grossir ; cependant, sa manière de s’alimenter le laissait perplexe. Il se nourrissait d’un régime plutôt liquide et lorsqu’il faisait son rot, une grosse bulle oblongue passait devant ses yeux. – J’ai trouvé ! S’exclama-t-il un jour. Je suis un fœtus dans le ventre de sa mère ; j’ai simplement conservé toute ma conscience et je vais bientôt renaître au grand jour ! Cette réconfortante certitude l’apaisa. Il s’endormit détendu ; peut-être suçait-il son pouce… Soudain, un choc, plus violent que les autres, le réveilla en sursaut. Il ne ressentait plus les paisibles ondulations du milieu amniotique. Un tintement métallique lui vrilla les ouïes ; Il avait dû gigoter dans son sommeil, car un défaut d’horizontalité lui souleva le cœur. Une odeur de citron le fit éternuer. – Celle-ci est de taille respectable ! fit une voix déformée. – Oui, elles ont bien grossies cette année, nous n’avons pas à nous plaindre ! – Où diable me suis-je fourré ! Soliloqua-t-il. Quelle épreuve pénible ! Il s’agit sans doute d’un cauchemar… Je ne pensais pas que la naissance fut si difficile ; quant à la mère qui me porte, elle doit bien souffrir ! Un crissement sur son côté droit retint son attention ; Presque aussitôt une douleur crucifiante lui fouailla le flanc. – Ils utilisent les forceps ! se dit-il en serrant les dents. J’y vois ! Hurla-t-il fou de joie ; Je viens de naître ! Je viens de naître ! Les sages-femmes le hissaient haut dans le ciel et il s’attendait à tout moment à la traditionnelle claque fessière. – J’y suis ! Ce doit être une clinique du Bassin ; peut-être celle d’Arès ! En effet, la magnificence de la baie étalait sous le soleil son panorama de rêve… Le vent, caressant sa peau laiteuse le fit frissonner. Il se déshydratait rapidement. Il ne s’inquiéta guère c’était normal pour un nouveau-né. Tout à coup, il se sentit partir ; doucement, tout d’abord, puis de plus en plus vite. Penchant la tête, il baissa ses yeux globuleux vers sa mère et les accoucheurs… Il ne put qu’admirer une bouche, démesurément ouverte, qui s’ouvrait tel un gouffre sans fond. Il tenta de ralentir sa chute mais il n’avait ni bras ni jambe ; il n’était qu’une masse verdâtre agitée de soubresauts… Il hurla de douleur, lorsque le gastronome, en quête du saint Graal, se mit à le mâcher, à petits coups de dents.
François VEILLON
Une fin bien singulière
Nouvelles
Il ne parvenait pas a comprendre. Il avait pourtant interrogé tous ceux qui auraient pu lui fournir des éléments. Kitesurfeurs, promeneurs solitaires ou en groupe, personnes âgées. Il avait même tracé jusqu' au port ostréicole dans l'espoir que quelqu'un ait observé quelque chose. Le plus grand nombre n'avait rien vu, occupé à vivre. Et ceux qui avaient vu racontaient une histoire abracadabrante pour expliquer les disparitions. Gilles Lecombes, journaliste pour un petit journal local du Bassin, regardait sa tasse de café d'un air songeur. Les faits s'étaient déroulés au bord du Bassin, sur les plages du Betey, des Quinconces, de Saint Brice, du Carré Pereire et près de la jetée d'Arès. A marrée basse, un soleil incroyable à chaque fois malgré le froid printanier. Les gens lui relataient une scène de vie à la mer, des plus ordinaires. Il y avait quelqu'un qui marchait dans le sable. La seconde d'après, il suffisait d'un battement de cils, plus personne ! Disparu, envolé. Comme si le sable l'avait avalé. Les chiens qui désespéraient de retrouver leur maître tournaient dans tous les sens. On cherchait sans trouver. Personne ne comprenait. Le phénomène s'était produit à cinq reprises peut-être même plus. Gilles menait son enquête en toute discrétion pour ne pas provoquer un affolement qui aurait pu nuire au tourisme local. Gilles Lecombes était natif du Bassin. Il comprenait parfaitement que ses terres puissent faire l'objet d'une telle attraction touristique. Il décrivait volontiers son cadre de vie comme un paradis : la dune la plus grande d'Europe attirait chaque année son flux de touristes. Tout était organisé pour que chacun y trouve son compte à la belle saison : pistes cyclables et loueurs de vélos, campings avec animations dédiées, balades en bateau, cours de surf etc. Les disparitions devaient rester de l'ordre du secret, entre locaux. On n'avait pas besoin de ça, les baïnes rejetaient leur lot de noyés chaque année, c'était suffisant. Les idées s'entrechoquaient dans sa tête. Après tout, il y avait bien des abrutis qui s'enlisaient chaque année dans la vase. Toute les hypothèses étaient sur la table, il fallait poursuivre. La Terre changeait. Il entendait à la radio, les événements climatiques se multiplier aux quatre coins du monde. Intempéries, tempêtes, tsunamis, sécheresses, canicules. Comme si la Terre voulait se venger des hommes pour leur mauvaise conduite. Les étés brûlants ne semblaient pas effrayer les touristes qu'on voyait circuler à vélo sous 30 degrés, rouges vifs et transpirants mais déterminés à profiter de leur deux semaines de congés annuels. Le temps avait changé. Gilles avait regroupé les événements étranges survenus sur le Bassin au cours des dernières années. Des nuages avec une forme particulière dans le ciel, des lumières qui clignotent, des halos. Il y avait bien quelques illuminés qui avaient leur idée sur la question. La venue des extraterrestres pouvait être une piste sérieuse pour certains. Après tout, il y avait bien un Ovniport à Arès. Chacun détenait sa vérité quant aux disparitions. Gilles, pour sa part, n'y croyait pas une seule seconde. Le drame devait être scientifiquement prouvé, au diable les balivernes des gens du coin. Il y avait bien des changements dans la terre, dans l'air et l'eau. Le Bassin se réchauffait, les ostréiculteurs modifiaient leur manière de travailler, les jeunes huîtres mourraient, les stocks diminuaient. Le temps se déréglait. L'année dernière, une nouvelle forme de catastrophe était apparue. Les mégas-feux avaient plongé la Gironde dans un état de stupeur. Il avait fallu s'organiser, se coordonner dans le chaos : protéger les habitants, déplacer les touristes en masse dans des gymnases, retourner sur place récupérer les animaux effrayés. Gilles s'était engagé dans cette bataille, effaré, aux côtés des pompiers. Il s'était porté au secours des vieux qui refusaient de quitter leur maison. Il n'y avait eu aucun mort heureusement. Une belle solidarité s'était mise en place, les gens avaient donné. Les pompiers étaient bien légitimement encensés. L'incendie était passé à la télé, la France les yeux rivés sur les langues de feu ingérable, les troncs calcinés. Et puis cette étrange fumée orange qui donnait au ciel, une couleur surnaturelle. Une couleur de fin du monde qui laissait présager le pire. Le Président avait annoncé des moyens pour lutter contre ce qui devrait désormais se répéter. Malgré tout, le Département restait un territoire attractif. Gilles avait besoin de s'aérer la tête et décida de partir du côté de la base nautique en espérant y voir plus clair. Il n'avait pas la moindre explication concernant les disparitions. Son chef le pressait de clôturer son article. Il se sentait abattu, il n'avait rien de tangible à se mettre sous la dent. Avant de quitter le bistrot, il paya son café en s'étonnant du prix en constante augmentation. Il pensait aux métamorphoses de son cadre de vie, surtout au cours de ces dix dernières années. Avec la pandémie Covid, ça s'était accéléré : Gilles avait vu arriver sur ses terres de plus en plus de citadins attirés par la vie au grand air, les bottes pour les petits et des paniers garnis pour les piques-niques sur la plage. Un beau fantasme alimenté par l'idée contemporaine qu'il faut allier vie professionnelle et vie personnelle. Les prix de l'immobilier avaient flambé apportant un matelas financier confortable à ceux qui vendaient la maison familiale en une journée à un acheteur capable de payer comptant. Laissant les plus précaires, dont des natifs du bassin, supplier sur les réseaux, une location inespérée pour toute l'année. Profiter de la mer était devenu l'apanage des plus riches, des plus chanceux et des touristes en haute saison. Gilles avait rédigé un article sur ces évolutions rurales et le sentiment de dépossession de ceux qui sont nés ici. Il reconnaissait que les familles étaient de plus en plus nombreuses, ça changeait des retraités et donnait à la ville, un dynamisme nouveau. Cette vie sereine et pleine d'innocence, voilà ce qu'ils étaient venus chercher. Se retrouver à l'air de jeux dans la douceur du printemps, en rêvant aux prochaines baignades à la base nautique. Profiter au plus vite, savourer le calme des rues, cette nature préservée avant l'afflux, les vélos fous et les appareils photos dégainés au moindre point de vue. L'été, le village avait un autre visage, plus festif et joyeux, le marché battait son plein, c'était bien aussi. Arrivé à la plage, lunettes de soleil sur le nez, Gilles regarde l'horizon avec quiétude. Le soleil tape fort sur son bob kaki. Il marche tranquillement. Il y a une petite fille assise dans le sable, un pelle verte à la main. Son père la couve du regard. Gilles tourne la tête vers l'eau calme au loin. Une silhouette féminine se dessine à quelques mètres de lui, une femme sans... MAIS ! Gilles manque d'avaler son chapeau ! Il peine à croire ce qui vient de se passer : la femme vient de disparaître sous ses yeux ! Il se précipite sur place, le regard fou, les lunettes de soleil valdinguent, il regarde de tous les côtés. Quand il sent le sable se dérober sous ses pieds comme une trappe, il réalise trop tard sa méprise. Tout va très vite, il sent les petits grains entrer à l'intérieur de sa bouche, de son nez, se faufiler dans le bas de son dos. Le regard tourné vers la lumière, impuissant, les membres prisonniers, silencieux, il s'enfonce dans les profondeurs du gouffre sablonneux. Le piège se referme sur Gilles Lecombes. Ne reste qu'une étendue de sable sur lequel s'égare un bob kaki. Une brusque bourrasque balaye définitivement toute trace du journaliste. Le soleil domine, offre à la mer quelques éclats chatoyants. Plus tard, les journaux du Sud-Ouest relayés par les chaînes de télés nationales parleront de ce nouveau phénomène naturel : les sables mouvants du Bassin d Arcachon. D'abord exceptionnels, ils deviendront rapidement de l'ordre de la banalité, un danger parmi tant d'autres. Certains touristes alertés choisiront une destination moins risquée. Mais en grande majorité, non.
Cléo BOSSON BOULNOIS
Un bob pour le climat
Ils habitaient une maison au bord de la plage, tout au bord, "les pieds dans l'eau" disait l'oncle faisant un geste jusqu'à la moitié des cuisses qui rappelait la sauvagerie de la dernière tempête, encore récente dans les esprits, elle les avait contraints à fuir en pleine nuit pour se réfugier dans le sémaphore voisin.La famille entière avait levé le camp abandonnant tout. Dans la débâcle générale de ce mois de février le couple, leurs huit enfants et le pépé qui avait refusé d'abandonner son fauteuil roulant pourtant bien défraîchi, s'était soumis à la péremptoire injonction du frère de madame, qui, depuis toujours (au dire des voisins) semblait faire la pluie et le beau temps auprès de cette tribu cocasse coupée de toute vie sociale. La mamette petite pomme rabougrie dont quelques vieux se souvenaient encore pour l'avoir enlacée dans les bals de l'été n'avait pas suivi non plus, son grand âge n'autorisant plus qu'un seul voyage, le dernier. Cette échéance paraissait pourtant trop lointaine à tous, son centenaire approchant, les voisins se réjouissaient, comme les élus de la ville d'avoir enfin une bonne raison d'investir les lieux, ses propriétaires n'autorisant plus la moindre visite depuis longtemps. L'oncle, un espèce de pachyderme poilu et rubicond, avait transporté pépé et le fauteuil à bout de bras, la fureur des éléments avait certainement couvert ses jurons fleuris qui faisaient sa renommée dans les estimanets de la commune. Il en rigole encore Maintenant. -"t'as vu le déchet et sa Rolls, hop, dans la lanterne et que ça saute" Lui, il n'avait pas quitté le domaine et toute la nuit ceux qui se sont approchés, sauveteurs, simples curieux ou promeneurs traqués par l'urgence et la violence de cet orage l'ont vu s'agiter entre terrasse, bâtisse et jardin. La plupart ont pensé que, pris en tenaille entre son orgueil démesuré et la peur panique qui devait le gagner, il devenait fou. Il aurait défié les flots montants prisonnier comme un rat dans une nasse pour éviter de céder à la raison et rejoindre sa troupe déjà mise à l'abri. Une autre version des événements plus glorieuse et qu'il n'infirmait jamais, même après force apéritifs dans les bars du quartier, racontait qu'il avait passé toute cette nuit à lutter contre les éléments pour protéger et rassurer la mamette, qui aurait pu disparaître comme un fétu de paille, déjà à la moindre vaguelette. Cette version relayée par chaque unité de cette armée homogène et qui n'avait jamais révélé la moindre faille, était devenue plus qu'une information, une légende. La famille au grand complet la gonflait au cours du temps de détails singuliers mais le thème central demeurait sous le titre glorieux. « La vieille dame et la mer », tous les quotidiens en avaient parlé ainsi. Les événements passés, très vite la petite troupe, son général et ses invalides avaient retrouvé le cours normal et ordinaire d'une existence sans surprise. Cette vie au quotidien rythmée par les vociférations de l'oncle se déroulait entre le jardin qui produisait abondamment en été et les retours de pêche. Dans les épiceries locales la livraison du butin parfumé d'océan servait surtout à donner à cet acteur né une nouvelle tribune pour commenter ses exploits. -" s'il avait su il aurait laissé l'océan faire son travail, au lieu de ça il doit continuer à nourrir tous ces bons à rien". Chaque jour qui passait, pourtant, voyait grossir sa notoriété, le sauveur de toute une famille n'avait d'ailleurs rien fait pour repousser les journalistes en quête de héros. Une fois passé le flot d'images et de drames racontés, ils se pressaient au domicile du surhomme, qui, royal, les recevait sur son bateau. Comme souvent, l'homme ordinaire a besoin de se construire des héros. Ces héros dans lesquels il se reconnaît, qu'il peut exporter, emmener en vacances ou en week-end dans sa belle-famille, qui l'accompagnent dans ses pires moments de solitude, à l'atelier, la ville avec madame, au lit avec monsieur. Une idée répandue dans des magazines réputés professe que, de nombreux coïts ne se passeraient pas avec les auteurs présents, mais avec leur doublure idéalisée et magnifiée. Ce qui est tout de même rassurant. Certainement sur la foi de cette prophétie l'oncle, conscient peut- être de sa responsabilité nouvelle et du titre qui venait de lui être décerné se transformait de jour en jour. Au panthéon des héros, cette bonification n'atteignait pas, pour l'instant, des Sommets. De ces sommets qui attribueraient le titre de grand-cru à une vulgaire piquette, mais, nous n'étions pas très loin d'un cru bourgeois. Nul ne sait si cette transformation était travaillée avec un quelconque manager ou si, l'intuition aidant il avait mesuré les nouveaux avantages qu'il pouvait retirer de ce titre obtenu. Se devait-il de valoriser après des années de démonstrations diverses, consacrant sa rustique personne et son caractère grossier, l'apparition d'un homme nouveau ? Percevait-il même les enjeux de cette métamorphose ? Le résultat était là, plus un seul naufrage sans qu'il soit soupçonné d'avoir au moins tenté un sauvetage. Plus une seule tempête sans qu'il soit consulté sur le mode de prévention à appliquer. Un accident ferroviaire dans une gare proche, on l'y aurait vu portant secours. Une attaque mortelle de frelons, il y était. Une morsure de renard, il connaissait l'antidote. Un retraité tombant d'une palombière, il aurait tendu ses bras évitant que la chute ne soit fatale. Tout, tous promouvaient son courage. Les malades venaient le voir, les enfants pour un devoir en retard, les jeunes filles pour une peine de cœur. Il se disait également qu'il recevait les veuves un peu trop longtemps, mais ce n'étaient certainement que ragots de sortie de messe ou pire, jalousies de pire provenance. Passer de l'opprobre à la sainteté n'est pas seulement une vertu, il est vérifié que, la ligne de séparation qui éloigne l'un de l'autre est si ténue que l'homme ordinaire, qui n'essaie jamais de la franchir, témoignerait d'un infini respect pour celui qui ose, quel que soit le camp qu'il ait choisi. L'oncle l'avait bien compris, il profitait donc de cette espèce d'impunité qui fournit les arguments de la morale à tous les malfrats comme à tous les prélats. Les gendarmes n'osaient plus le stopper, lorsqu'il filait à vive allure. S'il devait se rendre sur un drame ignoré encore de leurs services, il n'était pas question de ralentir les secours. Les enseignants, encore hier soupçonneux sur ses méthodes éducatives auprès de ses neveux s'en étaient fait un allié. -"Hier encore, il était venu consulter les collègues sur la finesse de l'accord du participe passé employé avec le verbe avoir ". A la poste on le saluait maintenant, l'invitant à couper la file toujours longue, (les citoyens attendent d'ailleurs des améliorations, merci). Son temps précieux au service des autres ne pouvait être gaspillé ainsi. Il fréquentait désormais la médiathèque, lieu où les liseurs ordinaires des journaux avaient pour habitude de les empiler contre leur fauteuil, se réservant la primauté des nouvelles locales et Internationales, ce qui avait pour effet d'encourager l'ignorance des foules. A midi ils quittaient leur siège et celui de la culture qu'ils venaient d'annexer quelques heures. Dans ce lieu du savoir pour tous il veillait aux grains. -"Bonjour, on va partager, vous voulez quel canard ?" se devaient ils maintenant de concéder aux lecteurs potentiels discrets et si patients. Bref, un sans-faute pour ce repenti que les simples saluaient et que les notables, sans toutefois l'avouer enviaient un peu. Certains lui faisaient les yeux doux dans l'intimité d'une rencontre informelle, et l'obtention du moindre accord administratif, se réalisait avec une inédite rapidité. L'oncle s'en amusait et devenait le citoyen de la commune aux demandes les plus extravagantes, remerciant vivement chaque élu rencontré de sa diligence et le faisant savoir autour de lui. Comment s'étonner que les escaliers du pouvoir ne lui aient pas encore été offerts ! Cette consécration ne paraissait pas cependant lui convenir, il arguait de son manque de temps, trop absorbé par le bonheur des siens pour espérer être à la hauteur d'un mandat électif dont il voudrait non seulement être digne, mais fier. Convoqué dans le Saint des Saints de l'exercice du pouvoir local par son premier magistrat lui-même, il sembla sur le point de céder pour une place honorable sur la liste du Maire aux élections proches. Quelques indiscrétions permirent le relais de cette information en soulignant le peu d'importance que revêtait cet entretien. Il s'agissait seulement de fixer un calendrier de festivités pour préparer le centenaire proche (bien que personne ne sache son âge véritable), de la mamette. Née dans un pays lointain, l'oncle jura de lancer les recherches afin de faire le point sur cette énigme, mais resta intransigeant sur une quelconque mise en scène, -"s'il l'avait une fois encore sauvée de la mort, il ne pouvait garantir, tant elle était faible, de faire encore obstacle à un fatal destin face à une si grande émotion". Le Maire, laïque fervent, accepta même le principe d'une célébration chrétienne en son honneur et d'un discours d'éloges qui lui serait transmis lors de la cérémonie annuelle des vœux. Cette réconciliation de l'église et de l'état enfin acquise et toutes les communautés de la ville applaudissant à ce geste, mis à part quelques anarchistes minoritaires, se disant volontiers trahis par l'un des leurs, passé à l'ennemi, un accord permit de sceller l'avenir politique de la ville. Revenant sur ses premières hésitations il accepta de paraître en troisième position sur la liste en construction à quelques mois des municipales. La campagne fût âpre et l'équipe en place peu ménagée. Ses réalisations durant le mandat précédent tenaient dans un mouchoir de poche et l'essentiel des projets d'un programme peu ambitieux allait vers la protection face aux risques naturels, l'eau, le feu, l'érosion des sols contre lesquels le triumvirat actif de la campagne promettait une série de remparts sans faille. L'homme ordinaire s'enflamme vite, mais peu longtemps sur le thème de l'égalité et de la justice sociale, l'équité lui semble un bien aussi précieux qu'illusoire. Pour ce brave électeur la pauvreté comme l'immense richesse sont affaire de destinée et toutes les intentions qui gouvernent à cette élégante ou misérable distribution, sont inscrites dans le grand livre du hasard, ce grimoire dans lequel il n'aura jamais espoir d'écrire la moindre page. Résigné, il vote pour l'ordre et la continuité. L'opposition mena une belle et ardente bataille A son actif la lutte contre les privilèges et la redistribution du patrimoine aux plus démunis. Plus une once du sable fin qui leur avait été volé par divers lieux privatifs ne devrait désormais leur échapper. Consécration de cette Marxiste aventure, tous les "corps morts " attribués à des familles et qui se perdaient à la mort des ascendants directs seraient dorénavant attribués à des familles dans le besoin. A ces mêmes familles seraient destinés les bateaux des professionnels cessant leur activité, embarcations de tout temps détruites. En cas de victoire, elles seraient rachetées par la commune, puis, offertes pour poursuivre utilement leur vie sur les flots bleus. Ambitieux et progressiste programme, pourtant, le destin des bateaux et des corps -morts devait rester inchangé. " Le paquebot des forces révolutionnaires ECHOUE au port ", titrait le lendemain des élections la presse locale. L'équipe municipale venait d'être réélue avec un score qui s'approchait d'un fort coefficient de marée, un peu sous la barre des soixante-dix – neuf pour cent. L'oncle, gloire locale avait été mis à contribution. De tous les meetings, de toutes les cérémonies, il avait, avec finesse et bien conscient de son ascendant sur ses compatriotes, adroitement "joué le coup". Son aura renforcée, il avait quelque peu effacé la posture déjà bien vacillante de "l'ancien maire". Le coup de théâtre qui suivit l'élection dans le très intime vote qui suivit la victoire n'étonna presque personne, sauf l’intéressé lui-même, trahi par son propre groupe. Allié au premier adjoint l'issue de ce scrutin venait enfin de consacrer au poste suprême « Un homme de l'ombre, en pleine lumière ». Le héros de la tempête, après la furie des éléments venait de vaincre les sceptiques. Il devenait premier magistrat d’«une ville à reconstruire ». La Dépêche locale titrait alors. L'accord prometteur conclu avec l'ancien élu n'avait été qu'un simple marchepieds et l'oncle venait tout simplement de reléguer celui-ci à son statut de potiche, d'épave même, qui serait un qualificatif plus adapté, tant l'imposture consommée avec délice, avait été aussi cruelle qu'inattendue, le laissant sur le flanc pour une improbable durée. Les journalistes revinrent, le vainqueur lui, continuant sa vie dans la concordance parfaite avec les marées poursuivait ses campagnes de pêche, déléguant en mairie et offrant toutes ses prises à la maison de retraite ou personne ne regrettait d'avoir voté," pour un homme si gentil" ! Il reçut les scribouillards en Mairie, contant peu sa victoire, offrant un visage d'humilité et d'abnégation. Le programme de rénovation paraissait bien léger, mais l'homme était attachant. La victoire tout à fait acquise après quelques distributions de délégations, l'opposition obtint, non sans mal, la gestion du cimetière et celle des commémorations, de la voirie et de l'évacuation des déchets, la fête pouvait commencer. Le nouveau Maire s'était réservé la gestion du port, ce qui fût fort apprécié des marins locaux. Les réjouissances se tinrent donc sur le domaine maritime, après moult discours, danses, ovations et pétarades diverses, alors que la foule poursuivait bruyamment ses libations, abusant de la "piquette" locale, le nouvel élu, un peu éméché partit se coucher. Il ne trouva pas tout de suite son lit et se blottit dans le jardin le long d'un buisson et d'un massif de cinéraires ou peut-être d'immortelles qu'il devait partiellement écraser. C'est là que les gendarmes vinrent le chercher au petit matin pour lui demander des comptes sur l'origine des ossements trouvés par quelques élus (de l'opposition) dirigés par le candidat malchanceux. Ceux-là étaient venus pour une expédition de nuit avec pour objectif d'honorer l'élu tout frais nommé en plantant dans son jardin le "mai" qui symbolise la réussite d'un citoyen si peu ordinaire qu'il doive présider à la destinée de tous ses semblables. Que cela soit pour cinq années ou plus longtemps les responsables de cette action expliquèrent qu'ils n'avaient pas voulu se soustraire à cette coutume. L'élu évincé, lui fut plus direct. Il expliqua qu'il n'avait jamais cru à la réclusion, "pour son bien " de la mamette ses soupçons étaient confirmés et que le "délinquant" qui occupait maintenant son fauteuil allait devoir rendre des comptes. Ceci constitua l'épilogue d'une bien étrange rédemption, la mort de la vieille mamie était bel et bien déjà ancienne, cachée à tous elle avait permis à la famille de bénéficier durablement de la jouissance d'un corps-mort qui, sinon, leur aurait échappé à l'officialisation de son décès. La vie normale reprit son court, normal, l'oncle partit en prison, un nouveau Maire fût élu (l'ex candidat malheureux), les corps-morts continuèrent à être attribués a des quidams chanceux et financièrement plutôt à l'aise, les citoyens ordinaires poursuivirent leur existence tranquille, se trouvant très vite d'autres héros.
Jean-Paul Labardin
Immortelles
Dix-huit heures, soirée orageuse sur le Bassin. En se chargeant de nuages gris, le ciel prend peu à peu la couleur mélancolique de l’automne qui s’annonce. Les mains enfoncées dans les poches de son pantalon, Charlie surveille la marée montante. L’eau recouvre peu à peu les plaques vertes et brunes et offre un puzzle de petits miroirs à la lumière d’un soleil couchant perturbé par la pluie qui approche. Le voile noir des nuages assombrit davantage son moral qui a du mal à monter plus haut que la partie dite « des chaussettes ». Les poings crispés et serrés au fond de ses poches l’aident à contenir la tension qui l’oppresse depuis l’arrivée de Noa au début de l’après-midi. Charlie sursaute. Un éclair zèbre le ciel au-dessus de la pointe du Cap-Ferret, les deux points noirs des cabanes tchanquées apparaissent et disparaissent, et aussitôt, le grondement du tonnerre se fait entendre. L’orage est là, dehors. Les éléments et son tourment se déchainent. Son retour sur le bassin lui a permis de retrouver toutes les sensations douces de son enfance. Alors pourquoi en s’écrasant bruyamment sur les baies vitrées de la véranda, chaque goutte de pluie ravive-t-elle sa désillusion ? La quiétude de sa maison au bord de l’eau échoue à apaiser la violence de ce découragement qui l’étouffe depuis quelques années. Pourquoi tous ses efforts pour vivre mieux ailleurs ont-ils été inversement proportionnels à ses attentes de libération et d’espérance ? Ce soir, la certitude que l’herbe n’est pas plus verte là-bas l’oblige à stopper son errance inutile. En regardant la plage désertée par les promeneurs, Charlie aspire à se cramponner à un de ces corps-morts abandonnés. S’y ancrer fera-t-il taire enfin, la souffrance quasi existentielle qui taraude son corps et sa tête devenus adultes ? Ne plus divaguer. Ne plus s’égarer. Depuis son adolescence, toutes les questions se sont multipliées sans trouver une seule réponse capable de dissoudre son vague à l’âme. Le léger cours de son insatisfaction, motif de son départ pour la capitale, est devenu petit à petit, un véritable fleuve. Que faire pour fermer la vanne et retrouver un peu de sérénité ? Dire et redire ne lui permettent pas d’arrêter le flux et le reflux des doutes et des peurs qui submergent sans cesse tous ses moments de tranquillité. Comme si le langage avec tous ses mots, était ce batardeau qui protège d’une forte tempête mais qui laisse toujours filtrer un peu d’eau salée. Les pelouses et les fleurs du jardin en sont le plus souvent desséchées. Protections perfectibles. Ce soir, la digue s’est rompue et les mots affluent à nouveau avec l’eau qui monte. Assis sur un tabouret, les mains sur les genoux, Noa regarde le sol. Il semble peiné et agressé par toutes les interrogations de Charlie. Depuis son arrivée, ils cherchent ensemble des explications et des interprétations qui leur permettraient de mettre à distance « impression, (perdre la boule)sensation, émotion » et qui pourraient ainsi bonifier cette soirée qui s’annonce si mal. - Tu finis par m’emmerder avec ton spleen à deux balles…Tu t’enlises dans un marasme qui ressemble à la vase du chenal. Quoiqu’on fasse, elle revient toujours… Le bonheur ne serait-il pas de jouir de tout ce qui est offert et de naviguer sur tous les bons moments en évitant simplement les zones trop boueuses ? Noa est ostréiculteur, il est né, il vit et il travaille ici. Quand il ne se sent pas très en forme, une balade dans la forêt des Quinconces, une sortie en bateau ou simplement une pression bue au bar de la jetée suffisent à le retaper. Noa est cet ours tranquille et silencieux qui attend le retour des jours plus doux, tapi au fond de sa darse. Et ce soir, il ne supporte plus ces palabres sans fin. Il serait prêt à courir jusqu’au bout de la presqu’île pour marquer un point d’arrêt à ce flot de paroles vaines. Quand il était enfant, avec ses cousins, Noa se souvient qu’ils multipliaient les coups de pelle pour protéger leur château de la marée montante. Ils ont toujours perdu. Leur barrage a toujours lâché. Peu sensible à l’invitation de se taire, Charlie, tenace, revient à la charge. Sa lutte stérile contre la submersion cafardeuse se poursuit. - Tu as raison Noa, le bassin avec ses plages et ses forêts apporte l’apaisement et la sérénité que le béton et l’agitation des villes détruisent. Le mouvement perpétuel des marées est celui du roseau qui plie mais ne rompt pas. En quittant le rythme urbain agressif de la capitale, j’ai retrouvé une douceur de vivre. Les odeurs salées, les longues marches sur la plage accompagnent toujours mon regard fasciné par la lumière et les couleurs si belles et si changeantes du ciel qui se reflète. Mais ce soir, la force du vent me cingle de tous ces maux poisseux et envahissants que sont l’habitude, le quotidien ordinaire, les répétitions… - Toi qui aimes chanter, laisse-toi plutôt bercer par la chansonnette « Yalo, yapalo » des promeneurs fascinés par cette étendue pleine ou vide. Laisse ton regard se poser au-delà des passes le jour, et la nuit, le phare du Cap-Ferret t’ouvre sa porte sur l’océan. Ce soir, ce spectacle orageux grandiose et fascinant ravive un peu de cette déception qui continue à se lire dans tes yeux bleus qui se glacent par moment. Ton mal-être semble augmenter avec le déchainement des vagues. Viens, s’il-te-plait, nous n’allons pas passer la soirée à regarder la pluie tomber. Je ne suis pas venu pour cela et tu étais d’accord ? Comme Charlie ne réagit pas, Noa s’éloigne de la lumière et s’affaire à sortir sa queue. Une queue longue et lourde, il aime les coups forts. En l’apercevant, Charlie sourit mais poursuit. - J’aspire à sortir enfin de cette asphyxie, à ne plus sombrer dans cette overdose de tous ces pourquoi, où, comment, mais je ne peux… - On y va maintenant, Charlie, l’interrompt Noa resté dans la pénombre. J’en ai marre… Sinon je me tire. Sa voix assourdie contient toute sa colère et son agacement. Charlie lève les épaules, ouvre son col et pousse un soupir. L’air est encore chaud, ses mains sont moites. (perdre la boule) - Je regrette tant la nudité de l’été, la chaleur sans orage, le soleil sans nuage…et le plaisir sans angoisse… - Arrête. Dis-toi que rien d’autre n’a d’importance et ton malaise va se dissiper, supplie Noa en s’approchant. Je ne veux plus écouter ton bavardage dont le sens m’échappe la plupart du temps. Nous avons tout pour être heureux alors profitons-en. Je commence ? Charlie s’approche, une queue courte et légère à la main. - Essaie d’être plus rapide que d’habitude, l’interpelle Noa un peu brusquement. Après toutes tes interrogations sans fin et ces heures de parlotes stériles, j’ai vraiment envie de passer une soirée agréable, dans l’action. Pendant plus d’une heure, leurs échanges se limitent à quelques gémissements, soupirs, regards. Charlie sent son corps se détendre. Le jeu l’intéresse, ses coups sont harmonieux et lui réussissent. Noa par contre est de plus en plus tendu. - Ras-le-bol, finit-il par lâcher, excédé. Mon étreinte est trop rigide, je perds de ma force. Je ne suis pas dans le coup. On arrête cinq minutes. Je peux allumer une cigarette ? Charlie acquiesce d’un hochement de tête, reste sans parler et s’assoit sur le tabouret, la tête dans les épaules. - Joue en solitaire, je prendrai peut-être plus de plaisir à te regarder, lui dit Noa en envoyant sa fumée au plafond. - Arrête, tu sais bien que cela ne m’intéresse pas. Je t’attends. Le dos de Charlie se voute à nouveau sous le poids de ses idées noires qui reviennent. - On continue…Noa écrase son mégot. Arrêtons s’il-te plait de se tirer la bourre. A jouer aussi calmement, tu augmentes ma tension et tu me gâches le plaisir de tes coups. Le jeu reprend. Ils tirent, liment, caressent sans échanger un seul mot. Charlie sent que les muscles de son corps retrouvent leur souplesse et lui permettent d’aller jusqu’au pelotage. Ses impressions de vide et de panique se dissolvent totalement dans les volutes de fumée des cigarettes de Noa. La barre entre ses yeux a fondu et les mots connus et caressés, reviennent se nicher dans sa tête… beauté, lumière, calme. Hors la saison touristique, Charlie aime prendre son vélo et découvrir le domaine de Certes et ses oiseaux, pédaler jusqu’au Grand-Crohot, grimper la dune de sable au milieu des pins et courir jusqu’aux vagues de l’océan. Le bassin offre toute cette rêverie de l’eau en mouvement qui atténue les bords coupants d’une réalité parfois difficile. Noa s’énerve de plus en plus, ses bandes ratent les unes après les autres. Il enrage. - Je n’y comprends rien. Tu disais être au pire de ta forme et tu n’as jamais eu autant de facilité et de sureté dans tes coups ce soir. Noa semble perdu. Il remet machinalement du bleu sur sa queue. - « La bandaison, Papa, ça ne se commande pas …», Charlie lui chantonne la chanson de Brassens en assourdissant au maximum sa jolie voix de soprane. Elle éclate de rire et dénoue son chignon avec sensualité. Ses cheveux d’un blond vénitien éclairent son visage et soulignent la pulpe rouge de ses lèvres. Elle s’approche de Noa en souriant. - Pardonne-moi ma mauvaise humeur de ce soir. Je suis là où j’ai envie d’être et je m’y sens bien, dit-elle en se lovant amoureusement dans ses bras. Douceur des corps qui se touchent, progression lente du désir accepté. Féline, elle éteint le lustre au-dessus du drap vert accentuant les zones d’ombre de la pièce et redonnant ainsi, vie à l’eau qui s’agite dehors sous le vent. Mutine, elle se colle contre lui et susurre en lui mordillant tendrement le lobe de l’oreille. - Que vivrait l’homme concentré sur ses boules si la femme ne venait pas l’y rejoindre ? L’orage est passé. L’atmosphère s’est libérée de toute l’humidité des tempêtes d’équinoxes. Charlie et Noa, amarrés l’un à l’autre et appuyés à la table de billard admirent cette grande marée un soir d’orage. L’ouverture du bassin sur l’océan en furie laisse entrer les vagues majestueuses. Les embruns frappent le parapet et inondent le parvis de l’église Saint Eloi. Précieux garde-fou pour l’eau qui déborde et pour tous ceux qui s’égarent. - J’ai perdu et tu as gagné. Noa sourit, il sent que Charlie a enfin lâché son inquiétude. Il caresse les cheveux blonds et les soulève pour déposer un tendre baiser sur sa nuque. Je veux prendre ma revanche. Je te propose de continuer la partie au creux du lit douillet dans ta chambre à l’étage. Il pose la queue du billard dans le râtelier, elle y rassemble les deux boules blanches et la boule rouge. En souriant, ils se regardent, s’enlacent et s’embrassent fougueusement. Le ciel prend sa couleur rosée. L’orage fuit vers d’autres rivages. Les eaux du bassin vont entamer une nouvelle descente. Ballet naturel guidé par la lune qui sourit derrière quelques nuages encore accrochés au-dessus du port ostréicole. Dans le jeu amoureux, les amants hésitent, avancent, reculent. Parfois même, ils trichent car ils ne peuvent pas faire autrement. Le doute est toujours salutaire à ceux qui aiment et qui sont aimés. Jeux de l’amour et du hasard. La nuit sera douce et paisible. Pour le billardiste comme pour l’amoureux, qu’il soit homme ou qu’il soit femme, le seul passage obligé pour jouer, est de devoir perdre la boule.
Annick JULLIARD
Perdre la boule
Nouvelles
En haut de la cale à bateaux, le dos rond et les mains dans les poches d’un ciré jaune, le vieil homme scrute le brouillard. Les ferrailles des parcs à huîtres et les pignots tordus sont fondus dans la brume épaisse. Perdu dans ses pensées, il descend lentement vers le bas de la pente. Ses sabots de bois raclent le ciment usé. Il s’arrête là où le sol devient glissant. Des flaques livides luisent sur la vase brune que la mer a abandonnée en fin de nuit. L’idée incongrue traverse son esprit. Il marmonne : — Il y a toujours une île… Il a parfois de telles fulgurances, issues de nulle part, qui le laissent toujours interrogateur sur le fonctionnement de son cerveau. Il a souvent pensé à noter sur un carnet les pensées incongrues, sans queue ni tête, qui surgissent sans prévenir, il ne sait d’où. A quoi servirait de les inscrire, il ne saurait qu’en faire. Quelqu’un qui trouverait un tel carnet rigolerait à sa lecture. Mais surtout, écrire l’effraie. En une réminiscence de la Primaire qu’il n’aimait pas et qu’il a quittée dès qu’il a pu, il a gardé en lui la vieille peur de l’orthographe qui échappe à l’attention. Les fautes lui valaient des zéro qui roulaient dans la marge des cahiers. Il a abandonné l’école sans regret, pour la mer, près de laquelle il est né. Au moins, là, on est son maître. Sauf sur le poisson. Et sur la mer bien sûr. Ce sont eux qui décident. Ce matin, il aimerait toutefois qu’il y ait toujours une île, comme celle là-bas, pour l’heure cachée dans la brume… Une île c’est un ailleurs, un monde quelle que soit sa taille. Une sorte de navire immobile. C’est une interrogation. Et une promesse. Un avenir donc. Un recommencement. Une éternité. Il aimerait qu’il y ait toujours une île, refuge pour les marins perdus, ceux qui ne reviennent jamais à terre… où pourtant on les attend. L’homme en ciré jaune aime croire que chacun a une île qui lui est destinée. Que, même né loin de la mer, chacun a la sienne quelque part, qu’il faut découvrir. Le vieux se dit que bien peu y parviennent et il trouve cela triste. C’est l’heure où la marée remonte. Même si le temps n’était pas bouché dans cette aube grise, on ne la verrait pas venir si tôt. Ici, elle vient de loin, elle a tout le Bassin à remplir avant d’arriver. Elle n’est pas pressée, elle a six heures devant elle. Ce matin il n’y a pas de vent pour la pousser aux fesses. Les corps-morts dans leur gaine d’algues, esseulés, jonchent ce que le brouillard laisse apercevoir de l’estran. Au début de la nuit, au descendant, la flottille des pêcheurs est partie, laissant un lourd silence sur la plage vide, telle une oasis après le départ des caravanes. Il n’y a que sa pinassote à lui qui est restée au bout de sa corde. Les autres sont quelque part au loin, revenant avec le flot. Ont-ils pris du poisson ? Peut-être. Cela sent la vase fraiche, l’iode et le varech. L’automne est là. D’un pas lourd, comme harassé, l’homme courbé remonte la cale encore mouillée du flot retiré et de la brume spongieuse qui colle. Il longe des empilements de caissettes en bois vides, des fouillis de cordages usés et quelques vieux filets en tas d’où émergent des drapeaux multicolores qui pendouillent, fixés à des bambous grisés. Depuis les cabanes construites au bord de la plage, proviennent des odeurs de feu de bois. Les femmes à l’ouvrage sur les coquilles coupantes brûlent des galips pour se réchauffer. En haut de la pente, elle l’attend. Toute menue, immobile, les bras frileusement noués sur le châle entourant sa tête et sa poitrine maigre. Ses yeux rougis creusent l’épaisseur du brouillard. L’homme n’ose la regarder tandis qu’il enlace ses épaules. Avec douceur il oblige la femme à se détourner, la forçant à s’éloigner du bassin asséché et vide. Dos à la mer en allée et au brouillard épais, ils vont vers le chemin sous les pins dont on distingue mal le plumet. Il pense soudain aux poissons qu’il n’est pas allé chercher aujourd’hui et regrette aussitôt cette idée indécente. Il ne pouvait pas pêcher aujourd’hui, il fallait rester près d’elle. Elle se retourne et s’immobilise, les yeux braqués sur la tenture grisâtre qui dissimule le paysage. Il la laisse faire. Cela ne servirait à rien de la brusquer, il sent qu’il doit aller à son rythme à elle. Au-delà des premiers pignots qui balisent l’estey en rayant vaguement la draperie blafarde, on ne voit rien. Comme si le monde s’arrêtait là. Un étranger qui débarquerait pourrait s’imaginer tomber dans un gouffre interstellaire de l’autre côté de ce rideau gris… D’ailleurs, les terriens croyaient ça dans les temps reculés ; que la terre était plate et qu’au bord on tombait dans une sorte de ravin interminable… Seuls les marins ont osé aller y voir. Heureusement qu’ils étaient là, sinon on serait tous tassés au milieu, craignant encore de disparaitre là-bas. Aujourd’hui, les terriens n’ont plus peur du gouffre, mais ils confondent la mer avec la plage et ses baignades. Ils n’entendent rien aux crocs rocheux tapis, aux sables et aux glaces qui emprisonnent, aux vagues scélérates et aux ouragans. Ni aux monstres sous-marins qui peuvent emporter au fond un bon bateau neuf… La femme est tournée vers la brume, le cou tendu, cherchant à voir plus loin. Son regard n’ira pas là où elle voudrait qu’il perce. Il comprend qu’il est trop dur pour elle de quitter les lieux si vite. Ça l’est pour lui aussi. A cet instant, l’invisible soleil montant, pugnace, teinte d’orange pâle le brouillard enlisé qui résiste, cramponné au sable mêlé de vase et de coquilles d’huîtres mortes. Il semble avoir emmailloté même les bruits ; le silence est si dense. Les mouettes avides, d’ordinaire criardes, sont absentes du ciel opaque. L’homme a l’impression que c’est toute la nature qui se met en communion avec eux deux. Elle se fait oublier, triste à mourir. Il sait que c’est son imagination un peu débordante, qui lui fait penser ça, car la nature n’a pas de compassion particulière pour les humains en peine. Tant pis, mais le fait de l’avoir imaginé lui fait un peu de bien. Là-bas, au bout de la presqu’île, le phare invisible doit corner dans la purée de pois. Il a guidé la flottille vers la passe Nord. Au moins n’ont-ils pas eu de vent pour creuser un peu plus les rouleaux traitres montant du large. Ils rament vers ici, à la boussole, portés par le flot, surveillant les abords de l’Île qu’ils laisseront à tribord. Les mains calleuses du pêcheur, durcies par le sel et le vent, griffées par les hameçons et les nageoires, soutiennent la femme qui va à son flanc. Il la remet doucement sur le chemin vers la forêt. Pour sûr, s’il n’était pas là, elle s’effondrerait sur le bas-côté. Et puis soudain, un souffle passe. C’est la mer qui respire. Elle arrive ! En l’air, invisible dans la nuée, un oiseau marin crie. Il a deviné le flot qui rentre, ramenant la pitance. Il part en chasse. Un triangle bleu troue soudain la couverture blanchâtre qui se délite lentement, diluée par la brise qui monte en avant-garde de la mer. Un instant on aperçoit planer l’oiseau blanc et gris aux sévères yeux jaunes. Le pêcheur qui n’est pas parti en mer ce matin et la femme qui va près de lui se retournent, s’immobilisent, hésitant à abandonner le bord sableux. D’une autre déchirure dans le coton gris-jaunâtre, le flot luisant apparaît à quelques encablures. À l’ancre dans le chenal, honteuse peut-être, la goélette rentrée hier soir et jusque-là dissimulée par le linceul du brouillard, brille dans un rayon du soleil levant. Un modèle pour un peintre ? — Ah ! S’il y avait au moins une île… se redit l’homme en se détournant. Sa main serre l’épaule de la femme qu’il n’ose regarder, il sait qu’elle pleure. Depuis hier elle pleure, avec la régularité immuable du ressac qui va et revient. Il a cru qu’à un moment elle n’aurait plus de larmes à verser, mais non. Désarmé, obstiné parce qu’il le faut bien, il l’entraîne vers leur maison au pied de la dune. Ils laissent derrière eux le rivage et la mer qui approche. Au mitan du chemin, comme une sentinelle, l’animal les regarde venir… Le vieux se dit qu’il ne connait pas de chiens errants ici. Puis, identifiant soudain celui-là, il fait passer la femme dans son dos, électrisé par la frayeur ancestrale. Lui reviennent, tel un coup de poing, les histoires entendues aux veillées. Les légendes et les contes, les croyances ataviques et les peurs enfantines… Mais sa femme repasse devant lui. Mettant au passage sa main sur le bras de son homme, elle murmure : — Que veux-tu qu’il me fasse de plus ? J’ai déjà tout perdu. Lui ne répond pas. Que dire à ça ? Rappeler que lui aussi a perdu ? Autant qu’elle. Et que, pour elle, il est là… Cependant, elle l’a contourné et s’en va vers le loup qui les observe. L’homme hésite une seconde. Des coups de tabac, des tempêtes, des tornades, il sait s’en accommoder. Mais d’un loup… Il la rattrape, hésitant toutefois devant le regard du fauve. Elle s’est arrêtée à deux pas de l’animal et lui parle : — Qu’est-ce que tu fais là le loup ? Tu es perdu ? Nous, nous sommes venus guetter. Nous guettons depuis cette nuit… Et toi, qu’est-ce que tu viens guetter ici ? Elle fait un autre pas vers le fauve. Elle ne va pas le caresser tout de même ! s’effraie l’homme qui se demande avec anxiété ce qu’il saura faire si la bête attaque. Du regard, il cherche une pierre, un bâton… Une simple pigne… Dans sa poche, il serre l’Opinel qu’il n’arrive pas à ouvrir d’une seule main, mais qu’il n’ose sortir franchement. Ce n’est pas la peine d’agacer le loup… Elle raconte : — Notre fils s’est perdu dans le brouillard de Terre-Neuve. La goélette a longtemps sonné la cloche qui guide les doris. Lui ne l’a pas entendue, à cause des courants qui l’ont emmené trop loin disent-ils… Eux autres sont revenus hier soir. Je crois qu’il va rentrer aussi, plus tard sans doute… Je le guette. Le loup penche la tête d’un côté, puis de l’autre tandis qu’elle lui parle. Pareil qu’un chien qui écoute. — Mais qu’est-ce qu’elle s’imagine ? s’interroge l’homme. Qu’il comprend ? Il se dit qu’au fond, il vaut mieux qu’elle ait un imaginaire auquel s’accrocher plutôt que de se mettre à hurler de chagrin. Lui sait bien que, de là-bas, on ne revient pas en doris. Il imagine que parler, même à un loup inimaginable, fait que sa peine ne reste pas enfermée à fermenter et pourrir. Alors, surveillant l’animal, il attend. Combien de temps restent-ils là tous trois ? Une éternité semble-t-il au pêcheur. Pourtant, à peine dix secondes. Peut-être… Enfin elle se tait. Après un gémissement bref, le loup se met en marche. Au trot, il passe à côté d’eux, descendant vers la plage embrumée. L’homme se dit qu’ils auraient alors pu se toucher… Il regarde le loup filer vers l’estran et disparaitre dans le brouillard agrippé à la vase. Un long frisson le parcourt. Il enlace sa femme et, à petits pas trainants qui font résonner leurs sabots, ils retournent à leur maison construite entre quatre arbousiers. Le lendemain, bien avant le jour, l’homme avale vite le café mâtiné de chicorée. Tout à l’heure il retournera pêcher. Il faut bien vivre. La femme tient son bol, sans boire, les yeux dans le vague, bien plus loin que les flammes de leur cheminée qu’elle regarde sans les voir… Hier, avant de se coucher, elle a arrêté la pendule. Chez eux, on fait ça lorsque la Mort est venue faucher dans une maison. L’homme se lève. Il évoque le loup. — De quoi parles-tu ? murmure-t-elle, les yeux fixés sur l’âtre. Elle resserre sur sa poitrine les pans du vieux châle tricoté. Il hésite, désemparé, ne répond rien. Tandis qu’il passe derrière elle, sa main s’attarde sur l’épaule de la femme. — A ce soir, dit-il.Il a presque envie de rester encore aujourd’hui… — A ce soir, dit-elle. Alors il sort et s’en va vers le Bassin. Il est pressé de revenir. Il ne parla plus jamais du loup. À personne. Pardi, il y a belle lurette qu’il n’y a plus de loups ici. Ce sont des bêtes devenues imaginaires sur le Bassin. S’il y en a eues ! Et s’il y avait aussi une île pour les loups, et que celui-ci avait trouvé la sienne ici ? A moins que lui aussi soit venu pleurer un petit disparu, en mer ou ailleurs, dont l’île serait celle aux oiseaux, juste en face… Qui sait ? On peut tout imaginer.
Pascal CASTILLON
L'île aux loups
Margot Delorme est née, il y a longtemps, dans ce pays du bout du monde où une langue de terre, coincée entre l’océan et le Bassin d’Arcachon, formait à l’époque, une presqu’île sauvage, sans constructions, battue par les vents marins et les marées. Seul son phare rouge et blanc défiait le paysage de toute sa hauteur longiligne. Ce distingué flambeau nommé « le phare d’Arcachon » guide les marins, depuis 1855, dans la dangereuse entrée du Bassin par la passe nord, entre le banc d’Arguin et le banc du Toulinguet. Pour accomplir sa mission, il fait de l’œil à l’imposante et majestueuse dune du Pyla qui cache sous sa masse de sable des secrets et des villages antiques oubliés. Une légende circule dans le pays. « <em>On raconte qu’il y a trois ou quatre mille ans, un petit groupe de pauvres pêcheurs nomades s’étaient installées dans les marais tout au bout de l’océan sous la protection de la fée des dunes. La fée leur a tout appris pour qu’ils vivent dans l’abondance de leurs pêches et de leur culture. Le bon peuple, qui ne réfléchit jamais assez, cru pouvoir tirer toujours plus de la fée et finit par la maltraiter pour qu’elle révèle sa magie. Devant l’ingratitude et la méchanceté des hommes, elle se coucha au milieu de leur village en laissant au roi des sables le soin de la recouvrir. Celui-ci créa la plus haute dune qu’il soit afin de protéger la plus gentille des fées, faisant ainsi disparaître à jamais le village de ces pêcheurs ingrats(1). Sur la minuscule péninsule du Cap-Ferret(2), dans les jeunes années de Margot, il n’y avait que peu d’habitants : des résiniers s’échinant tout le jour à récolter la sève bienfaitrice des grands pins, des pêcheurs au filet droit ou à la « trahine(3) » ou des ostréiculteurs venus, un siècle plus tôt de La Teste, installer leurs parcs à huitres. Dans ce coin perdu, ils pensaient trouver un endroit moins saturé de pêche et plus rentable. Le grand-père de Margot avait été un de ses courageux précurseurs. Les quelques touristes aventureux, tels que Jean Cocteau, Francis Carco ou Roland Dorgelès, qui venaient séjourner à la belle saison dans le seul hôtel situé à Piquey, « l’hôtel Brice », n’étaient guère envahissants comme ils le sont aujourd’hui. À cette époque, quelques cabanes entouraient l’hôtel et la route pour découvrir ce coin de paradis du bout du monde s’arrêtait à « Jane de Boy ». Le seul moyen pour l’atteindre restait le bateau. Dans sa toute petite enfance, Margot a vu construire l’unique route qui traverse maintenant les 20 km de la presqu’île. Cette Ferretcapienne, petite-fille, fille et femme d’ostréiculteurs, a consacré toute sa vie à l’huitre dans un combat quotidien contre vents et marées. Après son veuvage, il y a maintenant plusieurs décennies, elle a abandonné l’exploitation des parcs à huitres familiaux, à ses deux fils. Désormais, sa vie est une longue succession de journées identiques rythmées par les marées qui vident et remplissent le Bassin deux fois par jour. Dans son antique cabane, aux murs chaulés et peinte en bleue, située à un jet de pierre de la plage et du chenal, la vie de la vieille dame n’a plus beaucoup de sens. Elle lit des romans d’amour ou cuisine des pâtisseries pour ses petits-enfants. Parfois, elle accompagne ses gamins pour ramasser des bigorneaux et des crabes ou les initie à la pêche à la foëne lorsque le jusant découvre les terres vaseuses du Bassin. Margot n’est pas seule et abandonnée, ces enfants sont aimants, mais c’est une solitaire qui aime le calme et protège sa tranquillité. Elle ne fréquente que peu de monde et se contente d’un rapide et discret hochement de tête, pour saluer les habitants du village croisés sur la place de l’église les jours de marché. Ce n’est pas qu’elle ne les aime pas, non ! Simplement, elle n’a plus goût à côtoyer l’espèce humaine qui l’a bien souvent déçue et préfère garder son énergie et son reste de vitalité pour sillonner les lieux sur sa vieille bicyclette. Chaque matin, à la morte-saison, quand les touristes ont déserté les lieux et rendu son âme au village ; lorsque l’eau de là-haut ne vient pas brouiller l’horizon en rafraîchissant l’atmosphère, mais plutôt, quand l’astre rayonnant réchauffe la terre et éveille les sens, Margot enfourche son vélo. En quelques coups de pédales, elle retrouve le littoral. Au pied de la dune blonde, elle abandonne sa bicyclette contre le vieux pin maritime tordu à qui le vent a donné une allure de monstre bienveillant sorti d’un conte pour enfants. Margot, le souffle un peu court, grimpe le tas de sable au milieu des oyats et des chardons. Le crissement de ses pas sur le sable fin fait fuir les insectes et parfois un lézard vert des sables ou un garenne au cul blanc. Lorsqu’elle atteint le sommet, son regard se perd sans limites sur une symphonie de tons bleus et verts. Le grondement sourd et continu du ressac des vagues lui murmure une musique lancinante qui engourdit ses pensées. À cet instant, elle n’est plus une grand-mère aux cheveux blancs, mais la petite fille du soleil à la recherche de ses illusions et de ses paradis perdus restés dans l’ombre de ce qu’elle a vécu. Elle dévale la pente les bras levés vers le ciel d’azur en criant sa joie et son plaisir. « J’ai 10 ans, je sais que c’est pas vrai, mais j’ai 10 ans », fredonne-t-elle dans sa tête. Ensuite, elle marche sur la plage abandonnée où « coquillages et crustacés déplorent la fin de l’été », l’écume blanche caresse ses pieds nus. La vieille femme respire à pleins poumons l’air salé et iodé, laissant le vent emmêler ses cheveux et fouetter son visage. Cette communion avec la nature la rend pleinement heureuse. « Y a-t-il un bonheur plus parfait que celui-là », se demande-t-elle souvent ? Après quelques pas sur cette plage déserte, il existe au sommet de la dune, enfouie à l’abri du vent, une cabane connue des seuls autochtones qui s’aventurent à pied aussi loin. Un artiste y séjourne la majeure partie de son temps, créant des sculptures en bois flotté, fabriquant des totems et des masques avec des objets récoltés sur le sable que les sempiternelles marées apportent ou que les touristes oublient. Ce matin de septembre, l’artiste inconnu est assis sur un tronc d’arbre patiné par les flots, échoué au pied de la dune sûrement suite à une grande marée d’équinoxe et après un long voyage dans l’océan. Cet homme semble assez grand, plutôt mince, son corps sec et musclé n’a pas une once de graisse. Il porte un vieux short kaki et un tee-shirt à rayures bleues et blanches, ses épaules sont recouvertes d’un pull-over bleu marine. Sur son crâne, sans doute un peu dégarni, trône un bonnet de laine enfoncé presque jusqu’aux yeux. Ses longs cheveux gris, attachés en catogan, dépassent de son couvre-chef. Un bandana délavé s’entortille autour de son cou fripé. Ce petit foulard un peu crasseux amène Margot à l’imaginer chevauchant une Harley ou un pur-sang andalou. Pourquoi cet atypique personnage auréolé de mystère, la fait-elle fantasmer ? Après tout, ce n’est qu’un vieil homme. Il y en a plusieurs dans le village, mais on ne les voit jamais lire assis sur la plage. Ils sont plutôt installés dans le village ostréicole à ravauder des filets de pêche, trier des huitres ou fumer leur cigarette de papier maïs, le regard vague perdu dans leur mémoire défaillante. Margot a souvent croisé cet homme ; installé dans cette immuable position, il lit. Elle le surnomme « le vieux qui lisait des romans d’amour »(4) en référence à son auteur favori. Parlent-elles vraiment d’amour, ses lectures ? Peu importe, ce surnom lui est venu spontanément en voyant son visage brun et buriné par le soleil, son nez camard, ses lèvres épaisses et ridées qui lui donnent l’air d’un vieil Aztèque. Ce bizarre personnage et Margot ne se sont jamais parlé. L’air rogue et bourru qu’il affecte, sans doute dans le simple but de faire fuir les curieux et préserver sa tranquille solitude créatrice, intimide un peu la vieille femme. Elle n’est pas de cette jeune génération qui a tous les culots et ose tout. Cependant, ce matin, quand il a levé les yeux pour l’observer, elle a osé l’approcher et lui parler. — Bonjour, Que lisez-vous ? a-t-elle demandé timidement. Après un long silence en contemplation devant l’infinité de l’eau vrombissante, il s’est tourné vers elle et, sans répondre à sa question, l’a interrogé : — Pourquoi traînez-vous ainsi seule sur la plage, si loin de tout ? Que cherchez-vous ? — La paix et la liberté, lui a-t-elle répondu. Cette réponse laconique a dû plaire au vieil homme, car un furtif sourire est apparu sur ses lèvres et une étincelle s’est allumée dans ses yeux bleus délavés. Ces simples mots ont-ils réussi à l’apprivoiser ? C’est bien possible, car depuis ce jour, leurs rencontres, non convenues, seulement quand le destin veut bien leur faire vivre l’océan aux mêmes moments, sont devenues un plaisir. Ils aiment évoquer leurs vies respectives, leurs envies, leurs colères, leurs espoirs, leurs combats et même leurs désespoirs et leurs regrets. Le couple évoque régulièrement leur amour commun pour le Bassin qui pourtant ne leur a pas fait de cadeau. Ils constatent avec tristesse, que lentement, mais sûrement, ce lieu unique se dégrade et perd de sa magie par la surpopulation. Parfois, leurs échanges ne sont faits que de ces mots qu’on se dit avec les yeux, quand parler semble ridicule. Ils ont fini par échanger leurs patronymes. Il s’appelle Juan Belmonte.« Que c’est amusant ! « Un nom de torero »(5). Décidément, il n’y a pas de hasard. Voilà que Sépúlveda me vient une fois encore à l’esprit », a-t-elle songé en souriant intérieurement. Juan n’est certainement pas matador, il n’a même jamais vu une corrida de sa vie. Ce nom, il le tient de son père immigré du pays ibère au début du XXe siècle. Cet homonyme du grand toréro Belmonte est un ancien marin, originaire du Bassin, qui a fait plusieurs fois le tour de la terre par les voies maritimes sur un navire de charge. Désormais trop vieux pour naviguer et surtout trop pauvre pour posséder un bateau, il habite dans une ancienne cabane de résinier dans la forêt domaniale, à quelques centaines de mètres de là. Dans sa jeunesse, avant de s’embarquer traïnayre(6) pour le péougue(7), il pêchait à la foëne, dans les esteys(8), des anguilles et carrelets qu’il revendait aux restaurants d’Arcachon. Sa mère et ses deux sœurs aînées étaient au service des riches bourgeois bordelais dans les cossues maisons de la ville d’hiver d’Arcachon. Quand son père s’est noyé avec les sept hommes de sa barque, lors d’une grande tempête dans la passe sud entre le banc d’Arguin et la dune, Juan s’est engagé dans la marine marchande pour ne revenir au pays que lorsque son corps fatigué ne lui a plus permis de naviguer. Aujourd’hui, ses sœurs étant mortes sans descendances, il est seul au monde, sans famille. Ce n’est plus qu’une vieille carcasse usée qui attend tranquillement que le Dieu Neptune vienne le cueillir. Il n’a aucune crainte de la grande faucheuse, il est prêt à l’accueillir. Quitter cette terre ne le gêne pas, il en a fait si souvent le tour qu’il pense ne plus rien avoir à découvrir. Le plus bel endroit du monde, c’est ici sur cette presqu’île entre l’océan et le Bassin. Puisqu’il ne peut plus parcourir les mers, il veut mourir près de l’océan. C’est pour cette raison qu’il vient, chaque jour, l’écouter lui chanter la chanson de sa jeunesse perdue. Il ne craint qu’une chose, ne pas pouvoir continuer à passer la dune, cela lui est de plus en plus difficile, ses vieilles jambes commencent à le trahir un peu. En l’écoutant lui raconter ses vingt mille lieues sur les mers, Margot s’est prise d’affection pour ce vieil homme, presque autant qu’elle en a pour sa presqu’île. À chacune de ses escapades vers l’océan désormais, elle pense à Juan. Y sera-t-il ? Le verra-t-elle ? Que lui racontera-t-il aujourd’hui ? Cela rajoute du piment à sa promenade. Maintenant que Juan fait partie de sa vie, elle a retrouvé un élan de jeunesse qu’elle croyait oubliée et qui la fait pédaler avec plus de vivacité, malgré ses douleurs arthrosiques. « Suis-je sotte de m’exciter ainsi. Je ressemble à une jeune écervelée de vingt ans qui se rend à un rendez-vous galant », songe-t-elle en se moquant d’elle-même. Les mois de juillet et aout avec leur surpopulation estivale n’ont pas donné l’envie à Margot de rejoindre le bord de mer. Tous ces gens, sans gêne et sans respect l’insupportent, elle préfère se terrer dans sa cabane. De toute façon, Juan ne doit pas, non plus, être à leur rendez-vous habituel, il ne supporte pas plus qu’elle la populace. Ensuite, les grandes pluies d’automnes puis les bourrasques gelées de l’hiver ont rebuté Margot pour des promenades à vélo. Le printemps revenu, la vieille femme à fait fi de ses douleurs rhumatismales pour tenter de revoir Juan. Elle est impatiente de reprendre leurs conversations. Mais, voilà des jours qu’elle arpente le rivage sans succès. Il n’est plus là ! Elle est inquiète : « Pourquoi ne vient-il plus ? Serait-il malade ? », s’interroge-t-elle. Elle n’ose pas s’aventurer seule dans la forêt à la recherche de sa cabane. Demander à ses fils de l’y conduire d’un coup de 4x4, jamais de la vie ! La seule fois où elle a voulu parler de Juan en famille, ses enfants se sont moqués d’elle, lui reprochant qu’avoir une idylle à son âge c’est ridicule et dégoûtant. « Une idylle, pff... Comme ils sont sots ! Ce n’est que la vieillesse, nos souvenirs de jeunesse et notre amour du pays qui nous ont rapprochés ». Elle a pensé faire appel à son petit-fils préféré pour l’accompagner, mais elle y a très vite renoncé. À quoi bon ! Les adolescents n’ont jamais le temps de ne rien faire, si ce n’est de rester des heures sur leur téléphone portable. Ce matin de juin, lorsqu’elle enfourche sa bicyclette ce n’est pas sur le lieu habituel de leur rendez-vous qu’elle se rend, mais au village, chercher des nouvelles de Juan. Elle a besoin de savoir. Il doit bien y avoir quelqu’un qui le connaît. Ne serait-ce que le garde forestier ou peut-être la boulangère chez qui il se rend régulièrement acheter son pain. Quand elle arrive sur la place du marché, les cloches sonnent le glas et un sinistre fourgon noir stationne devant l’église. — Il n’y a pas grand monde ! Qui est-ce que l’on enterre ? demande-t-elle à Esther, la boulangère, qui sait tout sur tous et jacasse sans se faire prier. — Oh ! Un pas grand-chose, un vieux fou à moitié clochard, qui traînait dans le coin depuis quelques années. Vous ne l’avez jamais vu sur sa bicyclette rouillée ? Le vieux et son « guingue(9) » on se demande comment ils résistaient encore. Pas bavard et pas aimable, jamais un mot à personne. — Vous connaissez son nom ? — Mordious ! Bien sûr que non, on ne le connait pas. Il ne parlait à personne, un vieux fou que je vous dis. Il paraît que le garde forestier l’a trouvé raide mort dans la dune du côté de la Lède(10) du « Truc Vert ». Je crois qu’il habitait une vieille baraque en planches, en pleine forêt, sans eau et sans la létricité. Un vrai sauvage ! Tout de même, il y a de drôles de gensses, vous ne trouvez pas, Mame Delorme ? Pourquoi donc il vous intéresse tant ce bagaboun(11) ? Margot n’a pas répondu. Elle a compris. Le défunt que l’on enterre aujourd’hui, c’est Juan. Pressée de rejoindre le parvis de l’église, elle est sortie du magasin sans acheter de pain, sous le regard ahuri d’Esther. Le curé n’a pas pris la peine de faire rentrer le cercueil dans la maison du Seigneur. Il a donné, manifestement à contrecœur, une rapide bénédiction devant les portes ouvertes de l’arrière du véhicule. Ceci accompli, les portes ont claqué et les croquemorts ont pris la route du cimetière pour le confier au fossoyeur, afin qu’il l’ensevelisse dans la fosse commune, sans autre forme de cérémonie. Margot restée seule, émue, le cœur serré, a observé cette scène avec tristesse. Elle trouve cela totalement dénué d’humanité. « Nous ne sommes vraiment pas grand-chose sur cette vaste terre. Toute une vie d’aventure et de dur labeur balayée en un clin d’œil dans l’indifférence générale », songe- t-elle en essuyant rapidement une larme du revers de la main. Elle enfourche son antique engin à pédales et part en direction de la Lède cueillir quelques immortelles des sables pour les poser près du tronc d’arbre au pied de la dune. Désormais, son éphémère ami lui manque presque autant que son défunt mari. Les années suivantes, la cabane remplie des créations artistiques de Juan a disparu avec la tempête du siècle, lorsque la dune s’est effondrée le long du littoral. Avec l’usure du temps et son lot de douleurs, Margot a ralenti la cadence de ses randonnées, jusqu’à ne plus y aller. D’ailleurs, ses enfants lui ont supprimé son vélo : « Trop de voitures, trop dangereux », lui ont-ils asséné, sans discussion possible. Cependant, le vieil homme et la mer continuent de l’accompagner à chacun de ses pas. Le cœur des vieilles personnes ne reste jamais fermé, il peut encore palpiter et s’emballer sur un éventuel amour naissant, si platonique soit-il. Il en est ainsi de certaines rencontres inattendues et atypiques qui marquent pour toujours, que l’on n’oublie jamais et qui parfois, donnent du sens à la vie et vous réconcilient, pour un moment, avec l’espèce humaine. Chaque soir, Margot tourne son regard vers les passes pour observer l’astre rougeoyant s’enfoncer dans la mer, en laissant voguer son esprit sur les vagues de ses souvenirs. Elle continue de parler, dans sa tête, avec Juan de la merveilleuse magie du Bassin d’Arcachon et de la beauté de sa presqu’île. Tant que le vieil homme du Cap-Ferret vit dans ses pensées, il n’est pas tout à fait mort. 1 / Inspiré du livre « Les contes de la fée du bassin » – Charles Daney – ed La geste. 2 / La presqu’île du Cap Ferret tire son nom de l’expression « lou cap herré » qui signifie en Gascon, « la pointe de fer ». Ce nom est lié aux trainées de couleur rouille que l’on peut parfois observer sur la plage lorsque l’eau du sous-sol ruisselle. 3 / Filet de pêche que l’on traîne. 4 / Roman de l’auteur chilien Luis Sepúlveda paru en 19895 Roman de l’auteur chilien Sepúlveda paru en 2001 6 / Pécheur à la traine (une seine – filet de pêche) 7 / Pêche en mer 8 / Petit chenal. Partie d'un cours d'eau alimentant un chenal et qui, soumis au régime des marées 9 / Vélo en patois « bordeluche ». 10 / Dépression entre deux dunes. 11 / Vagabond
Danielle BEZIAT de MUNICO
Le vieil homme du Cap Ferret
Agnès n’a jamais aimé le bassin d’Arcachon. Elle y a pourtant passé toute son enfance dans la maison familiale d’Andernos avec ses parents et ses deux frères aînés. Aujourd’hui, en ce trente et un décembre 1999, elle observe les dégâts de la tempête Martin sur son village natal, et sur le littoral. Quelle idiotie que d’appeler un phénomène météorologique aussi dévastateur et dangereux par un prénom humain. Comme si cela pouvait rendre la tempête moins effrayante et plus sympathique pense t-elle. Agnès est sur la plage, la mer s’est retirée en ce début de matinée, et elle regarde le sable, la vase à perte de vue, le vent s’est calmé. L’aspect tout entier du bassin est méconnaissable, elle aussi comme tant d’autres est sidérée. Les arbres sont couchés comme des quilles, certains kiosques brisés, des bateaux renversés, jetés sur la berge, du bois à profusion, des tuiles. Spectacle silencieux après tant de fureur, de désolation, le bassin semble avoir subi un bombardement. Cependant, Agnès sait qu’il s’en remettra. Elle est descendue de Paris pour fêter le nouveau millénaire avec sa famille. Une fois la fête dûment célébrée et terminée, elle repartira aussitôt vers la capitale, avec ses rues rectilignes, ses grands immeubles haussmanniens ses monuments historiques, ses touristes, ses coups de klaxons, sa vie mouvementée. Ah oui; Agnès est une vraie citadine, La première fois qu’elle avait eu l’occasion de voir une grande ville, c’était Bordeaux ou sa mère l’avait emmenée,elle avait sept ans, et adorée cette atmosphère. Aujourd’hui, le bassin, son odeur iodée, ses algues déposées sur le sable ressemblant à des dépôts de mauvaises herbes, sa vase gluante et envahissante qui s’enfonce sous les pieds comme de la boue, tout ce que sa famille adore, voire même idolâtre ne la rendent pas nostalgique. Elle soupire, même la légère brise qui est plutôt agréable, ne parvient pas à chasser ses souvenirs, et à la soulager. Soudain, quelque chose attire son regard. Une sorte de branche de bois flotté planté dans le sable, droit devant elle, à une cinquantaine de mètres. C’est curieux, pour une branche, elle semble beaucoup trop droite, trop lisse. Agnès décide de s’avancer, la curiosité l’emporte. Plus elle s’approche, plus la branche ressemble de moins en moins à une branche. Le sable lui devient de plus en plus mou, elle retire ses chaussures, et malgré son dégoût pour la vase, elle continue d’avancer vers l’objet. Après quelques dizaines de mètres parcourus, elle en est désormais sûre, ce n’est pas une branche mais très certainement un morceau de métal ou de ferraille charrié par la tempête. En effet, les vents violents et puissants de Martin avaient laissé beaucoup de déchets divers le long des littoraux du sud-ouest. Une fois devant l’objet, dans un premier temps Agnès pensa avoir eu une hallucination. C’est une épée! Rouillée certes, rongée par l’eau, le sel, le sable et les années, mais c’est bel et bien une épée d’environ quatre vingt cinq centimètres. Elle est stupéfaite, les vents de la tempête ont fait émerger un trésor archéologique à ses pieds. Sans hésiter ni réfléchir, elle saisit le pommeau pour extraire l’épée du sable et la regarder de plus près. Le sol tangue. Il fait nuit ! Où est-elle? Elle a très mal au ventre, une douleur intense, qu’elle n’a jamais ressentie auparavant. Elle est couchée, sur le dos, les jambes écartées et elle hurle à s’en déchirer les poumons. Autour d’elle, tout a changé. Agnès n’est plus seule, debout sur le sable du bassin d’Arcachon, elle est sur un bateau en bois, avec des hommes et des femmes vêtus de tuniques, capes en lin grossier, épais. Elle pense à des hommes préhistoriques, mais en voyant la grandeur, la solidité et la forme du navire elle écarte rapidement cette hypothèse. Qui sont-ils? La majorité d’entre eux ont les cheveux longs et blonds. Cependant elle n’a pas le temps de se concentrer sur ces individus, elle est de nouveau terrassée par une douleur aiguë au bas du ventre. Elle se met instinctivement à palper celui-ci. Il est incroyablement rond et gros, beaucoup trop gros. Ce n’est pas normal! Elle essaye de se calmer quelques secondes, afin de garder au mieux son sang froid. Après une rapide constatation, elle se rend à l’évidence. Elle est sur le point d’accoucher, sur un bateau, entourée d’inconnus. Un homme se penche vers elle, assez grand, il porte des vêtements plus luxueux.«Mon amour soit forte, notre fils va bientôt être parmi nous». Il ne parle pas français, c’est une langue gutturale, étrange, mais pourtant Agnès a compris chacun de ses mots. Elle croit d’ailleurs reconnaître une langue du nord de l’Europe. Du norvégien peut-être? Elle est allée en voyage en Norvège, pour admirer les fjords. Cet homme venant lui témoigner son affection l’apaisait. Agnès ressenti comme un baume de douceur sur son cœur, et tout son corps se détendit. Elle ne l’avait jamais vu auparavant, néanmoins ses yeux bleus et son regard profond la rassurèrent et la soulagèrent totalement. Il y avait comme un lien de confiance inextinguible, invisible qui les liait tous les deux.</span><span> La douleur de son ventre s’apaise légèrement, alors elle en profite pour regarder plus attentivement ce qui l’entoure. Ils sont environ une trentaine de passagers, essentiellement des hommes. En effet, les seules femmes à bord sont au nombre de cinq, qui l’entourent et la soutiennent, dont une qui lui fait face et qui est la doyenne.Cette dernière possède d’étranges peintures sur son visage, et, elle observe méticuleusement le bas ventre d’Agnès. Malheureusement, elle ne semble pas satisfaite par ce qu’elle voit. Son regard est anxieux, fuyant. Agnès regarde encore quelques instants son environnement et elle pense avoir enfin un début de réponse. Le bateau sur lequel elle se trouve est très certainement un snekkja, un navire que l’on appelle couramment un drakkar. Mais comment est-ce possible ? Il y a quelques minutes elle était debout, sur la plage dévastée du bassin, à marée basse et désormais elle est sur un bateau, couchée, en pleine mer! Etait-elle vraiment en pleine mer ? Saisit de panique et de doutes, elle se soulève légèrement pour apercevoir l’horizon par dessus le bastingage. Non, elle n’était pas en pleine mer, le snekkja devait être à une centaines de mètres du rivage qu’elle distingua au loin. Un rivage constitué essentiellement de forêts et de sable, mais qui lui rappelait étrangement le bassin. Comment pouvait-elle se retrouver entourée de Vikings, sur un snekkja, alors que la dernière chose dont elle se souvenait, c’était d’avoir empoigné une vieille épée rouillée à demie enfoncée dans le sable. C’était insensé, irréel! Et pourtant la réalité la rattrapa avec une nouvelle vague de douleurs qui envahit tout son corps. Pas de doute possible, c’était bien une contraction. Elle n’avait jamais eu d’enfant, célibataire endurcie, sa relation la plus importante et la plus sérieuse n’avait pas durée plus de deux ans. Elle avait mal, elle souffrait, elle perdait beaucoup trop de sang. La vielle femme qui veillait sur elle se leva et s’approcha de l’homme qui lui avait parlé, très vraisemblablement son compagnon. «Il faut agir au plus vite Asgéir, dit-elle, si nous voulons que Holda et son enfant survivent, nous devons immédiatement donner une offrande au dieu Njörd pour qu’il accorde sa bénédiction à la mère et au bébé. - Mais je n’ai rien à offrir. Nous n’avons pas encore commencé à explorer ces nouvelles terres, je n’ai ni bracelet, ni collier, ni bague ou autre objet de valeur à lui offrir, répondit Asgéir. - Dans ce cas, pourquoi pas ton épée alors, proposa la prêtresse, cet objet a beaucoup de valeur à tes yeux non? - Oui c’est vrai, elle est dans ma famille depuis plusieurs générations déjà, mon père m’a raconté que mon ancêtre l’avait récupérée chez un seigneur anglo-saxon lors des premiers raids en Est-Anglie. Mais sans cette épée, comment pourrai-je protéger ma femme et mon fils à naître? - Tu devras te trouver une nouvelle arme, ou bien tu n’auras bientôt plus rien à protéger. Asgéir regarda Agnès qui était désignée sous le nom de Holda. Celle-ci était au bord de l’évanouissement, la douleur devenait de plus en plus intense, son tein était exsangue. Asgéir se tourna alors vers elle, et son choix fut sans appel. Il tendit son épée à la prêtresse. C’était une épée magnifique, son pommeau était incrusté de pierres précieuses dont un saphir et un rubis, et sa base finement sculptée. Sur la lame étaient également visibles des signes indéchiffrables pour Agnès, langue certainement celtique aujourd’hui perdue. Agnès ou Holda, elle ne savait plus, eut le temps d’admirer la beauté de cet objet qui scintillait à la lumière de la lune et des étoiles avant de subir une dernière vague de douleurs et de sombrer dans l’inconscience. Lorsqu’elle reprît peu à peu connaissance,sa position inchangée, la vieille femme présentait l’épée au ciel et à la mer en psalmodiant des phrases qui ressemblaient à des prières. Holda ou Agnès eut juste le temps d’entendre la fin de ces incantations, - Ainsi, Dieu Njord, nous t’offrons ce présent sacré. O grand dieu de la mer, des vents et de la fécondité, accorde la vie à Holda et à son enfant. Qu’il puisse grandir, respirer, vivre, se battre et mourir à ton service. O grand dieu Njord, cette épée est pour toi. Accepte-la. La prêtresse laissa tomber l’épée par-dessus bord, pointe vers le bas dans l’eau, où elle coula sans troubler de remous la surface. - Puisse t’il accepter l’épée, murmura Holda, ou peut-être Agnès. Parler et comprendre une langue étrangère dont on ne connaissait aucun mot il y a quelques instants fut une sensation unique pour elle. Pourtant, c’était si facile, si naturel. Tout à coup, une terrible contraction secoua tout son corps. Le bébé arrivait, c’était maintenant une certitude. Agnès ou Holda se mit à mordre dans un morceau de bois qu’on lui tendit, et commença alors le travail difficile et douloureux de l’enfantement. Accoucher fut une expérience à laquelle elle ne s’était jamais préparée. Dès ses trente ans Agnès avait pris la décision radicale de ne pas avoir d’enfant. Elle s’était dit tout simplement que puisqu’elle ne trouvait pas de père, il était inutile de devenir mère. A présent elle était là, sur une snekkja amarrée sur un endroit qui lui semblait être le bassin d’Arcachon, à une époque inconnue, autour de gens inconnus, mordant un bout de bois à s’en faire saigner les gencives pour mettre au monde un petit être humain. Après de longues minutes qui semblèrent des heures pour Holda ou Agnès, le cri caractéristique du nourrisson se fit entendre sur le navire. La prêtresse l’enveloppa aussitôt dans une sorte de peau de chèvre, et le déposa dans les bras de sa mère. - C’est une vaillante petite fille, déclara-t-elle solennellement, une guerrière. Son père, ainsi que tout le reste de l’équipage poussèrent alors des cris de joie et de victoire, Certains tapaient des mains, d’autres des pieds, d’autres encore frappaient leur bouclier. Malgré tous les efforts fournis, Holda ou Agnès demeurait à demie consciente. Elle se surprit à embrasser sa petite fille sur son front minuscule et chaud, puis regarda son compagnon qui lui souriait, le regard brillant. Puis, peu à peu, elle ferma doucement les yeux, la fatigue l’emportait, elle n’avait plus qu’une envie, se reposer de cette nuit inoubliable, libérée de toute douleur et de toute souffrance. Agnès ouvrit les yeux. Elle est debout, un peu hébétée. Elle a de l’eau jusqu’aux genoux. Mais où est elle à nouveau? Elle regarde brièvement autour d’elle. Elle est toujours et encore sur le bassin d’Arcachon, le soleil a commencé à décliner et elle comprend qu’elle doit rapidement se mettre à marcher si elle ne veut pas se faire surprendre par la marée. Elle serre les poings, comme si elle cherchait à attraper quelque chose. L’épée! Où est l’épée? Elle cherche à ses pieds, autour d’elle, dans l’eau, dans le sable. Rien. Rien que de l’eau, du sable et de la vase, partout. Avec un sentiment qui ressemble étrangement à de la nostalgie, elle se dirige vers le rivage lentement, les pieds fouettant doucement la surface de l’eau. Tout cela était donc un rêve… Le snekkja, les vikings, la prêtresse, son compagnon Asgéir, les prières au dieu Njörd, l’épée et l’accouchement si douloureux, si réel, si vivace. Agnès s’avança vers la maison de ses parents. A quoi bon tout raconter, elle n’avait aucune preuve à leur fournir. Si seulement elle avait pu retrouver l’épée. Elle se retourna et admira le paysage qui s’offrait, le soleil qui se couchait, le ciel qui s’irisait, la lune qui remplacerait bientôt le soleil pour réfléchir sa lumière sur la mer, le sable, les algues, cette douce odeur iodée, cette atmosphère paisible et éternelle. Quelque chose avait changé en elle, elle n’était plus la même, elle le savait à présent. Est-ce cela magie du bassin?
Baptiste FOURNAUD
Une épée dans le sable
Nouvelles
Dédé – André Bréhat pour ses prestataires de services- était un adepte de la contemplation et vivre sur le bassin d'Arcachon était une providence. Dédé "officiait" à temps "quand j'ai envie" -il avait horreur des obligations- dans les colonies de vacances du Bassin, ces havres de paix où l'on envoyait les marmots le temps d'un été, histoire de profiter de cette lagune que les habitants considéraient -sans modestie aucune- comme l'annexe du paradis. Quand le temps était trop chaud ou trop nuageux pour profiter d'une balade sur le sentier de littoral, les moniteurs des plus petits faisaient appel à ses services pour animer un atelier -que nous appellerons instructif- dans le but de distraire ces marmousets plus enclins à grimper aux arbres et à chahuter qu'à se tenir tranquilles. Une dizaine de marmots assis en demi cercle autour de lui, s'agitait donc régulièrement sous le tamaris à l'ombre frétillante de la plage de Lanton jusqu'à ce que Dédé fasse son entrée en scène sur le terrain des opérations. Il faut dire que sa tenue inspirait respect et par là même ébahissement. Sa veste d'abord : Extirpée -prétendait-il- du coffre d'un bourgeois lors de la mise à sac d'un galion démâté, elle était toute de velours faîte et d'un vert canard remarquable. Elle changeait de couleurs suivant l'angle de la lumière, rappelant par le fait, la vêture chatoyante du corps des libellules. Galonnée d'or et d'argent, elle maquillait parfaitement la silhouette de notre pirate, dissimulant dans ses plis et replis les imperfections qui le désavantageaient. Il se pensait trop rachitique en vérité et cette veste lui donnait une prestance qu'il appréciait, une carrure qui en imposait même si ce n'était que de l'esbrouffe pour ébahir une assemblée de menu fretin. Et puis ce vert remarquable, semblable à un éclair furtif par moment, marquait la mémoire des bouts de choux, tout autant que sa claudicante démarche. Un pantalon de lin grège, collant jusqu'aux genoux, cachait la jointure de sa jambe de bois cirée de frais dont l'embout caoutchouteux laissait sur le sable une empreinte semblable à celle d'une patte de petit agneau. Oui, il avait une jambe de bois, comme tout pirate qui se respecte. Une béquille callée sous le bras, Dédé l'pirate avançait en chaloupant vers le pouf de corde faisant office de trône que ses "employeurs" avaient l'habitude de lui adjoindre pour sa commodité. Son chapeau et sa plume frémissante complétaient le costume et il avait posé sur son œil droit -des fois c'était sur le gauche, on s'comprend- un bandeau de cuir fauve attaché sur la nuque à l'élastique du catogan emprisonnant sa chevelure d'argent. Les minots, éberlués, se poussaient du coude en rigolant pour les plus hardis ou avalaient péniblement leur salive pour les plus impressionnés. Le regard qu'il jeta à l'assemblée en se laissant tomber sur son trône calma dare-dare les ricanements et agîtements des insolents. Dédé dévisagea chacun des spectateurs en silence et un sourire amical découvrit sa dentition parfaite, agrémentée d'une canine dorée brillant comme une étoile. - Voila voila, commença-t-il. Toi, enchaîna-t-il brusquement en tendant un index inquisiteur vers un des agités qui se figea derechef. C'est quoi ton prénom ? - Marcelin, répondit l'interpellé en se tassant un rien. - Tu viens d'où ? - De Bordeaux. - Okay, approuva le pirate, en se caressant la barbe. - Et toi ? - Lucie, je viens de Blagon, bafouilla la marmotte en tortillant une de ces bouclettes brunes. Il passa ainsi de l'un à l'autre, sa mémoire fantastique lui permettant de retenir chacun des prénoms des minots réduits au silence et leur "provenance" -si l'on peut ainsi dire. Quand il eut terminé son inventaire, il se frappa le torse en disant : - Moi c'est Dédé. Dédé l'Blafard. Oui Léonie ? enchaina-t-il alors qu'une minuscule poussinette, blonde de cheveux et dorée de peau, ouvrait la bouche en levant l'index comme à l'école. - C'est quoi que ça veut dire lblafard Dédé ? Il sourit. L'enfance a de ces raccourcis qui font que l'on passe de l'autorité affichée par un inconnu à la familiarité qu'un sourire engendre, naturellement. - Tu vois la couleur de ta peau ma caille ? Regarde la mienne, dit-il en posant un doigt sur sa joue pâle. Blafard, c'est quand ta peau est plus blanche qu'un yaourt au lait. Tu vois ? - T'es malade ? interrogea Basile, sans doute confronté aux aléas de la vie. - Non. Vous voyez ma jambe de bois ? Les marmots acquiescèrent. - Et bé, dans ma jeunesse, j'étais pirate. Un jour, nous étions en approche pour aborder un navire marchand que nous pensions plein d'or et de bijoux. Ça canonnait, ça criait, ça tirait de tous les côtés bonded'là. Un boulet d'canon, nom d'un ptit bonhomme, m'a arraché l'mollet et je suis tombé à la baille. Je ne dois d'être en vie qu'à un dauphin qui m'a ramené sur la terre ferme en m'tirant par l'autre patte. J'ai perdu presque tout mon raisiné les amis et jamais j'ai pu récupérer tous mes globules. Du coup, bin chuis resté pâle comme vous l'voyez. D'où mon surnom. Muets, les yeux comme des soucoupes, les enfants se regardaient entre eux, se demandant muettement, si ce que leur racontait Dédé était du lard ou du cochon. - Et ton œil ? s'enquiert Martin, premier à reprendre ses esprits. L'Blafard balaya la question d'un revers de main impatient. - Plus tard, on est là pour parler du Bassin d'Arcachon. J'y suis né, ma famille aussi. Et... Et derechef, il largua les voiles et navigua, entre Pyla et Le Ferret, les yeux -enfin l'œil- noyé d'émotion. Il parla des parcs à huîtres du Banc d'Arguin, longue écharpe dorée déployant sa blondeur au gré des marées. - Qui qu'aime les huîtres ? interrogea-t-il en matant l'assistance. Quelques mains timides se lèvent, très peu en fait. Il toussota. Ok, faut pas insister. Il évoqua Arcachon et ses quartiers -quatre- qui se partagent les saisons du calendrier comme les gourmets se partagent un beau plateau de fruits de mer. Printemps, été, automne, hiver, les saisons se côtoient et se frôlent au gré des balades dans cette ville aux mille facettes. - Qui qu'aime les crevettes ? demanda-t-il -surement inspiré par le vent salé qui vint frôler la plume de son galurin et les poils de son nez. Toutes les mains se lèvent. - Moi, mais faut que maman me les dépiaute, affirma Hippolyte, autrement, j'en mange pas. Hochements de tête unanime des mioches présents dans l'hémicycle. - Tu parles de pirates, bougonna Dédé dans sa barbe. Bref. Il évoqua, dans la foulée, Pyla la belle et sa blondeur mouvante, que certains grimpent en ahanant et que d'autres dévalent en rigolant. Il parla des bulles multicolores des amoureux des courants d'air, voletant au dessus des pins verts et du sable doré de son épaule douce, pendus à leur aile comme des marionnettes. Il causa des sept ports de Gujan-Mestras, où prétendit-il, "de son temps" les pirates venaient se réfugier pour échapper aux canonnades de leurs ennemis. Il conta Audenge et sa piscine d'eau de mer, le domaine de Certes et ses chemins bordés de pruneliers, ses prés verdoyants où paissent les moutons et les vaches. Andernos et sa jetée avançant dans le Bassin comme la langue d'un caméléon. Les cabanes tchanquées, perchées sur leurs pattes grêles, posées devant l'île aux oiseaux comme des maisons de poupée vues du ciel. - Sur l'île aux oiseaux, prétendit-il, un corsaire, Calicot Jack pour ne pas le nommer, a enterré un trésor. Plein l'ont cherché, personne ne l'a trouvé. Les yeux des petits se mirent à briller davantage. Un trésor ! de quoi enflammer les imaginaires les plus débridés. Il évoqua Le Canon -en vitesse, le nom lui rappelant de mauvais souvenirs- l'Herbe, ses ruelles étroites bordées de logis colorés, Piraillan, Petit Piquey, Grand Piquey, le Cap Ferret au nez duquel les passes bouillonnent en jabot de dentelle. Les marmots, fascinés, écoutaient l'orateur parler avec amour de son Bassin, de ses villages essaimés sur le cordon littoral comme les perles d'un collier, de leur flamboyance quand la nuit tombait, des tempêtes balayant les cieux de leur colère de feu, du vent dans les pins, de l'air embaumant le sel et l'iode. Ses mains dessinaient les rondeurs des dunes, les aplats des sentiers ceignant les bords de plages, le vol planant des mouettes. Sa veste chatoyait comme un joyau dans la lumière ocellée du tamaris. Quand il terminait son récit, le silence qui suivait était encore du Dédé l'Blafard. Ne s'entendait que le vent bruissant dans la chevelure hirsute du tamaris, poinçonné par les criaillements rigolards des mouettes. Mâtés les minots... Les moniteurs qui s'étaient approchés pour récupérer leurs ptits lardons, devaient frapper dans leurs mains pour les arracher à leur rêverie. Dédé, aidé -bin oui, c'est comme ça- par deux âmes charitables, retrouvait alors la station et disparaissait comme il était arrivé, par enchantement. Personne ne savait où il logeait ni comment il se déplaçait. Certains suggéraient que son navire volant était arrimé à un nuage et qu'il descendait au local d'entretien -dont lui seul avait un pass- grâce à une nacelle. En vérité, il arrivait au volant d'une pétrolette spécialement aménagée, vêtu d'un jogging dissimulant sa jambe de bois et il se transformait en Dédé l'Blafard à l'abri des regards, jaillissant du local pile à l'heure prévue. Pour tout vous dire, il avait élu domicile dans une anse du bassin lors d'une grande marée ayant découpée une échancrure de plus dans le profond des sables, et, aidée par un vent d'enfer la poussant au cul comme un amant désirant très fort sa maîtresse, sa pinassote avait succombé, là, entre rocs et vase, sa voile jetée bas avec empressement par ce coquin pressé. Telle l'arche de Noé sur le Mont Ararat, elle chaloupait maintenant devant une digue aux pierres cyclopéennes. Une armée de petits piquets - pinqués là pour retenir la vase - offrait à notre Dédé une passerelle précaire et fort glissante sur laquelle il sautillait habilement malgré sa jamb' de bois. Sa vieille pinasse échouée gîtait lors des grandes marées, quand l'océan reprenait ses droits avec l'aide de Madame la Lune. Il avait bien essayé de la caler lors de son échouage mais, malgré tous les soins apportés à ses tentatives pour la maintenir d'équerre, la vase dans laquelle elle était accafouie était aussi mouvante que le sable dans les passes du Cap et certains jours, il se réveillait entre plat bord et plancher, ayant chu de sa couchette lors d'un abordage trop violent. Tous les soirs, en toutes saisons, par tous les temps, L'Blaffard posait son corps déglingué sur un rouleau de cordes tissé en pouf douteux, lui même posé à l'abri de la voile tendue en baldaquin et, la pipe au bec (car tout pirate se doit de fumer la pipe n'est ce pas ?), un ‘bouteille de rhum à portée de paluche, assistait en connaisseur à l'agonie du jour... Et là... Il regardait... Posée sur l'infiniment lointain, la pupille de feu du géant en train de s'assoupir. La paupière de cet œil se parait alors d'éclats mandarine, de bleus cobalts ardents et de verts malachite piquetés d'amandon... Le pinceau de l'artiste dérobait – au creux de quelque coquille desséchée- ce roux d'or fané qui fît Eldorado et en parsemait les sequins sur l'horizon tendu d'organdi. Il souriait alors et sa canine brillait comme une étoile. Il s'abîmait aussi dans le levé du jour. La lumière caressait alors le bassin, plus perlée, plus douce, nimbée d'une tremblante délicatesse. Une apparente fragilité dont Dédé appréciait le leurre comme il se devait. Il savait alors que la paupière allait se relever, lentement et que s'allait évaporer la brume qui cachait encore un peu le bout des seins de sa maîtresse. Arcachon, le Cap Ferret, les terres ultimes enserrant son cher Bassin. Les petits piquets ressemblaient alors à une armée de gnomes chevelus partant à l'assaut de la boue, les pierres de la muraille soupiraient d'aise et les faux cotonniers secouaient leur chevelure hirsute satinant l'air d'un voile de mariée. Les jours de grandes marées, quand l'eau avalait rocs et gnomes, il revêtait son costume de scène et s'adonnait à un rite spécial dont lui seul savait la signification. Le spectacle qu'il offrait alors tenait de l'admirable... Tenant d'une main visée sur son crâne un gigantesque galurin dont les plumes chamarrées palpitaient comme un oiseau fébrile, il gambadait avec grâce, les pans de sa veste battant comme des ailes, héron au pas long bec emmanché sur deux pattes dont une grêle et regagnait la grève où s’imprégnaient, en intaille, sa semelle dentelée et son sabot d'agnelet. Là, il étendait large ses bras, puis saisissait son chapeau et en caressait les arbrisseaux, le sable, l'écume frôlant le sentier sur lequel il s'agitait. Cette "cérémonie" durait le temps de lui mettre la sueur au front. Ensuite, il se calait à la coque envahie d'algues vertes et de coquillages de sa pinassote et reprenait son souffle, murmurant, semblait-il, en guise de remerciement, une prière entrecoupée de clins d'œil adressés, surement, aux Êtres invisibles qui peuplaient ses rêveries. Ce personnage hors du commun disparut un jour sans laisser de traces. Son logis flottant aussi. A croire que Dédé l'Blafard avait largué les voiles pour un autre paradis. Parfois, les admirateurs du couché de soleil sur son beau Bassin aperçoivent, furtivement, un pan de la veste chamarrée de cet amoureux pulsant sur l'horizon. Le rayon vert, c'est lui, Vénus, sa canine dorée quand il sourit.
Clotilde HERAULT
Le rayon vert
(La fille de Sindbad le marin au pays d’Arcachon) Dans les premiers jours de l’année 1851, une grosse tartane à voile latine remontait la côte de l’ancien pays wisigoth. Alors que le navire louvoyait au large de ce qui deviendrait plus tard Arcachon, et qui n’était alors qu’un hameau de pêcheurs pilleurs d’épaves, le vent forcit brutalement. À la nuit tombée, une tempête assaillit le malheureux navire. Parmi les marchands qui étaient à bord, une jeune fille prénommée Alma, effectuait son premier voyage. Elle s’était décidée à partir sur les traces de son père, Sindbad, le célèbre marin qui avait fait fortune au cours de plusieurs voyages extraordinaires. Suivant son exemple, Alma avait affrété un bateau, en s’associant avec d’autres négociants. Le vent se déchaîna pendant la nuit. L’eau froide se déversait sur le pont, arrachant tout ce qui n’était pas solidement arrimé. Au matin, les vagues s’aplanirent et le capitaine fit mettre en panne pour effectuer les réparations nécessaires. Heureusement, on ne décela aucune avarie importante. L’équipage s’activait à tout remettre en ordre, quand la vigie aperçut une île vers laquelle le navire dérivait. Il fut décidé que les passagers débarqueraient pour se reposer un moment. Le capitaine ajouta les fauteuils de sa cabine et quelques fagots de bois restés secs pour faire un feu. Tous tremblaient de froid. Alma débarqua avec les autres marchands. Elle portait une tunique de soie, une longue jupe sur des pantalons serrés aux chevilles, et enfin une veste de levantine brodée. Un bonnet en fourrure retenait ses longs cheveux noirs. Son visage exprimait une réserve naturelle, parfois sévère, adoucie par son sourire. Pendant le voyage, elle avait renoncé à souligner ses yeux de khôl, utilisant seulement un baume clair pour se protéger du soleil. Outre sa langue maternelle, elle parlait couramment le castillan ainsi que le gascon, qui est le basque primitif. Autour du cou, un petit sac de cuir renfermait ses lettres de commerce. L’île n’était pas très grande, recouverte de gros coquillages et de goémon, le sol rugueux, presque noir. Le bateau resta à proximité pour terminer les réparations, on s’employa à allumer le feu et bientôt debelles flammes s’élevèrent au-dessus de l’île. Alors que les marchands, regroupés autour du foyer, commençaient à se réchauffer, le sol se mit à trembler et à bouger en tous sens. Bientôt, l’île disparut sous la mer dans un grand bouillonnement d’écume. Alma comprit immédiatement ce qui se passait, car pareille aventure était arrivée à son père. L’île était en réalité un gigantesque cachalot endormi, le feu allumé sur son dos l’avait réveillé et il était furieux. Tous se retrouvèrent dans l’eau. Alma crut se noyer, heureusement elle réussit à s’agripper à un fauteuil qui flottait à côté d’elle. (C’était le fauteuil du capitaine) Elle resta ainsi un moment terrorisée dans les tourbillons. Les marchands, qui ne savaient pas nager, disparurent rapidement. Toujours accrochée au fauteuil, Alma attendit, espérant que le bateau la recueille. Malheureusement, il s'éloignait à toutes voiles, fuyant la colère du monstre. Le cachalot revint, dispersant à grands coups de nageoire les débris qui flottaient encore, et ouvrant sa gigantesque gueule, avala tout rond Alma et son fauteuil. Elle fut emportée comme dans un toboggan le long de l’immense œsophage. La chute dura si longtemps qu’elle pensa mourir noyée dans ce torrent d’eau salée. Elle tourbillonna, tantôt la tête vers le bas, tantôt vers le haut, dans une spirale infernale qui lui fit perdre ses sens. Elle ne savait plus où elle était, il lui sembla que cela ne s’arrêterait jamais. Puis enfin, elle arriva dans une vaste cavité remplie d’eau de mer. Rapidement, le niveau diminua, elle put enfin respirer. À deux reprises, l’eau envahit de nouveau la cavité, en une douche froide qui la suffoqua. Elle fut heurtée violemment par plusieurs objets qui l’assommèrent presque. L’eau disparut de nouveau. Alma resta un long moment immobile, haletante, assise au fond de ce qui ressemblait à une grotte. Elle percevait le grondement régulier du sang dans les artères du cachalot. Elle comprit qu’elle se trouvait, comme Jonas, dans l’estomac de la bête. Puis, elle se rendit compte qu’elle y voyait presque parfaitement. Les parois de l’estomac émettaient une douce lumière verte, elles étaient tapissées de plancton, des millions de minuscules organismes luminescents, avalés avec l’eau et qui se fixaient là, créant une étrange atmosphère. Grâce à cette lueur, Alma put examiner l’immense estomac. Vers le haut, l’obscurité occultait l’orifice d’arrivée. Vers le bas, le sol s’inclinait dangereusement vers les profondeurs du gigantesque animal. À côté d’elle gisait le fauteuil du capitaine. Comment sortir de ce piège ? Elle résolut d’en faire le tour, en prenant soin de ne pas glisser vers les sombres entrailles où elle serait inexorablement digérée. Apercevant sur le sol une veste de drap, elle s’en saisit et retira d’une poche une bourse de cuir. Déliant le lacet qui la fermait, elle découvrit un trésor de pierres précieuses, diamants, rubis, émeraudes, saphirs. Elle referma la bourse et la glissa dans le sac qu’elle portait toujours autour du cou. Après avoir fait un tour complet de l’estomac, elle revint s’installer dans le fauteuil, ne voyant aucune possibilité de s’échapper de ce gouffre vivant. Soudain, il se produisit un cataclysme. Le sol se souleva brutalement à plusieurs reprises, elle fut projetée vers le plafond, se retrouva dans le boyau de l’œsophage, et avant d’avoir compris ce qui se passait, elle barbotait dans l’eau l’océan, alors que le cachalot s’éloignait : il venait de régurgiter l’intérieur de son estomac, le fauteuil flottait à côté d’elle, elle s’y agrippa, et aperçut, toute proche, une terre, authentique celle-là. Entraînée par le courant, elle voguait bientôt, installée sur son fauteuil, au milieu d’une tranquille baie. Une heure plus tard, elle abordait sur une plage. Elle était sauvée. Elle s’enfonça vers l’intérieur, le sol était recouvert d’herbes des rivages, arméries, ajoncs, centaurées aux fleurs bleues. Elle sentait le parfum des immortelles des dunes, à l’odeur de curry. Depuis une petite dune couverte de pins maritimes aux formes étranges, tordus par le vent, elle aperçut un troupeau de dromadaires qui paissaient tranquillement. Cela ne la troubla pas, venant d’un pays où cet animal est commun. Au pied de la dune, dans une combe à l’herbe verte, elle découvrit une source. Une fois désaltérée, elle retrouva tout son courage et son optimisme. Elle s’éloigna du rivage à travers les dunes, espérant trouver une présence humaine. Un peu plus loin, elle aperçut la haute tour d’un phare. La contrée semblait pourtant déserte. Fatiguée, elle finit par s’allonger sur le tapis d’aiguilles de pin qui constituait le sol, et s’assoupit. Un peu plus tard, comme elle rêvait dans la tiédeur de l’après- midi, elle sentit une présence : immobile, une petite chèvre l’observait. Alma s’approcha lentement et vit que la chèvre portait des cornes et des sabots en or. La chèvre soudainement s’enfuit. Elle fit en vérité quelques dizaines de mètres, se retourna pour regarder Alma puis repartit tranquillement, l’invitant ainsi à la suivre. Elles arrivèrent au bord d’une petite rivière. Elles longèrent la berge fleurie, puis la chèvre partit en trois bonds quelques mètres devant, frappa vivement le sol à trois reprises de ses sabots d’or en regardant de nouveau Alma, et s’échappa définitivement. Alma continua seule à suivre la rivière sans plus se préoccuper de la chèvre et arriva bientôt devant un pont. Au loin, elle aperçut un village. Arrivé à ce point de ce récit, il me faut raconter, pour la bonne compréhension de la suite, l’histoire de cette chèvre et la légende qui l’accompagnait. Il se disait qu’une armée avait traversé la région il y a plusieurs siècles, fuyant les troupes des guerriers Francs. Leur chef voyant qu’ils ne parviendraient pas à s’échapper décida de cacher son butin, dans l’espoir de venir le récupérer plus tard. L’essentiel de ce butin était constitué d’une chèvre en or massif, ce qui faisait qu’on parlait du trésor à la chèvre lorsqu’on l’évoquait. La légende disait qu’il était toujours caché dans les environs, non loin d’une rivière. Il se disait aussi que la personne qui le découvrirait serait guidée par une chèvre aux sabots d’or. Personne n’ayant jamais vu cette chèvre, on n’y croyait pas vraiment. Avant d’arriver au village, Alma s’arrêta dans une auberge à quelque distance de celui-ci. Elle était épuisée et grelottait dans ses vêtements humides. Après un bon repas, elle se retira dans sa chambre. Malgré la fatigue, elle voulut explorer plus en détail le contenu de la bourse trouvée dans l’estomac du cachalot. Elle recelait un trésor en pierreries, ainsi qu’un petit objet parallélépipédique, brillant, de quelques centimètres, qu’elle n’avait pas découvert la première fois. Intriguée, elle le prit dans ses mains, essayant de découvrir s’il ne s’ouvrait pas par quelque dispositif secret, et le caressant des doigts, eut la surprise de voir apparaître au milieu d’une fumée blanche le visage effrayant d’un génie. – « Je suis le génie qui vit dans cet objet, j’y vis aujourd’hui même, et j’y vis aussi dans le futur, car je suis immortel. Ma maison s’appelle une clé USB. Sache qu’elle peut contenir autant de savoir que la bibliothèque d’Alexandrie. Quand les temps seront venus, les humains découvriront cet objet, et peut-être en feront-ils bon usage ? Je m’appelle GAFAM puisque tu m’as sauvé de l’engloutissement au fond de l’océan, je suis à ton service. Si tu as besoin de moi frotte la clé du bout des doigts, j’apparaîtrai, et toi seule me verras, je te demanderai ce que tu désires et tu me diras : « Bon génie GAFAM, qui vit dans cette clé, voici ce que je désire. » Puis, le génie disparut. Alma, d’abord effrayée, décida rapidement que sa situation n’était pas si mauvaise. Elle possédait le trésor du petit sac de cuir, et maintenant le génie. Elle n’était pas étonnée de sa présence dans la clé, car elle habitait Bagdad où les génies ne sont pas rares. On pouvait en rencontrer dans les vases anciens ou les lampes à huile. Elle s’endormit paisiblement. Elle repartit tôt le lendemain. Après quelques heures, elle s’arrêta un moment à l’ombre d’un pin et frotta la clé du bout des doigts. Aussitôt, GAFAM apparut, il avait vraiment l’air terrifiant ! Il lui dit : « Je suis à ton service, que désires-tu ? » Alma répondit: « Bon génie GAFAM, qui vit dans cette clé, voici ce que je désire. » « Retourne sur la plage où j’ai accosté, tu trouveras le fauteuil du capitaine caché dans les herbes, tu l’installeras sur le dos d’un des dromadaires dont tu rendras le pelage tout blanc et tu me les porteras. Tu me procureras également une ombrelle, car malgré l’hiver, le soleil est ardent. En un instant, GAFAM réalisa ses ordres. Elle dit ensuite : « Je veux que tu m’instruises sur cette chèvre aux sabots et aux cornes d’or ». Elle découvrit alors la légende de la chèvre et surtout l’emplacement du trésor que le génie lui révéla. Un peu plus tard, installée sur le dos du dromadaire blanc, tenant d’une main son ombrelle, Alma fit son entrée dans la bourgade d’ARES. Or nous étions le neuf janvier 1851, le village était en fête. Sur la grande esplanade, au pied d’un moulin à vent, une immense table était dressée, décorée de fleurs, pour un banquet républicain. Partout, les gens riaient, s’interpellaient, chantaient. Que s’était-il donc passé ? Le préfet du département avait signé le jour même le décret faisant des bourgs d’Ares et d’Andernos deux communes indépendantes. Sur une estrade, le premier maire d’ARES, Pierre Pauilhac, commençait son discours devant les notables et l’ensemble des habitants quand Alma fit son apparition. Jacques Hazera, maire d’ANDERNOS, venait de terminer le sien. L’effet fut extraordinaire : l’on vit apparaître le dromadaire blanc, avançant de son pas majestueux. Installé sur son dos, un grand et large fauteuil revêtu de velours rouge, et sur ce fauteuil, tenant d’une main une ombrelle blanche, Alma rayonnante. Pierre Pauilhac en laissa tomber son texte. D’ailleurs, tout le monde se désintéressa de lui pour entourer Alma et sa monture. Elle dut raconter en détail son aventure, mais ne parla évidemment pas du génie ni de ce qu’il lui avait appris sur la chèvre aux cornes d’or. Le maire déclara qu’elle serait la première citoyenne d’honneur de la nouvelle commune. Chaque habitant voulut l’inviter. Ares était situé sur le rivage d’une grande baie abritée (que l’on appelait le Bassin) où l’on pratiquait la culture et la récolte d’huîtres. Un jour, un pêcheur l’invita à participer à une journée sur son élevage d’huîtres. Alma avait découvert le goût délicieux de ces coquillages, naturellement totalement inconnus à Bagdad. Ils se dégustaient accompagnés du vin blanc de la région et elle en était très friande. La veille de la sortie sur l’eau, Alma pensa qu’elle ne pouvait garder plus longtemps son trésor dans le petit sac pendu à son cou, elle conserva seulement un gros diamant puis frotta du bout de ses doigts la clé USB. Aussitôt GAFAM apparut, il avait vraiment l’air terrifiant ! Il lui dit : « Je suis à ton service, que désires-tu ? » Alma répondit: « Bon génie GAFAM, qui vit dans cette clé, voici ce que je désire. » - Tu vas cacher mon sac de pierreries au même endroit que le trésor de la chèvre. Je récupérerai le tout plus tard. Le lendemain, Alma embarqua sur un petit bateau, qu’on appelait une pinasse, qui avançait à la voile et aux avirons, pour une journée sur l’eau. Bien que l’on soit au mois de janvier, le soleil brillait, il faisait fort chaud. Alma laissa sa veste sur un banc de la barque et participa à marée basse, aux travaux de collecte des huîtres. Le soir venu, exténuée, elle s’endormit sans dîner. Le lendemain matin, elle s’aperçut que la clé USB n’était plus dans la poche de la veste. Avec le pêcheur, ils fouillèrent en vain la barque, la clé resta introuvable, vraisemblablement tombée à l’eau. Elle se consola de cette perte, il lui restait le diamant, et surtout elle savait, grâce à GAFAM, où était caché le sac de pierreries ainsi que la chèvre d’or. Elle regretta beaucoup le bon génie, si effrayant et si gentil, qu’elle aurait aimé présenter à ses amies de Bagdad. Il lui fallait songer à rentrer chez elle. Après avoir pris congé de ses hôtes, elle partit un matin, juchée sur le fauteuil, lui-même installé sur le dromadaire blanc, pour de nouvelles aventures. Avait-elle pu récupérer le trésor ? Depuis, la vie a continué à ARES et au pays d’ARCACHON. La légende de la chèvre aux cornes et sabots d’or est encore connue de quelques personnes et quelque part au fond d’un estey, attend le bon génie... (Extrait d’un manuscrit daté de 1851, découvert à l’intérieur d’une bouteille sur la plage des Quinconces.)
Alain VARGAS
Le voyage d'Alma
Le carrelet descendait très lentement. Dès qu'il toucha la surface de l'eau, le plus athlétique des deux garçons ralentit encore son geste afin de ne pas risquer delaisser s’échapperce qui reposait au fond du filet : des étrilles écrasées, attrapées le matin même sur les rochers. Un excellent appât qui portait ses fruits : unevingtaine d’éperlans frétillaient déjà au fond du seau. Concentré dans sa tâche, il sursauta brusquement. Une femme se tenait debout près de lui. Penchée sur la balustrade de la jetée de Bélisaire, elle regardait le carrelet s'enfoncer dans l’eau. Elle resta ainsi quelques minutes, se redressa, fixa un instant les deux jeunes pêcheurs derrière ses gigantesques lunettes de soleil puis, sans un mot, fit demi- tour laissant échapper une espèce de ricanement. Interloqués, les garçons suivirent du regard sa longue silhouette, toute de gris vêtue, qui s'éloignait, d'un pas hésitant, en direction des bateaux-navettes reliant le Cap Ferret à Arcachon ou au Moulleau. « Encore une Parisienne qui n'a jamais vu autre chose que des poissons panés ! » se moqua le benjamin d'un air dégouté. « Pire, elle doit être végan ! » assena-t-il avec conviction. « Ôtes-moi d'un doute ! C'est bien toi qui habites Saint-Ouen et qui es arrivé hier par le TGV ? » le questionna l'autre, goguenard. Riant comme des bossus, ils se remirent à pêcher se fixant la mission de rapporter suffisamment de poissons pour le dîner du soir tout en occupant avec délectation leurs premières journées estivales. Les deux ados adoraient se retrouver ainsi lors des vacances qu'ils passaient chez leur grand-mère au Cap Ferret. Jean habitait la banlieue parisienne, tandis qu'Arnaud, pur Arcachonnais, avait l'insigne avantage d'être le « régional de l'étape » et de connaître le coin comme sa poche ! Dès le lendemain matin, marée oblige, alors qu'ils installaient leur attirail, quelle ne fut pas leur surprise de voir la dame se diriger vers eux. Même tenue grise, même lunettes, même démarche incertaine. À la différence de la veille, elle leur adressa la parole. - « Bonjourrrr les garrçons, je peux vous poser une question ? » demanda-t-elle d'une voix chantante, roulant les R telle une palombe. Sans attendre leur réponse, elle continua : « Je vois que vous venez ici tous les jourrrs, connaissez-vous des hommes qui font de la moto surrr l'eau ? » Tout en parlant, elle avait ôté ses lunettes découvrant des yeux immenses, légèrement en amande et d'un gris chatoyant. Totalement sous le charme, Arnaud resta silencieux tandis que le gouailleur parigot n'hésita pas : « Vous voulez dire des jet-skieurs ? » corrigea-t-il. « Ah oui, c'est vrrrrai, vous appelez ça comme ça...jet-skieurrrrr » murmura-t-elle. Elle était dotée d'une curieuse bouche en canard avec une sorte de sourire permanent. « Encore une qui a succombé à la chirurgie esthétique ! » supposa Jean, prompt à la critique. Reprenant ses esprits Arnaud répondit enfin : « Oui. Il y a beaucoup de scooters des mers sur le Bassin. Pas très loin dici, le club du Canon, juste derrière la mairie, organise des randonnées. » - « Ah merrrrci, vraiment trrrès intérrressant mais c’est quand même un peu dangerrreux, non ? s'inquiéta-t-elle soudain. Il doit y avoirrr des accidents ? » - « C'est certain, il faut faire très attention à ne pas aller trop vite, les vagues sont piégeuses, et aussi les dauphins. » - « Les dauphins ? » réagirent en chœur Jean et la femme. - « Souvent, lors des balades à jet-ski, des dauphins ou des marsouins rejoignent le groupe et s'amusent à plonger autour d'eux, ça peut déséquilibrer l'engin » expliqua Arnaud. - « Au revoirrrr ! » interrompit la femme qui, semblant soudain essoufflée, se précipita vers le bout du débarcadère. - « Waouh, elle est trop belle ! » s'émerveilla Arnaud en la suivant du regard. - « Waouh, elle est trop chelou ! » l'imita aussitôt Jean en se détournant pour s'occuper du carrelet. Repensant à la conversation, il demanda à son compère s'il connaissait le responsable du club en question : « Ce serait assez génial d'aller nager avec les dauphins ! J'en rêve ! » - « Je sais qu'il s'appelle Joël Martin. J'ai dû le croiser une ou deux fois. On m'a parlé de lui il n'y a pas très longtemps, je ne me souviens plus qui... ni à propos de quoi d'ailleurs ! » - « Ah ben ça c'est de l'information ! Je croyais que tu connaissais tout le monde ici ! Tu pourrais te renseigner un peu, faire ami-ami avec lui, il nous invitera peut- être à aller un jour en randonnée nautique. » Histoire de le motiver, Jean ajouta, moqueur : « Comme ça, si la belle Russe revient tu auras un prétexte pour l'aborder !» - « Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle est Slave ? maugréa Arnaud un peu agacé. Elle pourrait aussi bien être Espagnole, Portugaise, Brésilienne, pourquoi pas Italienne ou même Égyptienne ! » Infatigablement, chaque fois que la marée était favorable, et tant que leur grand- mère ne se lassait pas de leur cuisiner une friture d'éperlans, ils partaient pêcher à Bélisaire, Arnaud espérant secrètement croiser « son amoureuse » comme l'appelait Jean ! Et à chaque fois, quel que soit l'horaire, elle était là.Dès qu'elle les apercevait, elle les rejoignait avec sa drôle de démarche chaloupée et engageait la conversation d'une voix mélodieuse, les questionnant sur le Bassin, les bateaux, les horaires de marée, ce que devenaient les poissons qu'ils pêchaient... Intrigués, ils tentaient bien de savoir ce qu'elle faisait là mais elle restait vague disant qu'elle attendait quelqu'un, qu'ils s'étaient donnés rendez-vous sur la jetée mais qu'elle ne savait pas précisément quand, donc elle venait tous les jourrrs, gardant espoirrrr. Elle pensait qu'il viendrrrait avec sa moto de merrrr... Ou alorrrs, peut-êtrrre devait-elle aller à sa rencontre surrr l'eau ? - « Ah, c'est pour ça qu'elle se renseignait sur le club de jet-skis » pensa Arnaud, un peu jaloux. Les jours suivants, la météo étant favorable au surf, les garçons se rendirent à vélo côté océan où de belles vagues étaient annoncées au spot de la Torchère. Ils s'éclatèrent pendant des heures, ivres d'iode, de soleil et de mer. Ils en auraient presque oublié la mystérieuse étrangère si, sur le chemin du retour, au sommet de la dune ils n'avaient croisé le fameux Joël Martin. Très grand, des épaules de déménageur, des cheveux blonds presque blancs qui contrastaient avec sa peau tannée par le soleil, le gaillard était assez impressionnant. En voyant Arnaud, il l'interpella d'un air narquois : « Salut gamin ! Alors, comment va ta grand-mère ? Toujours folle de moi ? » N'attendant aucune réponse, il éclata d'un rire sarcastique et poursuivit son chemin vers la plage. Sidéré, Jean s'écria : « Il s'est passé quoi, là ? Qu'est-ce que c'est que cette remarque sur Mamie ? » Un peu gêné, Arnaud allongea le pas : « Viens, dépêche-toi, je vais t'expliquer. » Ca y est, il se souvenait ! Comment avait-il pu zapper cette affaire ? Leur adorable grand-mère était une fervente militante écologique. Elle suivait avec attention tout ce qui pouvait concerner le Bassin d'Arcachon, son environnement, sa préservation. Elle était membre de la Ligue de Protection des Oiseaux et de plusieurs associations de défense des fragiles écosystèmes locaux. Et... elle menait une guerre ouverte contre les jet-skis dont elle estimait qu'ils étaient une véritable nuisance pour la biodiversité, la faune, la flore, doublée d'un réel danger pour les baigneurs. Son dernier fait de guerre : lancer une pétition afin de les interdire dans toute la lagune ! Arnaud exposa la situation à Jean qui tombait des nues. - « Je savais que Mamie rageait quand on laissait couler l'eau, qu'elle était très pointilleuse sur le tri de ses déchets et qu'elle compostait ses épluchures au fond du jardin, mais j'étais loin d'imaginer un tel engagement. J'ai l'impression que ma balade « dauphinautique » est mal barrée... Ils profitèrent du dîner pour questionner leur grand-mère qui ne se fit pas prier et leur raconta sa haine des jet-skis et sa fierté d'avoir d'ores et déjà rassemblé plus de 5 000 signatures. - « Ah, je comprends mieux pourquoi Joël Martin ne te porte pas dans son cœur ! » s'esclaffa Jean. - « Joël Martin ? Vous l'avez vu ? Ah, ne me parlez pas de cet assassin écologique ! » rugit la vieille dame. Sidérés de sa réaction, ses petits-fils la pressèrent de s'expliquer. Une dizaine de jours plus tôt, au sortir d'une soirée très arrosée, le moniteur aurait emmené une bande de copains faire une virée au pied de la dune du Pilat leur faisant miroiter de s'amuser avec les dauphins. L'alcool leur donnant du courage, ils étaient partis à la seule lumière de la lune, bravant la houle et l'interdiction de naviguer la nuit. À leur arrivée les dauphins étaient bien au rendez-vous, prêts à jouer avec les jet-skis. Sauf qu'en fait de jeu, les ivrognes n'avaient rien trouvé de mieux que de viser et de percuter les cétacés... Bilan de cette monstrueuse soirée, les cadavres mutilés de plusieurs dauphins avaient été retrouvés au bord de la plage de la Corniche. Témoins de la scène, des campeurs avaient prévenu la gendarmerie maritime qui, le temps d'arriver, n'avait pu que constater le désastre sans trouver aucune trace des auteurs. L'un des témoins s'était empressé de filmer la scène mais la nuit empêchait de discerner les jets-skieurs et leur monture. Pourtant un indice avait amené les gendarmes à interroger Joël Martin : sur la vidéo on distinguait nettement la tête du chef de la horde arborant une belle touffe de cheveux blonds/blancs... En entendant cette histoire, les deux cousins étaient horrifiés. - « Je vous raconte ce que l'on m' rapporté, ajouta la vieille dame, vous devriez appelervotreonclePhilippe.Ilaccepterapeut-êtredevousenrévélerdavantage. » Sans attendre, ils repérèrent sur Internet un article récent sur les dauphins retrouvés morts au pied de la grande dune. On n'y mentionnait pas les jet-skieurs, en revanche était servie l'habituelle rengaine sur des blessures dues aux filets de pêche. Dès le lendemain ils contactèrent leur oncle, gendarme à Lège, pour tenter de démêler le vrai du faux. Celui-ci leur confirma les faits mais avoua que l'enquête en cours stagnait. Ils avaient bien interrogé Joël Martin pourvu d'un alibi en béton : il avait passé la soirée chez lui avec des copains et, évidemment, chacun d'eux confirmait l'alibi de l'autre. Méticuleusement les jet-skis du club avaient été examinés par les policiers mais, alors que certains étaient endommagés, aucune marque ou fibre suspecte ne permettait de les incriminer. Soudain, Arnaud pensa à sa belle inconnue. Elle qui voulait partir à la recherche de son « chéri », il fallait absolument la prévenir de ne pas faire appel à ce potentiel criminel. Il enfourcha aussitôt sa bicyclette tandis que Jean l'interpellait : « Mais la marée n'est pas bonne, on ne va rien attraper à cette heure-ci ! » - « Viens, suis-moi vite ! » Tout en pédalant avec ardeur, son cousin lui fit part de son inquiétude qui malheureusement s'avéra fondée. À leur arrivée à l’embarcadère ils virent, bras dessus, bras dessous, la dame grise et Joël Martin rejoindre un jet-ski amarré au ponton. Déjà équipée d'un gilet de sauvetage, elle s'installa confiante derrière le moniteur. - « Noooon ! N'y allez pas ! » hurlèrent Jean et Arnaud d'une même voix. En les entendant, la femme se retourna et leur fit un amical signe de la main. Souriante elle ajouta quelques mots qui se perdirent dans le vrombissement de la machine. Très vite ils ne furent plus qu'un petit point mouvant à l'horizon. Inquiets, ils attendirent longtemps qu’ils reviennent se relayant pour faire le gué pendant que l'autre allait acheter de quoi boire et manger. A la nuit tombée, le scooter n'étant toujours pas rentré, ils se résignèrent à regagner la maison de leur grand-mère. Leur angoisse fut à son comble lorsqu'ils entendirent le ronronnement de Dragon 33, l'hélicoptère de la sécurité civile, et virent son puissant projecteur sillonner les eaux du Bassin. Le lendemain, tout le Cap Ferret bruissait de la terrible nouvelle. Au bord de la plage de la Corniche, on venait de découvrir le corps mutilé de Joël Martin et, non loin de lui, son jet-ski totalement disloqué. Les recherches se poursuivaient, sans beaucoup d'espoir de retrouver la femme qui l'accompagnait. La mort dans l'âme, les garçons se sentaient coupables et meurtris de n'avoir pu sauver leur « amie » qui, au bout d'une semaine, n'avait toujours pas réapparu. Pourtant, un soir qu'ils se promenaient en dégustant une glace le long de la jetée, ils eurent la stupéfaction et la joie de la croiser, bien vivante ! - « Ah, je vous cherrrchais ! roucoula-t-elle, je voulais vous rrremerrrcier de m'avoir aidée et vous dire au-rrrevoirrr avant de parrtirrr. » Tout en continuant à parler, devant leurs yeux ébahis, elle escalada la balustrade où elle se tint debout. Soudain elle se propulsa en l'air avant de plonger impeccablement. Au fur et à mesure qu'elle se rapprochait de l'eau son corps se transforma, sa robe devint peau, son nez se changea en rostre et c'est un majestueux dauphin qui s'enfonça dans les flots du Bassin. Une seconde plus tard, sa tête refit surface, yeux et bouche rieurs, puis, dans un gloussement, le cétacé s'éloigna, ondulant vigoureusement vers la dune du Pilat.
Chantal CARRERE-CUNY
La Dame grise
Nouvelles
Message n°1 Bienvenue à la villa Les Varechs. Tu as trouvé la clé à l’endroit prévu. Comme tu le sais, ceci est un cadeau mystère anonyme qui t’est offert pour tes quarante ans, et tu es venu seul. Installe-toi, prends tes aises. Ensuite, je vais t’inviter à sortir cet après-midi. Tu te souviens des grands jeux auxquels tu participais pendant les colonies de vacances. Cela s’appelait les jeux de piste. Il y en avait un par session. On jouait par équipes. On devait suivre des flèches, résoudre des énigmes, rapporter des preuves de passage à différentes étapes. Au bout du périple, le trésor c’était le goûter, et bien sûr toutes les équipes gagnaient ex aequo. Tu vas faire un jeu de piste un peu particulier, car tu y seras le seul participant.&amp;lt;br&amp;gt;Ceci est le premier et dernier message sur papier, car ton outil sera ton smartphone dernier cri, jeu ancien mais technologie moderne ! Tu taperas le lien ci-dessous. Une appli se chargera automatiquement. Elle te localisera et t’enverra des messages aux moments opportuns. Tu ne pourras pas tricher ! Tu vas partir pour une balade vers une grande surprise, chaussé de tes sneakers de série limitée. Bon jeu de piste ! Message n° 6 Dans cette petite rue peu passante, regarde autour de toi. Dans les haies subsistent des rosiers de roses anciennes qui n’ont pas vu un sécateur depuis longtemps. Sens-tu leur parfum ? Mais peut-être n’y es-tu pas sensible, tu as maintenant un odorat de citadin. Message n°9 Lève les yeux. Les petites villas de l’entre deux guerres sont encore fermées pour la plupart, la saison d’été n’a pas encore commencé. Leurs volets bleu clair encadrent un pignon planté au milieu de la façade, comme un chapeau pointu fantaisiste. Bien sûr elles n’offrent pas le confort moderne que tu apprécierais dans les appartements du centre ville. Ont-elles quand même du charme à tes yeux ? Message n°12 Tu te demandes à quoi rime cette incursion dans le passé, tu t’impatientes. C’est vrai que tu es connu pour aller vite au but, même s’il faut bousculer quelqu’un. Mais tu dois suivre mes indications. Ce jeu est un cadeau, et un cadeau, ça ne se refuse pas, n’est-ce pas ? Message n°14 Une récompense t’attend. Mon guidage t’a amené au port ostréicole. Va jusqu’au bout de la rue. À la dernière cabane, donne ton nom, on te servira une douzaine d’huîtres et un verre de vin blanc. Enfin une activité normale de touriste. Tu vois, je prends soin de toi. Avoue que c’est délicieux, je sais que tu apprécies le goût et le cadre... Et que tu savoures également les regards intéressés des jolies femmes aux tables voisines. Message n°17 Tu t’es éloigné de la ville, et il y a moins de monde par ici. Sur ce chemin, tu ne trouves aucun intérêt aux haies où piaillent les oiseaux (tu ne sais pas qui je suis, mais moi je te connais). Descends sur le sable jusqu’à ces herbes rases, charnues. Goûtes-en une, tu peux y aller, c’est comestible. Reconnais-tu ce goût légèrement acidulé ? Tu avais oublié ? Ce sont des salicornes, les mêmes que celles que tu achètes en bocal à prix d’or dans l’épicerie fine en-dessous de chez toi. Message n°19 Les huîtres t’ont donné soif, et tu n’avais pas pris ta gourde, toi qui prétends tout maîtriser d’habitude. Sur le chemin qui longe le Bassin, il n’y a pas un café à tous les coins de rue pour te désaltérer comme dans ton quartier branché. Mais courage, la surprise finale vaut bien un petit inconfort.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span&amp;gt; Message n°22 Il n’y a plus personne autour de toi. N’apprécies-tu pas le calme ? Le sol est boueux, tu es obligé de marcher dans les flaques. Dommage pour tes chaussures, mais elles valent bien que tu les salisses pour la surprise qui t’attend. Tu n’as pas une petite idée de qui je suis et où je t’emmène ? Message n°24 Tu marches plus difficilement, tes pieds collent comme des ventouses. Tu n’es pas fatigué, quand même, un fringant sportif comme toi ? Tu n’es pas inquiet, bien sûr, tu n’as peur de rien. Continue d’avancer, la surprise n’est plus très loin. Message n° 25 Tu t’enfonces vraiment. Tu as perdu tes chaussures. Tu es dans la vase jusqu’aux mollets, et la mer monte. Tiens, tu paniques, et tu as raison, tu es en danger. Lis vite ce message. Pour ne pas mourir noyé, la seule solution est de te mettre à quatre pattes et de ramper jusqu’au piquet que tu vois à quelques mètres. Tu vas t’y accrocher. Mais pour cela tu vas devoir laisser tomber ton précieux smartphone que tu exhibais avec vanité, il va être hors d’usage. Heureusement pour toi, c’est jour d’entraînement des sauveteurs en mer. C’est moi le capitaine maintenant, nous sommes dans le coin, nous vois-tu ? C’est toi qui nous sers de cobaye aujourd’hui, c’est prévu. Les copains vont bien rire en te découvrant, habillé de boue noire de la tête aux pieds, et même jusqu’aux sourcils. Te voilà bien piteux ! Ils vont te trouver moins arrogant que quand tu les croisais autrefois, sans un regard pour eux, dans les rues touristiques. Moi, je n’ai eu personne pour me secourir, il y a vingt-cinq ans, quand tu m’as obligé à aller chercher mon sac à dos que tu avais lancé par ici. J’ai dû m’en sortir tout seul. Tu as compris qui je suis, maintenant ? La surprise t’a-t-elle plu ? Bon anniversaire.
Martine MAZURE
Jeu de piste
Le 17 aout 2030 à la une du journal Sud Ouest : UN CADAVRE SUR L'ÎLE AUX OISEAUX En page intérieure il est précisé qu'un ostréiculteur se rendant sur ses parcs situés à Mapouchet a fait la découverte au petit jour, d'un d'un homme vêtu d'un costume 3 pièces ficelé par un fil de fer sur un pignot. La victime a été tuée par la flèche d'un fusil harpon, tirée en plein cœur. Enfoncé dans la bouche un foulard jaune imprimé du logo d'Arcachon, porté lors des fêtes de la mer, dépasse de sa bouche, comme si on avait cherché à étouffer un dernier cri. Autre indice, le cadavre est celui d'un homme asiatique ,de par son faciès et sa carnation. L'enquête devra déterminer l'identité de la victime, et par la suite, les circonstances et les mobiles de ce crime. Dès le lendemain un premier compte rendu est publié donnant de nombreuses informations concernant la victime et des précisions sur sa présence sur le Bassin. UNE ENQUÊTE RONDEMENT MENÉE avec les papiers retrouvés sur le cadavre, la victime est rapidement identifiée : - Bounmy Rattenavan né au Laos n'est autre qu'un des frères TANG , des commerçants, connus sous ce pseudonyme. Propriétaires d'une chaîne de supermarchés en France et en Europe , les 2 frères ont fait fortune en s'implantant dans le XIIIème arrondissement de Paris, puis en créant des magasins dans toute l'île de France. Au tout début avec la vente de galettes de riz et de sauce au soja, ils ont créé un empire qui cherche aujourd'hui de nouveaux débouchés pour accroitre sa domination. Comme les chinois qui ont racheté de nombreux châteaux du vignoble bordelais, les frères Tang misent sur le tourisme, subodorant l'envie nouvelle de voyager pour les millions de ressortissants d'Asie qui ont vécu depuis des siècles dans l'isolement. Aujourd'hui les choses évoluent, les Chinois sont devenus les principaux pourvoyeurs de marchandises manufacturées au monde , une classe de plus en plus aisée a émergé et cherche à s'ouvrir sur le monde. Les Chinois en profitent pour racheter les aéroports français, avec pour corollaire une multiplication des vols entre les deux pays. Ayant désormais la main pour les faire partir, il faut échafauder des envies de découvertes qui créeront une source de profits. Le parcours de la victime est rapidement reconstitué, avec les éléments retrouvés dans la chambre de l'hôtel de luxe d'Arcachon qu'il occupait discrètement depuis plusieurs jours. Les plannings de rendez-vous montrent la stratégie mise en place par les frères Tang, pour le Bassin et sa région. De nombreux contacts officiels ou officieux , soigneusement répertoriés dans les agendas et les lettres d'intention retrouvées, témoignent l'activité de l'homme d'affaire depuis son arrivée. Dès le premier jour sur le Bassin une première rencontre a eu lieu avec le maire d'Arcachon pour étudier la mise en place d'une collaboration entre la ville et la galaxie Tang .Était envisagée la reconstruction du casino Mauresque ,avec pour l'occasion, un hôtel-casino 2 fois plus grandiose que l'original, un agrandissement substantiel du port de l'Aiguillon afin d'accueillir les yachts ,et un doublement de la jetée Thiers avec des navettes toutes les 10 minutes, pouvant relier tous les points du Bassin sans se soucier des marées et des coefficients, grâce à l'utilisation de bateaux équipés de roues et de chenilles tout terrain. La deuxième journée fut consacrée au quartier du Pyla avec une rencontre informelle avec le président du syndicat mixte de la dune .Ce syndicat en charge du site a mis en place une gestion privée de la dune après l'expropriation de tous les propriétaires de parcelles boisées dans son périmètre .Un village de commerces de piètre qualité enlaidissait ce site classé. Ce fut une opération juteuse sur un panorama unique au monde, dévoyée par des élus dans le but avoué de protéger une merveille, merveille qui sera pourtant difficile à sauvegarder au fil des siècles. Les spécialistes s'accordant sur le fait que la Dune reste tributaire de l'érosion et de l'avancée inexorable du sable vers la forêt, sa disparition est programmée dans un avenir lointain. Une offre de rachat du site est proposée avec une somme pharaonique à la clé. Cela permettra aux communes d'envisager d'autres investissements, avec l'aide bienveillante de la galaxie Tang, sans oublier les commissions aux intermédiaires. La Dune aura ainsi le standing qu'elle mérite avec des téléphériques, des pistes de ski et des campings haut de gamme avec des pagodes nichées dans les pins replantés, d'une espèce à croissance accélérée, le tout dans un confort 5 étoiles. Pour améliorer l'emploi ,la société sino- testerine s'engage à racheter l'entreprise Gaume qui a le monopole du bâtiment dans le secteur, en multipliant les constructions haut de gamme. Passage par la mairie de La Teste de Buch, pour un projet qui n'a pour but que participer à la rénovation des cabanes Tchanquées dont l'entretien pèse trop lourd sur le budget de la ville. Moyennent un bail d'exploitation de 99 ans , reconstruction à neuf de l'existant avec autorisation d'ouvrir 2 restaurants l'un à l'enseigne Mac Donald et l'autre proposant une dégustation de fruits de mer et de sushis importés directement du pays du soleil levant. Aucune pollution par les emballages tous solubles dans l'eau de mer et accès sur le site par des navettes à moteurs électriques, avec présence des consommateurs limitée à 1 heure sur le site, repas et selfies compris. Dans l'agenda, une autre réunion très attendue, celle avec le président du syndicat des ostréiculteurs. Depuis des années il dénonce la mortalité croissante des huitres. Pollutions et algues toxiques entrainent une surmortalité du naissain et des jeunes huitres. Le groupe d'investisseurs promet une aide massive à la profession en échange de l'introduction d'une nouvelle famille d'huitres plus résistante aux pollutions du bassin. Exit les huitres portugaises et autres japonaises, les variétés diploïdes ou triploïdes, il est temps d'importer des huitres perlières venues de Formose plus résistantes et qui offrent aux perles une palette de couleurs nacrées du plus bel effet. Une richesse nouvelle pour relancer l'ostréiculture et ouvrir une nouvelle filière pour la bijouterie.Ainsi naîtra dans le Bassin : la Perle de l'Atlantique. Dans le planning des consultations du frère Tang était prévue la visite du parc ornithologique du Teich ,avec une table ronde réunissant, la ligue de protection des oiseaux et le conservatoire du littoral. Il fallait faire revenir dans le parc, des espèces d'oiseaux qui ont déserté nos côtes depuis bien longtemps. Les oiseaux avaient aussi le droit de faire partie de ce projet. Les défenseurs de l'environnement trop souvent des laisser pour compte, ne se sentiront pas, pour une fois lésés dans l'attribution des subventions. Chaque projet était accompagné d'études préalables fort documentées, ce qui étayait le sérieux des propositions, aussi bien pour leur faisabilité que pour leur financement, car les frères Tang avaient fait appel aux meilleurs architectes et à un consortium d'investisseurs à très gros budgets. Parmi toutes ces prises de contact qui se voulaient avant tout « novatrices » et « protectrices », une réunion plus discrète avait eu lieu à Arès, avec la communauté indochinoise implantée en ces lieux depuis les années 50. À son retour en France, suite à la perte de l'Indochine ,l'empereur Bao Daï était revenu en Europe avec un trésor de guerre .Ce trésor aurait servi à bien des opérations louches qui sont toujours restées à l'état de suppositions, les Asiatiques ayant toujours l'art du secret. Pourquoi Tang voulait il se rapprocher de cette communauté citée par le journal Sud-Ouest dans d'un article paru en 2023 ? Les enquêteurs suputent que Bounmy Rattanavan alias Tang voulait, avec l'appui de ses compatriotes installés dans ce petit port tranquille, faire une offre de rachat de la clinique d'Arès comme un retour symbolique à la fondation privée de l'aérium créé par la famille Wallerstein au début du XXème siècle. Les dignitaires des régimes totalitaires du Sud-Est asiatique et les riches ressortissants de ces pays seraient des cibles lucratives pour des séjours de remise en forme sur mesure. Les enfants malades du siècle dernier seraient avantageusement remplacés par une génération de mandarins victimes des excès de la malbouffe et de la surconsommation. La santé donne toujours une bonne image à une opération qui ne se veut pas seulement mercantile. CHAPITRE 2 L'HÉRITAGE DES PEREIRE Dans la chambre de Bounmy Tang, outre les documents que nous avons cités, les enquêteurs trouvent des livres français, aux titres évocateurs : Émile et Isaac Pereire l'esprit d'entreprendre Les frères Pereire ,le bonheur d'entreprendre L'idéologie du Saint Simonisme. Les frères Tang n'avaient ils pas en projet de réaliser une opération identique à celle qui a fait la gloire des frères Pereire, qui ont laissé un héritage encore vivant sur la ville d'Arcachon avec un développement corollaire pour la région grâce à la ligne de chemin de fer Bordeaux/La Teste. Dans ce 19éme siècle avec la révolution de la machine à vapeur, la présence bienveillante de l'empereur Napoléon III et la vision affairiste des banquiers Pereire, ces 3 maillons ont permis de transformer cette région en un joyau pour notre beau pays. Deux cents ans plus tard ,l'histoire peut se réécrire avec cette fois la mutation dans le numérique qui bouleverse le rapport avec le travail, un empereur chassé d'une ex-colonie française qui avait des intérêts plus ou moins avouables et les frères Tang dans le rôle de promoteurs de loisirs. A nouveau 3 maillons pour une chaîne venue d'Asie. En se plongeant dans les archives de la société historique d'Arcachon ,les limiers chargés de l'enquête découvrent une information qui fit grand bruit à son époque et que seuls quelques vieux arcachonnais ont encore en mémoire. En 1957 le maire d'Arcachon Lucien de Gracia envisage de créer le lotissement du Parc Pereire, les quelques héritiers Pereire désirant vendre les 41 hectares de cette magnifique forêt dunaire. La bataille est féroce avec Louis Gaume qui veut acquérir le parc, non pas pour y faire des lots à bâtir élitistes, mais plutôt des petits immeubles de style méditerranéen. Le maire d'Arcachon soutenu par le journal régional La France ,concurrent du journal démocrate chrétien Sud Ouest annonce sous la plume du journaliste Michel Doussy : “des émissaires de l'empereur Bao-Daï ont rencontré le maire et sont prêts à investir beaucoup d'argent pour l'acquisition des terrains du Parc Péreire “. Polémique quant à l'origine des fonds, la guerre éclate entre Gaume et De Gracia ,tout cela finira au tribunal avec la victoire du maire d'Arcachon au cours d'un procès retentissant. Mais comment imaginer que Bao-Daï ait pu porter un intérêt à Arcachon exilé loin de sa Cochinchine natale. Mais Bao-Daï était déjà venu à La Teste ,avant la fin de son règne au début des années 50 pour y prendre livraison de 2 vedettes de guerre construites par le chantier Boyer. Une photo avait immortalisé ce bref passage en pays de Buch avec discours, fanfare et drapeaux tricolores. Cette cérémonie fut aussi brève que la survie des vedettes qui ont été coulées dans le golfe du Tonkin. Y avait il eu de rétrocessions de fonds à l'époque, comme avec les fameuses vedettes de Taïwan en 1991 ? On dit souvent que l'histoire se répète; on peut le penser aujourd'hui. Pourquoi les frères Tang auraient eu la tentation de s'approprier des lieux si éloignés de leur pays d'origine ? Et de farouches opposants à toute ingérence étrangère , iraient ils jusqu'à tuer ceux qui échafaudent des rêves de conquêtes ? Tout reste envisageable dans cette obscure affaire qui empoisonne l'establishment local et même au delà.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span&amp;gt; CHAPITRE 3 RUMEURS ET SOUPÇONS L'enquête qui se voulait discrète devient vite un feuilleton où chacun livre des hypothèses plus ou moins farfelues. l est particulièrement désagréable pour les limiers qui travaillent sur cette affaire de lire des informations fuitant dans le journal régional Sud Ouest, sous la plume du correspondant local qui alimente une chronique journalière sur l'avancée de l'enquête. Après les investigations menées sur la vie et les affaires des frères Tang, sur les intérêts supposés ou réels de quelques personnalités politiques ,les révélations des amitiés ou des inimitiés de décideurs locaux, tout est bon pour tenir en haleine les lecteurs qui cherchent à savoir la fin de l'histoire. Tout ce chahut médiatique met en lumière la malignité du journaliste qui prend un malin plaisir à brouiller les pistes comme dans un escape game. Puisque ce Sherlock Holmes médiatique perturbe le secret de l'enquête, il serait judicieux de passer son son profil au peigne fin. Au début de l'affaire, la police a été surprise par la rapidité de l'annonce du crime. Le corps retrouvé le 16 au matin sans divulgation ni des circonstances, ni des premières constatations, l'article à la une du journal dés le lendemain révèle déjà les détails de la scène. L'arme du crime, le fusil de chasse sous marine, se révèle être un fusil appartenant au club de plongée du Bassin dont le président n'est autre que le journaliste du Sud Ouest. Après recherche dans son état civil, on retrouve la trace d'une aïeule de ce chroniqueur comme femme de chambre au service de la famille Pereire jusqu'au décès d'Émile Pereire en 1875. Cette femme s'est déclarée mère d'une fille de père inconnu. Coïncidence cette fille a été l'arrière grand mère de ce reporter trop zélé.Cette dame avait d'ailleurs revendiqué , sans succès, à la fin de sa vie, d'hériter de la villa Régina Ceoli contiguë au majestueux chalet des Pereire en contre partie d'une promesse faite pour garder secret le nom du père de l'enfant tombé du ciel. Enfin le journaliste pour mettre fin aux soupçons, avait comme alibi les reportages effectués lors des fêtes de la mer les 14 et 15 aout 2030. Les photographies attestaient bien de sa présence, sur de nombreux clichés,où il apparaissait avec son appareil photo et son foulard jaune autour du cou comme signe festif pour cet événement. Bizarrement sur le dernier cliché lors du feu d'artifice au bout de la jetée, notre reporter n'a plus son foulard autour du cou .Une perquisition à son domicile ne trouvera aucune trace de ce foulard qu'il affirme avoir offert à un jeune estivant qui passait par là. Comme le mauvais temps qui assombrit l'horizon, les reportages dans le Sud Ouest n'annonçaient plus que de rares et brèves informations sur la poursuite de l'enquête. Les soupçons ne sont pas devenus des certitudes, les rumeurs continueront à courir entre 2 clans opposés. Le journaliste suspecté a bénéficié du soutien de la presse qui milite encore aujourd'hui pour dénoncer une conspiration politico-financière avec l'attribution frauduleuse de biens publics par des collectivités sensées défendre des biens communs. À qui profite le crime ? Syndicat mixte de la Dune, Natura 2000, Conservatoire du littoral, Communautés d'agglomération, Associations de défense de la forêt usagère, de propriétaires ayant pins, Comités de défense et de promotion de sites protégés, structures qui défendent parfois des intérêts particuliers aux dépends des intérêts communs. Avec la cupidité de certains qui s'érigent en défenseurs, mais qui sont d'humeur capricieuse, cela devient des proies faciles pour des enchanteurs à gros budgets. Le correspondant local du journal Sud-Ouest a été envoyé faire un reportage sur la disparition des icebergs au pôle nord ,suite au réchauffement climatique.Le Bassin redevient le lieu fréquenté par les touristes et les retraités en quête d'un bonheur fragile,histoire de passions et de compromissions CETTE NUIT UNE SOUCOUPE S'EST POSÉE SUR L'OVNI-PORT D'ARÈS La une de Sud Ouest annonce l'arrivée des petits hommes verts. Des prédateurs venus d'une autre planète pour accaparer des richesses que nous avons eu tant de mal à préserver.
Charles-Alberts GHYCELS
Le Bassin n'est pas à vendre
Il se passe toujours des tas de choses étonnantes sur le Bassin d’Arcachon. Toujours... Tout avait commencé comme ça... Georges Plassard avait effectué toute sa carrière dans la Police. Il était en retraite depuis une bonne décennie. Embauché comme simple agent à la circulation, il avait assuré dix ans de bons et loyaux services au sein du commissariat du 13ème arrondissement de Marseille. Adorant tracasser ses congénères, il contrôlait les automobilistes qui venaient de griller - soit disant - un feu rouge, il verbalisait des mamies qui n'avaient pas traversé la rue dans les clous ou effectuait des contres d’identité concernant surtout les exogènes d’Afrique du nord. À sa décharge, il faut dire qu'il avait fait la guerre l’Algérie. Trois ans. Il y était resté trois ans. Trois ans à fouiner dans les quartiers chauds d'Alger, là où son supérieur lui avait dit de chercher des noises aux natifs. Il y avait mené des enquêtes sur les trafics en tous genres comme les ventes sauvages - sous le manteau - de casseroles ou sur le non respect des règles sanitaires en matière de vente de brosses à dents. Mal vu, Georges vivait dans la crainte de représailles de a part des algérois tellement il leur menait la vie dure. Un jour, il avait fait décrocher le linge qui pendait à toutes les fenêtres de la rue Mohamed Ghinouze parce qu’il trouvait ça disgracieux. Cette initiative avait déclenché un tollé général dans ce quartier dont les habitantes révoltées en jetant toutes leurs poubelles par la fenêtre. Une autre fois, rien que pour contrarier de paisibles buveurs de menthe à l’eau du bar se trouvant à l’angle des rues Zikara Mouloud et Mohammed Ben Zineb, il les avait tous fait arrêter au prétexte fallacieux qu'ils avaient demandé, prétendument, à ce qu'on leur serve double dose de sirop. Bref, le Georges était un véritable emmerdeur. Ces frasques avaient été appréciées par Clampart, son chef divisionnaire. Lorsque le temps d'affectation de cette fripouille était arrivé à son terme, les algérois et les algéroises du quartier Belcourt avaient fait la fête. C’est pour dire... Au regard des loyaux services rendus à la mère patrie, Clampart avait usé de ses prérogatives pour que le Georges montât en grade. C'est comme a qu’il fut muté à la brigade volante du commissariat d'Aubervilliers en qualité de brigadier. Suite aux accords d’Évian qui avaient mis un terme à cette foutue guerre d’Algérie, les "Événements étant déclarés terminés, Plassard avait vu débouler dans sa banlieue des centaines de travailleurs algériens venus participer à la reconstruction de la France. Et ça, le Georges, il avait pas aimé. Petit à petit, notre homme grimpait dans la hiérarchie. À force de pugnacité, il était passé Brigadier-chef, toujours au Commissat d’Aubervilliers. Devenu Major au bout de quelques longues années au cours desquelles il avait fait montre d’enthousiasme à aiguillonner le maghrébin lambda, il avait été affecté au Renseignements Généraux où il avait finit par exceller, notamment dans le bornage des nord-africains. À "La piscine", il se sentait comme un poisson dans l’eau. Son caractère pugnace avait été remarqué par le Colonel Jouhan qui lui avait proposé un poste dédié à la traque des terroristes. Le problème, c’est que - par monomanie - le Georges, il voyait des terroristes partout. Partout, partout... Toute sa vie n’était conduite que par ça. Entre temps, notre homme avait dégotté l’âme sœur. Lors de la cérémonie du 1er mai dédié à mémoire de Jeanne d Arc, il avait rencontré Fabienne. Blondasse rustique, la Fabienne Bougnard exerçait le métier d’agent administratif au SEDPN, le Syndicat radical de la Police Nationale. Coup de foudre place des Pyramides ! Quelques semaines plus tard : cérémonie de mariage en l’Église Saint-Nicolas-du-Chardonnet ordonnée par Monseigneur Lellièvre en personne, traditionaliste de haute volée. Dans la foulée : voyage de noces à Lourdes. Au bout d’une paire d’années fadasse, Georges et Fabienne avaient décidé de s’offrir quelques congés. Normandie ? Morvan ? Sologne ? On hésitait. Petite, Fabienne était allée en vacances à Lanton avec ses parents. Elle affectionnait le Bassin d'Arcachon dont elle gardait bon souvenir. Son époux n'y ayant jamais mis les pieds, elle réussit à le convaincre d'y louer - pour une quinzaine - un bungalow au camping du "Coq Hardy". Le caractère authentique de ce petit coin de France avait emballé Georges. Plages accueillantes, parcs à huîtres, pinède aux effluves de résine, vins du Médoc tout proches... Il était sous le charme. De plus, en poussant un peu, le coin offrait de magnifiques balades : dune du Pilat ; petit port de Biganos haut en couleur avec ses jolies cabanes colorées ; flâneries en canot sur la Leyre domaine de Certes et Graveyron d'Audenge ; Andernos et son église romane, sa rue piétonne et sa jetée. Tout y était magnifique. Et pas un arabe ! Le must, c’était d’aller de balader au Cap Ferret. Ahhh ! Le Cap Ferret ! Une perle, un bijou d’amour. D’un côteé l’atlantique avec sa forêt de pins et ses dunes ambrées infinies où poussent les immortelles, les chardons et les oyats, son immense plage à l’estran qui révèle ses ridules comme d’immenses chevelures minérales où s’écoulent des rias d'eau formant parfois, au gré des bancs de sable, des lacs adoucis par les rayons de soleil, lagunes dont les enfants raffolent pour leurs douces baignades. De l'autre, une succession de villages ostréicoles apaisants. Déguster un plateau de fruits de mer accompagnés d'un petit muscadet bien frais à la "Cabane d'Édouard", flâner à la Pointe des Chevaux, découvrir les réservoirs du "Piraillan" où nichent les hérons cendrés, oser s’aventurer sur la conche de "Mimbeau"par marée basse, pousser jusqu’au bout du cap pour gravir les marches du phare et s’émerveiller de la divine dune, prendre le petit train à la jetée du "Bélisaire" et s’arrêter - peut-être - dîner chez "Hortense" des mets d’ exception... Que du bonheur. Lors d’une fin de ces escapades, on décide de s’arrêter à l’Herbe pour visiter la Chapelle de la Villa Algérienne. Rien que ce nom évoque de bons souvenirs chez Georges qui se surprend à regretter ses années de service, là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée où il jouait au coq dans les ruelles du quartier Belcourt. Justement, cette chapelle, parlons en... En 1863, Léon Lesca acheta un vaste domaine en bordure du Bassin. Ayant fait fortune dans les travaux publics en Algérie, il y fit construire un ensemble immobilier qu’il baptisa "Villa Algérienne". Au fil des années, Léon développa le domaine. Il planta un vignoble, créa des réservoirs à poissons, exploita la forêt et des parcs ostréicoles, construisit une école, une jetée ouverte pour des liaisons directes avec Arcachon, un presbytère et des maisons pour son personnel. Il y fit édifier une chapelle dont il confia la construction à Eugène Ormières, un architecte de renom. Celui-ci réalisa un édifice néo-mauresque remarquable destiné à la pratique du culte catholique. Sur le clocher, il créa - à la demande de son commanditaire - un subtil rapprochement entre la croix catholique et le croissant de lune musulman. Les inscriptions inscrites aux murs de l’édifice reflétaient les influences culturelles de Lesca. Les carreaux de céramique aux motifs floraux, l'utilisation de l'arc polylobé et la polychromie traduisaient l'influence de l'architecture mauresque tant appréciée par le propriétaire. De plus, de sublimes ex-voto apportaient au lieu son fervent attachement à la mer. Subjugués par l’harmonie du lieu, les Plassard se confortent dans l’idée - très personnelle - de la suprématie du culte catholique sur celui de l’Islam. Sous le charme, ils prennent congé du lieu afin de rejoindre leur voiture quand ils tombent soudainement sur la preuve flagrante de la présence d'une mosquée clandestine. Apoplexie !!! Le sang de Plassard se glace. Comment osent-ils ? Pour qui se prennent-ils pour oser installer, à cet endroit précis, un lieu dédié aux thèses islamistes ? Les Plassard ressentent un violent relent de provocation ! Georges compte : 17 paires de babouches, posées là, pêle-mêle. Quelle effronterie ! Venir souiller ce site aussi pur ? Il y a là quelque chose d'insupportable, quelque chose d'inadmissible pour lui ! Et la blondasse d'en rajouter... - Georges, tu peux pas laisser passer ça ! Réagit bordel... - T’as raison. J’appelle immédiatement Robert - C’est qui ça ? - Un copain que j’ai connu en Algérie. Il travaille à la Préfecture de Région à Bordeaux. Allô, Mademoiselle, passez moi Robert Clopineau, c’est urgent ! - Désolée Monsieur, mais Monsieur Clopineau est absent. - Ouais. C'est ça... À d’autres ! Ici Georges Plassard des RG. Clopineau est un ami. J’vous préviens, si vous faites barrage, il pourrait vous en cuire, chère Mademoiselle ! - Euhhh, j’vous l’passe tout de suite... - Clopineau ? Plassard à l’appareil ! - Ah, salut Plassard. - Je suis à l’Herbe, au Cap Ferret. Tu connais ? - Si je connais ? Mais j'ai une baraque au Ferret. Tu parles si j’connais. Qu mon vieux ? - J’suis passé - y a deux minutes - devant une mosquée clandestine ! C'est sûr, les basanés préparent un attentat. Ils doivent être au moins 17. Faut intervenir et fisc. Sinon il va y avoir ici. Je ne sais pas ce qu'ils préparent mais ça ressemble à un attentat contre une vedette pleine de touristes !!! - Wow... Je mobilise immédiatement le RAID... En quelques minutes, le plan "Calypso" est déclenché; Le Cap Ferret s'en trouve totalement bouclé. Trois vedettes rapides traversent le bassin depuis le port d'Arcachon. Deux hélicoptères, blindés de commandos, décollent de la base 107. De partout, les forces spéciales de la Police rapliquent à l’Herbe en à peine un quart d'heure. Fabienne, pétocharde, a trouvé refuge dans la Volvo dans laquelle elle s’est cloîtrée. Les hommes du RAID interceptent tous les bateaux zone : voiliers, hors-bords, pinasses, planches à voile, kayaks de mer, plates ostréicoles, vedettes touristiques... Leurs passagers sont tous arrivés. Ils sont débarqués tout au long du cap sous bonne garde. Pendant ce temps, une escouade - armée jusqu'aux dents - assiège la mosquée. Robert - déposé par hélicoptère express - retrouve Georges sur les lieux. On se renseigne sur le propriétaire de la baraque suspecte. Il s’agit d’un certain Benjamin Gaume, un jeune local qui exerce la profession de guide touristique saisonnier sur un petit bateau proposant la visite des parcs ostréicoles sauvages situés à proximité des cabanes tchanquées. Il est rapidement repéré. On l’interpelle, on l’emmène au QG installé Boulevard de la Plage afin de le questionner... - Qui es-tu, espèce de salaud? Nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, profession ? - Mais vous tes tombés sur la tête pour traiter les gens comme ça !!! - Ta gueule ! Nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, profession ? - Pourquoi ? J'ai rien fait ! J’m’appelle Benjamin Gaume. J’suis d’ici. J’suis né à la clinique d'Arès... - Rien fait ??? Mais t'es qu’une sale petite pourriture... - Moi ? Mais vous êtes fous ou quoi ? J’ai qu’un p’tit bateau et je fais découvrir le bassin aux touristes. - Et ils sont où les terroristes ? - Les terroristes ??? Quels terroristes ? - Fais pas l’malin avec nous, mon gars. T’es cuit. Tu vas en prendre pour vingt ans minimum. - Mais, bordel, qu’est-ce que vous me reprochez à la fin ? - Tu organises des prières clandestines dans ta baraque !!! Tu croyais avoir trouvé la couverture idéale ? Ben c’est raté. Tu t’es fais gauler, mec. - Quoi ? Quand ? Comment ? J’suis même pas croyant. Mon père est charcutier au marché municipal d’Andernos ! J’suis même pas pas circoncis ! - Fais voir ? Ah... ben ouais, effectivement. Bon... C’est quoi toutes ces babouches devant ta cabane ? - Mais c’est les tongs et les tennis de mes clients, ça. C’est pas aut’chose. Demandez leur ! Comme on va découvrir l’Ile aux Oiseaux et les bancs d’huîtres sauvages tout autour, mieux vaut qu’on soit équipés de sandales spéciales anti-coupures. Ces bancs d’huîtres des sables sont des lieux inhospitaliers pour les pieds car leurs coquilles sont extrêmement coupantes. Je fournis à mes clients des espadrilles pour éviter qu’ils ne se blessent. C’est tout. Y a pas de prières ni de trucs comme ça. Vous vous gourez complètement. - C’est quoi ces informations de merde là ? C’est qui qui a lancé l’alerte au djihad ? - C’est Clopineau mon Lieutenant ! - Qui ? - Clopineau ! - Mais c’est qui ça, Clopineau ? - C’est un mec de la Préfecture de Région !!! Il a reçu un tuyau par un indic qui a vu des islamistes préparer un attentat contre une vedette pleine de touristes. - Et ils sont où ces deux mecs ? - Juste à côté. Ils coopèrent. - Ils quoi ? - Ils participent à l’opération. - Mais c’est quoi ce foutoir ? Depuis quand des civils interviennent avec nous ? On est le RAID, bordel de merde. On est l’élite ! Allez me les chercher ces deux connards. Libérez tous les prisonniers et laissez repartir tous les bateaux !!! - À vos ordres mon Lieutenant. Quelques instants plus tard, Clopineau et Plassard, poussés sans ménagement dans la camionnette noire qui sert de QG, sont présentés au Lieutenant Tronchard. On les menotte chacun à une chaise... - Vous ! Déclinez votre identité ! - Robert Clopineau. Secrétaire du Préfet de Région. Réserviste de l’armée de terre au titre de capitaine ! - Et vous ? - Georges Plassard. Ancien actif de la Police Nationale au titre de brigadier-chef. Retraité en qualité de Major des RG. Spécialiste de la traque aux musulmans radicaux dans le cadre de la cellule anti islamiste du ... - OK ! Qui a informé l’autre ? - C’est moi qui ai appelé Robert parce qu’il y avait danger imminent d’attentat. - Ah ouais ? Et qu’est-ce qui vous a fait pensé à ça ? - Les babouches devant la p’tite mosquée, juste là, sur le bord de la jetée. - Mais c’est pas une mosquée ! - Si si. Allez y voir vous même. Ça ressemble à une cabane de pêcheur mais c’est une couverture, en fait. En vrai, c’est un lieu de rassemblement pour les bougnouls. - C’est qui que vous appelez comme ça ? - Ben les bicots, les ratons quoi. - Les quoi ? - Les arabes si vous préférez. Vous êtes sourd ou vous le faites exprès ? - Vous vous foutez de ma gueule ? Pourquoi vous les appelez comme ça ? C’est du racisme pur et dur ça ! Du racisme de facho... Et c’est puni par la Loi ! - J’les aime pas, les melons... - J’avais cru comprendre. Vous savez combien ça va coûter au contribuable votre petite affaire là ? - Non. Et j’m’en fous royalement ! - Ah oui ? Je vous transfère illico au parquet de Bordeaux. Un juge d’instruction du Parquet anti-terroriste vous y attend. Vous allez en prendre plein la gueule !!! - Mais ! Attendez... Y a un malentendu là ! Vous n’avez pas le droit de... - Effectivement. Un malentendu, comme vous dites... Allez, embarquez moi ces deux barjots !! Quand je vous l’disais qu’il se passe toujours des choses extraordinaires autour de notre sublissime Bassin !
Alain KERZULEC
Opération "KALYPSO"
Nouvelles
Le choix d’Ivan de vivre sa retraite à Arcachon avait d’abord été motivé par le charme si particulier de cette ville. Mais cette décision s’expliquait aussi par le désir de prolonger sa vie professionnelle d’ancien chercheur en écotoxicologie par l’étude de la faune et la flore du Bassin et de leurs altérations par les activités humaines ; la vieille maison qu’il avait achetée nécessitait malheureusement de nombreux travaux que le modeste niveau de sa pension de retraite l’avait contraint à réaliser lui-même, repoussant ainsi d’année en année la réalisation de son projet d’études. La lecture, dans La Dépêche du Bassin, d’un article concernant la mise à attribution par le Conservatoire du Littoral de trois cabanes situées sur le domaine public de l’île aux Oiseaux éveilla son intérêt. Son projet d’étude écologique nécessitait un isolement que seule pouvait lui apporter une vie solitaire dans une cabane uniquement accessible en bateau et l’éloignant ainsi de sa maison chronophage; et quel lieu de vie plus propice à un tel projet que le milieu même du sujet d’étude ? Il envoya donc une lettre de candidature détaillant sobrement les raisons de cette dernière : il s’agissait de louer l’une des cabanes proposées non pour son seul plaisir, mais dans le but éminemment utile d’une meilleure connaissance du milieu naturel que l’homme, pauvre être suicidaire sciant la branche sur laquelle il était assis, dégradait chaque jour un peu plus. Ces cabanes avaient été construites à l’origine pour loger de pauvres pécheurs ou ostréiculteurs ; mais le temps passant, elles se transformaient peu à peu en résidences tertiaires de riches avocats ou entrepreneurs pour lesquels il était du dernier chic de clamer haut et fort qu’ils passaient leurs vacances dans une pauvre masure de l’île aux Oiseaux ; ils oubliaient de préciser qu’en réalité, leurs ronflements nocturnes faisaient vibrer les murs de leurs luxueuses villas de premières lignes du Cap Ferret ou du Pyla et non ceux de leurs cabanes. Face à de tels candidats aux réseaux surdimensionnés, Ivan n’avait aucune chance, lui le chercheur solitaire naturellement enclin à se faire un ennemi de tout homme de pouvoir. Toute sa vie professionnelle avait été émaillée d’altercations avec ses supérieurs hiérarchiques, ce qui lui avait d’ailleurs valu le surnom d’Ivan le terrible. Il avait un besoin irrépressible de ramener ses patrons à ce qu’il estimait, à tord ou à raison, être leurs véritables valeurs et avait fait sienne la devise de Cyrano : « ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul ». Pour toutes ces raisons, sa candidature permettait d’augurer autant de chances de succès que l’achat d’un billet de loto pour l’enrichissement d’un clochard ou d’un ex-voto pour le salut de l’âme d’un marin disparu. Sauf,...sauf s’il donnait un coup de pouce énergique au destin ; et quoi de plus énergique et efficace dans notre bas monde que le recours à la Camarde ? Après une petite heure de « tournicotage » cérébral, il trouva une solution simple ; bon sang, mais c’est bien sûr, comme aurait dit le commissaire à moustaches et à pipe de nos vieux écrans cathodiques, il lui fallait supprimer ses principaux concurrents; l’idée était toutefois un tantinet primaire et beaucoup plus facile à dire qu’à faire ; parmi les nombreux candidats à l’offre de location des cabanes, lesquels avaient le plus de chances de l’emporter ? Et un tel massacre serait-il moralement acceptable, même pour une noble cause? Bien sûr, quelques dizaines de destructeurs de la nature envoyés ad patres ne pouvait qu’être profitable à cette dernière ; mais cela aurait une efficacité epsilonesque pour un risque personnel monumental et il faudrait que l’inspecteur chargé de l’enquête soit plus stupide que l’inspecteur Clouzeau (que les jeunes lecteurs veuillent bien m’excuser pour cette nouvelle référence culturelle antédiluvienne) pour qu’il ne comprenne pas que le seul suspect potentiel de cette hécatombe était le seul candidat à la location encore en vie. Il rejeta donc cette stratégie grossière et chercha une autre solution. Bon sang mais c’est bien sûr, comme aurait dit dans un deuxième épisode le commissaire dont ne peuvent se souvenir que les plus vieux d’entre nous, ce ne sont pas les candidats qu’il faut supprimer c’est leur envie de candidater ; il fallait pour cela associer à l’île aux Oiseaux une réputation semblable à celle des îles d’Alcatraz ou du Diable ; la solution lui parut soudain évidente ; jamais dans sa carrière de chercheur une idée aussi géniale ne lui était venue à l’esprit (j’entends de mauvais esprits susurrer que cela était dû à ce qu’il n’en avait jamais eu la moindre; qu’ils ne comptent pas sur moi pour diffuser une aussi méchante assertion) ; supprimer à l’aube un seul chasseur de canard dans une tonne de l’île aux Oiseaux, voire deux pour plus d’efficacité, ne pinaillons pas, permettrait d’atteindre un tel résultat. Et la chose était cette fois tout à fait réalisable : comment différencier un coup de fusil contre un canard d’un coup de fusil contre un chasseur de canard ? Seuls le gibier et la taille des plombs différaient. Un tel évènement devait logiquement conduire au désistement de la majorité des candidats aux cabanes ; quel chasseur aurait encore envie de risquer sa vie pour supprimer celles de pauvres volatiles, alors qu’il pouvait en trouver sans le moindre risque, tout plumés et vidés dans le premier supermarché venu ? Ivan rechercha donc au fond de son grenier le vieux tromblon à chiens de son arrière- grand-père et acheta dix cartouches à chevrotines ; l’arme, qui n’avait pas servi depuis plus d’un siècle, fut testée sur les volets de son nouveau et bruyant voisin ; le test fut concluant : les volets furent joliment décorés et artificiellement vieillis façon brocanteur sans que la pétoire n’explose. Il avait ensuite le choix entre trois moyens de déplacement pour atteindre l’île aux Oiseaux : un petit hors-bord en bois Matonat des années soixante (qu’il nommait « le Riva du pauvre »), l’un des deux kayaks blancs achetés au club d’Andernos ou bien sa vieille planche à voile Dufour des années soixante-dix ; les deux premiers esquifs, quoique plus confortables et pratiques, étaient trop facilement repérables. Il décida donc d’atteindre l’île allongé sur sa planche à voile. Un beau matin d’automne, vers quatre heures, après s’être noirci le visage et avoir enfilé sa combinaison isotherme, il glissa le vieux fusil et les cartouches de chevrotine dans un sac étanche, posa une paire de « mastouns », quelques zostères de camouflage et un canard en plastique sur la planche, puis rama discrètement vers l’île aux Oiseaux pour son opération spéciale. Une griserie imprévue l’envahit alors, à laquelle sa vie de petit fonctionnaire ne l’avait pas accoutumé. Nous n’entrerons pas dans la description détaillée de la dite opération de peur de traumatiser les enfants par des descriptions de scènes « tarantinesques » ; il pourrait en découler quelques mauvais procès pour l’auteur de ces lignes et ce n’est pas le but recherché. Qu’il me suffise donc de vous dire que ce fut un succès total pour Ivan, puisque, tel un pilote de chasse de retour de mission, ce ne fut pas une mais deux croix qu’il put inscrire sur sa planche ; coup double ! deux cartouches de chevrotines et, à défaut de canards, deux canardeurs canés. Il revint ensuite le plus rapidement et discrètement possible vers la plage d’Arcachon qu’il atteignit au moment où le soleil dardait ses premiers rayons matinaux, mais aussi, malheureusement, alors qu’un insomniaque intempestif observait la plage depuis son balcon ; l’arrivée d’un homme allongé sur sa planche façon nageur de combat attira un peu l’attention de ce dernier, mais sans plus; et tel un zombie, il retourna vers son lit pour tenter de grappiller encore quelques miettes de sommeil. Ce ne fut que le surlendemain, lorsqu’il apprit qu’un double meurtre avait été perpétré sur l’île aux Oiseaux, que dans un effort de réflexion méritoire, il fit le rapprochement entre les deux évènements ; il s’en alla en fin de matinée confier ses observations à l’inspecteur Couzau que la quasi homonymie patronymique avec l’inspecteur Clouseau avait transformé en tête de Turc de tous les commissariats du département; ses collègues l’avait surnommé la Panthère rose car tout chez lui le rapprochait de l’inspecteur si bien campé par Peter Sellers. L’inspecteur Couzau, donc, après avoir cherché sans succès l’inspiration dans une pantagruélique blanquette de veau arrosée d’un demi-litre d’une infâme mais revigorante piquette, plongea dans sa rituelle sieste quotidienne à la recherche d’une explication rationnelle du crime. Tout à coup, alors qu’il émergeait à peine de son sommeil réparateur, une idée s’imposa à lui avec la fulgurance de l’éclair. Bon sang mais c’est bien sûr, dit-il en se réveillant, inspiré par l’inspecteur à l’origine de sa vocation et déjà mentionné à deux reprises (il faut absolument que je signale à l’écrivaillon de cette admirable nouvelle que le comique de répétition a ses limites ; trois occurrences de la même « blagounette », n’est-ce pas un peu trop ?), il doit y avoir un rapport entre les meurtres de l’île aux Oiseaux et le planchiste repéré par mon témoin de première ligne. Vous vous souvenez certainement, sauf assoupissement très improbable devant une œuvre aussi palpitante, que cette idée lui avait en réalité été suggérée par le dit témoin et que donc, l’inspecteur Couzau ne pouvait en rien en revendiquer la paternité ; mais le vol d’idées entre scientifiques de haut niveau est monnaie courante; et l’inspecteur Couzau ne faisait-il pas partie de ce milieu par la remarquable rigueur technique de sa pratique policière ? Jugez-en plutôt : appliquant alors sa méthode d’investigation favorite dite du « ratissage massif », il fit arrêter tous les véliplanchistes, surfeurs et body bordeurs de la totalité du Bassin d’Arcachon pour les confronter à son témoin insomniaque à fin d’identification. L’inspecteur Couzau était connu pour son recours systématique à des moyens extrêmes; cela faisait d’ailleurs le désespoir de ses supérieurs qui trouvaient à juste titre son rapport coût/résultat catastrophique. Pour l’inspecteur il fallait « ratisser large pour ne pas rater le coupable ». C’était sa technique préférée et il en justifiait l’usage par des proverbes personnels tels que, « plus nombreuses les tentatives, plus grandes les chances de réussite » ; règle d’inspiration shadockienne basée sur une connaissance approfondie de la science probabiliste. Le résultat ne se fit pas attendre ; son témoin, après quelques échanges avec l’inspecteur, comprit qu’avec un tel homme il y avait danger pour sa propre personne ; ne voulant pas être mis en prison comme suspect de secours, il identifia sans la moindre hésitation le planchiste criminel en la personne du plus chétif et malingre d’entre eux ; c’était de la part du témoin faire le choix du moindre risque pour le cas improbable où le « coupable » sortirait prématurément de prison pour bonne conduite ; on n’est jamais trop prudent. Le pauvre suspect, lui, eut droit à un procès expéditif prestement mené par un juge désirant surtout réduire rapidement son énorme pile de dossiers en attente de jugements ; il y gagna un séjour gratuit et à perpette dans une cabane bétonnée, entouré de petits camarades avec ou sans casquettes mais tous plus sympathiques les uns que les autres. Il avait même accès à une salle de musculation qu’il fréquenta assidument, conscient qu’il était du dangereux contraste entre sa conformation physique et celle de ses colocataires de cabane. Il avait obtenu tout ces avantages sans avoir fait la moindre démarche administrative; de quoi pouvait-il se plaindre ? Ivan, quant à lui, du fait que les candidats à la location s’étaient majoritairement désistés, et qu’une partie même des locataires dont le bail de location n’était pas terminé préféraient y renoncer, obtint sans difficulté une cabane. Il avait cherché la solitude et l’avait obtenue au-delà de ses attentes ; à tel point que pour atténuer celle-ci et aussi, il faut bien l’avouer, sa mauvaise conscience vis-à-vis du « coupable » de substitution emprisonné, il établit avec ce dernier un échange épistolaire abondant ayant trait à deux sujets scientifiques essentiels : l’écologie comparée des faunes insulaires et carcérales, et l’application des théories Darwiniennes à la survie dans les marigots naturels ou anthropiques. Ils devinrent ainsi les meilleurs amis du monde. Ce qui prouve que, contrairement à une légende soigneusement entretenue par les juges et les policiers (qui ne cherchent jamais, ce faisant, qu’à justifier leurs fonctions) une histoire criminelle peut, si chacun veut bien y mettre du sien, se terminer avec bonheur. Et en guise de morale profitable à l’édification de nos charmantes têtes blondes, nous conclurons que, pour peu qu’il soit perpétré avec de louables intentions, un crime parfait peut très bien être profitable à tous, ... ou presque.
Yves CROUAU
Cabanes
Je menais une vie paisible au cœur des montagnes jusqu’à cette terrible tempête qui défraya la chronique. Cette nuit-là, alors que j’étais solidement accroché à mon rocher, la pluie et le vent semblèrent s’acharner sur moi. En un instant, je fus balayé et transporté contre mon gré vers des lieux inconnus. A quoi bon lutter ? La nature était déchaînée et c’est avec une certaine résignation que j’acceptai mon sort. C’est ainsi, qu’un petit matin, dans un calme presque assourdissant, je me retrouvai sur une plage du bassin d’Arcachon. Le paysage devant moi s’étendait à perte de vue . C’était un mélange d’herbes vertes, ressemblant à une pairie, et de vase marron ; on aurait dit de la boue molle et visqueuse ou bien de la crème au chocolat, selon son humeur et ses envies ! Enfin, on était bien loin de l’idée de mer bleue calme et tranquille que j’avais imaginée. D’ailleurs, la mer, où était -t-elle passée ? C’était marée basse, la mer, elle s’était retirée loin, très loin, on ne la voyait plus. Sur la gauche, quelques parcs ostréicoles étaient à découvert. Ceux-ci avaient la réputation d’offrir un environnement propice et sécurisé au bon développement des huîtres. J’avais beaucoup entendu parlé de ces étranges créatures. Leur coquille de couleur brun verdâtre, d’apparence rugueuse, grossièrement feuilletée à l'extérieur et nacrée à l'intérieur pouvait parfois dissimuler une perle ; ne pas se fier aux apparences, celles-ci peuvent parfois cacher des trésors ! On m’avait rapporté que ces êtres vivants avaient une forte personnalité ; certain parlaient de parfums délicats et rafraîchissants de légumes et d'agrumes pour celles du Cap Ferret, puis d’arômes végétaux et minéraux pour celles de l’île aux Oiseaux. C’était de vrais connaisseurs aux sens du goût et de l’odorat particulièrement développés. D’autres se contentaient de les déguster, parfois même de les gober, accompagnées d’un bon petit verre de vin blanc ! A droite, on pouvait apercevoir le phare, longue tour tronconique blanche dont la partie haute était peinte en rouge. Toutes les cinq secondes, un éclat rouge dont la portée lumineuse s’étendait à presque cinquante kilomètres guidait les marins ; véritable repère pour les âmes perdues. Bravant toutes les tempêtes et les intempéries il était toujours là, au milieu des pins et des nuages. Un peu plus loin, une jetée, construite sur pilotis, s’avançait, offrant au promeneur un point de vue magnifique. C‘était aussi la promesse d’embarquer en vedette ou en pinasse vers d’autres horizons et de s’approcher des cabanes tchanquées, véritables petites merveilles architecturales, posant fièrement, comme les gardiennes d’une longue histoire et d’un riche patrimoine. Une légère brise me caressait, les rayons du soleil me réchauffaient, le rire des mouettes et le claquement des cordages aux mâts des bateaux me berçaient ; j’étais bien et je me remettais, peu à peu, de mes émotions, savourant l’instant présent . Je m’étais assoupi quand je fus réveillé par un joyeux tintamarre. La marée avait monté et l’eau n’était pas loin de me recouvrir. La plage s’était tout d’un coup remplie de monde. Des parasols, des ballons, des seaux, des pelles et des râteaux... Le sol était jonché de toutes sortes d’objets multicolores. Tout à coup, un étrange personnage se pencha vers moi. Il n’était pas très grand, mais il avait cependant de longues jambes fines. Il était vêtu d’un short de bain rayé bleu marine et blanc sur lequel semblaient flotter quelques bateaux jaunes et violets et d’un tee-shirt blanc. Sa tête était recouverte d’un bob de couleur rouge éclatant d’où dépassaient quelques mèches blondes rebelles. Des lunettes de soleil à grosse monture verte couvraient ses yeux. Son corps tout entier était recouvert d’une étrange pellicule blanchâtre qui paraissait collante. Il semblait à la fois surpris et émerveillé par ce qu’il venait de découvrir ; à côté de moi, une magnifique étoile de mer à la silhouette rayonnante était échouée. Elle possédait cinq bras épais, arrondis et effilés à l’extrémité ; elle était de couleur brun jaunâtre, avec des reflets oranges et mauves, sa face inférieure était plus claire que sa face supérieure parsemée d’épines calcaires. L’individu se pencha et d’un geste habile et sûr s’empara de sa découverte ; c’est alors qu’au même moment, je sentis une force me soulever dans les airs et en l’espace de quelques minutes, sans comprendre ce qui m’arrivait, je fus projeté au fond d’un coffre de voiture. Le noir total. Plus de couleurs, plus de sons, quelques odeurs encore ; des senteurs de crème solaire, de criste marine, et de coquillages. La voiture démarra et roula, je ne sais combien de temps, cela m’a semblé une éternité. Puis, elle s’arrêta net. Je n’aspirais qu’à une chose, que ce coffre s’ouvre, que je puisse à nouveau voir le bleu du ciel, sentir le vent me chatouiller, entendre le chant des oiseaux... Mais rien, il ne se passa rien. Les secondes, les minutes, les heures passèrent, peut-être même les jours, que sais-je, j’avais perdu toute notion du temps. Qu’allais-je devenir ? Je poussais alors une longue plainte déchirante. Mais qui allait l’entendre ? « Moi, moi, moi...», j’avais l’impression d’entendre des dizaines et des dizaines peut-être même des centaines voire des milliers de « moi ». N’étais-je donc pas seul dans cette galère ? Ce son était-il réel ou était-ce le fruit de mon imagination? Je n’osais plus bouger. La terreur s’était emparée de moi, j’étais son prisonnier. Je me demandais ce qui me faisait le plus peur, rester coincé dans cet habitacle ou sentir la présence d’autres créatures. Mon imagination alors s’enflamma et je me mis à me représenter des êtres dignes de mes pires cauchemars quand j’entendis une petite voix : - Je suis comme toi, prisonnier de cette automobile depuis longtemps, trop longtemps. Certains arrivent à s’échapper, d’autres non. Ils sont ensuite embarqués dans des villes plus ou moins grandes, bien loin de la mer et des plages et de ce décor de carte postale. Ils sont alors maltraités, balayés et guère aimés. Ils tentent parfois de trouver refuge dans une maison mais ils sont souvent mis dehors, accusés même, parfois, de contrarier une situation ou d’en déranger le bon fonctionnement. - Mais c’est atroce. Depuis toujours je rêve du Bassin d’Arcachon et me voilà à peine arrivé que déjà je devrais le quitter. Je ne peux me résoudre à un tel destin. Il faut que je m’échappe. Ne pas perdre espoir, ce coffre va bien finir par s’ouvrir, il faudra alors faire preuve de ruse. Mon imagination se remit au travail et j’élaborais des plans tous plus alambiqués les uns que les autres pour sortir de là. Mais l’espoir s’érode avec le temps. Alors il faut s’accrocher, se fixer un but et ne pas en démordre. En peu de temps j’avais déjà pu admirer tant de choses : la mer à marée basse, la mer à marée haute, les cabanes tchanquées, la jetée, les parcs ostréicoles, le phare...Tout un monde fascinant pour moi qui venait des montagnes. Il y avait encore une chose que je n’avais pas vu, c’était la dune. « Magique, lieu incroyable, vue imprenable , superbe panorama... » les qualificatifs ne manquaient pas pour décrire un tel lieu. C’est quand même la plus haute dune d’Europe, sans égale ailleurs dans le monde, ça doit valoir le détour ! Alors cette idée de voir la dune est devenue de plus en plus envahissante, voire obsessionnelle. Je tentais de me projeter, c’était la seule façon pour moi de tenir le coup. Puis, un jour, enfin, le coffre s’ouvrit. L’individu qui avait ouvert la malle paraissait de mauvaise humeur. Il râlait en faisant de grands gestes, le ton de sa voix était autoritaire et le petit personnage au maillot de bain rayé bleu marine et blanc, qui se tenait à ses côtés, semblait tout penaud. J’aperçus même une larme rouler le long de sa joue et je fus, quelques instants, attendri par ce moment rempli d’émotion. Mais c’était le moment ou jamais ; il fallait s’en saisir, ne pas le laisser passer. La situation était confuse, il fallait en profiter, mais comment faire ? C’est alors qu’une gigantesque bouffée d’air m’envahit et je pus m’échapper. Je me retrouvai alors au pied de ce qui ressemblait à une immense montagne. J’aurai voulu grimper là-haut, tout là-haut, c’était mon rêve. Tout à coup, l’étrange personnage au costume de bain rayé réapparut. Je ne pus m’empêcher de ressentir une vive inquiétude. Il avait retrouvé son allant. Son visage était à nouveau rayonnant, il paraissait prêt à l’assaut de cette grande colline. Il s’assit pour enlever ses chaussures. M’agripper à lui était peut-être ma seule chance de monter là-haut. Mais que faire, y aller et prendre le risque d’être à nouveau prisonnier ou rester là, en bas, avec ce désir brûlant et inassouvi ? Ni une ni deux, je m’accrochai discrètement à son sac à dos. Après quelques efforts, me voilà enfin au sommet. Là un panorama époustouflant s’offrit à moi. D’un côté, une forêt à perte de vue, d’un vert profond, à l’odeur de pins enivrante, dégageant une énergie folle ; de l’autre, l’océan, chargé d’iode, grandiose et majestueux ; face à moi, le banc d’Arguin dévoilant ses courbes somptueuses sur lequel au milieu d’immortelles des sables embaumantes, quelques mouettes venaient se reposer. Un véritable écrin pour cette grande dame blanche, trait d’union mouvant entre terre et mer. Je me suis senti tout petit face à une telle géante ; je me suis senti aussi très fier de lui appartenir quelques instants. Après ce moment d’extase, je redescendis dans une course effrénée, culbutant au milieux d’éclats de rire joyeux. C’est ainsi que certains descendent la dune du Pilat. Que d’émotions ! Je tombai du sac et me posai enfin, désireux de souffler un peu. Petit à petit le calme semblait revenir. Le doux clapotis de l’eau, répété et prolongé, apportait un certain apaisement. Les deniers rayons de soleil se réfléchissaient avec splendeur sur le bassin. Puis, semblable à une grosse orange, le soleil s’enfonçait peu à peu dans l’eau. C’était un spectacle à couper le souffle. Bientôt la nuit et les étoiles apparaîtraient. Pourtant ce calme ne fût qu’éphémère. De gros cumulonimbus firent leur apparition dans le ciel puis, un arcus, impressionnant de par sa taille, passa. Des rafales de vent convectives puissantes se mirent à déferler, des éclairs gigantesques zébrèrent le ciel, on aurait dit qu’ils allaient le déchirer, des grondements de plus en plus rapprochés se firent entendre. La pluie commença à tomber, tel un déluge, puis ce fut un véritable bombardement de grêlons. C’était l’affolement général. Les gens criaient, couraient, et d’un coup il n’y eut plus personne, le silence à nouveau. Et moi, je restai là, sous la pluie. Mais, j’étais libre, dans un lieu splendide ; après ce que j’avais vécu, il n’était pas question de se lamenter sur mon sort. A ce moment là je me suis mis à fredonner quelques notes de "Singin’ in the Rain" car chanter sous la pluie, c’est braver les obstacles et sourire aux fâcheux ; ne nous en privons pas alors ! Puis, le vent commença à s’essouffler et j’aperçus bientôt une trouée de ciel bleu dans un magnifique cumulonimbus, l’orage était fini. Les jours passèrent, apportant chacun leur lot de surprises. Il y eut des journées agitées, d’autres plus calmes. Il y eut des rires, il y eut des larmes. Puis, un beau matin, je vis réapparaître le petit personnage étrange au maillot de bain rayé bleu marine et blanc. Il était accompagné d’une ribambelle d’individus armés de pelles, de seaux et de râteaux. Bientôt, d’autres groupes firent leur apparition. Et puis, on entendit une voix forte crier : « Vous avez deux heures devant vous ; que le meilleur gagne » ! Ils avaient tous l’air très sérieux et paraissaient investis d’une mission de la plus haute importance. Une véritable organisation se mit en place. Certains étaient délégués à la confection de pâtés, d’autres avaient pour mission de remplir des seaux d’eaux, d’autres encore étaient chargés de ramasser coquillages , galets, bois flotté, plumes, algues... Tout objet en tout genre susceptible d’embellir l’œuvre qu’ils étaient prêts à créer ; ils étaient tout affairés et soucieux de mener à bien leur mission. On sentait la tension monter au fur et à mesure que le temps s’écoulait. Au début, j’étais simple spectateur et je me délectais devant tant d’enthousiasme et de frénésie. Puis, malgré moi, je fus embarqué dans cette belle aventure. Mais attention, construire une telle œuvre ne s’improvise pas. Face à l’adversité des pâtés dont la moitié reste collée au fond du seau l’avancée des travaux s’annonce parfois compliquée. Mais une fois la formule magique trouvée avec la bonne quantité d’eau selon une règle scientifique bien établie, l’édifice prit corps. Douves, remparts et autres tours émergèrent du sol. Après environ deux heures de travail acharné au milieu des cris, parfois des disputes, mais aussi des rires et des éclats de joie enfin un superbe château de sable vit le jour et j’en faisais partie. Oui, je suis juste un petit grain de sable parmi des milliards et des milliards d’autre grains de sable. Ce jour-là fut magique pour moi car la plus merveilleuse chose que je vis fut le sourire et la joie dans les yeux du petit personnage au costume de bain rayé bleu marine et blanc. Nul besoin de bâtir des châteaux en Espagne pour être heureux ! Aussi, la prochaine fois que vous vous baladerez sur une plage ou, qui sait, la prochaine fois, que vous construirez un château de sable, vous penserez peut-être à moi ; mais ayez aussi une petite pensée pour l’histoire, pas seulement l’histoire imaginaire des châteaux et des contes de fées, mais également l’histoire réelle du sable. En effet, n’oubliez pas que chaque grain de sable est un fragment de roche qui encapsule une longue histoire de montagnes disparues, de rivières anciennes, de marécages et de mers envahies de dinosaures, de climats et d’évènements du passé : autant d’éléments qui racontent l’histoire de notre planète !
Claire PIERROT
Un château au PYLA
Huit pieds qui randonnent en rythme génèrent un bruit indescriptible. Décrire un bruit ou une musique demande un vocabulaire technique ou poétique. Il n’existe pas de mot qui délimite un son comme une couleur par exemple. Comment rendre palpable le son que produisent des chaussures de randonnées foulant un sol sableux, légèrement dense, parsemé d’épines, accompagnés de souffles sportifs et des bourrasques des vents d’ouest ? Le visage de Blandine se fend d’un sourire. Si elle livrait le contenu de ses pensées à ses trois amis silencieux, ils rigoleraient et partiraient dans une analyse surjouée de critiques musicaux renommés. En ce début du mois de juin 1987, les propriétaires de ces huit pieds profitent d’eux même. « Vous sentez ? » Les têtes, flanquées d’un regard interrogatif, se lèvent vers elles d’un même mouvement. « Vous sentez les embruns ? On se rapproche de la plage doucement, de la frange dunaire plus exactement... » Les narines lyonnaises, peu coutumières de ces molécules iodées, tressaillent à l’unisson et valident. Ces dernières ont laissé la capitale des Gaules pour profiter de ce grand week- end de Pentecôte chez leur amie. La météo clémente a permis cette randonnée en forêt. Pas n’importe quelle randonnée et pas n’importe quelle forêt. Ce GR8 traverse la forêt domaniale de Lège et Garonne, dans le Bassin d’Arcachon. Dépaysement olfactif, visuel, tactile et gastronomique aussi, mais ce dernier est prévu pour plus tard dans la journée. «Dans mille ans, cette forêt n’existera peut-être même plus. Il n’en restera que des cartes IGN, des photos ou des croquis...». Le débat est lancé. Érosion, loi littoral, parc naturel, Dune du Pyla, tout est pesé, mesuré, analysé selon les points de vue économique, urbanistique, historique, touristique ou, éventuellement, écologique. Le panorama suit les arguments des uns et des autres. Certains pins penchent plutôt pour Thierry, d’autres plutôt pour Caroline. Cette dernière est assez sensible à l’enjeu du patrimoine naturel mais aujourd’hui, elle est occupée à lutter contre les bourrasques qui s’accentuent avec la chaleur. Ses longues boucles brunes ne font pas le poids face aux vents du Ponant. « On va faire une pause, il faut vraiment que je m’attache les cheveux ! » La troupe acquiesce et guette une zone pour poser les sacs et s’asseoir. Une fois installés, les gourdes passent de main en main tandis que Caroline cherche des élastiques et Blandine, son Polaroid. « Vous n’allez pas y couper, les loulous ! dit-elle en brandissant son appareil photo. - Montre moi ça ! Tu t’es acheté un nouveau Pola ? - Oui, j’ai pas résisté. Tu peux avoir des cartouches noir et blanc ou couleur. J’adore ! - Il est top ! » Auguste manipule l’objet avec respect. « Je peux ? - Bah oui !! Attends, on va trouver un endroit qui va bien, viens ! » Comme deux girouettes cherchant le nord, les têtes tentent de s’orienter vers le mélange parfait entre lumière, perspective et relief. C’est Blandine qui tend le doigt la première. « Là ! - Parfait ! On va faire des clichés de star. Vous nous rejoignez dans deux minutes ? » Le chœur mixte éructe un oui-pas-de-problème en souriant. Le site est à quelques mètres, parfait, comme organisé pour faire des photos, en quelque sorte. Auguste tente son premier cliché en guidant son amie pour obtenir un résultat satisfaisant. Il enclenche, entend ces bruits, sort le papier et tend le résultat à sa modèle pour qu’elle le mette à l’abri de la lumière. Blandine prend le relais. Même rituel. Le cadre est effectivement agréable avec ses trois pins en premier plan et un autre plus gros en arrière plan. La lumière glisse sur les troncs au premier plan, reste discrète sur le fond pour créer un contraste naturel très photogénique. Lorsque le groupe est au complet, Blandine saisit l’instant, cliiiic, tchaaaach. Encore une avant une petite dernière et pourquoi pas, une autre dernière pour être bien sûre. Les visages commencent à faire des grimaces et les corps à prendre des pauses aussi obliques que les arbres. Une fois la pellicule vide, les bouclettes maîtrisées, les compagnons repartent à moitié hilares. Les silhouettes s’éloignent, laissant sur place un silence épais et quelques traces sur le sol, que le vent se chargera d’effacer. Indifférente, la lumière continue de jouer sur les écorces, les branches et les petits monticules de sable. Deux piles de Polas étalés sur le lit. Rectangles noir et blanc ou couleur. Blandine passe la main dessus pour les regarder à nouveau, témoins de ces moments agréables, instantanés capturés pour toujours. Elle sélectionne les quelques photos qui vont rester sur son mur. Elle commence par les portraits noir et blanc, en garde la moitié et ouvre une boîte métal pour ranger les autres. Même traitement pour les photos de la randonnée. Assise sur le lit, elle regarde les visages qui deviennent grimaçants au fur et à mesure des clichés. La lumière est parfaite, même les tests respirent la bonne humeur ensoleillée. Tous iront donc sur le mur. Patafix dans la main droite, Pola dans la main gauche, elle s’attelle à l’affichage avec concentration. Son mur est déjà bien rempli et l’harmonie de l’ensemble lui tient à cœur. D’abord les couleurs. Une par une. Ici et là. Ici ou là ? Rythmer les trois pins. Jouer avec cette lumière. Ces points lumineux aussi. Tiens, les points ont disparu. Un autre Pola, rien. Et les revoilà. Oubliant son objectif artistique, Blandine pose sur les murs tous les Pola couleurs. Ces trois points se retrouvent sur deux clichés, en formant un triangle, à un emplacement strictement identique. Sur le premier, elle pose et la forme géométrique lumineuse apparaît sur le gros arbre en fond. Sur le test où Auguste pose, strictement rien. Idem pour les photos de groupe qu’elle a prises sauf... sauf celle où elle grimace. Thierry avait été le photographe. Elle recule et sa tête ressemble à celle d’une spectatrice d’un match de tennis, passant de droite à gauche, et inversement, d’une marque à l’autre, strictement identique. Impossible donc que cela soit un jeu du soleil à travers les branchages, le vent était trop fort ce jour là. Les minutes se disloquent, ne lui apportent aucune aide, aucune réponse. Une main gantée de glace étreint sa nuque. En posant ses cartons dans cette ville, il y a quelques années, elle n’avait prêté qu’une oreille distraite aux légendes courant sur cette forêt. Elles lui reviennent en tête, quelques bribes tout du moins. Une seule idée arrive à se frayer un chemin au milieu des questions. Retourner là bas, à la même heure, très rapidement. Essoufflée par cette marche rapide, la randonneuse pose son sac à dos à côté des pins ayant servis de cadre. Elle n’a pas eu de mal à les retrouver. Non seulement, elle connaît bien ce GR mais leur forme reste assez esthétique. Ce n’est pas « les trois grâces » qu’elle est venu observer. Quelques mètres à côté se trouve ce gros pin, sombre, même en plein jour. Elle se rapproche doucement de l’écorce, s’attendant à trouver des pointes de résines expliquant facilement ces points lumineux. Même si cela n’expliquera pas leur disparation et leur réapparition. Historiquement, la résine et ses dérivés ont été utilisés comme comme goudron pour calfeutrer les bateaux. Ce serait normal de se retrouver nez à nez avec ce produit typique. A première vue, rien de particulier. Ce tronc arbore ses écailles épaisses et caligineuses. Les dessins que ces dernières forment pourraient être suivi comme des sentiers sur une carte. Blandine ressort les deux Polas pour mieux situer les trois points lumineux. Elle estime leur hauteur à plus de deux mètres au dessus du sol. En reculant, elle lève la tête. Rien. Elle fait un pas à gauche. Rien. Deux pas à droite. Toujours le néant. Déconfite, elle baisse la tête et reste immobile, ne sachant plus vraiment quoi faire, ni pourquoi elle a voulu à tout prix revenir ici. « Je me demande bien ce que je m’attendais à trouver ! N’im-por-te-quoi ! ». Elle soupire et relève la tête un peu trop vite, se sent prise d’un léger vertige, empiré par une lumière aveuglante, sortie de nulle part, ou, si, certainement de la frange forestière. Forcément la frange. Elle se protège les yeux et de ses mains et vacille légèrement. Le flash a disparu comme il est apparu et la randonneuse, ébaubie, reste figée le temps de reprendre ses esprits. La température a baissé d’un coup et il est vraiment temps de rentrer. Sac à dos en place, poumons remplis, esprit encore brouillon, fourmis dans les jambes...La check-list mentale n’est pas très encourageante. Pourtant un pas après l’autre, Blandine réactive sa biologie. Le rythme cardiaque se stabilise, la pression artérielle augment de manière réconfortante, le système nerveux, passablement émoussé, fini sa réinitialisation, globules rouges en ordre de marche, système auditif passe en alerte. Des voix, des cris ou un gémissement. Impossible à identifier pour le moment mais une chose est certaine, c’est humain. Tympans, enclumes, marteaux et étriers font le tri entre les différents sons pour situer au mieux les objets vocaux non identifiés. Le quartet envoie directement les infos au cerveau pour diriger le corps tout entier vers la frange forestière. Quitter la futaie. Se rapprocher des bruits humains et océaniques du coup. Différencier les deux et avancer automatiquement. Analyser le moindre décibel allant croissant. Identifier la nature du son. C’est tour à tour une toux rauque, un cri, un gémissement. L’alerte est donc générale. Blandine accélère et traverse la dune grise puis la blanche en tournant la tête dans tous les sens. Nerfs auditifs et oculaires sont désormais surmenés.Ces derniers identifient enfin la source et poussent toute la masse musculaire vers ce point. Trois hommes sont allongés, détrempés, sur la plage. Blandine arrive sur eux, essayant de comprendre ce qu’il se passe. Les morceaux de bois fracassés et les silhouettes dans des tenues originales activent son adrénaline. Cela ne peut être qu’un naufrage, étant donné la dangerosité de la houle, des courants du Bassin et de la passe nord précisément. Les vagues poussent encore des débris. Jetant son sac, elle court vers l’homme qui est le plus proche d’elle pour lui porter secours, si elle le peut. Il est vivant, a peu près, et essaie d’évacuer l’eau de ses poumons fragilisés. Un autre homme, vêtu d’une chemise terne, épaisse et d’un pantalon d’un autre âge, est allongé à côté, faible mais vivant aussi. Le dernier est immobile. Sans chercher à comprendre le pourquoi de ses tenues particulières, elle commence à parler au premier homme qui lui répond laborieusement dans une langue qu’elle ne connaît pas. Marins étrangers ? Patois local ? Ce n’est pas le moment de se lancer dans une réflexion linguistique. Il faut les aider à respirer, leur donner de l’eau et à manger si possible, évaluer les blessures pour faire un premier rapport aux pompiers, les réchauffer, attendre les secours, rester avec eux... et c’est ce qu’elle fait pour les deux survivants, le troisième n’a plus besoin de secours. Aucune possibilité de joindre qui que ce soit à moins de les laisser sur place. La barrière de la langue est donc un frein. Le seul mot qu’elle commence à reconnaître c’est « malur ». Le dialogue se noue avec des gestes, des sourires, des mouvements de tête. Elle recense une fracture tibia-péroné, un poignet luxé et de nombreuses ecchymoses. Sans compétences médicales, elle ne peut rien faire que leur apporter un certain soutien moral, les quelques gâteaux protéinés qu’elle a toujours dans son sac, qu’ils ont accueillis avec ce qu’elle a identifié comme de l’effroi. Les deux hommes parlent ensemble, elle écoute, attrape ce même mot encore et encore, ainsi que ce qui semble être des prénoms. Clarisse, Françou. Les silences sont de plus en plus pesants. Les heures passent et rien ne se passe. L’inquiétude et la fatigue gagne la randonneuse. Elle tente de s’occuper, de comprendre. En essayant de trouver des restes utilisables du bateau, elle se griffe la paume de la main. Elle trouve malgré tout un peu de nourriture dans un petit tonneau, presque intact. Viande séchée qui aide tous les estomacs présent sur cette plage pourtant magnifique. La brûlure de cette griffure est amplifiée par le sel marin et l’intensité nerveuse de l’après-midi. Le désinfectant de sa trousse de secours est le bienvenu. La sensation de malaise qui va avec beaucoup moins. Les yeux dans le vague, bercée par les vagues, Blandine commence à dodeliner de la tête. Impossible de garder les yeux ouverts plus longtemps. « Il faut vraiment que les secours arri... ». Black out. « Bonjour, je m’appelle Isaac, je suis infirmier. N’essayer pas de parler, vous avez été intubée et je vais vous enlever tout ça.Votre gorge va être un peu irritée mais cela va passer. » L’accent du sud-ouest très marqué de ce monsieur en blanc déclenche un carambolage d’images dans la tête encore étourdie. Les trois points, les cris, le naufrage et ces trois hommes, des heures interminables, la griffure et donc enfin, les secours. Malgré toute sa volonté, parler est impossible. Elle murmure, cherche à savoir où elle est, combien de temps elle est restée inconsciente et, surtout, où sont les deux rescapés. Si la physionomie de l’homme est restée impassible, cet éclair dans son regard ne lui a pas échappé. « Vous êtes au Centre Hospitalier d’Arcachon. Il 16h38 et vous avez été admise à 15h environ. Ce sont des randonneurs qui vous ont vu faire un malaise dans la forêt et qui ont pu prévenir rapidement les pompiers. Vous êtes restée inconsciente presque... Que se passe-t-il ? » Blandine, agitée, se racle la gorge encore et encore pour essayer de mieux parler. « Dans la forêt ?? - Oui, sur le GR8, un peu en retrait. - C’est impossible ! J’étais sur la plage tout l’après-midi. Où sont les hommes qui étaient avec moi ? - Je vais me renseigner. » Encore ce regard. Demi tour et départ. Seule, elle récupère de plus en plus de souvenirs mais n’arrive pas à analyser que cet infirmier a dit. Allongée sur un brancard, dans un box des urgences, semble-t-il, l’environnement médical s’impose à la patiente doucement. Bruits, voix, bips, lumière blanche, placards, minutes vides et poubelles pleines. Isaac revient de longues après, accompagné de «’jour, je suis le docteur Tosti ». Même discours, même mine indifférente, même regard interrogateur. « Votre dossier indique que vous étiez seule... Racontez moi ce dont vous vous souvenez ». Ainsi fut fait. « Vous ne pouvez pas les manquer, ils avaient des tenues du siècle dernier ou d’avant encore, j’sais pas moi. Il y a eu un naufrage. Vous devez être au courant ! ». Et enfin, elle pense à la preuve indiscutable. Ce qui clouera le bec de ces messieurs. « Je me suis blessée en cherchant de la nourriture dans les débris du bateau. Regardez !
Karke SERAFIN-ZABAL
Grise et Blanche
Nouvelles
Dans les années 1980, arrivé à l’âge adulte, Paul, natif du Bassin d’Arcachon décida de « monter à Paris » pour rejoindre l’élue de son cœur Alice. Il l’avait rencontrée pendant l’été dans la station balnéaire d’Andernos-les-Bains où elle passait ses vacances. Arrivée dans la capitale, il n’eut pas longtemps à chercher du travail car Alice, infirmière à l'hôpital de la Salpêtrière, réussit à lui obtenir un poste d'agent hospitalier. Après de nombreuses recherches, ils trouvèrent, Porte de Choisy, au cœur du quartier chinois proche de l'hôpital, un studio perché au 23ème étage depuis lequel ils avaient une vue magnifique sur Paris. De là, Paul avait l’impression de dominer la situation, et se sentait prêt à croquer sa nouvelle vie parisienne auprès de sa compagne ! Il était vraiment heureux du poste qu'il occupait dans ce lieu historique où il accédait fièrement en traversant la loge d'entrée. C'est là que se croisaient, pour pointer, tous les travailleurs qui entraient et sortaient. Face à cet endroit, s'élevait un grand corps de bâtiments en pierre de taille avec en son centre, la chapelle au dôme imposant qui en rompait l’austérité. Il passait à travers cet espace pour se rendre dans le service de médecine générale où il avait finalement été affecté. Il ne fallait pas laisser s'emballer son imagination, il était là pour travailler, s'adapter à un labeur assez physique : apporter les prises de sang au laboratoire, récupérer les résultats, aller chercher des médicaments à la pharmacie centrale, ramener de la banque du sang des culots, laver des gamelles en acier et aider le personnel soignant à coucher les malades. Il savait qu’il devait attendre sa titularisation pour faire évoluer sa carrière. Mais dans le service de médecine générale où il avait été nommé, dès qu’il le pouvait, il s’initiait aux soins qu’il aurait à faire plus tard s’il devenait infirmier. Un jour, peu de temps après avoir commencé à travailler dans ce service, il lui arriva une drôle d’aventure. Revenant des courses qu’il avait à accomplir dans ce vaste hôpital, il retourna à la salle commune pour apprendre quelques soins faciles mais l’équipe médicale était en pause. A peine était-il entré dans la salle, que les patientes presque toutes âgées, commencèrent à hurler : « Le bassin, le bassin ». La tête un peu tournée par un tel enthousiasme, il avait du mal à comprendre cette agitation. Mais oui, il avait presque oublié qu'il était natif du Bassin d’Arcachon ! Il n'avait jamais pensé qu'il avait habité un coin aussi célèbre et dans une bouffée de fierté redressa son bassin, oh... je veux dire son corps. « Le bassin, le bassin » continuaient à crier les grands-mères. Il étendit la main pensant les calmer « Le bassin, le bassin... » mais devant l’inefficacité de son geste, il prit conscience qu'il devait s'égarer. Il passa en revue tous les bassins qu'il connaissait mais un cri impératif le fit sortir de ses méditations : « Mais qu'est ce que vous attendez, je vais me faire pipi dessus ! » Il découvrit alors ce fameux bassin, objet incontournable de la vie hospitalière. Il fit ainsi son premier apprentissage. Plus tard, il apprit à distribuer les thermomètres et à noter la température des patients sur une petite pancarte qui était accrochée au pied du lit. De même, il apprit aussi à prendre la tension et le pouls et à les noter. Aujourd'hui, c'était jeudi et il semblait à Paul que cette semaine de travail était interminable. Dimanche soir, il rendrait son tablier ou plutôt sa blouse blanche salie par une longue semaine de labeur. Il imaginait ce lundi de repos et toutes les heures de ces journées de congé. Le matin, il prendrait avec Alice qui avait enfin les mêmes repos que lui, le train rapide qui le ramènerait vers sa province natale. Arrivé à la gare d'Austerlitz, il achèterait au kiosque le journal Sud Ouest et une revue nautique. Installé dans le premier wagon accroché&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span&amp;gt;à la locomotive, une BB 92 56, machine capable de soutenir les 140 km/h, d'avaler la campagne à cette vitesse et de le transporter d'un monde à l'autre. Il attendrait avec elle, l'heure exacte où le train prendrait son élan pour ce long voyage à travers la campagne et se voyait déjà prenant un café au wagon grill express qui se trouvait au milieu de la rame.Tout serait en ordre et à l'heure dite, le train démarrerait. Il se sentirait rassuré. Un petit goût d'aventure s'emparerait de lui quand il monterait les marches du wagon et qu’il suivrait avec Alice l'étroit couloir à l'odeur caractéristique du passage des nombreux voyageurs. Il chercherait alors pour eux un compartiment vide. Mais avant de savourer ce moment de liberté, il lui fallait d'abord installer Micheline, la sœur de Georgette dans son lit ! « Tu viendras me coucher » lui avait-elle dit de sa voix fluette. Encore une de plus à coucher avait-il pensé avec sa conscience professionnelle qui s'effritait de jour en jour. Mais la pause si attendue, agrémentée par bonheur de deux jours de repos supplémentaires, arriva enfin. Paul et Alice purent descendre pour retrouver le Bassin, berceau de leur amour naissant. Paul revivait quand il arrivait dans sa région. Tout lui paraissait plus beau et plus familier. Cette cité balnéaire avait une longue histoire qu’il raconta fièrement à Alice. Au temps de la préhistoire des hommes s’y étaient déjà installés, vivant de pêche, de chasse et de cueillette. Il y avait aussi des vestiges de la période gallo-romaine sur le site où avait été construite plus tard l’église St Éloi, un des relais du pèlerinage de St Jacques de Compostelle. Au 19 ème siècle, Andernos s’était développé comme station balnéaire avec une architecture caractéristique dont la maison Louis David était un des plus beaux symboles. Tous les deux appréciaient les maisons aux dimensions modestes entourées d’un coquet jardin qu’ils découvraient le long des rues intimes où ils aimaient se promener. On y sentait une douceur de vivre, un air de vacances où il faisait bon séjourner. Le soir, tout le monde convergeait vers la jetée la plus longue du Bassin où l’on pouvait observer le coucher du soleil sur les cabanes ostréicoles qui vous invitaient à déguster les fameuses huîtres. Au loin, dans la direction du soleil couchant, les pins façonnés par les tempêtes sur l’avancée du site naturel des Quinconces retenaient le regard. Certains soirs, le spectacle était saisissant. Particulièrement, le soir où Alice lui offrit son premier baiser émue par la beauté du lieu. En avançant au bout de la jetée on pouvait observer au loin l’Île aux Oiseaux et l’ensemble du Bassin. Au retour, on pouvait se restaurer en prenant une glace ou en s’asseyant dans un restaurant ou un café pour écouter un orchestre de jazz. Mais aujourd’hui, comme le temps était moins propice à la plage que l’été de leur rencontre, ils décidèrent de faire une balade en mer. Les parents de Paul avait un petit voilier doté d’une cabine qu’il pouvait emprunter facilement car il pratiquait la voile depuis son enfance. Ils lui recommandèrent d’être prudent car un bon vent soufflait. Il décida de ne gréer que la grande voile et ils partirent en direction de l’Île aux Oiseaux en tirant des bords, car il avait le vent debout, c’est à dire face à eux. Il fallait slalomer entre les piquets qui délimitaient un chenal étroit. Heureusement le dériveur était très maniable et stable grâce à sa voilure réduite et ils purent enchaîner de nombreux virements de bord en toute sécurité. Il fallait coordonner leurs mouvements pour que le voilier reste bien à plat, et reprenne vite son cap en réglant rapidement la grande voile pour ne pas perdre du terrain avant d’arriver vers des espaces plus larges. C’était un vrai plaisir de naviguer dans ses conditions. Il sentait dans la barre la puissance du bateau qui rebondissait de vague en vague. Il fallait bien le tenir pour qu’il ne gîte pas trop car ils auraient pu embarquer de l’eau. Paul était heureux de naviguer et de montrer à son amie son savoir faire nautique émaillé de termes techniques qu’elle avait du mal à retenir et à comprendre. Le bateau n’était pas sa passion mais elle était fière de son capitaine dont le visage rayonnait de bonheur. Tous deux respiraient à pleins poumons l’air pur du Bassin et des embruns venaient fouetter leur visage. Ils se serrèrent l’un contre l’autre pour trouver un peu de chaleur. Ils étaient heureux d’être ensemble et d’oublier si vite les contraintes de la vie quotidienne. L’hôpital était bien loin d’eux quand ils virent qu’ils approchaient des fameuses cabanes tchanquées situées au milieu du Bassin qui, à marée haute, ont les pieds dans l’eau. Malgré la beauté magique du lieu, Paul s’inquiéta quand il vit une grande barre de nuages violacés arriver de l’océan face au Cap Ferret. Il décida qu’il était grand temps de revenir vers Andernos malgré l’insistance de son amie qui aurait voulu profiter encore du panorama. C’est à ce moment qu’Alice remarqua une plate, bateau d’ostréiculteurs qui paraissait en difficulté car une femme agitait ses bras pour demander de l’aide. Elle demanda à Paul de s’approcher de l’embarcation mais le vent s’était levé brusquement rendant la manœuvre délicate. Malgré les efforts de Paul, ils se virent drossés par le vent et par un fort courant vers des piquets qui délimitaient le parc à huîtres non loin de l’autre bateau. Pendant que Paul amarrait le voilier à un des piquets en bois et en faisant de son mieux pour que la coque ne subisse pas trop les assauts du vent, Alice essayait de stabiliser le bateau. Elle réussit à communiquer avec l’ostréicultrice qui lui fit comprendre que son mari s’était blessé et saignait beaucoup. A la grande frayeur de Paul, elle sauta à l’eau ayant compris qu’il y avait une urgence. Il eut juste le temps de lui passer une longue corde qui lui permettait de relier les deux bateaux. Alice, bonne nageuse n’eut pas trop de mal à les rejoindre malgré des vagues qui commençaient à déferler. Elle fut saisie par le bras costaud de la femme qui l’aida à monter à bord. Elle leur dit qu’elle était infirmière et leur demanda de se calmer et de lui passer la trousse de secours pendant qu’elle se séchait avec une serviette. Elle examina la plaie au visage qui paraissait impressionnante car le sang ruisselait sur son œil, sa joue et les vêtements. Elle détecta rapidement que c’était l’arcade sourcilière qui avait éclaté. Elle demanda qu’on lui passe des compresses pour rapprocher les deux berges de la plaie et les compresses en même temps longuement pour que l’hémorragie s’arrête. Alice rassura son patient et surtout sa femme qui n’arrivait pas à brancher la VHS, radio des bateaux qui peuvent communiquer entre eux ou avec les secours. Elle lui dit d’attendre car si elle arrivait à arrêter le flux de sang, elle saurait le soigner toute seule. Mais elle s’inquiétait pour Paul et son bateau. Pendant ce temps, celui-ci essayait d’enlever la voile car le vent s'y engouffrait et poussait le bateau vers les piquets. Après bien des difficultés, il réussit à la baisser et l’embarcation devint plus stable. Avec l’aide de l’ostréicultrice qui tira la corde, ils arrivèrent à le dégager des piquets pour le placer derrière la plate. Il put alors sauter à l’eau pour les rejoindre. Il tremblait comme une feuille quand il monta sur le bateau et trouva Alice en train de soigner l’ostréiculteur comme si elle se trouvait dans son service. Les soins finis, ils se présentèrent. Jeannot et Yvette, ostréiculteurs à Andernos. Paul et Alice, des parisiens en vacances. Jeannot leur dit avec son franc-parler qu’il n’aurait jamais cru qu’il serait un jour sauvé par des habitants de la capitale mais les félicita. Il était grand temps de rentrer avant de se trouver à marée basse. Cela ne prit guère de temps car la plate possédait un moteur puissant qui les remorqua sans problème malgré le vent très fort. Arrivés au port ostréicole d’Andernos, ils furent reçus comme des héros par les autres ostréicultures car la VHS avait finalement annoncé les nouvelles des rescapés. Dans les cabanes, ce fut la fête. On arrosa l’événement au petit jaune sans oublier les huîtres. Les verres se succédèrent car on les remplissait vite pour éviter la marée basse ! A la suite de ce sauvetage, Alice et Paul devinrent vraiment enfants du pays d’autant plus qu’ils se marièrent quelques mois plus tard à l’église St Éloi en bordure du Bassin.
François VERGNOLLE
Les charmes du Bassin
LA DÉPÊCHE DU BASSIN MINIER N°1403 du jeudi 12 juillet au mercredi 18 juillet 3032 ___________________ Nord-Pas-de-Calais ___________ Elio, départ pour le rêve Originaire de Lens, Elio est un petit garçon de neuf ans comme les autres, à ceci près qu’il a dans la tête un endroit merveilleux et connu de lui seul. Il appelle son jardin secret le « Bassin d’Arcachon ». Ce lieu énigmatique semble sorti tout droit de son imagination. Et pourtant... 24 juin, 7 heures du matin. Elio, sa sœur Margot (treize ans) et leurs parents, Elsa et Marc Laborde, quittent la banlieue de Lens et prennent la route pour le Sud-Ouest. Direction l’hypothétique « Bassin d’Arcachon » qui hante Elio depuis toujours. Elsa au volant, le coffre plein de valises et de paquets, Polly le perroquet en cage sur le siège arrière, calé entre les deux enfants, le trajet promet d’être long au vu des quelques 844 kilomètres à parcourir. « Elio serait un enfant comme les autres si quelques particularités ne le rendaient particulièrement attachant, explique Elsa. Ce ne sont pas ses yeux vairons ni son amour immodéré pour les perroquets qui font de lui un être à part, c’est surtout ce pays imaginaire qu’il s’est construit... Ça ne le quitte jamais. Il nous a souvent emmenés dans son histoire et nous l’avons toujours écouté, c’est important. C’est nous qui l’emmenons aujourd’hui, là ou nous devons aller, tous ensemble. » Le garçon indique d’un doigt ferme un point précis sur la carte, « C’est là que nous allons » affirme-t-il sans hésiter. « On verra bien... » ajoute Marc, dubitatif. « Il existe une région où la mer entre dans la terre et repart avec la marée, raconte Elio. Tout autour il y a du sable et des pins. Les pins sont des arbres avec des aiguilles et les fruits s’appellent les pommes de pin. Il y a aussi une grande dune de sable de plus de cent mètres de haut. Elle est si grande que de là-haut on peut voir l’autre bout du bassin d’Arcachon : le Cap Ferret. » Toute une flore et une géographie fictives sont en place, la carte mentale est confondante de réalisme. Au fond du bassin se trouve « Arès et les prés salés », des champs tantôt recouverts d’eau, tantôt découverts quand la mer se retire... Une véritable poésie émane des descriptions du petit garçon. L’imagination règne en maître, et il en faut une bonne dose quand on sait la réalité de cette région sinistrée, outragée par l’urbanisation et la bétonisation sauvage. Les constructions massives ont largement dégradé l’image du Sud-ouest à tel point que s’y rendre autrement que par nécessité devient une véritable curiosité aux yeux des gens du Nord. « C’est pure folie que d’aller là-bas » confiera un voisin des Laborde au moment de leur départ. C’est pourtant le défi que relève aujourd’hui la petite famille sur les conseils limpides du docteur D., pédopsychiatre à Lille qui suit l’enfant depuis deux mois : « Il est essentiel pour Elio d’aller se confronter à son rêve. Le subconscient transcende des horizons de l’essence multidimensionnelle, dissolvant ainsi les échos éthérés des névroses existentielles, dans un paradigme quantique d’introspection métaphysique. Bref, ce voyage lui montrera que tout n’est que fantasme et inversement. » Les kilomètres défilent sous le ronronnement du moteur et le temps est long pour Margot, adolescente rebelle et incrédule. Après plusieurs heures, elle sort de son marasme et s’exprime enfin : « C’est n’importe quoi ce voyage, on roule des kilomètres pour rien. » Tout est dit. Maman rétorque : « Il est important d’écouter ton frère. Il exprime sûrement une souffrance, nous devons le rassurer, l’accompagner jusqu’au bout de son rêve. Ce voyage le fera grandir. » Ça tient la route&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span&amp;gt;Mais le pragmatisme de ses proches ne décourage pas Elio dont la source créative ne tarit pas. Son histoire tient la route malgré quelques incohérences, ainsi « la dune de sable » se nomme « Dune du Pilat » mais le village d’à côté s’écrit « Le Pyla »... Contrairement à Margot, nous ne lui en tiendront pas rigueur tant son histoire nous émeut. « En face de la dune il y a une église, c’est une sorte de villa rouge et blanche. Elle est construite comme dans le désert et elle regarde la dune du Pilat. C’est la villa algérienne. » L’exotisme s’y mêle, et c’est un enchantement de l’écouter parler. Tout y est, même les habitudes alimentaires des autochtones : « Ils mangent des « huîtres ». Nouvelle étrangeté que ces « huîtres » dont il parle avec délice et dégoût à la fois. « C’est un coquillage qu’on ouvre avec un couteau spécial et qu’on avale vivant tout cru ». Tout simplement... « Les cabanes de pêcheurs sont comme un petit village avec des rues en sable et les gens peuvent aller dans le bassin après le travail ou dans l’océan parce que tout est à côté. Il y a beaucoup de végétation, des palmiers, des fleurs et dans l’eau, des hippocampes.» Des hippocampes ? « Des animaux bizarres en forme de cheval qui nagent tout droit et ce sont les mâles qui portent les bébés ». Evidemment ! On resterait des heures à l’écouter. Midi, pause déjeuner sur une aire d’autoroute. On sort Polly pour l’aérer. A la vue d’un pain au chocolat, Polly lance un tonitruant « chocolatine ! » des plus déroutants. Le volatile semble lui aussi inventer son propre vocabulaire... Il faut dire que les deux complices sont connectés : plus qu’un « doudou », l’oiseau est un véritable confident pour Elio. Marc taquine son fils : « Au lieu de parler à ton perroquet, raconte-nous plutôt l’histoire de ces maisons sur pilotis si j’ai bien compris, qui trônent au milieu d’une île déserte... Les cabanes « planchées » c’est ça ? » Son interlocuteur lève les yeux au ciel et, s’adressant à Polly : « Il ne comprend rien, ça fait mille fois que je lui dis. Les cabanes Tchanquées ! Deux maisons sur des bâtons qui sont sur l’île aux Oiseaux. A marée haute, la mer passe en dessous des maisons. Je t’y amènerai demain mon Polly, promis. »&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span&amp;gt;Elsa et Marc ont beau chercher, rien ne peut expliquer ces descriptions souvent très détaillées. Peut-être avaient-ils croisé un jour des maisons sur pilotis pendant leurs vacances ? Ou bien a- t-il vu ces architectures dans un livre ? Sur le Net ? Quand bien même trouverait-on une origine rationnelle à ses visions, cela n’explique pas comment et pourquoi il a retenu tout ces détails au point d’en réaliser des dessins très précis. « Pour atteindre la réalisation de soi, Elio doit transcender les niveaux subconscients de l’être en éveillant les chakras supérieurs tout en intégrant un archétype psychique transpersonnel » précise le docteur D. 15 heures. C’est la bonne direction mais « toujours pas de panneau Arcachon », ironise Marc qui a désormais pris le volant. Elsa lui lance un gentil coup de coude tandis qu’Elio s’endort, bercé par le mouvement léger du véhicule. Du rêve à la désillusion 18 heures, l’autoroute a bien roulé, nous arrivons à destination, un lieu précis appelé « l’Herbe » et qualifié par Elio de « merveilleux ». Mais le réveil de l’enfant est brutal. Pas plus d’Herbe que de « pins ». Où sont « la Dune du Pilat » et les plages de sable blanc ? Il était question d’un point de vue panoramique où l’on devait observer des cabanes de pêcheurs au bord d’une eau paisible ponctuée de « pinasses » (les bateaux du coin) et, dans le lointain, la majestueuse Dune du Pilat. Le promontoire existe bel et bien mais sous un autre nom et il fait triste mine. Rien de miraculeux ne s’offre à la vue du petit rêveur. Polly, lui qui partage tout, reste dans la voiture. A quoi bon lui montrer le désenchantement? Tout n’est qu’immeubles à perte de vue, rouleaux de bitume charriant des files de véhicules ininterrompues. Ici, des centres commerciaux écrasants, étalés comme de larges verrues ; là des parkings inondés de fumées et des tours sans fin, symboles d’une architecture galopante et non maitrisée. Les remparts Barthorette, du nom de leur concepteur, s’érigent lourdement contre les assauts d’une mer déchaînée toujours encline à monter davantage chaque année en puissance. Le niveau des eaux a imposé des digues si hautes qu’au beau milieu de l’après- midi, l’ombre se répand déjà sur un monde de ténèbres en perpétuelle activité. Ces murailles censées protéger des eaux isolent définitivement l’humanité d’une nature jadis si belle. Elio se souvient-il de ces temps antédiluviens où de probables civilisations prospéraient dans l’harmonie et la lumière ? Arcachon a perdu sa consistance et se dilue irrémédiablement sous les yeux en larmes d’Elio. Il ne dit plus rien, seul son regard parle pour lui, un œil clair qui espère, un œil sombre en deuil. « Génial ! » commente Margot avec ironie. « Il n’y a rien à faire ici, c’est nul.» Elsa et Marc ont du mal à la contredire. Elio, dans les bras de sa maman, restera muet jusqu’à l’hôtel où les Laborde resteront une nuit « pas plus » pour se reposer et se remettre de leurs émotions. Le retour à Lens tire un trait sur les rêves envolés et les illusions perdues. La fin du voyage signe la fin de la naïveté et de l’innocence. 30 juin. Elio n’ose plus parler d’Arcachon. Il y croit toujours pourtant, sa maman recueille encore, le soir, ses courageuses confidences. Imagination fertile ? Réminiscences d’une autre vie ? Réincarnation ? La réponse viendra dans l’après-midi lors d’un vide-grenier. Les faits sont têtus Parcourant une brocante de quartier avec Elio, Marc est attiré par un objet en verre au milieu d’un étal en bazar. C’est une petite boîte de forme rectangulaire contenant du sable et, sur le couvercle, un paysage marin peint à la main, bordé d’une grande dune de sable. Dans le ciel, écrit en lettres jaunes : « Bassin d’Arcachon ». Sur le visage de son père, Elio lit la stupéfaction. Il comprend qu’un événement incroyable vient de se produire. La probabilité pour tomber sur une boîte marquée d’un mot inventé de toutes pièces par son enfant est faible. Coïncidence ? Malice du fiston qui aurait discrètement placé une boîte de sa confection sur le présentoir ? Le brocanteur affirme ne pas connaître la provenance de ce vieil objet qu’il cède à Marc pour trois fois rien. Pour Margot, « c’est du mytho » tandis qu’Elsa se lance dans des recherches qui resteront infructueuses. Notre rencontre avec Elio s’achève sans réponse et le mystère reste entier, mais une chose est sûre : le petit explorateur d’un autre monde a trouvé son bonheur car lui seul sait qu’il a raison. C’est la boîte qui le dit. (Propos recueillis par Laurent Delacouette.)
David POHIC
Elio, départ pour le rêve
Il faut lui reconnaître cette qualité, Jeanne était une femme très courageuse, mais surtout c'était une virtuose, elle jouait admirablement du piano. Son rêve d'être pianiste internationale fut tué dans l'œuf par ses parents, qui y mirent un véto immédiat. Il n'y avait pas d'explications, c'était comme ça. Une jeune fille « de bonne famille », pianiste, ça ne se faisait pas. Alors Jeanne continua à travailler son piano par plaisir. Elle se maria et eut deux filles et un garçon. Puis la grande Histoire s'est mêlée salement à son histoire. C'était celle d'un moustachu, déçu dit-on d'avoir échoué à l'examen d'entrée de l'Académie des beaux-Arts, qui décida de transposer ses désillusions créatrices dans un autre domaine : la destruction du peuple juif et autres « sous- hommes, tels que les Tziganes, les malades mentaux... Sans doute un magnifique exemple de sublimation pour les psychanalystes. Suzanne avait six mois, Élisabeth quatre ans et Paul onze ans. Lorsque sa maman lui cousit une étoile jaune sur son blaser, Paul prit alors conscience à ce moment-là de sa judéité. La famille fut plongée dans un véritable cauchemar au quotidien. Pendant toute cette période d'angoisse, de peur et d'incertitude, du matin au soir et également pendant ses nuits, Jeanne se demandait comment elle allait nourrir ses enfants. C'est avec cette question torturante qu'elle dut partir un matin, seule avec ses trois enfants, au volant d'une voiture qui lui avait été prêtée par des amis, pour retrouver des cousins dans la France libre, à Villeneuve-lès Avignon. Son mari Jules, devait régler des affaires pour son travail, mais lui promit de la rejoindre très rapidement. Elle avait dans le coffre une petite réserve de pain, de jambon et d'eau. Son angoisse était accentuée par le fait qu'elle n'avait pas l'habitude de conduire sur de longues distances. Avec ce temps magnifique, les enfants étaient insouciants, ils avaient l'impression de partir en grandes vacances. Elle arriva finalement à bon port sans trop d'encombres et fut accueillie chaleureusement par une de ses cousines. Jules put finalement prendre la route peu de temps après. Quand il arriva sur la place du village de Villeneuve-lès Avignon, il apprit en écoutant deux dames discuter, que neuf personnes avaient été arrêtées, dont cinq femmes. Son cœur se mit à battre. Il ne posa de questions à personne, il était extrêmement méfiant. Il savait que partout, il y avait des gens zélés qui surveillaient leur environnement et rapportaient tout événement suspect à la police. Il partit vite rejoindre sa famille. Tout le monde était sain et sauf et heureux de se retrouver. Jules ne le sut qu'après, mais s'ils eurent la vie sauve et échappèrent à la déportation, c'est bien sûr parce qu'ils n'avaient pas croisé la mauvaise personne au mauvais moment, mais c'est aussi parce qu'il avait eu la bonne idée de ne pas s'identifier, en inscrivant leur nom dans le registre du village, comme l'exigeait la procédure légale. Quelque temps après, Jules partit en Espagne pour rejoindre le Général De Gaulle qui était à Londres, il fut dénoncé par un passeur et fut déporté à Auschwitz. Ce fut un drame pour la famille. Paul perdit sa voix. Après de nombreux examens, les médecins conclurent à une aphonie d'ordre psychologique. Jeanne, dépassée par toutes ces émotions, tomba dans une sorte d'état dépressif. Elle dormait beaucoup, avait du mal à se lever le matin. Elle qui était toujours raffinée, portait des tenues négligées. Ceux qui ont survécu à cette saleté de guerre n'en sont pas sortis indemnes. Même s'ils ne le montraient pas, ils étaient traumatisés par ce qu'ils avaient vécu, parce qu'ils avaient perdu des êtres chers, pour certains des pans entiers de leur famille, ou tout simplement parce qu'ils portaient la culpabilité d'être vivants. Jeanne finit par sortir de sa torpeur. Elle n'avait pas le choix, elle devait s'occuper de ses enfants. Elle fit les démarches nécessaires pour changer de nom de famille. C’était un crève-cœur pour elle, mais elle pensait avant tout à l'avenir de ses enfants. Ensuite, pour subvenir à leurs besoins, elle décida de donner des cours de piano. Aussi étrange que ça puisse paraître, elle se convertit au catholicisme. Quelles étaient ses motivations profondes ? Un coup de folie après les atrocités qu'elle avait vécues ? Cherchait-elle à fuir le passé ? Voulait-elle se donner une apparence pour protéger sa famille ? Ou en découvrant cette religion, y avait-elle trouvé véritablement quelque chose qui lui correspondait ? Non seulement elle se mit à aller à la messe tous les dimanches, mais elle exigeait que tous ses enfants viennent. Elle les mit au catéchisme. Les années passant, Paul ne savait pas trop comment il allait orienter son avenir. Sa mère lui avait trouvé un professeur de violoncelle. La musique devint son grand bonheur. Il travaillait beaucoup et faisait régulièrement des duos avec sa mère. C'était un peu la façon qu'ils avaient trouvée tous les deux pour communiquer. Il avait un tempérament doux, rêveur. Il était profondément gentil. Il avait à cœur de rendre service, de se faire aimer en faisant plaisir. Lentement, mais sûrement, Jeanne lui mit dans la tête qu'il pourrait devenir prêtre. Paul n'était pas du tout convaincu par tous les arguments que sa mère lui présentait. Il aurait préféré rentrer dans un orchestre. Jeanne lui signifia que c'était extrêmement difficile de gagner sa vie, qu'il y avait très peu d'élus et qu'il ne s'agissait aucunement d'un renoncement à la musique. Elle aussi avait dû renoncer à une grande carrière musicale, mais la musique l'accompagnait cependant tous les jours. C'est encore une fois, par manque d'affirmation et pour faire plaisir à sa mère que Paul démarra une formation philosophique et biblique fondamentale pendant deux ans. Puis il fit un master de recherche en théologie pendant trois ans et termina par une année qui l'amena au niveau doctorat en théologie. Il fut ensuite ordonné prêtre. Il se lia d'amitié avec un prêtre qui travaillait dans les prisons. Paul se dit que cela donnerait du sens à sa vie de devenir aumônier. Il suivit une nouvelle formation et se mit à aller à la rencontre des détenus, en se promenant dans les couloirs de la prison. Il appréciait beaucoup ces moments d'échange avec eux. Il écrivait sur un carnet pour s'exprimer et il se servait également de la musique. Il se déplaçait toujours avec son mini-lecteur de CD. Il se mit dans l'idée qu'il pourrait peut-être contribuer à les mettre sur la voie de la reconstruction. C'est dans cet univers carcéral qu'il fit la connaissance d'Elisa, une jeune femme de vingt-six ans. Elle était complètement recroquevillée dans sa cellule lorsqu'il la découvrit la première fois. Elle ne prit pas la peine de le regarder. Il revint le lendemain pour la saluer à nouveau. Toujours pas un mot en retour. Cela dura une semaine. La semaine suivante, il inséra dans son lecteur de CD, la suite n° 1 pour violoncelle de Jean Sébastien Bach. Surprise, Élisa se redressa et prit conscience de sa présence. Au fur et à mesure, elle se détendit. Il aperçut son visage avec ses yeux tristes. À la fin du morceau, le silence se fit à nouveau. Puis, au lieu de lui poser des questions, Paul lui écrivit sur son petit carnet, qu'il jouait du violoncelle, que la musique avait une très grande importance dans sa vie. Elle le regarda enfin dans les yeux. Il lui écrivit sur son carnet : vous pouvez garder l'appareil, je vous apporterai d'autres musiques. Il entendit enfin le son de sa voix : «merci». Les fois suivantes, Elisa commença à lui poser des questions. Puis elle lui raconta qu'elle était là car elle avait aidé un copain algérien sans papiers à venir en France. Elle l'avait rencontré lors d'un séjour en Italie. Elle l'avait même hébergé quelque temps. Paul vint régulièrement la voir. Il s'aperçut qu'il commençait à s'attacher à elle et à négliger les autres détenus. Il pensait à elle également quand il était à l'extérieur de la prison. Cela le troubla. Ils se mirent à échanger beaucoup, à rire ensemble. Elle lui dit qu'elle avait hâte de sortir, de reprendre sa vie d'avant. Elle adorait les animaux et était éducatrice canine. Elle formait notamment des chiens pour qu'ils deviennent guides d'aveugles. Au bout de quelques mois, Elisa annonça à Paul que le grand jour était arrivé, elle allait enfin pouvoir retourner chez elle. Elle lui prit les mains, le regarda dans les yeux et lui demanda s'il viendrait la voir chez elle à Biganos en Gironde. Paul fut très troublé par ce contact physique. Il lui confirma que bien sûr, il viendrait la voir. Elle lui donna son adresse. Paul traversa une période de confusion, il dormait mal la nuit, il pensait à Elisa. Il se demandait si c'était une bonne idée d'aller la voir.&amp;lt;br&amp;gt;Mais le cœur prit le dessus sur la raison. Quand il arriva chez elle, en fin d'après-midi, il la vit en train de travailler dans son jardin avec un Golden Retriever. Elle était douce, patiente. Pour la première il la vit avec ses longs cheveux châtains détachés. Il fut à nouveau troublé par sa beauté. Elle l'aperçut et lui fit signe d'entrer. Elle était surprise mais ravie de sa visite. Elle lui présenta ses petits pensionnaires : un Labrador marron et le Retriever blond.&amp;lt;br&amp;gt;Puis elle lui proposa un verre de rosé. Ils s'installèrent dans le jardin. L'alcool aidant,&amp;lt;br&amp;gt;Ils prirent du plaisir à échanger et à rire ensemble. Puis elle lui prit à nouveau les mains, le remercia d'être venu et l'embrassa. Étrangement, Paul n'avait pas envie de résister. Il ne s'en alla qu'au petit matin. Si la nuit fut douce et enchanteresse, le réveil chez lui après quelques heures de sommeil, fut cruel. Il avait très mal à la tête, il était confus, il culpabilisait de sa conduite, il se sentait faible et minable. Il essaya de mettre de l'ordre dans ses idées. Puis il retourna voir Eliza. Il lui expliqua les sentiments contradictoires qui l'envahissaient. Elle lui dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi la religion imposait cette chasteté aux prêtres. Comment pouvaient-ils avoir une vie équilibrée ? Il lui expliqua qu'en plus, autrefois, on incitait les prêtres à ne pas se marier, mais ils avaient le droit de vivre en concubinage. Ce n'a été qu'au XIIè me siècle, que l'interdiction avait été formulée. À chaque fois que Paul revoyait Eliza, il retombait sous son charme. Mais quand il se retrouvait seul, il se flagellait moralement. Il dit à Elisa qu'il avait besoin de prendre un temps pour faire une introspection, pour savoir ce qu'il voulait vraiment au fond de lui. Elle accepta tristement cette séparation, mais elle ne voulait pas démarrer une histoire avec quelqu'un qui vivrait dans un tourment permanent. Il vécut très confusément pendant cette semaine de retraite, il était très agité. Il se dit qu'il avait toujours agi dans sa vie pour faire plaisir aux autres ou pour ne pas froisser. Il prit conscience que son engagement dans la voie de la prêtrise était le choix de sa mère, mais pas le sien. Il eut l'impression de surcroît d'avoir trahi son histoire familiale. Pour la première fois, il eut envie de s'écouter et de faire un choix par lui-même, quelles qu'en soient les conséquences. C'est avec une grande sérénité qu'il alla retrouver Elisa. Pour la première fois de sa vie, il avait le sentiment de prendre son destin en main. Lorsqu'il l'aperçut dans son jardin, il courut vers elle pour l'enlacer. La parole était superflue, ils étaient heureux. Elle lui dit qu'elle avait beaucoup réfléchi également pendant son absence, mais de manière positive, car au fond d'elle, elle savait qu'il reviendrait. Elle lui proposa s'il était d'accord, de lui présenter son ami Alexandre qui était ostréiculteur et qui cherchait quelqu'un pour remplacer le départ d'un de ses collègues. Paul fut étonné, mais touchée qu'elle ait commencé à penser à un avenir commun. Il lui fit part de ses doutes sur un tel recrutement, car il ne connaissait de l'huître que le plaisir qu'elles lui apportaient quand il en mangeait. Elle le rassura, en lui disant qu'Alexandre était un ami de longue date et que ce qui était important pour lui, c'était de travailler avec quelqu'un sur qui il pouvait compter, pour le reste, il apprendrait sur le terrain. Même s'il savait que ce métier était dur, l'idée de travailler dans le silence et la nature lui plaisait énormément. La collaboration avec Alexandre fut facile. Ce dernier n'était pas un bavard, mais il adorait son métier et aimait transmettre son savoir. Une amitié a vite commencé à s'installer entre eux. Paul avait l'impression de renaître. Il admirait les couleurs changeantes du bassin, la végétation dunaire et tous ses oiseaux qui venaient se nicher sur les bancs de sable, les sternes à tête noire, les milans noirs, les bernaches... Mais il était particulièrement fasciné par les goélands argentés, qui pouvaient faire plus d'un mètre d'envergure. Lorsqu'ils suivaient le bateau, il avait l'impression que les goélands l'interpellaient. Avec le temps, Paul réussit à distinguer une dizaine de cris. Il discernait les jappements, les cris plaintifs, les clameurs éclatantes, les cris d'appel pour alerter les congénères d'un danger, les cris de la parade amoureuse, les cris pour encourager leurs petits à l'envol... Il se mit à claquer la langue et à siffler pour attirer leur attention. Jamais, il ne s'était senti aussi vivant. Il avait l'impression que les goélands le provoquaient pour parler avec lui. Un jour, la magie opéra.Il se mit à pousser des cris pour répondre à ces appels. Ivre de joie, il se dit qu'il n'était plus celui d'avant, il avait désormais le pouvoir de parler aux oiseaux. Sur le coup, il fut tellement surpris lui-même, qu'il n'en parla à personne, c'était un secret entre lui et les oiseaux. Il était vraiment devenu lui-même. Le Lendemain, il alla retrouver les oiseaux pour vérifier qu'il pouvait toujours échanger avec eux. Cela fonctionna parfaitement. Ce n'est qu'au bout d'une semaine, qu’il offrit à Elisa le cadeau de l'emmener en bateau voir les goélands, pour qu'elle découvre qui il était devenu. Conscient que cet immense bonheur qui lui tombait dessus, il le devait à Elisa, ses premiers mots pour elle furent : « merci mon amour ».
Nathalie SAGLIER
MERCI
Nouvelles
Il était petit et rond. Rond de la rondeur d’un œuf. Sa surface lisse était d’un beau noir, avec quelques fines rayures blanches. On aurait dit un réglisse. A chaque vague, il venait s’échouer sur la plage. Il se laissait rouler, abandonné à la puissance de l’eau. Lorsqu’il se heurtait à d’autres galets, ils émettaient ensemble un joli cliquetis. Les vagues, en se retirant, leur répondaient avec un petit chuintement. Secoué dans le roulis d’écume, puis délaissé, il aimait les quelques instants durant lesquels il brillait. Mouillé, il affichait un noir luisant et profond mais, sa surface étant totalement imperméable, il suffisait de quelques secondes pour qu’il sèche et perde sa couleur luisante. Il retrouvait alors un noir mat, sobre, discret. Mais voilà, c’était donc cela : il ne souhaitait pas être discret, au contraire. Il voulait briller, briller à tout prix. Le peu de temps que durerait son éclat, il espérait qu’une main charitable viendrait le ramasser. Peu lui importait de finir dans le sac d’une artiste du dimanche pour se retrouver collé à des coquillages dans une composition destinée à décorer la salle de bain. Peut -être finirait-il dans la poche d’une « glaneuse » de celles qui ne peuvent s’empêcher de ramasser les feuilles sèches, les bois flottés ou les cailloux. Comme toutes ses autres trouvailles, elle finirait sur l’établi du garage et on l’y oublierait. Ou alors, c’est un garnement qui le ramasserait pour le lancer le plus loin possible dans l’eau en poussant des cris de sauvages. Ce risque-là était grand, car, alors, il se retrouverait bien loin de la barrière d’écume et scintillerait au fond de la mer, inutile. Celle qu’il attendait arriva enfin. Il la connaissait bien, depuis trois jours qu’il l’observait. Coquet et plus brillant que jamais, il roulait au bord des vagues, et s’arrêtait sur l’écume dont la blancheur mettait en valeur sa couleur sombre. Pour elle, il cognait ses voisins. Il voulait provoquer un bruit qui l’attirerait, qui détournerait son attention. La fillette avançait depuis le bout de la plage, sautillant, son seau à la main. Elle allait, venait, s’arrêtait, repartait indécise. Les yeux baissés, elle s’appliquait à bien balayer du regard ces millions de petits cailloux qui s’offraient à elle. A fond du seau, déjà, quelques belles trouvailles : un galet tout rond comme une bille, un autre plat comme un jeton, un morceau de verre translucide... Le petit galet ne quittait pas l’enfant du regard. Il suivait sa progression sur la bordure mousseuse dans laquelle les pieds de la fillette s’enfonçaient, laissant une trace vite effacée par les vagues. Un malotru rouge sang essaya de pousser le petit galet sous l’écume. Celui-ci arriva à se caler contre une coquille d’huitre et resta hors de l’eau. Maintenant, un groupe de petits cailloux blancs lui bouchait la vue. Il se déplaça, concentrant toute son énergie pour se maintenir sur la bande de galets que les vagues faisaient s’entasser tout au long de la plage. Bousculé, tantôt submergé, tantôt propulsé par le flux jusqu’au sable fin, il essayait de ne pas perdre de vue l’enfant et son seau. La fillette était maintenant accroupie au-dessus d’une carapace de crabe qu’elle soulevait et retournait avec sa pelle. Allait-elle s’intéresser à ce bout de pierre noir et blanc qui se haussait au-dessus de la barrière de galets ? AH ! S’il avait pu crier « Ohé ! ». Sans doute d’autres cailloux roulés avaient-ils vu l’enfant, eux aussi. La pauvre petite bille noire n’était sûrement pas la seule à vouloir se faire remarquer.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span&amp;gt;Alors qu’il roulait courageusement vers la plage il se trouva tout à coup dans le noir. Une algue venait de s’échouer sur lui. Plongé dans l’obscurité, il tâtonnait de tous côtés. Les fibres végétales l’emprisonnaient et il risquait bien perdre la partie. Allait-il rester coincé sous cette algue sans que l’enfant le voit ? Non, il ne pouvait manquer cette occasion !l tenait en vain de se libérer avant le passage de l’enfant. Et s’il y arrivait trop tard ? Par chance, une vague plus forte que les autres l’arracha aux lanières vertes et le ramena à la surface. Délivré des longues herbes qui avaient tenté de le maintenir au fond de l’eau, il entreprit de rouler, rouler vers le sable sec avec toute la force qui lui restait. Maintenant, il n’avait plus peur. Poussé par une vague, rattrapé par la suivante, projeté par-dessus les algues ou enveloppé d’écume, le petit galet parvint à atteindre la ligne du rivage où s’étaient échoués toutes sortes de coquilles et de déchets. Il était entouré de choses à l’air hostile : des bouchons, des morceaux de plastique déchiquetés, des mailles de filets de pêche et même des canettes&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span&amp;gt;de boisson. Il regretta tout d’abord de s’être mis en avant. N’allait-il pas finir dans une poubelle ? Périrait-il dans l’estomac d’une mouette vorace ou entre les filaments d’une grosse méduse ? Y penser le faisait trembler de peur, et bien vite, après tous les efforts fournis pour ne pas être englouti, il sentit la fatigue le gagner et se laissa sombrer dans le sommeil. Un sommeil de pierre, dur et lourd dans lequel il oublia rapidement les secousses, les tourbillons, les bousculades qui l’avaient amené jusqu’à la grève. Oubliant aussi l’enfant, il plongea dans ses rêves. S’il pouvait flotter un jour ! Il aimerait tant rester hors de l’eau et se laisser bercer sans secousse et sans le va et vient des vagues. Mais a-t-on déjà vu un galet flotter ? Il s’enfonça dans des rêves pesants où il essayait en vain, de regagner la surface. Les échecs rendaient ces rêves encore plus réels. Soudain, le soleil brilla au-dessus de la plage. Le petit galet était sec, d’un noir terne que seules les rainures blanches venaient égayer. Après un temps qui lui parut infini, il se réveilla tout à coup, porté par une main d’enfant. La peau douce des petites paumes le débarrassait du sable collé à sa surface. Après ces caresses vint le bain, dans le seau. Maintenant, le petit galet n’avait plus peur. Les trois ou quatre cailloux qui reposaient au fond du seau en plastique luisaient dans l’eau fraîche. Lui aussi ! Il avait réussi ! L’enfant l’avait trouvé et, pour la remercier, le petit galet brillait tant qu’il pouvait. Il se sentit tout à coup soulevé à nouveau, tâté, retourné entre des petits doigts agiles. Il les sentit dans un frisson suivre ses fines lignes blanches. Puis, soudain, il s’envola au-dessus de la grève. Son envol lui coupa le souffle et il retomba lourdement dans la mer. Il coula lourdement, victime de sa destinée de pierre. Il atterrit sur le fond sableux, ayant juste eu le temps d’entendre : - Aujourd’hui, je ne prendrai que les galets blancs. - Peut-être demain, soupira le petit galet. Notre histoire se terminerait là sans l’intervention involontaire d’une méduse. Petit galet, déprimé, terni, était bien décidé à ne plus rouler et à s’enfoncer dans le sable.. Triste histoire, me direz-vous ! Mais non, car, contre toute attente, une méduse arriva soudain en dérapant sur l’écume. Cette grosse boule gluante bouscula tout sur son passage et souleva d’un coup le petit galet, le propulsant violemment sur le sable mouillé. Il existait donc une dernière chance ! Le petit galet concentra toute son énergie pour rouler, rouler sous l’effet de la vague suivante. Seule l’ultime frange d’écume arrivait à le bousculer. Il affichait maintenant son côté le plus lisse et le plus brillant, et c’est en poussant un grand soupir de pierre qu’il atterrit dans la main d’un garçonnet. Celui-ci glissa rapidement Petit Galet dans sa poche et quitta la plage. Toute la journée le petit galet se laissa caresser, joua avec délice à roule dans la paume de la main de l’enfant. Le lendemain, les parents du garçonnet décidèrent de changer de plage. La maman trouvait qu’il y avait trop de déchets sur le sable et le père trouvait l’océan trop dangereux. Sur la plage d’Andernos, le Petit Galet était heureux, dix petits doigts le réchauffaient , le faisaient sauter en l’air... jusqu’’à ce qu’il tombe malencontreusement sur le sable. L’environnement le fit frissonner : Pas un galet, pas une coquille, ni même un morceau de bois délavé par la mer . Un vrai désert ! Mais aussi, que cet endroit était calme ! Que l’eau immobile était douce et tiède, sans vague ni déchets ! Dis, Papa, pourquoi il n’y a pas de galets sur le sable ici ? Pour que tu puisses retrouver le tien plus facilement. Allez, viens, on le cherchera demain. On le retrouvera sans problème. C’est vrai, ça, pourquoi n’y a-t-il pas de galets sur la plage d’Andernos ?
Martine BUTON
Le petit galet
Un chêne liège. Un cheval. La pluie rebondit de feuille en feuille. Pony sommeille, insensible aux gouttes chaudes glissant sur sa robe de cuir. La tête baissée, le cou alourdi s’est étiré dans toute sa longueur. Enivré de l’odeur apéritive au bord des premières herbes, ses naseaux palpitent doucement contre l’écorce. La bride vaguement attachée à un broustic, il attend, docile, d’être repris en main pour son travail de tracteur des sables. Johan s’est abrité, accroupi, sous la tiédeur du canasson. Il réfléchit en mâchouillant son chicot de tabac déjà lessivé. À côté, les fumées du foyer vital tourbillonnent dans les courants d’air du pare-pluie incliné dos au vent. Un matelas en varech, ignifugé naturellement par détrempage, a protégé les braises toute la nuit. Noah dort encore, la tête enfouie dans les peaux de mouton, englobées par le filet de pêche suspendu entre les branches. Léo et Tom se font encore couver par leur mère Esterella, protégés par le nid quotidien de la voile huilée. Il est charpenté par le mât en biais, à peine planté dans le sable et posé sur les avirons en croix. La vergue de taillevent a été orientée par les écoutes bordées sur des piquets d’accroche. Dans les tamaris décharnés, Machouille la chèvre et Cornille le bouc, asservis au piquet, terminent conjointement le travail de coupe rase. Suif, leur garde-chiourme attitré, les protège des loups gourmands. Pour se camoufler, il a choisi une belle charogne en se frottant de chaque côté le cou avec délicatesse. Il n’a pas vraiment dormi de la nuit dans sa planque. Les hurlements perçaient régulièrement le silence des buissons alentours. Il pleut. Les nuages d'horizon s’éclaircissent de mauve. Des traînées effilochées roses déchirent le catafalque orageux. Le large fleuve profond s’allonge entre les rivages sableux. Sombre encore de nuit, il commence à briller au contre-jour de ses vaguelettes révélées. Le vent d’est les brosse sur la plage dénudée. Elles roulent la jonchée de roseaux et la richesse de la laisse de mer matinale. La noria d’oiseaux opportunistes fait son marché à peu d’effort. Les gravelots pressés trottinent en zigzaguant pour éviter les remontées mousseuses et picorent avidement les infiniment petits. Le campement reprend vie aussi. Johan a récupéré des branchages mis à l’abri et ravive le foyer. La nichée familiale s’est réfugiée sous la tente où l’eau dirigée a bien rempli les gourdes suspendues. Il reste encore de quoi se donner des forces : quelques oignons, du fromage et du miel, du millet avec le lait de Machouille. Suif est désormais en indélicatesse avec toute la famille. Il se venge en aboyant après les cornus moqueurs. Déchargé de surveillance, il va fureter dans les fourrés de la jonquière pour dénicher peut-être son seul repas de la journée. Chanceux, il reviendra avec la plume au bec. Le soleil a finalement asséché la pluie. Il reste une fine bruine tiède ondulant dans le vent. Johan propose à tous de monter sur la grande dune. Son flanc ouest offre une rampe facile. Esterella connait déjà. Elle préfère rester ranger les affaires et préparer le brancard de Pony pour la journée. Suif est assigné à résidence au cas où. Il rejoint ses jouets préférés. Les enfants partent alors avec fierté découvrir leur monde. Noah a emporté son arc et se retarde à scruter avec vigilance le moindre bruissement. La rampe se gravit facilement, d’autant que le sable s’est figé par la pluie nocturne. À mi-pente, les explorateurs matinaux s’arrêtent et se retournent vers l’Ouest. Devant eux, s’étale jusqu’à l’horizon la majestueuse immensité de la plaine des montagnes. Johan raconte une nouvelle fois à ses enfants l’histoire de leur pays. Il y a un siècle, Lou halha a détruit toute la forêt artificielle d’une ancienne presqu’île. Celle qui avait barré le delta d’origine du fleuve. Un soir d'un vent de chaleur, des bergers rebelles au progrès avaient mis le feu à la forêt du Grand Crohot. La mèche allumée a serpenté tout le long des plantations faisant exploser les réservoirs de résine sur pied. Le chalumeau maléfique a réduit en cendre légère tous les pins prometteurs. L’invasion des sables a alors repris sa terrible progression. Rien de pouvait l’arrêter. La fratrie ne parle plus. Seul l’instinct animal vibre. Chacun ressent la force gigantesque de cette néfaste nature en marche. Quelle est celle qui pourrait la maîtriser ? Certainement pas le misérable physique humain. La nouvelle génération pense déjà, avec la prétention de se savoir être doué d’intelligence compensatrice, qu’il doit y avoir une solution. À réfléchir. Le fatalisme ne fait pas partie des résolutions de la jeunesse. Alors quelle solution ? Celle de la raison savante qui figera ces dunes. Celle du petit David, aussi forte que le poids de l’énergie des milliards de grains de sable. Contre ce Goliath éolien capable de déplacer des montagnes. Ils regardent avec une émotion ingénue ce paysage menaçant mais d’une beauté extraordinaire. L’éclairage solaire rasant illumine les flancs bombés de la horde des dunes venues de l’Atlantique. Les veines brillantes des rivières résiduelles traversent les monticules en constante reptation. Les vestiges du Cirès, du Bétey et de La Meule ont adapté au fur et à mesure leurs méandres prolongés. Il n’y a plus d’esteys. Plus de chenaux. Pendant des années, leur libre cours a été progressivement entravé par le barrage des dunes envahissant l’espace de l’ancien Bassin d’Arcachon. Des étangs se sont élevés aux estuaires des crastes et des rivières. Chargés des eaux terrestres, leur volume est resté suspendu quelques temps. À force, la surverse a rompu le seuil le plus fragile en un goulot étroit. Au-delà de la cascade de purge, le cours a repris cherchant le talweg le plus bas. Johan montre du doigt à ses enfants ces bassines difformes devant les anciens villages de Lège, d'Arès, Andernos et Lanton. Ils poursuivent l’ascension de la grande dune qui s’allonge depuis l’ancienne Île des oiseaux jusqu’aux marais salans de Certes. À 120 m, au sommet, l’émerveillement s’amplifie. Tout en bas, au sud, le grand fleuve de l’Eyre. Immense couloir profond qui chasse la marée basse. Il entrave la montagne centrale dans sa progression inquiétante. Il lui sape continuellement le pied et charrie le plus loin possible les déblais. Avec les pluies diluviennes de toutes ces années, la rivière tortueuse s’est transformée en une redoutable artère fluviale. Lors des crues hivernales, la rencontre du jusant provoque un maelstrom mobile qui emporte les rives sableuses dans son rotor sous-marin et impose son lit de géant. Ainsi, elle a raboté en grande partie l’île de Malprat. Et balayé la plupart des digues de Gujan et de La Teste déjà endommagées quelques années auparavant. Les garçons veulent savoir. Ils veulent intégrer la connaissance de leur père. « Comment c’était avant ? » Juste après lou halha , notre terrible destin a subi celui de la France. Comme un incendie ravageur, comme des sujets végétaux fragiles, nous avons été décimés par le feu bactérien. Lou gran malautiá. Nos ancêtres ne l’ont pas vu venir. Ils l’ont appelé ‘’tuberculose’’ mais le mal était beaucoup plus pernicieux et contagieux. Un ou plusieurs foyers ont pris naissance par les individus les plus vulnérables. La mèche humaine a pris diaboliquement corps. Elle s’est propagée par la confiance mutuelle des proches. Qui, eux-mêmes, ne pouvaient pas douter de l’amour partagé de leur famille étendue ou de leurs proches spécifiques. Les églises, les écoles, les marchés ont été des combustibles sociaux. Les projets, les espoirs et même les guerres ont été anéantis par ces flammes invisibles. Inextinguibles. Même par les plus ferventes et sincères prières. À l’époque, le désert de sable s’était étendu à celui de l’humanité. Aujourd’hui, les jeunes pousses percent enfin le minéral. Des nuages d’oiseaux sillonnent le ciel et piétinent la terre. La vie a repris ses droits, mue par la résistance programmée à la mort. Assis au bord de l’à-pic, les héritiers des rescapés de l’ancien monde contemplent le panorama exceptionnel qui se développe tout autour d’eux. Le père explique à ses enfants le pays de ‘’l’autre côté de l’eau’’. En face, dans le renfoncement lacustre, les vestiges du grand village de La Teste. À côté, à une trentaine de mètres de haut, la paisible pignadar des Arcansons, peuple de la forêt, qui abrite la chapelle Notre Dame des Marins, en vigie protectrice. Au loin, derrière, la grande forêt de Brémontier qui longe le littoral du Moullo jusqu’à la pointe du Pilat, tout au Sud. Elle a heureusement réussi à fixer les sables qui progressaient vers La Teste. La grande Leyre a noyé le Teychan. Son redoutable flot s’est progressivement amplifié. Il se gonfle encore plus, au flux de l’océan, de millions de mètres cubes salés. Sa trajectoire n’est plus déviée par les masses d’eau englouties plus au nord. Alors ce boutoir hydraulique a traversé au plus court, de part en part, la presqu’île encore fragile. Le phare blanc du Cap-Ferret s’est retrouvé épargné par miracle. Il borde désormais heureusement la nouvelle passe et campe sur l’île du Ferret. L’ancien estuaire des passes d’autrefois est traversé par de multiples chenaux. Il s’est transformé en une immense plaine de sable à marée basse de trois kilomètres de large. De multiples bancs se sont élevés à partir d’Arguin et de Matoc. Certains sont devenus des îles fixées par de la végétation. À marée haute la profondeur reste faible, à trois mètres environ. Les eaux extrêmement transparentes apportent tous les nutriments océaniques. Cette étendue paisible est favorable aux nurseries de toute la faune sous-marine. Voilà. Johan s’est levé. Il brosse son manteau de peau de mouton pour faire tomber tout le sable compressé. La fratrie ne veut pas se détacher de cette vue onirique. Car ils ne veulent pas non plus rompre l’imaginaire que suscite en eux le récit de leur père. Bien que toujours dans l’enfance, ils se retrouvent avec nostalgie encore plus jeunes, dans les limbes de l’endormissement quand il leur racontait des histoires qui étaient déjà le début de leurs rêves. Devant l’insistance de leur sollicitation émouvante, Johan se rassoit et poursuit ses explications descriptives. Les rares héritiers des marins du Pays de Buc, les Ostréogots, ont inventé la culture des huîtres. Depuis la précédente génération, les plus entrepreneurs ont créé des champs de gravettes, délimités par des pignots enduits de goudron. Ils se sont installés devant le Moullo jusqu’au Sabloney, sur la plage, au bord de la forêt. C’étaient de simples huttes à l’origine. Désormais, leurs cabanes sont plus avancées dans la mer et tchanquées pour permettre de basculer d’immenses filets, les carrelets. Elles forment tout un village allongé qui s’est développé grâce au train. À l’époque de Grand-Papé, quand les affres de la gran malautiá se sont dissipés, la voie de chemin de fer a été réactivée et prolongée sur une digue. Elle longe les prés salés de la Montagnette à l’ouest du bourg de La Teste par Pechiq et Les Ninots jusqu’à Séoube. Elle rentre alors dans le massif dunaire fixé par les semis au niveau de la lède de Jaugut, c’est un bas-fond, et le traverse par la vallée de la Grave jusqu’au Bassin. Les travaux ont duré presque dix ans. Le père insiste maintenant pour le retour. Il autorise une course entre les garçons et lui. Ils dévalent ensemble la pente, libres, heureux de vivre. Les poumons gonflés de cet air tellement pur, enivrant d’oxygène, parfumé de l’iode océanique et de l’odeur prégnante de l’eau douce chargée du rinçage terrestre. À l’approche du camp de base, les apprentis explorateurs sentent les effluves de grillades. Esterella surveille en effet la cuisson de deux lapins maintenus écartelés par des tiges de bois vert. Tout a été rangé sur le brancard. Pony s’alimente dans les herbiers de salicorne. Les cornus, fâchés d’être entravés par un rondin, s’éloignent quand même vers les délicieuses jeunes pousses des buissons piquants. Bon prince, Suif laisse brouter. Johan doit partir à La Teste. Chaque semaine il apporte des provisions à ses parents, surtout au prétexte de s’inquiéter de leur santé et de leurs besoins. La marée est porteuse, il ne faut pas tarder. Il appelle les enfants pour l’aider à mâter la tillole et à la pousser vers la rive. La puissance du courant de cette forte marée permettra de rejoindre La Teste, après avoir passé le cap de l’Aiguillon, en une heure à peine. Il pose, calée au fond, sa hotte structurée de bambou et de toile graissée. Elle contient du poisson fumé, des coquilles Saint-Jacques en saumure, des œufs de cygne et un sac de salicorne. Toute autour de lui, la famille cache son appréhension instinctive par un sourire forcé. La mère a confiance malgré son intuition qui la pousse à s’inquiéter. Les garçons sont fiers de leur père, frustrés sous l’autorité maternelle, ils acceptent quand même de ne pas l’accompagner. Aujourd’hui c’est dangereux. La force hydraulique de l’océan commence à ralentir celle du fleuve. Les deux géants sous-marins vont rivaliser dans leur masse insaisissable. Ils ne pourront pas s’entrechoquer comme les bois des grands cerfs en rut. Ils vont glisser l’un sur l’autre, l’un dans l’autre, se mélanger, dissoudre le sel ou acidifier l'amertume. Des vagues nerveuses traduisent la rencontre. Chargées d’ondes de fond, elles roulent en biais sur l’estran. Des frissons de pluie. Des crépitements de bulles. C’est le signal. Coiffé de son bonnet de feutre de laine, Johan appareille, la voile de suite choquée au largue. Il se distrait quand même une seconde pour secouer une main à ses admirateurs de complaisance. Le bateau étalon vibre de toutes ses bordées. Il galope au-dessus des barrières de vagues, marquant le coup à chacune et reprenant de l’allant à la suite. Soudain, Johan l’entend. Il le connait. Il sait que son émissaire est aveugle, sournois et puissant. Bien d’autres se sont fait engloutir. L’océan a encore gagné. Il a envoyé ses meilleurs rouleaux compresseurs. Au front, menant la charge, la scélérate se dresse, bavant d’écume. Elle gronde de malice. Le marin barre vent arrière toute. Le souffle d’embruns des naseaux du titan redouble la poussée. La tillole se cabre soulevée par les premières lignes porteuses. Heureusement, ces paliers rehaussent la frêle embarcation à moitié hauteur de la crête. Un paquet d’eau arrive à rentrer pour envoyer par le fond la proie ridicule. Ce n’est pas suffisant. La vitesse de la lame double l’esquif qui reprend sa course par le vent salvateur. Johan arrivera à La Teste par l’esclavèir du Menan, à l’arrière de l’église. Ses parents lui donneront en échange des oignons et des pommes de terre du jardin, du miel, du fil de pêche avec des hameçons. Il retrouvera sa famille nomade au bord de la forêt de chêne-liège qui occupe toute l’ancienne île aux oiseaux. Nous sommes en 1942*. (* mille neuf cent quarante-deux)
Joël CONFOULAN
Le nouveau monde
Arès déployait comme d’habitude sa longue ligne droite, menant comme un agréable chemin de croix à la place de l’église, centre tutélaire et lieu de vie incontournable des habitants. Tout d’abord méprisants envers ce délicieux endroit, niché au fond du bassin, et protégé des vents du large par un rideau de brume mêlé de soleil, nous allions au contraire y découvrir la vie et les gens. Depuis quelques années, Ils avaient envie de vivre sur le bassin. Célie et Jean, car tels sont leurs prénoms, amoureux depuis toujours, avaient déniché leurs maisons après d’infructueuses recherches chez la très courtisée voisine, Andernos. Certainement un premier acte de bravoure du Dieu Arès, Dieu, certes, mais farouche et mal aimé, voire détesté par les Grecs, alors que son équivalent romain, Mars, fut au contraire fort apprécié. Mars, père des fondateurs de Rome, Romulus et Rémus, et mois symbolique pour Jean, cette histoire vous dévoilera pourquoi. Ils débarquèrent donc un matin de février 2021 après d’interminables tractations dont je vous épargne la désagréable énumération qui ne flatterait pas la digne charge notariale ni celle de banquier. Le jardin, à l’abandon depuis quelques mois, commençait déjà à fleurir de toute part, et les senteurs nous envoutaient, nous les citadins, humains desséchés au béton , bitume et boulot. Le temps était doux, délicieusement doux, la brise marine balayait les cheveux de Célie, la rendant encore plus resplendissante et totalement en harmonie avec l’environnement. Ça tombe bien parce que l’environnement, c’est précisément son dada. Jean, de son côté, avait décidé de transférer son activité sur Arès pour éviter les fastidieux allers retours vers Bordeaux, il en était parfaitement satisfait. Ils avaient réalisé leurs rêves, côtoyer les Dieux de la côte et en particulier Arès. Rapidement, ils découvrirent le village et les alentours à vélo et s’attachèrent à l’endroit paisible et bienveillant. Arès s’est assagi au fil du temps et a cessé les combats pour jouir d’une retraite guerrière éternelle. La jetée, la plus ancienne du bassin, proche de leur maison, fut très rapidement un lieu de promenade apprécié par le chien, mélange surprenant de Teckel à poil ras et de je ne sais quoi d’autre, à ce jour indéterminé. Ce havre de paix, portant un nom de guerre, allait révéler une histoire inimaginable avec en point d’orgue un évènement marquant, survenu le 12 mars 2023 et faisant désormais date au sein de leur famille. Avec le recul, comment s’empêcher de penser qu’il n’est pas tout à fait fortuit et qu’il est, au contraire, le travail surnaturel, destructeur et constructif du Dieu Arès ? Mais, revenons en arrière, un an plus tôt, en décembre 2021Jean s’était mis en tête de voler et il avait opté pour L’ULM, lui, l’opposé d’un casse-cou. Mais, entre son adresse plus que contestable, les vents capricieux, certainement manipulés par Zeus lui-même, le COVID, fumeuse plutôt que fameuse épidémie mondiale, les heures de vols s’accumulaient sans arriver au graal : le brevet Vu d’en haut, le bassin ressemblait à une forme féminine, délicieusement ouverte vers le large, ne se laissant pénétrer que par les passes, écumantes et tourmentées, comme les passions et les pulsions de l’océan. Poséidon devait bien s’amuser. Jean se demandait si les rives du bassin, jadis déshéritées et aujourd’hui parsemées de fortunes immobilières, n’étaient pas depuis toujours un repère touristique pour dieux Olympiens. Le prétest du brevet, ultime répétition avant le sacre, tourna au désastre. Jean, malmené par l’instructeur, se retrouva en grande difficulté, que le soleil, radieux, et la beauté séculaire des lieux, ne purent atténuer. Ce fut l’échec, rapidement débriefé et radicalement consacré. Jean ressentait les affres de l’enfance lui agresser le cœur, perdant chaque jour un peu de confiance qui s’envolait dans la brume des petits matins arésiens. Il s’enferma de plus en plus en lui- même, laissant Célie perplexe toujours aimante, mais voyant les petites chamailleries de la vie quotidienne s’amonceler comme des cumulonimbus agressifs en mal d’orage dévastateur. Jean était tourmenté, depuis toujours, mais l’échec aérien avait fait remonter avec une force jamais ressentie jusque-là, cette étrange impression de ne pas être totalement lui-même. Heureusement, Jean avait Célie. Mariés depuis 20 ans, ils avaient tous deux réussi à surmonter des divorces pénibles et singulièrement couteux, à tous les sens du terme. L’amour veillait toujours sur le couple, peut-être avec moins d’intensité mais avec plus de grâce et de bienveillance. Une rencontre d’âmes disait-elle. Ils étaient fiers de leur famille, « cinq enfants à nous deux , trois chacun », aimaient-ils lâcher, taquins. Il exerçait sur Arès comme psychothérapeute, après avoir fait une reconversion quelques années avant, échappant ainsi aux tourments professionnels des grandes entreprises en perpétuelles mutations. Ce métier était fait pour lui, empathique, très à l’écoute et soucieux de l’autre. Mais il va s’avérer également comme une nécessité dans son chemin de vie. Il avait également la passion du sport et du Ping Pong en particulier. Le club qu’il avait choisi l’avait rapidement intégré dans les équipes jouant le modeste championnat départemental. L’ambiance était bienveillante, certes quelques plaisanteries de potaches accompagnaient les entrainements bon enfant, mais tout cela respirait le plaisir de passer un bon moment. Célie, son métier, et le ping pong ne suffisaient pourtant pas à Jean pour être heureux de vivre sur le bassin. C’est alors qu’Arès retrouva toute son ardeur guerrière pour le guider vers la délivrance. Mais avant cela, il passa par quelques étapes qu’il est bon de revisiter avec un minimum de recul. La conscience de soi-même. Depuis l’enfance, Jean ressentait en lui une différence fondamentale avec les autres garçons. Il ne s’était jamais senti très à l’aise avec son corps et portait en lui de sacrés complexes. Souvent maltraité à l’école et au collège, il n’avait trouvé un peu de paix qu’en intégrant le lycée, où il subit des études très moyennes sanctionnées par un redoublement mérité et un BAC obtenu de justesse, l’année suivante. Timide et sensible à l’extrême, Jean n’avait jamais eu de petite copine, n’avait même jamais rien tenté pour séduire une jeune fille ou un jeune homme. Oui, il est clair qu’il n’avait aucune idée de son orientation sexuelle, sujet tabou, interdit fondamental. Il a grandi dans la plus grande ignorance de la sexualité. Bien au-delà de cela, il s’ignorait lui-même. Certes, il était depuis toujours attiré par les vêtements féminins, mais il vivait ça comme un secret, terriblement honteux, qui devait rester dans la confidentialité la plus totale. Rien ne l’empêcha pour autant de vivre et travailler tout en gravissant laborieusement les échelons innombrables de la fonction publique. Il crut longtemps avoir trouvé la parade à ses folies en épousant sa première femme, Annie, dont la féminité ne sautait pas directement aux yeux des admirateurs. Jean l’épousa sans avoir jamais connu de femme et se montra bien maladroit, vous l’aurez deviné, je pense. Mais de cette union naquirent cependant deux enfants à 4 ans d’intervalle, qui se révélèrent formidables, en particulier en mars 2023. La parade ne fonctionna nullement. Les mêmes fantômes lui traversaient l’esprit. Et inlassablement, les mêmes doutes, les mêmes angoisses, les mêmes pulsions qu’il fallait bien contrôler tant bien que mal. Le temps passa et le divorce saignant sanctionna cette union désunie, sans lien apparent avec les ressentis de Jean, dont il n’avait jamais fait état. Puis vint la formidable rencontre avec la belle et jeune Célie, resplendissante, à la spontanéité sans égale, hypersensible et plus intelligente que quatre ordinateurs en série. Bref, une HPI haut de gamme. Belle et intelligente, on frise le gag. Que venait faire le timide Jean dans cette histoire ? Il trouva l’amour pour la première fois de sa vie à 40 ans. Inespéré. Elle lui rendit bien et ils s’engagèrent ensemble dans un chemin de vie commun, semé d’embûches diverses, mais aussi de succès imprévisibles, tant professionnels que privés. Mais cette année 2022 ne ressemblait pas aux précédentes. Jean se morfondait et se trouvait confronté à l’obsession, trouble qui ne pouvait évidemment pas lui échapper. Il prit peur et décida de consulter une consœur. Les premiers rendez-vous débutèrent en novembre 2022. Entretemps, Jean éplucha tout internet, lu de nombreux articles sur la transidentité et, malgré le déni qui l’avait fait différer la prise de conscience, il arriva seul à la conclusion irréfutable qu’il était transgenre. Le combat, les doutes, les autres. Ce fut alors que vinrent les doutes, les peurs, les nuits sans dormir auprès d’une Célie, de plus en plus gênée par l’agitation nocturne de son mari. Que fallait-il donc faire ? Continuer à se dissimuler les choses ? Faire le contraire de ce qu’il essayait de faire chaque jour avec ses patients en les accompagnant vers l’acceptation d’eux-mêmes ? Qu’en pensait donc Arès ? A l’évidence, il préconisa le combat acharné pour la vérité. Il promit à Jean, un soir d’insomnie et tandis qu’il s’était introduit subrepticement dans la maison, d’en discuter avec ses potes Dieux, du moins ceux qui avaient pris la lascive habitude de se pavaner sur les rives sablonneuses du bassin, dont le chef Zeus et quelques déesses dont Athéna et Héra, déesse du mariage et des femmes. Ravis d’avoir un peu de distraction, ils convinrent d’aider ce pauvre mortel à sortir de l’isolement ou il s’était laissé enfermé depuis tant d’années. Jean venait d’avoir 60 ans. Mais était-il sûr de lui ? Pas du tout. Chaque jour, il relisait ce qu’il avait déjà lu des centaines de fois. Chaque fois, se reproduisait le même phénomène négatif. Pourquoi vouloir tout bouleverser à son âge ? Retour arrière et on recommence. Puis, un matin, il reçut une convocation de Zeus lui-même. Pas par la poste, pourtant pratique depuis la nuit des temps, mais par Arès, le farouche compagnon de Jean. Sommé de se rendre à l’île aux oiseaux, uniquement à la force des rames, il fallait ensuite attendre l’ascenseur céleste, invisible des mortels humains mais pas des oiseaux, et se laisser porter vers les cieux jusqu’à un village de nuages servant de bureau aux Dieux désœuvrés. Décontenancé, on le serait à moins, Jean fit donc la connaissance de Zeus, Athéna, Héra, mais aussi Iris, la traductrice, messagère des Dieux de l’Olympe. Ce fut bref. Tu seras femme lui dit Iris et tu devras le révéler au monde en mars, avec la force donnée par Arès. Tu peux t’en aller. Alors, on peut se raconter ce qu’on veut en psychanalyse, en réalité, l’homme obéit à bien d’autres choses qu’à son inconscient ! Il obéit aux Dieux. Bon, je suis d’accord, toutes sortes de Dieux ; Dieu, sous toutes ses formes, la médecine, la psychologie, l’entreprise, la voie du peuple, le bon sens populaire, la pluie et le beau temps, internet, j’arrête. L’homme obéit à tout autre chose qu’à lui-même. Avait-il rêvé ? Peut-être, se dit-il, mais il avait compris le message. Il devait agir, et c’est bien cela qui compte pour nous pauvres mortels. Sinon, comment la belle Arcachon serait -elle sortie de terre ? En fait, notre pensée n’est qu’un réservoir insondable de doutes, de peurs et de freins qu’il faut bien affronter et lever. Jean repris sa barque, solidement amarrée à un piquet de l’île, reçut les félicitations sincères d’un Héron qui passait nonchalamment par là. Comment le savait-il cet oiseau perché ? Jean enregistra définitivement au plus profond de son inconscient qu’il n’aurait jamais réponse à tout mais qu’il pouvait agir sur lui. Le chemin de l’aveu Le temps passait et les enfants observaient bien, lors de leurs rares visites, que l’ambiance de la maison n’était pas au beau fixe. Ils trouvaient Jean taciturne, agressif, distant, et Célie, rapidement sur les nerfs. Il faut dire que sa chute de cheval lui avait laissé les deux malléoles complètement cassées et tout ce qui existe entre les deux aussi ! D’un certain côté, cet accident survenu comme un nième avertissement, avait recentré Jean sur autre chose que ses interminables obsessions. Il devait aider Célie, complètement immobilisée et souffrant le martyr, d’autant qu’elle sut, dès le départ qu’elle en avait pour plus d’un an. Mais l’accident de cheval n’était pas le seul évènement de juin 2022. Victor, le fils de Célie et sa femme attendaient un bébé, qui naquit, quasiment le même jour. Bébé, la nouvelle venue, se trouvait à l’étage au-dessus de sa grand-mère, à la clinique d’Arès ou le Dieu lui-même fut soigné à de nombreuses reprises, vu le caractère du personnage. En venant à la clinique, Jean eut une pensée émue et tendre pour son père, parti avant la tempête de 99, dans cette même clinique. Ombrageux comme Arès, le dernier AVC avait eu raison de son armure défaillante. Il laissa sa femme à Andernos, qui vécut les affres de la mémorable tempête, la laissant souvent apeurée, seule dans sa maison. Elle repose désormais dans sa prairie de Mérignac, après avoir eu la joie de connaître sa dernière petite fille. Bébé était née. Bébé était là. Bébé était absente de la vie de Célie. Elle fit avec, avec cette curieuse tendance à la dissociation, chère aux HPI qui veulent éviter de trop souffrir. Après un été torride sans bouger, Célie put péniblement se remettre sur ses jambes, souffrant lors de séances de kiné, dirigées par une espèce de cerbère aussi empathique et à l’écoute qu’une demi-douzaine de paras dans la casbah d’Alger. Partie en congés, elle laissa à Célie une algodystrophie carabinée comme cadeau de départ. On lui souhaite plein de bonheur quand même. Quand vint l’automne et les feuilles mortes, qui, bien entendu se ramassent à la pelle sur le pré vert, le couple s’enfonçait dans un inéluctable conflit. Jean démarra avec sa psy, qui imposa, dès la première entrevue, un cadre rigoureux et intangible. Célie avait décidé de faire feu de tout bois, moyennant bien sûr les difficultés liées à la cheville. Elle bombardait Jean d’informations sur les intersexes, sur la sexualité, sur la transidentité. Elle demanda à Jean s’il voulait aller voir « un homme heureux » avec Lucchini et Catherine Frot. Un film tendre et juste sur un homme transgenre et son mari. Une histoire d’amour qui finit bien. Mais comment peut-elle savoir ce que je vis, se demanda Jean, sceptique ? C’est impossible à deviner et pourtant on dirait qu’elle a compris. Mais elle n’avait pas compris, du moins pas consciemment. Jean aurait voulu y croire mais non. On pense toujours que nos problèmes, nos peurs, nos peines vont se résoudre tout seul mais c’est rarement le cas. Il faudra agir pour cela, avoir une forme de courage et accepter l’idée de perdre ce qu’on a de plus cher, l’amour de sa femme , de ses enfants, de ses amis et parents proches. Les premières séances de psy furent très rapidement aidantes pour Jean et permirent de renouer le dialogue avec Célie, qui s’était progressivement transformé en deux monologues conflictuels. Jean fut confronté à la réalité, sa réalité, d’une certaine manière rassuré sur le fait qu’il ne souffrait d’aucune pathologie, mais également emporté par un tourbillon inarrêtable une fois le bouton enclenché. Le moment fatidique se rapprochait sous le regard goguenard des coachs de l’Olympe, décentralisé sur le bassin. Cet endroit merveilleux serait-il magique ? Le miracle aura-t-il lieu ? Jean avait peur, de plus en plus peur, seulement encouragé par les autres membres de l’association trans à laquelle il venait d’adhérer pour sortir de l’isolement. L'aveu Le 12 mars 2023, Jean se leva et il sut tout de suite que ce ne serait pas un jour ordinaire. Après de multiples tergiversations, l’ayant amené à renoncer à parler à Célie, le jour était arrivé. Certains évènements se produisent sans qu’on sache vraiment pourquoi. Jean, quant à lui, avait compris que son destin reposait sur lui-même, avec l’aide des truculents Dieux du bassin et peut-être, reconnaissons-le, de sa psy. Mais pourquoi ce jour-là ? Et pas le lendemain ou dans huit jours, personne ne le sait! Célie se leva, et vint, comme à son habitude, s’installer dans la cuisine pour boire son café. Jean, silencieusement assis en face d’elle, sentait la confusion et la tension artérielle monter de plus en plus. Il fallait lâcher. Prendre ce risque majeur de perdre son amour, de bouleverser les vies de ses proches. L’angoisse monta et se déversa. Timidement, avec un débit inversement proportionnel au tumulte intérieur, Jean commença à expliquer à Célie, encore aux prises avec les évaporations du matin, qu’il se sentait femme, depuis toujours, et sans le moindre doute. Elle l’écouta avec toute sa tendresse, son amour, mais aussi bien sûr, sa détresse, face à un pareil aveu. Arès, toujours goguenard, surveillait la scène et informait Iris de l’évolution de la situation. Tsunami. « J’ai pris un mur » dit Célie. Bien entendu, elle ne s’attendait pas du tout à ça et Jean dut immédiatement se rendre compte qu’elle ne pouvait pas savoir. « Je vous aime », reprit-elle en employant le vouvoiement qu’ils affectionnent d’utiliser ensemble. « Mais j’ai pris un mur ». Le reste appartient à ce couple hors norme et le rideau va se refermer pudiquement sur cette formidable démonstration d’amour. Amour encore des enfants, des proches et amis. Mais il ne serait pas juste de ne pas évoquer les réactions d’une profonde humanité, des patients, des membres du club, des voisins. Non, contrairement aux augures anxieuses, les gens ne sont pas si méchants que ça. Au contraire, ils sont formidables. A jamais confiance en l’humanité. Espoir Arès, les Dieux Olympiens et le mythique bassin avaient réussi. Il était devenu Elle. ...Célie est toujours là. Ils s’aiment.
Camille DUSSARRAT
ARES, dieu d'espoir
Nouvelles
— Ecoute-moi bien, Jean-Mickel. Ça ne peut plus durer. Chanter, rêver, toute la journée, ce n’est pas bon, tu sais ? Chanter : Ça ne sert à rien, ça n’apporte rien à la colonie, tu y as pensé ? la colonie, TA communauté... Nous, les grandes aigrettes, on a besoin d’oiseaux forts, d’oiseaux qui pêchent, d’oiseaux qui reconstruisent les nids, d’oiseaux qui rapportent, et pas d’oiseaux qui sonnent ou qui font pouêt-pouêt toute la journée. Même pour toi ! Regarde- toi, pauvre Jean-Mickel... On dirait un petit pigeon des villes, tout déplumé. Tonton Jasper parlait toujours un peu dans son bec quand il était gêné. Il cherchait longtemps ses mots et regardait un peu de côté. Il ne voulait pas qu’on voit son émotion, qu’on devine ses larmes dans le coin des yeux, quand il avait l’impression d’avoir involontairement touché la vérité. La vraie vérité. Celle toute nue qui d’habitude ne se montre jamais. Lui-même en était tout étonné. C’était si rare que ses longs sermons y parviennent, sans se perdre en platitudes ou en clichés. Il rabaissa alors doucement sa patte gauche, pour faire tomber la pression et descendre en émotion. Il commençait à avoir des crampes à force de tenir tout son poids sur une seule patte, en attendant que ses ailes sèchent. — C’est vrai Jean-Mickel que tu as un bien joli filet de voix, je ne dis pas... C’est sûr que c’est joli quand tu ouvres le bec et siffles tes petits airs au vent. Je ne dis pas, tu m’entends ? je n’ai rien dit là-dessus, oh là non ! que ta vieille mère m’en garde, je ne me permettrais jamais de dire quelque chose sur ça... Ta pauvre mère, elle ne me le pardonnerait pas... « Jasper ! Espèce de vieux cormoran solitaire ! Espèce de gros croûton sans oignon ! Qu’est-ce que tu es encore allé raconter ? Qu’est-ce que tu as encore à dire sur mon fils ? Tout ça parce qu’il croasse aussi bien que son père, mieux que toi et que tous les autres oiseaux ! » – C’est vrai, c’est sûr, c’est très beau, même, ta voix, tout ça. Pourtant Jean-Mickel, regarde toi- même : y a-t-il parfois des poissons dans ton bec quand tu l’ouvres pour chanter ? des branches ? des insectes ou des petits vers ? Rien ! de l’air, il ne sort que de l’air, et du son... C’est là toute l’affaire. C’est là où je veux en arriver, mon petit Jean-Mickel. On t’a beaucoup donné. On t’a couvé, on t’a nourri. Ta pauvre mère passe ses journées à pêcher depuis que tu es né. Chaque jour on remet un autre poisson dans ta tire-lire ; mais c’est triste à dire : comme une machine à sous, je ne sais pas comment ta vie digère tout ce qu’on y met, il n’en sort rien, jamais ; tu prends, tu prends et ne rapportes jamais. Tonton Jasper essaya de rabaisser la patte droite, mais dut se raviser au dernier moment. La gauche était restée coincée dans la vase. Il fit un geste avec ses ailes pour se dégager. Ses yeux sortirent subrepticement de leur gond. Il n’aimait pas, qu’on le voit planté sur deux échasses, comme un arbre. — Tu comprends Jean-Mickel ? Je veux dire, où cela a-t-il bien pu passer, tous ces poissons ? En cuicuis ? Regarde-moi dans les yeux, Jean-Mickel. Crois-tu vraiment que toi et moi sommes des machines à fabriquer des sons ? Observe-moi bien le bec et les plumes. Ressemblé-je à un instrument de musique ? Sincèrement ? Non Jean-Mickel, non. Si c’était le cas, voyons... on nous aurait au-moins mis une caisse de résonnance, des hanches ou des cordes, on ne nous aurait pas fait pousser un ventre et des yeux... à quoi serviraient d’avoir des palmes et des ailes ? Nous aurions un tambour à l’intérieur et non pas un pauvre cœur qui ne sait même pas siffler ... Tonton Jasper se tut, pour voir l’effet que son discours avait pu faire. Il était content de lui. Il regarda Jean-Mickel encore quelques minutes sur le côté, fier d’avoir été si clair, encore un peu ému d’avoir été si près de la vérité. Il rabaissa sa patte gauche et leva celle de droite, puis tourna son croupion au soleil. Il parlait mieux qu’un albatros mouillé quand il voulait. Mais Jean-Mickel restait silencieux. Il regardait au loin, vers les forêts. Il replia son long cou et enfonça sa tête entière dans les épaules. Il n’allait pas perdre son temps à répondre à tonton Jasper, à se justifier pour ses cris, pour ses rêves. Ça ne servirait à rien de lui expliquer, pourquoi, au lieu de passer ses journées à faire le piquet dans les marais, il préférait l’imaginaire, il préférait chanter. Car sincèrement, justement, ça le faisait chier, Jean-Mickel, pêcher, tremper ses pattes à tour de rôle dans le marécage, même faire l’échasse c’était devenu relou. Autant c’était drôle au début, d’avoir le droit de faire comme sa mère, comme les autres aigrettes, de faire comme les grands. Autant, c’était toujours la même chose. Lever la patte gauche, puis la droite. Puis la gauche. Ça tournait en rond. Maintenant qu’il avait le droit de voler seul, que sa mère était partie s’installer avec un autre type plus jeune, le cinquième depuis que son père était parti pêcher en Mérique, à quoi ça rimait de survoler toujours les mêmes lieux, regarder en-dessous de lui toutes ces décharges, toutes ces poubelles ? Mêmes les poissons, quand on tentait de les attraper, n’essayaient même plus de se faufiler dans la vase ; ils se signaient de leur nageoire, tombaient raides, fermaient les yeux sans résister et remerciaient le ciel qu’on les retire de leur taudis, espérant que, peut-être, la gorge d’une mouette ou l’air du ciel serait plus carbon-safe que leur bouiboui. Alors, pourquoi chanter ? Pourquoi ne pas rester à cloche-pied la tête plantée dans la merde, et se satisfaire d’être un oiseau : continuer de pêcher, dire merci et se taire ? Tonton Jasper ne tarderait pas à savoir d’où lui venait cette envie de regarder en l’air. Jean-Mickel avait entendu parler d’un endroit, un lieu encore vierge et non recouvert de poubelles, que la nature avait accepté de partager avec tous les animaux et tous les végétaux, seul territoire encore préservé qui n’avait pas été confisqué au nom de l’espèce supérieure, mais où on plantait même des huîtres avec un peu de sel, et leurs fruits poussaient tout seuls entre les roseaux. La première fois qu’il avait appris l’existence de ce lieu, c’étaient de la bouche des hommes. Jean-Mickel avait dû s’approcher d’un de leur chalutier pour pouvoir manger. Comme ses camarades de la colonie, il suivait souvent ces gros goinfres fumants et ferrailleux pour venir discrètement picorer entre leurs dents quand ils avaient le dos tourné ; de tous les animaux de mer, le chalutier cendré était le dernier qui arrivait encore à pêcher autre chose que des pneus. Les deux hommes avaient fait comme s’ils ne l’avaient pas entendu arriver. Il avait pris soin pourtant de chanter pour les faire fuir. C’est à ce moment que Jean-Mickel les a entendu parler du Bassin. — J’te jure, c’est vraiment le paradis là-bas ! Y’a les plages, y’a les canelés, y‘a de l’eau y’a des nids d’oiseau, puis un peu plus bas y’a le bassin, avec des bancs de sable pour s’assoir, et puis y’a même un cœur qui bat à l’intérieur, le « cœur du bassin » qu’il s’appelle... Depuis, il l’avait cherché partout, ce « Bassin » dans lequel la nature avait planté un cœur pour qu’il saigne du même sang que les oiseaux. C’est pour ça que Jean-Mickel continuait de regarder vers le ciel, là où personne n’était encore jamais allé, même pas à aile d’Aurado. Cela faisait deux mois qu’il n’avait pas reparlé à tonton Jasper. Le grand soir était arrivé. Jean-Mickel s’apprêtait à monter sur l’estrade. Ses pattes s’agitaient toute seules pour se donner du courage. Voilà, ça y est. Le moment tant attendu, tant redouté. Il allait enfin pouvoir prendre la parole devant tout le monde. Révéler en public la nature du projet auquel il travaillait en secret depuis si longtemps. Aux anciens, aux anciennes, aux chef.es de tribu, à tonton Jasper, à sa mère. A Marie-Eau d’Ange, surtout. Les convaincre de le suivre. De partir. Quitter enfin ce lieu, abandonner leurs nids, leurs branches sèches, leur litière à fiente, cette réserve désertique qu’on leur avait donnée parce que même les vers de terre n’en avaient pas voulu, oser l’aventure et trouver enfin, plus loin, quelque part, l’espoir, « la mérique ». Dans la salle, c’était la cohue. Toute la colonie était venue entendre le dernier tour de chant du célèbre chanteur. Sur les affiches, il y avait juste marqué « Jean-Mickel se donne en concert ». Ses plumes de héron délavé reluisaient de sueur tellement il était stressé. Il ne savait pas combien de lui précisément il devrait donner. Un public immense l’attendait. Ce serait ce soir son plus beau cuicui, ou son dernier cri. Toutes les aigrettes s’étaient attroupées. Il y avait quelques chevaliers gambettes ; il y avait des mouettes. Il y avait aussi les tribus d’à côté, et des oiseaux de l’île aux rochers. Même quelques martins-pêcheurs avaient daigné quitter leurs fils électriques si douillets, et étaient descendus en V dans leur van migrateur. On les voyait rouler des mécaniques dans la fosse, en train de saccader leurs pas et faire Tss-Tss avec la tête. Au-dessus de la scène, des vautours faisaient les gros yeux, sûrement attirés par le piaillement hystérique des poussins, qu’on avait autorisés exceptionnellement à descendre du nid, avant leur becquée du soir. Jean-Mickel s’avança sur le devant de l’estrade. Son cloaque était sec, ses plumes déjà décoiffées. Il commença à chanter, sans même prendre la peine de s’éclaircir le bec.t; — Il existe, notre paradis, le paradis des grandes aigrettes, je le sais, je le connais ; il est tout là-bas, on ne vous ment pas, le soleil ne nous ment pas quand il s’écrase tout en-bas, mes amis, c’est vers le bas qu’il faut aller, je vous le dis, c’est en Gironde qu’il est, je l’ai vu, croyez-moi. Le bassin, mon bassin, ô mon petit bassin chéri. Marie-Eau d’Ange, qui connaissait toutes les chansons de sa rockstar préférée par cœur, – c’est pour elle qu’il les avait toutes écrites –, fronça légèrement les sourcils. Cet OP triste et sérieux, plus déchirant qu’une râpe, c’était la première fois qu’elle l’entendait. Jean-Mickel jeta un rapide coup d’œil vers elle. Il sentit ses palmes devenir poites. Tout le monde s’était tu. Marie-Eau d’Ange pourrait ne pas comprendre, elle pourrait être surprise devant un tel navet. Il redoutait surtout qu’elle soit déçue et se mette à pleurer, ou pire, qu’elle se lève et quitte la salle, outrée que son amoureux ait encore osé parler de ses rêves avec elle devant tout le monde. La belle femelle ne bougeait toujours pas. Perdu pour perdu, il reprit. — Et tous les poussins, les petits de la terre, ne regardaient plus que vers lui. D’espoir, de ciel promis, ils s’envolèrent. Et le trouvèrent. – Chantez-le avec moi, mes amis ! – Le bassin, ô le bassin, mon petit bassin chéri. Jean-Mickel avait soigneusement préparé le final. Tout était dans le dernier effet. Avant de faire tomber le rideau et s’envoler, il se tourna en arrière vers un vieux coucou qui faisait les basses. Celui-ci se mit à gazouiller des sons graves du fond de la salle. Son roucoulement ne venait pas du cou, mais lui sortait directement des tripes. Quand il expirait ses rou-rouhhs lancinants, ce n’était plus un chant, c’était un cri.
Jean Favre
Ô mon Bassin
Il grava avec sa truelle un trait vertical ; un sourire de satisfaction éclaira son visage. 31 traits se serraient côte à côte sur le ciment frais de ce discret angle de mur. Il venait de réussir son combat, le plus difficile qu'il n'ai jamais mené dans sa vie. Il voulait aller jusqu'à 31. Il aurait pu se contenter de 30, mais en cochant le 31ème sa victoire ne faisait plus aucun doute. C'était un mois complet, un chiffre absolu, son nombre premier. Et le premier de sa nouvelle vie. Il y a un mois jour pour jour il avait pris ce virage qu'il espérait irréversible. Il revoyait ce jour là son médecin lui expliquer avec des mots simples. Il devait l'appréhender comme une « allergie », ne plus toucher cette substance. Il devait tenir un mois. Puis s'offrir une récompense : débuter un projet, un acte, qu'il n'avait jamais accompli. Un vieux rêve. Vieil homme pensa à sa vie d'avant, celle où il nageait dans la rivière de poison qui coulait autour de lui, incapable d'atteindre la berge. La torpeur du matin au soir. L'alcool l'avait noyé à petit feu.&amp;lt;br&amp;gt;Il ne se souvenait plus quand ça avait vraiment commencé. C'était sûrement venu progressivement. La convivialité du verre partagé s'était insidieusement mué en solitude triste. Puis il n'y avait plus eu de partage du tout. C'était en solo que son anesthésique liquide venait le cajoler, l’envelopper de coton, l'endormir, le bercer ; l'emporter par le fond. Son travail l'avait tout de même maintenu à la surface. Enfin entre deux eaux. Il lui devait la vie. Mais sa petite entreprise s'était vite réduite à lui même et sa vielle fourgonnette Citroën hors d'âge. Plus personne ne voulait faire maçon. Ce n'était pourtant pas le travail qui manquait. Partout sur le Bassin on cherchait à élever des pyramides de brique, dresser des murs, détruire, reconstruire. Mais si cette œuvre était valorisée il y a encore quelques décennies, on lui préférait désormais les métiers des écrans et des électrons qui circulent dans du silicium. Plus personne ne voulait transformer des sacs de poussière volcanique en habitat. On préférait les simuler en 3D sur des logiciels de DAO, faire tourner une réalité d’algorithmes dans des machines à portes logiques. Alors quand il fallait transformer l'image de synthèse en matière palpable tout le monde soupirait...., et se tournait vers lui. Un des derniers hommes à savoir manier à la fois les mathématiques, la géométrie, la chimie, et la truelle. Les mains dans le ciment irritant, les narines tapissées de poussière. La main d’œuvre avait fuit, il était resté le dernier soldat bâtisseur. La travail acharné avait concurrencé l'alcool ; deux assommoirs valent mieux qu'un. Pour mieux l'écarter du monde des vivants.Il avait perdu dans la bataille ses rares amis, une partie de sa famille, et surtout son amour propre. L'alcool avait tout dissout, lentement, par capillarité, comme un sucre dans un café. Il espérait secrètement que désormais quelques grains de cette vie puissent repasser la phase de distillation à l'envers. Revenir, les reconquérir. Il pensait à sa petite fille. Mais il n'en était pas encore là aujourd'hui. Les chantiers s'étaient accumulés, avaient pris du retard. Bâtir n'est pas une mince affaire, mais bâtir seul était encore plus difficile. Les bouteilles et les parpaings accumulés l'écrasait tout les jours un peu plus. Et puis il y a eu Oussman. Un ange noir tombé du ciel. Ce type était apparu au milieu de nulle part, avec son sourire et sa gentillesse. Lui qui était plutôt cartésien, y voyait quand même là un événement un peu mystique. Sa rencontre devait être un message. Finalement son salut venait en partie d'un gars qui était encore plus en détresse que lui. Un autre noyé de la vie, mais au parcours différent. C'était il y a 32 jours. Vieil homme s'est dit que le seul signe à apparaître dans ces années de blizzard était à saisir. Maintenant. Carrément. Il n'y en aurait peut être plus jamais d'autres. Le soir même il pris un grand sac, ramassa de pièces en pièces les cadavres de verre qui habitaient sa maison à sa place. Cinq allers-retours au conteneur de recyclage avaient eu raison de ces quilles de silices qui jonchaient sa route quotidienne. En les jetant, chaque « bling ! » étaient une petite victoire sur le passé. Comme si en se dégageant un à un de ces lests, son corps remontait à la surface. En suivant, il avait pris rendez vous avec son médecin. Celui ci l'avait calé entre deux consultations le jour même. Une chance. Il avait dû sentir qu'un patient qui reprends contact après 15 ans d'errements doit avoir un bon motif pour vouloir le voir. Et il avait raison. Ce mois passé avait été une chasse aux fantômes. Un combat silencieux contre des sirènes qui sortent de chaque interstices de sa journée, de chaque fissures de sa chambre. Des moments de sueurs froides, de manques, de frissons, de tremblements tièdes. Il les avait appréhendé comme des mises à l'épreuve. Il les attendait. Il savait qu'il ne devait pas plier. L'ennemi attaquait de partout ; dans sa cuisine, dans sa chambre, sur le chantier, à chaque pause, cherchant à combler chaque silences, chaque pensées tristes. C'est en cela que sans le savoir Oussman l'avait aidé. Tous deux avaient tout de suite sentis qu'ils étaient chacun porteurs d'un fardeau. Mais sans jamais le nommer. Dès que l'un sentait que l'autre flanchait, que son regard baissait, que son visage s'attristait ; alors une attention naissait. Un truc simple. Minimaliste, mais réconfortant. Un sourire, une blague, une vanne, un parpaing repositionné, un niveau corrigé, un ciment enrichi. Le chantier était devenu une entreprise de reconstruction mutuelle. Les coups de truelle et de pelle devenaient bienveillants. Oussman avait beaucoup à apprendre du métier et faisait des erreurs normales de débutant. Mais le corriger apportait à Vieil homme une satisfaction indescriptible. A son apprenti aussi. Cette complicité furtive lui avait permis de passer le cap des nuits blanches et du manque. Durant un mois. 31 jours aujourd'hui.Son premier mois de sobriété depuis des décennies. Il n'y croyait pas lui même en contemplant les 31 gravures. Sa truelle à la main. Fier comme un gamin qui vient de remporter sa première médaille. Il était désormais venu l'heure de la récompense.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span&amp;gt;C'est elle qui l'avait guidé jusque là. Ou plutôt lui : le Bassin.&amp;lt;br&amp;gt;Il aurait tant aimé que « Bassin » soit un mot féminin ; mais il fera avec. Vieil homme salua Oussman et quitta le chantier. Il n'avait pas besoin de lui expliquer.&amp;lt;br&amp;gt;Il prit sa voiture pour parcourir les deux petits km qui le séparait de cette étrange casse nautique. Devant le portail il observa ce lieu atypique. Dans une petite parcelle, à l'abri des bois, s'entassait en plein air un cabinet de curiosité composé de bateaux à moteurs, de voiliers verdis de mousse, de bouées, de moteurs désossés, et d'un bordel indescriptible de pièces nautiques. Comme si la mer d'Aral s'était asséchée ici, d'un coup, en aspirant tout ce qui avait flotté à sa surface pour le jeter à terre. Au fond, une caravane où vivait le maître des lieux. Sur le portail, écrit pompeusement sur une bouée, à l'antifouling orange : « chantier nautique ». Le propriétaire des lieux apparu. Vieil homme vu tout de suite à sa démarche chaloupée que lui nageait toujours dans le poison. Un naufragé de plus. Il essayerai de l'aider en temps utile, mais pour l'instant, il devait se concentrer sur son propre combat. « Salut Vieil homme , j'ai ton bébé ». Ils se serrèrent la main. Il ne se souvenait plus à partir de quand on avait commencé à l’appeler « Vieil homme ». lui qui n'était pas si vieux d'ailleurs. Mais lui voyait dans ce surnom une marque d'affection. Pourquoi d'ailleurs l'adjectif « vieil » aurait une connotation péjorative ? Plus que « jeune » ? c'était une phase de la vie, plus mature. Lui le vivait bien. Le mécano lui présenta son « bébé ». C'était une petite barque sans prétention, refaite à neuf, rafistolée avec un moteur de récup. Elle trônait sur une petite remorque. L'homme avait l'air assez satisfait de son travail ; et il pouvait l'être. Il avait su refaire un petit bateau fonctionnel et fiable en greffant des organes composites récupérés aux quatre coins de son terrain. Vieil homme connaissait les faiblesses du mécano, il avait les mêmes, mais il connaissait aussi ses qualités. Il savait qu'il pouvait prendre la mer en sécurité avec cette coquille de noix. La coque était propre, l'accastillage solide. Il savait qu'entre deux bouteilles à la mer, il avait réalisé sérieusement sa commande. Il attela la remorque à sa voiture et ils se saluèrent.&amp;lt;br&amp;gt;Il se rendit à la mise à l'eau de Cassy, calme à cette saison. La marée était bien au rendez vous convenu sur son calendrier. On pouvait toujours compter sur la Lune, elle, au moins, était fiable. Il descendit la barque à l'eau puis s'installa dessus. L'étrange chaloupage de l'embarcation le fit sourire. Cette fois ce n'était plus l'ivresse, mais la poussée d'Archimède qui le faisait tanguer. La sensation était délicieuse. Un coup de lanceur et le moteur s'ébroua tranquillement. Le bonheur commençait à monter dans sa poitrine sans qu'il ne puisse le contenir. Il remonta le chenal le sourire aux lèvres. Progressivement il quittait les méandres vasculaires pour rentrer dans l'entraille profonde du Bassin. Les terres s'écartaient à gauche, à droite, devant. Le ciel et l'eau s'ouvraient autour de lui. Il croisa un kayakiste qui glissait silencieusement ; ils se saluèrent. C'était drôle comme sur l'eau tous les humains se comportaient en citoyens fraternels d'un même pays. L'inverse que sur terre. Ils devenaient des Gens de Mer. Il se dit qu'il se mettrait au kayak peut être un jour. Ce sera le stade d’après. Pour l'instant, il glissait sous le rythme à deux temps du petit hors bord. Et c'était bon. A mesure qu'il s'enfonçait sur l'eau il avait l'impression de laver son corps des toxines accumulées. Il se retourna et vit que la pointe de Branne était maintenant loin derrière lui. Il était entouré d'eau. Il coupa le moteur. Il était seul. Enfin pas tout à fait. Une gamine en catamaran passa près de lui, le sourire aux lèvres elle aussi, elle le salua en braillant un truc inaudible. Elle pourrait être sa petite fille. Ça y est. Il y était. Il regarda autour de lui. De l'eau. Il écouta. Du vent, des oiseaux, le clapotis sur la coque. Immobile. Serein. Ça y est ; il avait sa récompense : le Bassin. Vieil Homme Il y avait ces pleurs d'enfants, ces cris d'adultes. Les seuls éléments humains a habiller cette nuit d'enfer étaient des clameurs de détresse, de peur, d'angoisse. Ils étaient tous là entassés comme du bétail. Sous les hurlements des hommes armés, ils étaient poussés dans le bateau. Là où normalement cinq, six personnes s'installaient, ils étaient maintenant près d'une trentaine. Et ils en poussaient encore à bord. La barque s'enfonçait toujours plus dans l'eau. Bientôt, le franc-bord, cet espace entre la ligne de flottaison et le rebord du bateau ; cet espace qui délimite la frontière entre la vie et la mort en mer ; se ramenait à une dizaine de centimètres. A côté d'eux, deux autres embarcations subissaient le même sort. Chargées de chair humaine grouillant, s'enfonçant dans l'eau plus que de raison. Un des hommes se tourna vers lui. « toi ! Tu sais comment ça marche ! Mets toi là ! ». Il lui désignait l'espace infime entre les corps humains ou dépassait la manette de gaz du moteur hors bord. Oui il savait comment ça marchait. Il était pêcheur. En revanche les deux autres embarcations allaient être pilotées par des hommes qui n'avaient jamais mis les pieds dans un bateau. Les passeurs montrèrent au loin des lueurs orangées : la côte a atteindre. Puis crièrent « GO ! GO ! » en menaçant de leurs armes. Ils n'avaient pas pris la peine de les accompagner, ils savaient vers quoi ils les envoyaient. Il tira sur le lanceur. Le moteur de 25 chevaux gronda et son embarcation de mort, chargée de regards apeurés tournés vers lui, s'élança dans la nuit. Il entendit derrière lui les deux autres barques démarrer. Il ne les revis jamais. D'ailleurs, personne ne les revis jamais. En moins d'une minute, il venait de se retrouver pilote d'une barque de clandestins. Une quarantaine d'âmes à son bord. Sa responsabilité maintenant. Il devenait à la fois passeur et clandestin. En tout cas gardien de leurs vies. Il pointa la barre vers Gibraltar. La houle commençait à monter, la mer à se dégrader. Les lumières de la côte tant désirée clignotaient, leur photons interrompus par les murs d'eau qui rampaient devant eux. L'eau rentrait dans l'embarcation, se mêlait à l'essence, leur brûlant les pieds. Les hommes écopaient avec des bouteilles plastique découpées, les femmes serraient les enfants contre elles. C'est son expérience de pêcheur qui les maintennèrent en vie. Sa connaissance de la mer, sa façon d'attaquer les vagues à 45 degrés, d'équilibrer le bateau. Les autres n'eurent pas cette chance. Et puis les lumières ont grossi. La côte est devenue plus palpable. Les lumières des routes formaient des guirlandes. Elle était là leur terre promise. Il visa un endroit plus sombre pour accoster. Au contact de la côte les vagues se mirent à déferler ; dans leur dos cette fois. La barque, à chaque surf, prenait une vitesse sinistre. Et puis un grand bruit. Ils venaient de toucher la côte. Instantanément, dans un mélange de panique et de délivrance, tout le monde se jeta hors de la barque et couru sur la plage. En direction du Nord. En moins d'une dizaine de secondes, il se retrouva seul, éberlué. Il pris son sac plastique, son seul bien, et fila à son tour vers le Nord. Le mois qui suivi fut un mois d'errance, de petits boulots, de nuits passées caché dans des fossés, d'angoisse. La peur de se faire prendre, de tout perdre à nouveau. Il lui fallait suivre son but. Il avait trouvé une carte postale de France avec des étranges maisons en bois sur pilotis, posées sur l'eau. C'est là qu'il arrêterai sa fuite, il le savait. Il remonta l'Espagne ainsi. Puis il pris le chemin de Saint Jacques de Compostelle à l'envers. A contre courant des pèlerins avec leur coquille fixée au sac à dos. C'était son pèlerinage à lui. Après des jours de marche et des nuits de cache, il arriva sur un sentier bordé de bassins abandonnées. Des oiseaux migrateurs, comme lui, y trouvaient un refuge. Il savait qu'il était arrivé à destination. Maintenant il lui restait une épreuve : travailler, faire ses preuve, gagner la confiance, et peut être des papiers. Sur le littoral il tomba sur une maison en construction. Un homme travaillait seul à monter un mur. Il hésita puis s'approcha de lui. L'homme ne le remarquait pas. Avec son fort accent ils se lança : « Bonjour Monsieur ». « Je cherche du travail, je sais un peu faire la maçonnerie ». L'homme leva les yeux vers lui avec le regard de quelqu'un qui vient de voir le messie, un extraterrestre, ou les deux réunis. Il le fixa ainsi pendant une longue minute sans rien dire. Oussman L'adolescente pédalait à vive allure sur la piste cyclable. Les cheveux dans le vent. Ses parents s'étaient encore engueulés toute la soirée la veille. C'était vraiment une journée de merde pensa t- elle. Et puis ce matin, paf, interro surprise en math au collège. Un grand moment de solitude. C'était vraiment une journée de merde. Ce coup-ci elle le pensa si fort qu'elle le dit à voix haute. Ses parents avaient eu une seule bonne idée dans leur vie : l'inscrire au club de voile le mercredi aprèm pour s'en débarrasser. Ils lui avaient aussi donné un nom de vent de l'hémisphère Sud. Elle ne savait pas ce qui leur était passé par la tête. C'était donc son échappatoire de la semaine. En arrivant au club nautique, elle sentit le vent frapper son visage. Elle ferma les yeux et pris une grande inspiration. C'était bon. Quand on fait de la voile on développe un sixième sens : celui de ressentir qu'on perd son temps sur terre lorsque le vent souffle. Aujourd'hui il était bien là, et grossissait. Elle entendait le claquement des drisses sur les mats. Tout le monde s'affairait à gréer les voiliers. L'excitation était palpable. ça s'ajoutait à ce truc qui brûlait dans son ventre. Elle prit dans la voilerie les différentes pièces du gréement et posa son dévolu sur un Hobbye Cat. Elle avait envie d'un cata ; et seule. A côté d'elle un garçon timide gréait son petit monocoque, c'était Gaëtan. Elle le trouvait sympa et mignon. Elle le salua en esquissant son premier sourire de la journée. L'eau montait, le vent aussi. Les voiles faseillaient. Les bateaux côtes à côtes ressemblaient aux oriflammes d'une bataille médiévale avec leurs voiles colorées battantes.&amp;lt;br&amp;gt;Puis elle sauta sur le trampoline du cata, borda son écoute, et partie comme une torpille. Très vite elle laissa les autres sur place, pris de la vitesse. C'était grisant. En vent de travers la vélocité augmentait encore. Elle filait sur l'eau. Bientôt les molécules d'eau divorcèrent de la coque de résine et elle se souleva en rappel à un mètre de haut. Le Hobbye gîtait. C'était génial. Elle poussa des « Youhouhouuu ! » d'extase. Comme un cri de guerre. Elle volait désormais. La baume sifflait au dessus de sa tête comme une guillotine à chaque virements de bords et empannages. Elle évitait ce sabre mortel en baissant le tête au dernier moment. Elle hurlait à son coéquipier imaginaire ses instructions « Paré à virer ? Virez ! » « Paré à empanner ? Empannez ! » « Youhouuuu ! ». Vent arrière, elle pris le cap vers la pointe de Branne, et toujours plus de vitesse. Elle réfléchirai plus tard à comment rentrer. Là elle était libre et c'était chouette. Seule au loin une barque avec un homme à bord, il aurait pu être son grand père. Elle passa à côté en poussant à nouveau son cri de guerre. Deux sillages parallèles restaient gravés dans l'eau. Celui de la barque et un autre. Comme deux coup de griffe dans le Bassin. Elle vira pour les couper en travers et rajouter le sien. ça faisait comme le symbole mathématique « différent » ces trois sillages dans l'eau. Elle trouva ça marrant. Finalement, c'était une chouette journée. Alizée
Yannick HERAUD
Le même bateau
- Mais comment puis-je faire pour me sortir d’un tel piège ? L‘endroit connu de tous pour arracher bas de lignes de pêche et filets ne se revendique pas lieu saint pour nager. Située dans l’axe du joli port ostréicole de Piraillan et de l’île aux Oiseaux, l’épave du Jeanne Blanc abonde de naissains * et d' esquires* tant convoités de part sa proximité avec les terres vaseuses* émergeantes à marée basse dans les parcs à huîtres. Les jours bénis, les tâches noires* affleurant la surface attirent embarcations de petits patrons-pêcheurs qui tendent à souhait d’innombrables aumaillades* dans les esteys. A l’aurore naissante de ce premier juillet, Raie-Brunette , petite femelle poisson, avide de plaisir de se rouler dans la vase n’a pu empêcher que sa nageoire gauche se prenne dans un inattendu esquerey *retenu à l’étrave de l'épave, de plus gorgé d’hameçons saillants. - Alors petite, tu sembles reine dans l'art de t'attirer des embrouilles ! lui dit avec ironie Monsieur Maigre, catégorie gros poisson de caractère connu pour quelques combats ou plus d'un de ses adversaires tel Monsieur Maquereau s'en est trouvé borgne. Territoire sous haute protection, qu'on se le dise ! - Combien de fois faudra-t'il te ressasser que nager à proximité de filets, c’est se jeter dans les filets ! Sans compter le danger des piquets *! Inconsciente ! - Monsieur Maigre, je vous prie de m’excuser. Je n'ai pas vu ... - Silence ! Et vous les pouffeurs de rires et autres "tacots" taisez-vous aussi ! somma- t'il." Pas un curieux présent n’osa défier Monsieur 60 kilos. Quelques grimacées de certains cachés derrière son immense nageoire trahissaient que ce n'est pas l'envie de retoquer le “Gros” qui devait manquer. - Tu t'exposes au danger ! Combien te faudra- t'il de temps pour comprendre? Ne t’a- t’il pas servi de leçon lors d' une de nos sorties en face de la Plage de l ' Horizon de constater que certains touristes excessifs et sots de naiveté se mettrent en péril à défier rouleaux et baïnes lors des malines * ? Quelle bande d’inconscients me faites vous tous ! - Monsieur Maigre, ... Les yeux du redresseur de tort s'ouvrirent si grand qu'il faillirent déformer leurs cavités.&amp;lt;br&amp;gt;Il vociféra : " Le danger ! Comprends-tu le danger !” - Mais ... - Taistoi ! Tu n'as pas vu! une raie qui ne voit pas! Une raie qui ne voit pas !! - Veux tu me faire croire que tu es hypermétrope ? De si beaux yeux or en forme de coquille Saint-Jacques ! Tout quidam prierait Dame Mer pour être doté d'une telle vue et toi tu ne vois rien ! Un court instant passa, sa colère sembla s'atténuer. Il se reprit d'une triste voix : - Ah , si tes parents étaient encore de ce monde, que ne t’auraient t’ils sermonnée ! “Bah” dit t'il en hochant doucement la tête . “Pauvre petite . Il est vrai que sans tes chers parents, tu n' as point bénéficié d’éducation. Ah ! les pauvres ont disparu ensemble le même jour, un si beau couple. Fous d'amour l'un de l'autre qu'ils étaient. Un dimanche de promenade au trou Saint-Yves, devant la jetée de La Chapelle, l'endroit de nos valses éternelles. Ah quel malheur !“ “Qui pourrait comprendre que l’imaginaire de son enfance, dénudé de tendresse et d’amour, se soit souvent atrophié dans notre cruel monde d’adultes “ pensa t'il. Le corps de Raie-Brunette se mit à trembler, consterné par ces propos qui lui rappelèrent sans ménagement la solitude de ses très jeunes années. Imitant le regard noir réprobateur d’un pasteur envers ses ouialles, Monsieur Maigre se tût , disséqua la situation afin de déprendre Raie-Brunette de son piège. Il s’avança prudemment, esquiva avec lenteur quelques hameçons retords, puis avec sa bouche protrusible commença à délier le filet nuisible. Le même jour, la plage de Bélisaire notait d’ une exceptionnelle activité. Elle fût assaillie dès potron-minet par une foule bigarrée. Une organisatrice habillée fluo s'égosille dans un haut-parleur depuis l’embarcadère. Des fanions bariolés accrochés aux luminaires de la jetée, des publicités nautiques en tout genre, la grande tente blanche des passionnés du Bassin , la tente orange vif des Sauveteurs-en-mer, la tente des inscrits et inscri- tes, l’ensemble situant l’endroit du bassin où il faut être aujourd’hui. Le Cap-Ferret ! Pénètrent depuis huit heures du matin dans deux vestiaires les participants hommes et femmes en survêtements et en ressurgissent méconnaissables en combinaisons de néoprène noires luisantes ou orange, fluo parfois, gilets numérotés, paires de palmes aux mains, bonnets de nage imprimés de l’édition de l'année, bien ficelés par des masques ou paires de lunettes de plongée indispensables. Des familles médusées d’assister à la future prouesse de leur proche-héros, trois scooters des mers et quatre bateaux ayant accosté à l’ancre sur la plage, d’autres engins flottants et tourbillonnants moteurs au ralenti à cinquante mètres du sable, s’enjoignant de cris entre capitaines. Le curseur du haut-parleur à fond, l’organisatrice s’égosille des premières consignes inaudibles tant le vent d ' ouest projetait les directives vers l’intérieur du bassin et des terres. Le grand chahut. Pas de matinée grasse pour les riverains. C’est la Grande Messe Nautique. La Transocéa ! Jetée de Bélisaire - Jetée du Mouleau. Cinq kilomètres à la nage avec marée, avec ou contre-courant ! Rien que ça ! Un mouvement intempestif des jambes trahit la nervosité de Moana. Assise sur le rebord en béton de la rampe de mise à l’eau, elle éprouve un léger détachement en se concentrant sur sa respiration. Pour certains les mâchoires claquent ostentatoirement, "ce qui laisse un avant-goût sur la température de l'eau" pensa- t'elle. Moana prête oreille à certains nageurs qui se racontent leur traversée passée. Elle est bien consciente d’avoir progressé en deux ans. Elle a sacrifié ses repas du midi parfois du soir par d’innombrables couloirs en piscine. Rigueur et travail l’ont faite passée de “débutante” à “confirmée”. Malgré les encouragements, face aux courants, elle sait que l’effort à fournir sera bien plus important. Elle regarde vers Le Mouleau. La réverbération du soleil sur une légère brume affleurant la mer l'empêche de le percevoir. La traversée lui semble être d' une distance astronomique. 8H45. Appel Haut-parleur “ Exercices d’assouplissement pour tous”. 9H15. Appel Haut-parleur “ Distribution des bouées en Eaux-Vives”. Dernières recommandations de prudence de l’organisatrice :&amp;lt;br&amp;gt;- Si vous avez des crampes passagères, levez le bras, un secouriste en canoé kayak à proximité vous permettra de vous stabiliser quelques minutes. - Si vous n’arrivez plus à récupérer votre respiration, idem. - Vous suivez toujours le groupe. Toujours l'axe du groupe ! - Si vous ne pouvez plus, n’insistez pas ! Je répète : N’insistez pas ! - Levez le bras, un kayak vous ramènera en sécurité vers un bateau. Servez-vous de votre bouée Eaux-vives pour flotter. - Pensez sécurité ! - Maintenant le Bassin est à vous ! La joyeuse horde des participants s’exclama d'un tonitruant “Hourra!". 9H30. Tous à l’eau. Départ. Tels les jeunes mulets frénétiques dans leurs ballets au printemps, tous les nageurs se mirent à l'eau, en quelques secondes formèrent un îlot gigantesque orné de taches orange-fluo dessinées par leurs bouées de secours . Un sterne survolant l'endroit, sidéré, crut voir une raie manta géante. Les atlètes commencèrent à nager le long du débarquadère. Dans cette procession grouillante, il fut impossible aux familles de reconnaître leur héros. Bonnets identiques. Rien d'autre ! Quelques enfants contrariés rouspillèrent entre eux. Ils évitèrent les piquets, commencèrent à dépasser la jetée qui jaillit dans le Bassin. L 'axe de navigation apparaissait. Moana se sent à l'aise . Bien qu'elle reçoive sur ses mains quelques coups de pieds du nageur précédent. Elle s'écarte un peu. Vers les cent mètres le groupe s'effila légèrement, permettant à chacun de nager aisément. Moana est heureuse. L'eau est son élément depuis toute gamine. Ses parents , de crainte qu'elle ne tombe dans la piscine dans leur jardin lui avaient offert des cours de natation vers ses 6 ans. Elle se souvient de cette période, éprouvant à chaque fois le même sentiment originel de plénitude quand elle rentrait dans les bassins. Glisser sur l'eau, non pas nager mais bien glisser sur l'eau. Être un poisson. Fendre l'eau. La sentir caresser son corps. Maintes fois elle avait exhibé ce ressenti de joie à ses jeunes copines de nage. Certaines rigolaient, d'au- tres qui n'y comprenaient rien. Etonnés par tant de raffut, les poissons du bassin filèrent sur le lieu d'agitation. Au delà des cinq cent premiers mètres , une distance notable se creusa entre nageurs aguerris au courant et nageurs entraînés en piscine. L'effet de la marée. Pas trop fort mais assez vicieux pour obliger Moana à nager en crabe. " Quelle galère , mon corps va vers le Pilat , ma tête vers Le Mouleau" pensa- t'elle. Elle accéléra légèrement le battement de ses pieds palmés. - Oh ! comment peuvent t'ils nager aussi mal ? Les Êtres de terre sont bizarres tout de même. Ils cherchent constamment à nager vite. C'est pourtant facile d'aller vite ! s'exclama Raie-Brunette. - Tu n'as qu'à regarder ! lança Monsieur Dorade ." Ils n'ont pas de nageoires. Ils s'en fabriquent et se les mettent pour nous imiter sur leurs tiges qui dépassent. Ah, Ah! des Êtres de terre qui se prennent pour des poissons ! Fais attention Raie-Brunette à ne pas t'approcher trop près de leurs engins Coupe-eaux, ils pourraient te découper en mille morceaux !" Malgré ce conseil entendu par tous, quelques poissons effrontés jouaient très près des embarcations. Une petite houle s'était levée avec la marée montante et ces petites vagues rendaient plus pénible la traversée. Le crawl effectué par Moana lui avait permis de dépasser le profond chenal. Peu habituée à ce genre de résistance, elle s'efforçait de garder le cap. Un début de raidissement musculaire parcourut ses jambes. " Je ne vais pas avoir de crampe, tout de même ! Je la sens arriver " pensa- t'elle. Elle ralentissa le battement ciseleur de ses jambes pour mouliner plus vite avec ses bras. La rotation devenant plus rapide, les poumons de Moana exigèrent plus d'oxygène. Les " allez Moana , on tient " venus des proches bateaux se transformèrent en encouragements à peine audibles tant l'eau brassée regurgitait de ses tympans. - Ne vous approchez pas trop des planches Coupe-eaux, toi aussi Raie-Brunette! hurla Monsieur Maigre. - Comme c'est étonnant! Les Hommes de terre pour nous imiter prennent de l'air pour le souffler dans l'eau ! fit remarquer Raie-Brunette dont la particularité est de bénéficier d'une ouie très fine. - Ils nagent si mal ! - Chut ! Regardons-les , ils vont bien finir par renoncer, la mer n'est pas leur monde “ dit Monsieur Maigre. Lessivée par l'effort, Moana ne put que prendre une pause sur un kayak. Elle y resta quelques minutes, le temps que la crampe naissante passe. Le sauveteur fut surpris de la voir si essouflée. - Voulez-vous arrêter là ? - “Non , je continue ". Elle prit repos des pieds sur le flotteur, se relança en exerçant une poussée vive pour gagner quelques mètres au Bassin. Au trois-quart de la distance, Moana ne pouvait plus respirer normalement. Son corps devenait une masse lourde, traînarde. Elle avalait régulièrement un peu d'eau de mer. Elle doutait quant à réussir sa traversée tant elle était épuisée. Elle avait atteint sa limite.; L'ouie de Raie-Brunette percût ce tragique essoufflement. - Chut ! vous entendez ? Vous voyez la Femme de terre là-bas ? Elle recrache de plus en plus d'eau dans l'eau au lieu de l'air! Je ne peux pas la laisser se remplir d'eau ! Je vais l'aider ! - Ah tu vas l'aider ? Et comment vas tu t'y prendre pour l'aider. De quoi te mêles-tu ? c'est une affaire de Femme de terre ? ironisa Monsieur Maigre. - Je vais vous montrer ! lui rétorqua Raie-Brunette. Prenant son courage par nageoires, elle fonça sur les Coupe-eaux , en choisit deux bien distants, telle une aiguille serpenta à toute berzingue entre eux, ralentit sa nage, s'approcha de Moana , se posta à deux mètres puis analysa la situation. - Je ne peux pas la pousser, elle va m'assommer avec ses longues tiges ... Je ne peux pas la tirer, elle est mons- trueuse .... Je vais la porter ! C'est ça, je vais la porter ! dit- t'elle. Elle frôla le corps de Moana, s'approcha par dessous, puis avec une infinie délicatesse se colla des deux nageoi- res au ventre de la nageuse. Moana ne sentit rien tant sa combinaison était épaisse. le mucus du poisson faisant office de joint de dilatation. " Ouf ! Allez !" Raie-Brunette poussait de toutes ses forces. " Allez !". Les poissons médusés écarquillaient leurs yeux. Ils découvraient pour la première fois de leur vie un poisson scotché à un Être de terre. Le corps de Raie-Brunette secoué de toutes parts ressemblait à un cerf-volant par fort vent d'ouest. - Ce n'est pas possible ! Je ne peux pas ! Je n'y arrive pas ! elle est trop lourde ! Venez m'aider ! Allez vite ! A l'aide !; Monsieur Maigre un temps pétrifié de voir sa protégée se mettre en galère, se ressaisit et ordonna d'une voix de général à un banc d'une cinquantaine de chinchards proches de lui : - Allez l'aider ! Bon sang , allez l'aider ! Les poissons n'écoutèrent que leur peur pour Monsieur Maigre, imitèrent le parcours de Raie-Brunette, la rejoignirent. - Placez-vous très doucement en bloc sous mes nageoires, faisons bloc, une dizaine au premier contact, voilà c'est ça ! les autres placez-vous en couches par dix sous vos collègues ! guida Raie-Brunette . - C'est exactement cela. Allez ! On pousse ensemble vers le haut, ne dépassez pas mes nageoires. A mon signal : Hop ! On pousse ! Un flottement aussi soudain qu'inattendu donna à Moana l'impression de se sentir progressivement délestée de son poids. Sans pouvoir comprendre. Elle avait tant avalé d'eau que l'idée de renoncer avait cheminé sur les cinquantes derniers mètres parcourus. Ce jaillissant sentiment de béatitude donnait enfin raison à ses longs entrainements de couloirs de piscine, à ses confidences jeune à ses amies. Sa tête pleine d'étoiles, son corps ondulant avec légèreté, elle glissait dans l'eau. Elle avait enfin la certitude d'avoir été dans une autre vie un poisson. Elle reprit une nage parfaite, mouvements de pieds en harmonie avec mouvements des mains. Récupérant son souffle naturel sur chaque mètre gagné dans cette course. La proche arrivée jaillissait comme une simple formalité. La forte pression qu'exerçait les chinchards sous le corps de Raie-Brunette obligeait celui-ci à un léger écrasement contre le corps de la Femme de terre. Dès que la Femme de terre nagea calmement, sans geste brus- qué, Raie-Brunette perçut une onde faire osciller tout doucement ses nageoires, puis canalisant sa concentration, elle entendit un fort battement. Un son identique revenait dans ses rêves les nuits seule cachée dans les algues du Bassin. "Bong.. Bong .. Bong ". Chaque "Bong" la ballottait. La surprenait. Elle sursautait. Elle comprit. La douceur du glissement des deux corps joints battant à l'unisson, le mucus qui les liait, les collait, les assemblait s'inventât dans l'imagination de Raie-Brunette comme une corde tissée entre elle et Maona. Son pouls s'accéléra. "Bong ... Bong". Des larmes naquirent sur ses joues. - C'est .. c'est le battement d'un coeur ! C'est un coeur ! Maman ? C'est toi Maman ? On m'a tant raconté que les Femmes de terre se réincarnaient en sirènes ! Que l'inverse était tout aussi possible ! C'est vrai ! C'est Maman ! Elle veux me parler ! Elle a quelque chose à me dire ! Je t'écoute Maman ! Je suis là ! Contre toi ! Maman chérie, je suis si heureuse ! Ton coeur parle au mien. Ta douceur me berce. Je t'ai tellement cherchée. Tu es là, je te sens, toi le battement tant rêvé au long de toutes ces années sans toi, sans Papa. Enfin ! Donne-moi toutes tes caresses, toutes tes caresses de maman qui m'ont tant manqué ! J'en veux ! Je suis là ! Prends-moi , mange-moi si tu veux , dévore-moi ! Je me veux toute à toi Maman , toute ! Sereine comme jamais, se promenant deux jours plus tard dans le trou en face du Mimbeau au Cap-Ferret, Raie- Brunette ressentit une vive douleur lui harponner la lèvre supérieure. Instatanément l'eau se transforma en un couloir vertigineux baigné de rais de lumière hypnotisante. En une fraction de seconde, elle se rappella ce que Monsieur Maigre,veillant certains soirs à la rassurer avant qu'elle ne s'endorme seule, lui avait maintes fois raconté :“ tes parents sont au paradis des poissons. Les Portes de la Mer s'ouvrent pour les poissons qui auront su se tenir sages, on ne sait pourquoi il n'y a que les sardines qui restent punies. Le jour venu, il te faudra traverser la Lumière." Curieusement , elle se sentit apaisée. Elle eût une vision. " J'arrive, Maman. Donne-moi ta nageoire quand je passerai près de toi Je t'en prie, ne m'oublie pas une deuxième fois ! . Naissains : Larves d'huîtres . Esquires : Crevettes du Bassin . Terres vaseuses : appelées aussi Crassats . Tâches noires : appelées aussi Négresses . Aumaillades : filet à trois nappes de tailles dégressives pour la pêche des petits rougets ou soles Esquerey : filet à crevette Estey : Petit chenal dans les crassats Piquets : appelés Pointus , petits piquets de 50 cm destinés à éloigner les poissons plats prédateurs des huîtres Malines : Grandes marées
Philippe DUPUY
Donne moi ta nageoire
Nouvelles
Marie Marie referme soigneusement le colis qu’elle vient de préparer. Elle ajuste le foulard qui couvre sa tête nue, note machinalement l’adresse du destinataire : Ama Baïta, 33120 le Moulleau. Elle termine la lettre d'instructions qu’elle donnera à son avocat et imagine sa surprise à la lecture de la destinataire. Mai 2023 Vendredi Gabriele Remontant l’allée, je me souviens... Je me souviens de mes tongs à pâquerettes, du sable roux qui pénètre entre mes doigts de pied, des petits cailloux ronds qui roulent, des épines de pin qui viennent ajouter des intrus... Vivement la plage et son sable fin... au diable les tongs et les graviers ! Un virage, un autre et enfin je la vois, comme dans mes souvenirs, peut-être un peu plus petite mais qu’importe ! J’ai le coeur qui bat vite... L’émotion me gagne, elle est toujours là : la maison de mon enfance. Les jardinières débordent de géraniums... pour éloigner les moustiques comme le disait ma grand-mère quand elle déposait, pour compléter son arsenal anti bestioles, sur nos tables de nuit, un coton imbibé d’huile essentielle de citronnelle. « Sur l’eau, exquise maison basque, six chambres, salon, salle à manger, un lieu enchanteur pour des vacances familiales hors du temps sur les plages du Moulleau », voilà comment une agence immobilière aurait pu la décrire. Alors même si j’ai dû dire adieu à nombreux de ses occupants, leur souvenir tout à coup m’envahit. C’est comme si... Comme si à chaque instant ils allaient entrouvrir une fenêtre et m’appeler. Je perçois le bruit sourd du gong nous invitant à passer à table. Mes sens sont aux aguets... prêts à tout... le désir et l’imaginaire s’entremêlent. La force de l’esprit... j’entends leurs voix, respire leurs parfums, ils sont là avec moi. Comme j’aimerais avoir cinq ans et revivre ces doux moments. Je presse le pas, impatiente. Je serre entre mes doigts le trousseau donné, il y a quelques minutes, par l’agent immobilier. « Vous avez de la chance, un désistement de dernière minute. La villa est grande, vous comptez y séjourner seule ? ». Pensive, je mets du temps à répondre : « non, des amies arrivent, nous serons trois... non quatre ! », voilà mon unique réponse, il ne compte pas lui, alors pourquoi perdre du temps en banalités. J’arrive sous le porche de la villa, la serrure n’a pas été changée, il suffit de tourner la clé à l’envers et de donner un petit coup d’épaule pour l’ouvrir. Je referme la porte délicatement, retiens mon souffle, les meubles ne sont plus là mais la lumière est la même. L’imposant escalier n’a pas bougé et donne à l’entrée son caractère majestueux. Je ferme les yeux et tout me revient en mémoire, les fauteuils Morris, le tapis, la pendule à l’inimitable sonnerie de Big Ben. Cette sonnerie, ma madeleine de Proust à moi. Si bien qu’à Londres, lorsqu’elle retentit je m’imagine sur le bassin ! N’y tenant plus, je me dirige, fébrile vers le salon pour la voir... j’en suis sûre, elle n’aura pas changé... ma vue du bassin : les pins, le Perret, la plage, la mer, les bateaux aux corps morts...le combo parfait. D’instinct, je me positionne pour avoir dans mon champ de vision le cadrage idéal, celui imprimé dans ma mémoire. Oui, comme toujours c’est parfait. Rapide, j’envoie un bref message à notre groupe, les quatre redoutables :&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;« Rendez-vous demain à la gare d’Arcachon, je viendrai vous chercher, soyez à l’heure. N’oubliez pas Marie sera avec nous ce week-end ! » Je sais qu’elles attendent le top départ. À l’autre bout de la France, leur téléphone a dû faire sursauter les jeunes femmes. Samedi Gabriele Depuis ce matin je m’active... Chambres, lits, salles de bain, tout doit être parfait. Laura et Aurore seront à l’étage, la grande chambre jaune du rez-de-chaussée sera réservée à Marie, je m’installerai en face, dans mon ancienne chambre. Incroyable, son papier peint n’a pas été changé, le décor champêtre de la toile de Jouy vieux rose m’invite comme toujours au vagabondage. Mon regard s’attarde sur mon vieux sac de plage, celui que je traînais sur la plage adolescente. Aurore Il est huit heures, Aurore jette un bref coup d’oeil à son salon. Il est parfait, parfaitement décoré, parfaitement rangé, le tout dans un style bohème chic, et pourrait faire la Une d’un magazine de déco ! Mais tellement triste depuis que le rire des enfants ne résonne plus... ce calme, cette angoisse... Elle retient une larme...se ressaisir, ne pas laisser la moindre place à la mélancolie, ni aux regrets. Et puis cela fait maintenant deux ans que Paul et Suzanne sont en garde alternée. Blonde, élancée au look casual chic, elle sait capter les regards même si aucun n’a trouvé grâce à ses yeux depuis le départ de Tom. Entre son taf de commerciale et ses enfants, elle n’a pas vraiment le temps. Et puis Nevers est une toute petite ville... Laura Laura, la rousse... et oui, même si elle préfère se présenter en tant que blonde vénitienne, elle l’admet de temps en temps à demi-mots... elle est plutôt rouquine... Laura aux tâches de rousseur, Laura qui ne s’arrête jamais. Une agence de com, un mari, une fille : Emma, son portrait tout craché, un appartement à Paris, une maison à la campagne, dans le Berry évidemment pour voir les filles ! Sur le quai de la gare, Laura rajuste sa coiffure, resserre la ceinture de son trench, grimpe dans le train. Pas question de louper le premier rendez-vous à Tours. Gabriele Me baigner, je n’ai que cela en tête. Alors que je suis sur le sable, prête à profiter de ce moment, de mon moment... A la recherche d’une fouta, je fouille la poche de mon vieux sac de plage, et tombe sur une vieille enveloppe toute froissée. Je reconnais l’écriture de Marie : « serment du bassin ». Cinq minutes plus tard, assise face à la mer je replie soigneusement la feuille de cahier d’écolier, la replonge dans mon sac, une larme coule sur ma joue. Je repense à nous quatre, enfants, penchées sur ce cahier... Le paysage est apaisant, les bateaux dansent au bout des corps morts, la mer est bleue, des reflets argentés couleur « banc de sardines », comme je me plais à le raconter au téléphone à mon amant du moment. Les voiles colorées des planches se mêlent à celles des voiliers, voltigent telles un ballet de papillons devant mes yeux embués de larmes. Je murmure : nous serons bien quatre ce week-end... Aurore-Laura Sur le quai de la gare de Tours, telles deux lycéennes, Aurore et Laura se sont jetées dans les bras l’une de l’autre en hurlant et gesticulant ; une vraie danse de sioux maugrée un passant grincheux ! Après ce charivari vient le temps des questions : comment vas-tu ? Ton taf ? Tes enfants ? Les réponses et questions s’entremêlent. Après ces questions nécessaires mais plutôt futiles, le ton s’assagit et la partie commence enfin. « - Tu sais pourquoi Gabrielle a tenu à avancer notre week-end annuel ? demande Aurore. - Non, répond Laura, elle m’a juste évoqué un problème d’agenda, mais je crois qu’elle voulait surtout honorer notre serment». Un ange passe, et les deux amies reprennent le flot de leur conversation. Gabriele Après un bref tour chez Boirie, l’ancestrale épicerie du Moulleau, où je fais le plein de fruits, légumes et bonnes bouteilles, je prends ma voiture direction la gare. Laura et Aurore m’attendent déjà sur le parking et notre joyeuse bande prend la direction du Moulleau. Des « Oh ! Ah! Toujours aussi magique la vue ! » ponctuent l’arrivée d’Aurore et Laura à la villa. Après avoir montré à chacune sa chambre, je m’octroie un repos bien mérité... dix minutes face à mon bassin, jamais non vraiment jamais je ne me lasserai de cette vue : mer scintillante, cris des mouettes, odeur des pins... Mon repos est de courte durée, très vite les doutes m’assaillent... La magie va-t-elle opérer ? Mes pensées s’évadent : Un taxi quitte l’allée, c’est Marie ! Marie qui fidèle à son amour pour le spectacle nous fait une apparition théâtrale. Capeline beige sur la tête, grand châle sur les épaules...une star ! Alors, mon comité d’accueil ? Tout se perd ici...lance-t-elle à la cantonade. Déjà les filles dévalent l’escalier criant « Marie ! Marie ! » Elles s’étreignent longuement. Un voile mélancolique passe sur mon visage, puis n’y tenant plus, je m’exclame « Dix-huit heures ! Apéro ! Mojito ! » Aussitôt dans un brouhaha, les filles dansent direction la cuisine où chacune s’active. Quelques minutes plus tard, assises dans les transats aux rayures bayadères (on est dans le pays basque, non !), un plateau à leurs pieds débordant de victuailles interdites : 4 Mojitos, bols de chips, saucissons, les filles papotent. Marie ne touche pas à son verre. Laura se lève et lance le premier toast : « à nous les filles, à nos amours, à toi Marie ! Yallah ! ». Le cri de ralliement de notre enfance dérange le voisin qui somnolait dans son transat. Il regarde hébété trois jeunes femmes qui dansent autour d’une table basse. Puis la soirée suit son court, enfants, maris, amants....une soirée filles ! Le lendemain matin, fidèle à mes habitudes, j’ouvre les volets du rez-de-chaussée. J’ai toujours aimé l’idée de faire entrer la lumière dans une maison. J’entre dans la chambre de Marie, pour procéder à mon rituel matinal, elle n’est pas là, son lit est fait. J’ignore le pincement au coeur qui monte et file préparer le petit déjeuner. Nous nous retrouvons toutes sur la terrasse. Aurore est sur heureuse d’annoncer « Voici nos cafés et le thé de Marie ! » Un bref coup de sonnette nous fait sursauter, « qui cela peut-il bien être ? » râle Laura qui file ouvrir. Elle revient livide et pose un colis sur la table. Stupeur, le colis est adressé à Marie ! Je me refuse à l’ouvrir, et retiens Laura qui veut s’échapper. C’est Aurore qui fait preuve de courage et découvre un album photos. Sur la couverture inscrit en lettres d’or : le serment du bassin. Nous nous asseyons en rond sur le tapis du salon et découvrons les photos de notre enfance. Chaque été, nous venions en vacances chez nos grands-parents respectifs, et nous nous retrouvions sur la plage. Pêche à la crevettes, premiers cours d’Optimiste, premières sorties, premiers amours tout y est.... L’examen des photos se fait sans bruit, nulle n’ose briser le silence. La dernière page provoque un flot de sanglots : la copie du serment du bassin, et un QR code (NDLR : lien internet vers une page web). À l’aide de mon téléphone, je le scanne, Marie apparait sur la vidéo ! « Coucou les filles. Si vous voyez cette vidéo, ce satané crabe a gagné. Ne pleurez pas, j’ai pris tellement de plaisir à vivre notre histoire. Ce message, c’est ma façon à moi de respecter notre serment. Bien sûr, j’imagine que Gabriele a préparé ma chambre avec soin, Laura a mis mon couvert à chaque repas et Aurore a préparé avec double dose de menthe mon verre de Mojito. Avec cette vidéo, je veux donner un coup de pouce à votre imaginaire. Vous dire, je suis là. Allez, faites moi plaisir crions ensemble une dernière fois notre Yallah,...Yallah ! » Sous le choc nous entonnons un magnifique Yallah. En pleurs, nous tombons dans les bras les unes des autres. L’été de nos onze ans Gabriele « Ils m’envoient l’été prochain en Angleterre ! », Laura arrive en pleurant sur la plage. « Non ! » , nous réagissons d’une seule voix. « Ils disent qu’il est temps de grandir et qu’un voyage à l’étranger me fera le plus grand bien. Pfff, ils n’y connaissent rien. Et puis l’année prochaine c’est le début des cours de catamaran, vous allez toutes progresser et moi...» Aurore lui coupe la parole : « pas question d’être ici sans toi. Je vous propose un pacte : ici à quatre ou aucune ». C’est ainsi que le serment du bassin est né. Écrit sur une feuille de cahier d’écolier paraphé de nos signatures enfantines. D’autorité, Marie le met dans son sac. Elle nous enverra plus tard une copie, je choisirai de cacher la mienne dans mon sac de plage. Mai 2023 Gabriele Laura brise le silence et balbutie : « mais comment, comment est-ce possible, comment a-t-elle fait ? ». Je lui réponds : « J’imagine qu’elle avait tout prévu avec son avocat dès l’annonce de sa maladie » . « Elle nous connaissait si bien, elle savait que pour honorer notre parole nous n’hésiterions pas à faire comme si , comme si elle était là » renchérit Aurore. C’est alors que je suis prise d’un fou rire qui contamine Laura et Aurore. Nous nous mettons alors à chanter d’une seule voix, « Nous quatre, nous quatre ici comme promis, merci Marie ».
Sofie DÉON
Le serment du Bassin
« Vous ne risquez pas de tomber ? » dit une voix. Je me retourne ; en douceur, pour ne pas tomber. C’est une jeune femme en jogging et survêt’. « Si ! » Ses cheveux défaits ruissellent dans son cou. « Mais on voit mieux d’ici... » Elle se rapproche. On regarde le soleil se coucher ensemble. Les couleurs se dégradent, se démultiplient, dans le ciel aquatique. Lorsque le ciel est dégagé le soir j’aime promener mes yeux du bleu au bleu. Du clair de jour, au nuit intense, d’un bout à l’autre du nuancier. Je me baisse et m’assois sur le muret. Elle l’enjambe et s’assoit à côté de moi. Elle s’appelle Ariana. J’ai grandi ici, à Andernos. Je reviens de temps en temps. Retrouver la terre de mon enfance. La terre, le sable, la vase... Je ne vais plus vraiment dans la vase. Je ne vais plus à la pêche aux palourdes. Mais j’ai vécu ici assez longtemps pour que l’odeur de la vase ne me gêne plus. Chaque fois que je reviens, j’ai mon rituel. Le soir après dîner je sors me balader. Toujours le même chemin : je passe devant l’église, j’emprunte l’avenue Cazenave, je contourne le parking de la résidence, je passe à côté du Fish Head, très animé en été, et j’arrive sur la promenade qui longe la plage. Je m’arrête devant le muret. Je fais le tour de l’horizon. En été, il fait encore jour. En hiver, nuit ; les lumières des villes encerclent le Bassin. J’observe les bateaux, plantés dans la vase à marée basse, plantés dans l’eau à marée haute. Puis je grimpe sur le muret. Je marche alors sur le muret, jusqu’à la plage du Bétey qui est un peu plus loin. À chaque escalier qui descend sur la plage, il y a une ouverture dans le mur. Quand j’étais petit, le mur était plus bas, et les ouvertures plus étroites. Je prenais mon élan, et je sautais par-dessus. Le mur a été refait depuis ; plus haut ; les escaliers plus larges. Je ne saute plus. Parfois je faisais des petits bonds, ou des ronds de jambe. Je me tenais sur un pied, je laissais l’autre jambe pendre dans le vide, et je pliais le genou, pour travailler les cuisses, l’équilibre. Je recommençais de l’autre côté. Je m’imaginais être un danseur en train de m’exercer. Encore aujourd’hui. Un danseur sous les étoiles. Quand j’étais à l’école du Bétey, on y allait souvent. Une piscine d’eau salée... après, sous la douche, mes yeux étaient révulsés. Je repasse parfois devant l’entrée ; la ventilation projette l’odeur du chlore de sel. Souvenirs. Ariana aussi a grandi au bord de la mer. Elle est chanteuse. Elle vient des États-Unis. Côte Est. On parle anglais. Ariana sur le Rivage ; ce sera le titre de ma prochaine chanson. Elle a pris quelques jours de vacances, incognito. Personne ne sait qu’elle est ici, sauf son chauffeur, qui attend son appel. Et puis... habillée comme elle est, pas coiffée pas maquillée, personne ne la reconnaîtra. Dit-elle. Nous sommes survolés par un oiseau. Il vole assez haut. Deux oiseaux ! Ils ont l’air d’être ensemble. Ils passent sous la lune ; et sous un avion, qui vole, très haut, et laisse derrière lui une fine robe blanche. Je n’ose pas lui dire que j’ai écrit quelques chansons. Je lui demande un autographe. Ça la fait sourire ; elle dit oui. Je n’ai pas de papier. Elle signe sur mon bras. Sa signature est une succession de vaguelettes légères et fluides, surmontées d’un petit cœur. Indéchiffrable. Ariana me dit : « Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours rêvé d’être chanteuse. » Je lui réponds : « Moi aussi... » Andernos est un des rares endroits que je connaisse où on peut facilement rencontrer des gens. Je ne sais pas si c’est parce que j’y ai vécu, ni si c’est pareil tout autour du Bassin. Rencontrer des gens, je veux dire, en vrai, en chair et en os ; et sans raison particulière. Ailleurs, il faut avoir une bonne raison pour se parler. Ici, on peut juste se parler. Andernos est une ville très touristique : en été ou en hiver, l’ambiance est très différente. Mais dans les deux ambiances, on peut rencontrer des gens. En hiver, tout le monde se connaît, quoi que pas toujours, et les locaux rencontrent les locaux. En été, tout est possible. Ariana voudrait aller quelque part. Mais où... Nous regardons vers le large. La marée monte. Le bateau démarre. C’est un petit Flyer de 9 mètres. Je l’ai emprunté à un ami ; je sais où il cache la clé. S’il savait... mais je lui revaudrai ça, c’est sûr. Au large, je coupe le moteur. Nous sommes pas loin de l’Île aux Oiseaux. Mais je ne compte pas trop m’en approcher ; encore moins de nuit. Je mouille l’ancre. Puis Ariana et moi nous installons sur le pont, devant le cockpit, où sont aménagés des transats matelassés. Dans l’obscurité, sous les étoiles, loin des rivages, on écoute le monde ; il ne reste que le clapot des vagues sur la coque. Autour de nous, les villes du Bassin brillent. Elles forment un long liseré de billes dorées, un bras de galaxie. Ariana me parle de sa carrière, éprouvante ; de sa prochaine tournée. Elle repart bientôt. En ce moment elle lit Nicolas Bouvier ; l’Usage du Monde. Partir... voir... tendre la main à d’autres ; revenir... souffler... et repartir... ailleurs... dans l’exact même but... Elle aimerait être comme lui. Elle-même voyage beaucoup, mais elle a rarement l’occasion de rencontrer quelqu’un. Elle aussi voudrait passer plus de temps à tendre la main et à voir le monde... en tout cas un peu moins à être vue. Son prochain concert est à Kiev. C’est courageux, lui dis-je. Mais c’est bien. Nous écoutons la nuit, le bateau tangue docilement. « J’aimerais être au sommet du monde... » soupire Ariana. Je la regarde. Ariana ? Oui ? Tu y es déjà. Comment ça ? Le sommet du monde, c’est ici. Elle me demande pourquoi la lumière des villes au loin vacille. Je crois que c’est une histoire de température. La lumière traverse des masses d’air froid et d’air chaud, qui altèrent sa trajectoire. C’est étrange, dit-elle, la lumière paraît si imperturbable, si sûre d’elle ; et elle se laisse troubler par... de l’air ? des variations de température ? Elle a raison. La lumière a beau être éblouissante, elle n’en est pas moins fragile. Elle veut nager. L’eau est encore bonne. Nous revenons côté cockpit et nous nous déshabillons dos à dos. Une fois dans l’eau il n’y aura plus personne sur le pont. Je noue une corde à mon poignet, sait-on jamais, comme me l’a appris mon ami Seb sur ce même bateau. On saute. On nage près du bateau, qui se tourne vers nous, et nous fait face. Ariana s’imagine qu’il pourrait tout à coup s’animer, démarrer et nous rouler dessus. On serait alors happé par l’hélice... C’est vrai que, quand on est dans l’eau, avec seulement la tête émergée, près de la coque d’un bateau, c’est assez impressionnant. Et encore, c’est un petit bateau. Elle me dit qu’elle a un peu peur, de nager, loin de tout, la nuit, dans l’eau sombre, et le silence. Mais c’est aussi la peur qui lui a donné le frisson d’y aller. Je pourrais lui dire qu’il n’y a pas de requin dans le Bassin, mais la simple évocation des requins risquerait d’empirer les choses. D’autant que je ne suis pas sûr de mon anglais ; si ma phrase n’est pas assez claire et qu’elle ne comprend que le mot requin... Je lui dis de se rapprocher. Elle vient vers moi ; elle se sent déjà mieux. Je lui dis de se rapprocher encore ; je lui dis qu’elle peut se rapprocher autant qu’elle veut. Elle s’approche encore, et lorsqu’elle tient mes hanches entre ses jambes, elle pose sa tête sur mon épaule et me dit : là c’est bien. Je sens son cœur battre comme si une meute de requins nous encerclaient. À moins que ce ne soit le mien. De retour sur le pont, séchés, rhabillés, on s’allonge sur les transats, avec un plaid. Elle me demande de lui raconter quelque chose. Je lui dis qu’un jour, cette histoire de bateau qui te roule dessus, ça a failli m’arriver. J’avais 10 ans, le père de Seb nous emmenait sur son bateau à lui, trois garçons, trois copains, pour une virée sur le Bassin. On aimait s’asseoir à la proue, les jambes dans le vide, les mains agrippées au garde-corps. Le bateau sautait sur les vagues, nos fesses faisaient des petits bonds et claquaient sur le plat-bord. Un jour on a fait du ski nautique, j’étais seul sur le pont avant, debout, et tout le monde regardait vers l’arrière le skieur en action. Mon père était avec nous ce jour-là. Soudain le bateau a ralenti. J’ai été projeté en avant. Je suis tombé entre le garde-corps et la coque. Je n’étais pas très épais. Puis l’instant d’après le bateau a accéléré plein pot. J’avais un coude sur le plat-bord, une main agrippée au garde-corps, et les jambes dans le vide. Je n’ai même pas pu crier, je tirais de toutes mes forces pour ne pas tomber. Si j’avais lâché, je serais passé dessous. Heureusement, j’ai réussi à remonter. Personne ne s’est rendu compte de rien. Je ne l’ai raconté à mon père que des années plus tard. Ariana me dit qu’il y a une morale à cette histoire. Il ne faut jamais se tenir debout sans attaches à l’avant d’un bateau lancé à pleine vitesse. Elle a sacrément raison. On passe la nuit à se raconter des souvenirs. Moi des souvenirs d’ici, et de l’Île de la Réunion. Elle des souvenirs de là-bas. Là-bas : de l’autre côté de l’océan. Elle aime imaginer que, si on pouvait voir assez loin, et si la Terre n’était pas ronde, d’ici, on verrait la Floride, et Boca Raton, sa ville natale. Une toute petite traversée de l’Atlantique nous en sépare. On s’est endormi tard dans la nuit. Le jour se lève sur le Bassin. La marée a eu le temps de descendre et de remonter. Où va-t-on maintenant ? Ariana saisit son sac et en sort le stylo avec lequel elle m’a écrit sur le bras. Je regarde l’autographe sur ma peau ; il est déjà presque effacé. Elle pose le stylo devant le tableau de bord et le fait tourner comme l’aiguille d’une boussole. Le stylo s’arrête. « Par là ! » dit-elle. Bon, manque de bol, le stylo pointe vers la réserve ornithologique.&amp;lt;br&amp;gt;Je lui explique qu’on ne peut pas y aller comme ça, la fleur au fusil. Elle me dit : « I want it, I got it. » Ce que je traduirais par : Quand je veux quelque chose, je l’ai. J’aimerais pouvoir en dire autant... Sauf qu’en plus de ça, elle commence à avoir faim. Et dans les marais, à moins de courir après les ragondins et les cigognes, on ne va pas manger grand-chose. Bon on pourrait aller juste à côté, il y a des ports, mais la vérité, c’est que je ne suis pas chaud pour naviguer dans ces eaux-là. Je ne connais pas très bien, et... et je n’ai pas mon permis bateau. Mais je lui promets que si elle revient un jour, on ira à cet endroit magnifique, avec les cigognes et tout et tout. Par contre, si on part dans la direction approximativement opposée, je connais un endroit sympa et nettement moins loin où on trouvera de quoi se restaurer. Après tout, on n’a jamais dit quelle extrémité du stylo il fallait suivre ! « D’accord, mais je veux des croissants ! » « Comment est-ce qu’on mange ce truc ? » Le truc en question est une huître qu’Ariana observe avec circonspection. Nous sommes à Claouey. J’ai pensé qu’ici en fin de matinée, il n’y aurait pas trop de monde, donc pas trop de monde qui pourrait la reconnaître. Même si elle m’assure que sans coiffure ni tenue de scène et cetera, il n’y a aucun risque. Nous avons improvisé un brunch en terrasse, au port ostréicole. Croissants et crustacés, je n’avais jamais vu ça. Elle s’est arrangée avec le restaurateur pour qu’il trouve tout le nécessaire. Quand elle veut quelque chose... En arrivant, j’ai légèrement planté le Flyer dans le sable... Je ne sais pas trop comment je vais faire pour le ramener. J’espère que Seb ne m’en voudra pas. Ariana me dit qu’elle va devoir repartir. « Comme Bouvier ? je lui demande. — Comment ça comme Bouvier ? ... vers un nouvel ailleurs, mais dans l’exact même but... » Elle me tire la langue. Elle appelle son chauffeur et lui indique où venir nous chercher. En attendant, elle me raconte des histoires de coulisses, ubuesques. J’aimerais bien voir ça, une tournée de concerts. Le chauffeur appelle. Il est garé un peu plus loin, il ne peut pas venir plus près, nous sommes dans une allée piétonne. Ariana se lève. Je l’accompagne. Sur le chemin, je me demande comment je vais expliquer à Seb que j’aurais besoin de son aide... à Claouey... pour ramener son bateau à bon port... son beau Flyer tout neuf, planté dans le sable... Ariana m’interrompt dans mes pensées : « Thomas ? — Oui ? » Elle réfléchit un instant, puis me demande : « Tu es déjà allé à Kiev ? »
Grégoire BARRAULT
Fragments d'une nuit d'été
Avant-Hier Elle avait 10 ans. Elle regardait ses pieds engoncés dans des chaussures noires, vernies. Il faisait beau, le ciel était bleu. Le soleil voulait effacer chaque ombre de sa mémoire qui en contenait tant et plus. Mais pour elle, ce bleu n'était pas le vrai bleu; celui qui pouvait devenir rouge en une fraction de seconde sous le vent du désert. Et le soleil ne brillait pas de façon à réchauffer les caméléons et les margouillats. D'ailleurs, ici, il n'y avait ni l’un, ni l’autre. Ses yeux ne demandaient qu'à laisser échapper des larmes. Son ventre était aussi agité qu'un vaste champ de papillons gigotant dans tous les sens. Elle voulait fuir, courir pieds nus, loin de cette vie qui ne ressemblait pas la sienne. Elle était abandonnée, seule, elle qui avait si peur du noir. Son père, son idole, était reparti en Afrique, reconstruire une nouvelle vie sur les ruines de celle laissée derrière eux. Elle avait dix ans en septembre 1975, et c'était le premier jour de la rentrée à Saint-Elme, l’école privée très chic d'Arcachon. Elle était en cinquième A. Elle portait un tablier blanc, comme le voulait le règlement du collège. Chic à l'extérieur. Pour elle, un enfer à l'intérieur, elle le pressentait de toute son âme, de toutes les fibres de son être. Entrée en classe, elle s'est assise au dernier rang, petite souris grise voulant passer inaperçue tout en observant discrètement les élèves. Ils sont tous blancs, à son grand étonnement. Dans sa classe à Niamey, c’était une mosaïque des couleurs du monde. Les enfants se tournèrent vers elle. Tully prit peur devant tous les regards braqués sur elle. Son cœur menaçait d'exploser. Tous ces enfants étaient plus âgés qu'elle de deux ou trois ans. Des "grands" en somme. Ce jour-là, en récréation, personne n'adressât la parole à Tully. Elle le remarqua à peine tant elle était absorbée par l’Antigone de Jean Anouilh à laquelle elle s’identifiait entièrement. Puis les jours, les semaines, les mois suivants, l'enfer déploya ses brasiers rougeoyants. Un petit groupe d'enfants décidât de s'en prendre à elle. Les filles s’amusèrent à lui lancer des jets d'encre noire sur sa blouse blanche, les railleries se multipliaient. Elle usait de ses poings pour se défendre.&amp;lt;br&amp;gt;Elle argumentait pied à pied pour se justifier devant les professeurs gênés de ne pouvoir la défendre face aux enfants de l’élite arcachonnaise. Cette année-là marqua la petite fille au fer rouge. Le bruit courut très vite qu'elle venait d'Afrique noire. Les conclusions s'imposaient dans les paroles distillées, comme un poison lent, par les parents dans les oreilles de leurs enfants. La politique a toujours été dangereuse en Afrique. Le père de Tully s'était mêlé à l'opposition, ce qui l'avait conduit, en 1968, à quitter Dakar pour le Niger, avec sa petite famille. Premier exil. Il a tout rebâti à Niamey. Tully a trois ans. Au Niger, elle était heureuse avec ses parents. Elle allait au lycée Français et sa vie lui semblait parfaite. Mais les coups d’états se multipliaient. La situation politique se crispait. Le père de Tully se retrouva compromis dans un imbroglio politique qui l’obligeât à quitter le Niger en vingt-quatre heures, avec femme et enfant, laissant toute leur vie derrière eux. L’exil ou le poteau d’exécution, voilà le choix qui leur était imposé. Dans la mémoire de Tully résonnerait toujours le bruit des balles des fusils semant la peur dans les quartiers de Niamey Elle verrait toujours les larmes de son père quand il leur annonça l’exil forcé. Elle sentirait toujours son cœur se serrer lorsque ses souvenirs lui rappelleraient la douceur d’une vie effacée d’un coup de fusil ravageur. Le père de Tully avait acheté, quatre auparavant, un appartement au Moulleau, dans une résidence à peine finie, le Panoramic. C'est là, qu'il laissât sa famille, exilée, meurtrie, déracinée. C’est là qu’il abandonna une petite fille au cœur lourd d’injustices qu’elle avait tant de peine à comprendre. Il repartait en Côte d’Ivoire, reconstruire, encore une fois, une nouvelle vie et mettre à l’abri, définitivement, sa famille. Du moins, il l’espérait. Hier Elle a grandi. Tully adorait le Bassin, ses couleurs changeantes, du bleu au vert émeraude selon la lumière. Elle regardait, la nuit, la lumière du phare du Cap Ferret et elle imaginait des corsaires, des boucaniers vivant dans cette immense forêt qu'elle voit de l'autre côté de l'eau. Munie de sa licence de droit, elle fut admise à l'école de journalisme de Lille. Elle a réalisé son rêve de devenir grand reporter. Elle écumait toutes les zones de guerre afin de dénoncer l’oppression des plus faibles, la dictature, l’innocence dévastée, la soumission des victimes à des systèmes odieux. Elle les a vécu, enfant. Elle sait. Elle a fui Arcachon et son urbanisation inconsciente, ses volets fermés neuf mois sur douze. Tully a posé ses valises à Lège-Cap Ferret, à Claouey. Elle y respire mieux loin du béton. Elle est tombée amoureuse de la Presqu’île, de ses villages et de leur authenticité, qui peine à se faire voir derrière un côté bling-bling donnant à son refuge des airs de station touristique huppée. Parfois, son envie de tourner le dos à ce passé et ce présent en sursis la démangeait fortement. Un seul regard vers le Bassin, aux couleurs topaze, saphir, émeraude, lui faisait oublier cette tentation de Venise. Alors, elle part sur les zones de guerre pour assouvir sa soif de vengeance, en quête d’une quelconque rédemption afin de comprendre l’indicible qui entraîne le monde à sa perte. Bien sûr, c’est une idéaliste, elle en a conscience. Mais pourquoi devrait-elle s’abandonner au fatalisme ambiant et ne rien faire, ne rien dire de ce qui se passe à travers le monde ? C’est vrai, ce serait tellement plus facile. Heureux ceux qui ne cherchent pas à savoir, leurs nuits sont si belles. Mais à quoi servirait une conscience si elle devait rester silencieuse ? Aujourd'hui Tully a été convoquée à Paris, au siège de son journal. En 48h, Tully se retrouvât dans un avion pour le Burkina-Faso, où les tensions s’exacerbaient chaque jour un peu plus. Le Pays des Hommes Intègres s’embrasait sur les ruines d’une paix qui avait pourtant permis à ce peuple travailleur de se projeter dans un avenir plus serein. Encore une fois, déstabilisé par l’extérieur, des innocents payaient le prix du sang. L’ambassadeur de France l’accueillit au pied de l’avion. Samuel Levine semblait très tendu et jetait de fréquents coups d’œil vers les berlines noires sur le tarmac, surveillées par des men in black tout aussi inquiets. Tully eut immédiatement un coup de cœur pour ce diplomate d’un certain âge, aux manières raffinées mais pleines d’assurance. Dans la berline, la discussion s’engageât à bâtons rompus, sur tous les sujets possibles, y compris le Bassin d’Arcachon. La jeune reporter apprit que Samuel était originaire d’Arcachon. Il avait grandi à la Villa Kermaden au Moulleau. Un lieu magique, hors du temps, remplacé aujourd’hui par un immeuble hideux. Ses parents avaient du quitter la Villa Kermaden pour Andernos et jamais il n’avait pu oublier combien il avait été heureux dans cette maison face aux couchers de soleil, aux tempêtes, aux changement de couleurs du ciel et de l’eau. Leur relation devint très vite une amitié complice où chacun se reconnaissait dans l’autre, dans ses espoirs, ses blessures et sa soif d’un monde plus juste. Mais, Tully avait une feuille de route remplie. Elle devait faire un reportage au plus près de la réalité des violences meurtrières attribuées à des djihadistes à la frontière du Mali. L’armée Française, la force Sabre, avait été évincée, manu militari, du Burkina. Tully, son caméraman nigérien Kesch, Samuel et le chauffeur, un touareg du nom de Ahmed, partirent dans les villages du Nord, en 4X4, armés de caméras, de micros et d’appareils photos. Des militaires Français suivaient dans deux autres 4X4 afin d’assurer leur protection. A la frontière entre le Ghana et le Togo, survinrent deux attaques sanglantes. Tully voulut absolument filmer les villageois dont les mercenaires avaient incendié les maisons, kidnappé les jeunes filles et abattu les jeunes hommes. La peur se lisait sur tous les visages. Les enfants se cachaient derrière leur mère, des larmes séchées encore visibles sur leur doux visage aux grands yeux pleins d’incompréhension. Soudain, des 4X4, débouchèrent à toute allure et les tirs de kalachnikovs retentirent. Les mercenaires avaient sûrement appris que l’Ambassadeur et une équipe de tournage venaient dénoncer leurs exactions au monde entier. Samuel, hurla à Tully de remonter en voiture avant que les voitures lancées à toute vitesse n’arrivent à leur niveau. Ahmed, fit démarrer le 4X4 en trombe, suivi des 4X4 des militaires de l’Ambassade mais Tully et Kesch voulaient filmer, à tout prix, les ruines fumantes des maisons. Samuel sortit de la voiture et courut comme un fou chercher la jeune femme et le caméraman. Elle se retournât à l’appel de son nom, Kesch fit demi-tour et ils se précipitèrent tous les trois, vers les voitures, sous les tirs des milices armées. Samuel et Tully sautèrent dans la première voiture. Kesch jeta la caméra sur le siège arrière du 4X4 avant d’être fauché par une balle. Tully poussa un hurlement et voulut descendre afin de sauver son caméraman mais les voitures étaient déjà lancées dans une course folle afin d’échapper aux djihadistes. Elle criait et se débattait. Samuel la serrait dans ses bras, lui murmurait des mots de consolation, lui promettait de toujours la protéger, de ne jamais l’abandonner. Il l’assura de tout faire pour Kesch. Tully pleurait sur ces injustices, ces innocents comme Kesch, fusillés pour avoir voulu livrer la vérité au monde. Elle pleurait sur ces Burkinabés qui n’ont eu d’autre choix que l’exil plutôt que les poteaux d’exécution, comme son père. Elle livrait toutes ses peurs à Samuel comme jamais auparavant elle ne l’avait fait. Le diplomate l’écoutait en silence, soulagé que les djihadistes aient abandonné la poursuite. Tout s’enchaina très vite dès leur retour à Ouagadougou. Samuel prit les choses en main concernant Kesch. Le caméraman avait sauvé les dernières images avant de tomber, sous les balles. Tully passa quelques jours sous la protection de Samuel attentif à la fragilité de la jeune femme. Elle voulait donner sa démission et fuir un monde fait de tant de douleurs auxquelles elle ne pourrait jamais remédier. Tully et Samuel avaient deux expériences parallèles sur le Bassin, distantes de vingt-cinq ans. L’amour du Bassin les unissait, ce petit paradis qui leur avait donné leurs racines et leurs ailes. Un monde disparu puis, par eux réinventé, sous le ciel bleu et la terre rouge du Burkina Faso. Il était temps de rentrer à Paris. Samuel accompagna Tully à l’aéroport de Ouagadougou, Ahmed à quelques mètres derrière eux. Comment expliquer ce qui n’est pas explicable ? Comment définir ce qui est indéfinissable ? Un homme et une femme que vingt-cinq ans séparent, qu’une amitié rare réunit par un hasard mystérieux sous le soleil d’Afrique. Tully serre fortement la main d’Ahmed et le remercie pour toute son aide. Il esquisse un doux sourire et lui souhaite toute la bénédiction d’Allah. Samuel la serre longuement dans ses bras. Il a juré de venir la voir sur le Bassin, après Paris, où il est convoqué, d’ici cinq jours, pour « consultations ». L’avion décolla et laissa dans son sillage la trace d’une amitié à la saveur d’une madeleine de Proust, douce et réconfortante. Tully engrange tous les succès lors de la diffusion de son reportage dédié à Kesch. Que rapportent ces succès au peuple du Burkina confronté à la violence? Rien. Seules, Tully et la chaîne de télévision sortent gagnantes de la souffrance d’un peuple qui vit dans la peur de mourir la minute suivante. Tully a la victoire triste et amère. Tully est rentrée à Claouey. Elle s’est accordée un mois pour réfléchir à sa vie. Elle doutait de vouloir rester grand reporter tant son impuissance pesait lourd sur son âme. Samuel lui avait envoyé un message tôt ce matin pour lui confirmer son embarquement de Ouagadougou pour Paris dans l’après-midi. Bien sûr, ile la rejoindrait pour deux ou trois jours sur le Bassin. Tully avait hâte de le revoir. Elle décidât de rejoindre Arcachon par la route. Avant l’arrivée de Samuel, elle voulait retrouver ses repères au Moulleau. La jeune femme gara sa voiture au parking de l’église de Notre-Dame des Passes et s’installa à la terrasse du café où elle avait passé son adolescence à siroter des diabolos menthe et des cocas. Elle vit le ciel s’obscurcir sur le Bassin, des nuages sombres luttaient pour effacer toute trace du bleu azur sur la surface scintillante de l’eau. Son téléphone vibra sur la table et le numéro de la rédaction s’afficha à l’écran. Tully réprima son envie d’ignorer l’appel. Elle décrocha et écouta son patron sans dire un mot puis elle reposa lentement son téléphone, le regard dans le vague, immobile. Les mots de son patron résonnaient dans sa tête, aussi impitoyables que l’orage en approche. Une attaque a eu lieu sur la route de l’aéroport de Ouagadougou. Un tir de mortier a frappé la voiture de l’Ambassadeur. Aucun survivant. Samuel et Ahmed, son chauffeur, ont été exécutés. Pour eux, pas de droit à l’exil. Le Moulleau s’était vidé, il n’y avait plus qu’elle sur la terrasse, face aux éléments déchaînés. Elle était trempée jusqu’aux os, en état de choc. Les gouttes de pluie se mêlaient à ses larmes. Elle se retrouvait encore seule à affronter l’avenir. Elle avait perdu un ami rare, son alter ego au masculin. Ce genre d’amitié était un doux trésor qu’elle garderait si précieusement qu’elle avait peur de l’oublier. Devant elle, se dressait la Villa Kermaden, intacte, et dans le parc de la Villa, un grand garçon protecteur, tenant par la main une toute petite fille, exilée, au regard déterminé se promenaient, riant et parlant d’avenir. Le soleil pointait le bout de ses rayons, chassant les dernières traces d’un orage aussi bref que dévastateur. Elle reprit son téléphone et confirma à son patron qu’elle acceptait la mission au Mali, pour tenter d’anesthésier toute forme de douleur personnelle. Ses questionnements, ses doutes s’étaient envolés avec les derniers nuages noirs. Elle devait continuer, pour Samuel. Pour Kesch. Pour Ahmed. Elle n’avait pas le droit de fuir encore, de s’exiler à nouveau. Elle n’avait pas le droit de se taire. Elle baisse la tête et regarde ses pieds, toujours engoncés dans des chaussures noires.
Victor DARTENSEY
Le fantôme de Kermaden
Nouvelles
Le sentier rejoint le port de Biganos par sa rive droite à hauteur d’un petit bois de chênes. Une silhouette s’en détache, marque un temps d’arrêt avant de replier une carte et de la glisser dans un sac à dos posé au sol. Durant quelques secondes un faisceau lumineux trace d’étranges circuits sur le toit noir de la nuit avant de disparaître au fond d’une poche. L’écran du portable affiche trois heure cinquante sept. Un imprévu l’a obligée à modifier le parcours initialement planifié depuis l’hôtel. La marche en a été retardée ; il est temps de rejoindre le lieu du rendez-vous. Elle avance maintenant en territoire connu et se fait une alliée de l’obscurité. Il lui faut quitter le couvert des arbres, filer droit devant jusqu’à une échancrure plus claire sur l’écran nocturne indiquant le lit de la rivière. Le projecteur de la lune l’aide dans sa progression rapide révélant entre le dos des cabanes de planches bordant le chemin, des tables de bois, quelques arbres penchés au- dessus d’embarcations alanguies . Un vague passage bordé d’une haie odorante de prunelliers piqués de blanc conduit à l’entrée du petit port. Son pas s’accélère. Une légère brise nord-ouest révèle l’odeur miellée du tabac puis un point de braise s’allume en contrebas du quai. Le contact est là, assis sur un canoe renversé au niveau de la cale de mise à l’eau des bateaux. Elle hésite un instant puis s’engageant dans le passage devant elle, toussote pour annoncer sa présence. La consistance du sol a brusquement changé aussi doit-elle se retenir à la murette entourant la cale pour ne pas glisser sur la pente envasée. L’homme se redresse déroulant un corps massif et porte la main à hauteur de sa tête. Probablement un salut auquel elle répond d’une voix étouffée. Sans plus de manières, il lâche un « Par là. Attention, ça glisse. » avant de projeter son mégot dans l’eau. L’interlocuteur joint quelques semaines plus tôt au téléphone a posé des conditions strictes à sa demande de sortie nocturne. Il se gardait le droit d’annuler l’expédition si le vent s’annonçait soutenu ou se renforçait dans le courant de la journée précédent le départ. Une pleine lune et un ciel dégagé permettraient une clarté maximale ; bien sûr une marée montante assortie d’un fort coefficient seraient obligatoires. Il serait seul juge de la faisabilité du projet, point. Dans un premier temps, déconcertée voire découragée par tant d’exigences, celles-ci lui parurent finalement relever du bon sens et être les garantes de la sécurité de l’expédition et du sérieux de l’encadrement. Un peu de rigueur dans l’aventure la rassurait. - « Là » dit-il pointant l’avant de l’embarcation. Il lui faut courber le dos, se tasser un peu pour enjamber les bords de la barque et prendre pied sans trop de tangage. Son sac à dos la déstabilise et la contraint à saisir vigoureusement le banc de bois fixé devant elle et à s’asseoir. Le gars s’affaire autour de la galupe, ses bottes piétinant la vase puis monte à son tour. Elle aurait préféré se trouver derrière l’homme. Cette position de figure de proue la rend soudainement vulnérable. Qui est cet individu au visage à peine tracé sous un large béret, avare de mots, peu aimable, avec lequel elle vient de se lier dans la pénombre ? Seule sur cette embarcation instable, loin de toute présence,elle est à sa merci. L’inquiétude s’invite, se nourrit de la forte respiration de l’inconnu, de l’incessant balancement sous ses pieds. Le gars reste debout un long moment, apprête le rafiot en silence. Elle le sent derrière elle et tente sans succès de chasser son appréhension. D’un puissant appui sur une longue perche le batelier arrache brusquement la barque du fond vaseux avec un fort bruit de succion. Bousculée par la vigoureuse secousse imprimée à l’embarcation, elle agrippe les rebords de bois de toutes ses forces afin de garder l’équilibre. L’embarcation retrouve rapidement une profondeur suffisante pour être aisément dirigée. Puis le batelier crache bruyamment, s’assoit et se saisit des rames. La galupe file sur l’onde brune. Le cours d’eau rejoint bientôt La Leyre dont la courbe dévoile une large étendue clapotante entre de solides rives. De hautes futaies de feuillus bordent la rivière, impriment sur le ciel profond de lents mouvements à peine audibles. La clarté nocturne installe aux pieds des arbres un enchevêtrement de longues herbes, de buissons tachés de clair, de végétaux qui semblent se disputer la berge en chuchotant. Au fil de l’eau, d’étranges spectateurs plongent leurs branches vers l’onde, saules et aulnes enlacés dans une lente chute. Parfois l’amicale présence d’une prairie entre les troncs bruns. Au dessus de l’équipage, des milliers d’étoiles tremblotent, clignotent, discutent entre elles du commencement des temps. La galerie s’étire dans la pâle noirceur des fins de nuit. Loin devant dirait-on, au bout de ce tunnel sans couvercle se devine le plastron gris du jour à venir. A coup sûr les arbres parlent dans leur dos. « Je suis incollable ! Vas-y, pose moi des questions ! » lui demande-t-elle pour la troisième fois. Jeanny ne doute pas un instant que son amie ait réponse à tout. Son projet d’expédition nocturne a pris forme ces dernières semaines. La réalisation de son mémoire de recherches comprendra un volet photographique. « Il s’agit d’un travail sur la lumière dans l’obscurité. Explorer l’obscur, en faire surgir sa lumière, son intimité ! » Elle rit. « L’eau sera l’élément support de mon projet artistique. J’ai besoin d’une belle nuit, d’une grosse lune et d’un plan d’eau accessible. J’ai une idée ! » Elle rit à nouveau. Sa passion à se saisir de la fugacité des rencontres, du « télescopage des impossibles » ou encore de « l’esthétique cachée des choses » comme elle aime à le répéter, l’habite toute entière tout autant que sa patience à attendre le temps qu’il faut et sa ténacité à présenter sa réalité du monde en fragments indéchiffrables. Les rames entaillent à peine la surface de l’eau, s’appuient sur le liquide glauque. La clarté lunaire joue sur les ondes, lance des serpentins d’ivoire en travers de la rivière. De chaque côté de la barque se propagent de souples ondulations déroulant un arc parfait jusqu’aux berges sombres. Une étoile filante lâche des poussières brillantes avant de s’éteindre. Depuis combien de temps ont-ils quitté le petit port niché au creux du delta ? Les minutes semblent maintenant répondre à une ordonnance mystérieuse qui lui échappe. Le cadencement des rames, le son de l’eau ouverte devant elle l’apaisent. Peut-être devrait-elle parler à l’homme posté dans son dos, lui offrir une cigarette mais elle n’ose pas se retourner, figée, les jambes sous elle dans le triangle aigu de l’avant. Des éclaboussures ont mouillé les poignets de sa veste, dégouliné le long de son sac à dos basculé à ses pieds. Sous les semelles de ses chaussures, la vase collante adhère au fond du bateau. Vaguement boudeuse, elle ramène la capuche de sa parka sur sa tête et fixe une étoile loin devant elle. Un hoquet de surprise et de peur lui échappe soudain. La galupe vire brusquement sur la gauche, quitte la rivière pour un cours d’eau plus étroit entre deux rives resserrées ourlées de vase brillante. Prompts à lâcher leurs fleurs de coton, les baccharis éclairent faiblement le fouillis végétal des berges hérissées de roseaux. L’homme manœuvre en jurant entre ses dents, écarte à l’aide des rames des branches grises coiffées d’herbe prisonnières de la vase. Une giclée visqueuse s’écrase à l’avant de la barque. D’étranges formes chevelues surgissent ça et là rendant la progression difficile. Des tamaris tordus pris dans l’étouffement des cotonniers cèdent peu à peu la place aux roselières bruissantes au-dessus de leur tête. - « On arrive. » grogne le gars en approchant un ponton en partie dissimulé par les roseaux. La galupe est habilement conduite et maintenue à un poteau de bois en partie enfoui dans la vase. Une petite échelle métallique dresse quelques barreaux peu engageants à la verticale de la barque. « Ici dans deux heures. »marmonne l’homme en vissant une cigarette sous sa moustache. Elle acquiesce d’un signe de tête suivi d’un « d’accord. »et ajustant son sac sur son dos se lève prudemment cherchant son équilibre. Puis, elle empoigne les montants glissants avec précaution, prend pied sur le ponton et rejoint la digue en quelques enjambées. L’étau dans sa poitrine se desserre une fois sur la terre ferme. Enfin, elle y est ! Elle n’en revient pas et se félicite intérieurement d’avoir tenu bon, vaincu ses peurs. Après avoir tiré ses bâtons de marche du sac, elle vérifie le rangement du Canon et du trépied sanglé dans son fourreau puis sort un mouchoir de sa poche pour essuyer les traces de vase sur son pantalon, ses mains aussi. Ne sachant que faire du papier visqueux, elle le glisse au creux des roseaux et se met en marche. A droite un tracé terreux dans l’herbe rase engage le pas vers un horizon rempli de ciel et de prés fantomatiques. Le domaine endigué semble s’étendre à perte de vue. De longs bassins d’eau immobile emprisonnés entre des levées de terre s’étendent de part et d’autre du chemin. Des chuchotements montant de la terre peuplent l’air. Elle frissonne, croise les bras sur sa poitrine et accélère le pas avec prudence laissant derrière elle un couvert confus de fourrés percés de rares arbres et de friche impénétrable. L’obscurité perd de sa puissance, lâche un peu de sa lumière révélant des formes aux contours encore indistincts. L’étonnante luminosité des rayons lunaires la presse de commencer son travail photographique. Rapidement extrait du sac à dos appuyé aux montants d’une écluse, le matériel est déballé avec précaution, l’appareil photo muni d’un puissant téléobjectif fixé sur le solide trépied. Agacée par le vol incessant de minuscules insectes autour de son visage, elle attrape une petite bombe d’insecticide et vaporise généreusement le produit sur ses veste et capuche. Une forte odeur âcre l’isole un moment du monde des vivants. Une bulle de silence accompagne ses derniers préparatifs. A la surface des bassins, sur l’eau indolente dansent de brillants éclats. Se font et se défont des milliers de reflets étincelants sous les lustres nocturnes. Capturer ces étoiles que la lune fait jaillir de l’eau sombre... Elle colle son œil à l’oeilleton et commence son travail de chasseuse d’images. Une légère vibration me fait relever la tête. Je frotte mon œil. Impossible d’en déterminer la provenance. Elle semble s’amplifier; je réalise alors qu’elle provient du sol. Je pense immédiatement à l’écluse dont je me suis peu éloignée. Probablement un mouvement d’eau entrante ou sortante qui cogne aux rives. Très vite je comprends qu’il est question de toute autre chose. Du fond du chemin que j’ai longé sur plusieurs centaines de mètres se détache une masse confuse. L’obscur tableau de végétaux en arrière plan m’empêche de distinguer de quoi il s’agit. Un martèlement sourdre sous mes pieds. Mon coeur s’emballe d’un coup. La masse grondante se dirige vers moi à toute vitesse. Une virée de gars à motos ou en quads ? Cette fureur venue de nulle part hurle que je dois me cacher dans les replis de la nuit. Je saisis vivement le trépied qui chute dans ma course. Je l’abandonne dans l’herbe. Je n’ai pas le temps de récupérer mon sac et me roule en boule sous les roseaux les plus proches. La peur frappe l’intérieur de mon crâne à coups de marteau. La chose envahit alors mon champs de vision. Des formes effrayantes armées de crochets, montées sur de courtes pattes surgissent à quelques mètres de ma tanière, se bousculent en une course effrénée. Des cailloux, des mottes de terre projetés avec violence retombent autour de moi. La terre tremble. L’air crache de rauques soufflements, d’épouvantables grognements. La terreur me paralyse. La harde s’éloigne aussi vite qu’elle a surgi. Quelques couinements aigus s’attardent. Le bruit sourd du martèlement des sabots sur la digue va diminuant. Je rampe hors de mon trou, m’assois les genoux ramenés sous le menton. Des tremblements impossibles à dominer agitent mes épaules. Les sangliers ont laissé derrière eux une forte odeur de poils mouillé et d’urine. Je laisse s’éteindre les étoiles. En sourdine, le jour à venir met en route l’orchestration naturelle des lieux. Des chuchotements prisonniers des roselières, un pitpitpit délicat auquel répond un coassement de grenouille si proche que je m’écarte vivement et me lève. Encore sérieusement choquée, je choisis de faire demi tour et rassemble le matériel. L’appareil photo encore fixé sur son trépied n’a pas été piétiné. Le système de fixation a subi des dommages dans sa chute et je peine à dévisser les deux parties de mes mains encore tremblantes. Laissé ouvert au pied de l’écluse, mon sac à dos plein de débris doit être vidé. Le fourreau du trépied se trouve dans le même état ! Alors que je m’apprête à la saisir, un mouvement singulier déplace l’étroite sacoche ; d’imperceptibles agitations venus de l’intérieur animent le tube de toile. Rapidement, je saisis mon bâton de marche et gifle l’herbe alentour, tapote l’étui afin d’en chasser un visiteur indésirable, une couleuvre curieuse, une vipère furieuse de s’être fait piégée. Je ne chasse que de frêles grelots nocturnes, des voix soufflées à la surface de l’eau, conversations intimes des invisibles. Le tube de toile orange luit sous les clartés célestes. Je décide de me suffire de cette lumière et recule d’un pas. De l’embout métallique du bâton je dégage l’orifice de l’étui tout en le sondant de légers coups. Une petite masse occupe le fond du sac renvoyant un son mat, rond. Je le prends par le fond et le secoue au-dessus du sol. Un galet ovale, légèrement bombé tombe à mes pieds. Quelques éclats d’or à sa surface me permettent de le distinguer. Je m’agenouille. Une tortue cistude plus petite que ma main gît à la pointe de mes chaussures. Je la soulève avec précaution ; elle tient dans ma paume, ridicule berceau. Quatre petites pattes griffues tachées de jaune s’étirent, une tête reptilienne d’un autre âge frôle ma peau. L’animal reste immobile un long moment, le cou tendu vers la lune offrant à mes yeux une carapace peinte par les dieux. J’allonge mes doigts sur l’herbe, lui demande pardon en effleurant la peau froide de son cou. La tortue se remet en marche avec lenteur, quitte ma main et ses griffes impriment une douleur dans mon coeur. Très vite elle disparaît dans la jonchaie dans un doux froissement de tiges sèches. Je referme mes doigts sur un nid vide. L’aimant terrestre attire alors mon buste vers le sol. Le visage contre les genoux, je mêle mes larmes à l’humidité de la terre. L’espace d’un instant, un oiseau raye la lune déclinante. Un escargot a tracé sa route au dos de ma veste.
Fabienne COZIC-LAMAISON
La forme de l'eau
Ce jour-là, le soleil illuminait la mer de ses feux et la faisait briller d’un million d’éclats, éblouissant Nicolas qui arrivait sur la petite plage isolée d’Andernos qu’il chérissait tant. Comme à son habitude, il terminait sa journée de travail par une échappée belle au bord de l’eau, profitant d’une reconnexion avec le vent, le sable, la mer et le calme avant de rejoindre sa meilleure amie Juliette autour d’un verre. Nicolas avait dédié sa vie à un travail extrêmement laborieux. Il passait ses journées à jongler avec des chiffres et des contrats dans un petit cabinet comptable... Lorsqu'il passait le pas de la porte à la fin de sa journée de labeur, il ressentait donc un besoin irrépressible de s’ouvrir à la plénitude que lui offrait les grands espaces du Bassin d’Arcachon avant de retrouver la vie réelle et son tourbillon incessant. Ce jour-là, cependant, n’était pas un jour comme les autres, et il allait bientôt l’apprendre à ses dépens... Il prit place dans le sable comme à son habitude et s’allongea sur le dos pour profiter du calme. Appuyé sur ses coudes, il admira l’horizon duquel il voyait dépasser les dentelles des villes d’en face. En effet, le Bassin était un de ces écrins de mer, créé par les océans qui s’étaient frayé un chemin au milieu des terres, ce qui en faisait un endroit préservé et calme. Cette pensée l’apaisa et il soupira profondément avant de basculer en arrière et de plonger son regard dans le ciel d’un bleu azur que le son du ressac accompagnait telle une douce berceuse naturelle. Il songea que rien ne pouvait plus troubler cet instant de sérénité, lorsque des éclaboussures accompagnées de cris stridents vinrent le faire mentir. Il se redressa promptement, surpris et quelque peu irrité, pensant que des enfants n’avaient pu s’empêcher de rompre sans ménagement ses rêveries. Cependant, son agacement fut de courte durée lorsqu’il tomba nez à nez avec une jeune femme étrange empêtrée dans des algues et du varec. Elle avait l’air complètement désorientée. La jeune fille était d’une beauté irréelle, de longs cheveux d’une couleur indescriptible lui tombaient en cascade sur les épaules et ondulaient dans le vent iodé du bord de mer. Ses yeux, d’un vert d’eau translucide, se détachaient sur sa peau halée et le fixaient avec incrédulité. Ses lèvres fines et son nez retroussé étaient crispés dans une légère moue dans laquelle semblaient se mélanger douleur et peur. Nicolas, pris de court par cette vision insolite, mit quelques minutes avant de reprendre ses esprits et lui porter secours. Lorsqu'il se redressa et se précipita vers elle afin de la dégager de ses liens, la jeune femme tenta de s'écarter, visiblement terrifiée par l'inconnu qui s'avançait vers elle. Il interrompit son geste et essaya une autre approche afin de ne pas l'effrayer davantage. - Je ne vous ferai aucun mal... murmura-t-il pour la rassurer en s'asseyant dans le sable, à quelques pas d'elle. Je m'appelle Nicolas, et vous ? La jeune femme le dévisagea mi-intriguée, mi-apeurée. Elle ne semblait pas comprendre les mots qui sortaient de sa bouche. - Ni... Nicolas ? répéta-t-elle de sa voix juvénile. - Oui, c'est mon prénom, comprenez-vous ce que je vous dis ? - Je... Oui... Oui, bien sûr, c'est seulement que... C'est la première fois que je m'adresse à quelqu'un comme vous. Je vous en prie, ne me faites pas de mal... implora-t-elle, visiblement effrayée par l'étranger. - Je vous promets que ce n'est pas mon intention... répéta-t-il doucement. Comment vous appelez-vous ? - A... Ariane... bredouilla-t-elle, toujours en état de choc. - Ariane, enchanté. Vous semblez être en mauvaise posture. Je vous en prie, permettez-moi de vous aider. La jeune femme sembla hésiter, détaillant tantôt son corps, entièrement pris dans les algues et le varech, tantôt son interlocuteur qu'elle semblait jauger afin d'estimer si elle pouvait lui accorder sa confiance. Elle finit par acquiescer d'un hochement de tête silencieux et Nicolas entreprit de la libérer de ses liens. La jeune infortunée aurait effectivement été incapable de se défaire de sa prison, car en plus des diverses algues, un filet de pêche avait entouré son corps entier, bloquant ses bras et ses jambes comme dans un étau. - Je peux savoir ce qui vous est arrivé ? risqua Nicolas en continuant de s'affairer à sa besogne. -Je... C’est une histoire compliquée... bredouilla-t-elle en évitant de croiser son regard. - Je comprends et je ne veux pas être indiscret, je... Les derniers mots de Nicolas se bloquèrent dans sa gorge lorsqu'il découvrit avec stupéfaction les jambes d'Ariane. Couvertes d'écailles d'un bleu opalescent, elles s'habillaient sur toute leur longueur de nageoires, semblables aux nageoires dorsales des poissons. Lorsqu'il finit de les libérer, des pieds palmés, loin de ressembler à ceux des humains, apparurent alors sous son regard ébahi. - Je vous en prie, ne me faites pas de mal ! se précipita de répéter Ariane lorsqu'elle lut la stupeur sur le visage de son sauveur. - Mon intention n'a pas changé, n'ayez pas peur, réussit à articuler Nicolas lorsqu'il reprit contenance. J'ai promis de vous aider et je tiens à respecter ma promesse. - Vous n'avez pas... peur ? demanda-t-elle avec appréhension. - En fait, je suis plutôt émerveillé et curieux, répondit-il avec sincérité. Ariane parut étonnée par cette réponse. Elle lui expliqua qu'elle n'avait jamais pu discuter avec des personnes comme lui auparavant, les humains. Le peu de contact qu'elle avait eu avec eux jusqu'à présent s'étaient soldés par de la peur et de la violence. Elle lui raconta comment elle était arrivée sur cette plage lorsque des pêcheurs les avaient vus nager, elle et son jeune frère aux abords de ce que les humains appellent l'île aux Oiseaux. Ils les avaient immédiatement pris en chasse avec leurs harpons et leurs filets. Elle avait pu se cacher sous l'eau malgré le filet qui l'avait atteinte, mais elle avait perdu son petit frère dans le tumulte de la bataille. Elle s'inquiétait énormément pour lui et craignait qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. - Vous pourriez peut-être m’aider ! tenta-t-elle. Je ne peux me déplacer hors de l’eau, ce qui entraverait mes recherches... S’ils l’ont emmené sur leur bateau ou même sur terre, je risque de ne jamais le revoir ! Nicolas, bien que toujours sous le choc, croisa le regard empli de tristesse de la jeune fille. Il ne put s’empêcher de comprendre son désarroi, il n’imaginait même pas dans quel état il serait si on lui enlevait Juliette ! - C’est d’accord. concéda-t-il. Par où commençons-nous ? - Prenez cet anneau, il vous permettra de m’accompagner dans les fonds marins. De cette manière, nous y chercherons les premiers indices ! Elle lui tendit un vieil anneau qui semblait avoir plusieurs siècles. Recouvert de petits coquillages, il avait passé énormément de temps sous l’eau à subir les affres du temps et de l’érosion. Nicolas tendit une main tremblante et s’en saisit sans certitude. - Est-ce que je vais devenir l’un des vôtres ? - Ne vous inquiétez pas, il vous permettra simplement de respirer sous l’eau, ce n’est pas une transformation permanente. Ne le perdez surtout pas ! Il ne fait effet que si vous le portez à votre doigt ! avertit-elle très sérieusement. Nicolas approcha l’anneau de son doigt, il lança un dernier regard vers ses affaires étalées sur la plage. Dans quoi allait-il mettre les pieds ? Ariane sembla ressentir son hésitation et posa une main aussi compatissante qu’implorante sur la sienne. Il se retourna et croisa son regard juvénile et profondément triste. Aussi invraisemblable que lui parut cette histoire, il ne pouvait pas laisser cette pauvre jeune femme seule contre l’immensité de la mer et la cruauté des hommes qui lui avaient enlevé son frère ! D’un geste décidé, il enfila l’anneau à son doigt. Il inspira à plein poumons et ne vit aucune différence avec l’air qu’il respirait quelques minutes auparavant, il ne se sentait pas... changé. La jeune femme ne lui laissa pas le temps de se poser plus de questions. À présent libérée de ses liens, elle se saisit de sa main et l’entraina dans l’eau fraiche du Bassin. D’abord surpris, Nicolas fut pris de panique. Et si la sirène l’avait trompé ? Et si elle l’avait amadoué afin de l’entrainer dans les fonds marins pour le noyer comme il avait si souvent pu le lire dans les mythes et les légendes ? Il retenait son souffle de peur que des flots ininterrompus n’y pénètrent. Sentant sa crispation, l’être de l’eau s’interrompit dans leur descente aux enfers. Elle fit volte-face et planta son regard dans le sien avec un sourire rassurant, ses pupilles se dilatèrent étrangement lorsqu’elle s’adressa à lui. - Vous allez mourir si vous ne respirez pas. dit-elle avec douceur. N’ayez pas peur, inspirez... Il ne savait pas pourquoi, mais il était tout simplement incapable de lui désobéir. Il inspira profondément, relâchant la pression dans tout son corps. À son grand étonnement, l’eau entra dans ses poumons mais il ne suffoqua pas. Il la recracha de la même manière qu’il l’avait ingurgitée, en expirant doucement. - Pouvons-nous continuer ? demanda Ariane avec un sourire. Nicolas acquiesça, rassuré. Ils progressèrent très vite dans l’eau froide, évoluant parmi toutes sortes de poissons qui ne s’inquiétèrent pas de croiser leur chemin. Rapidement, les fonds marins se transformèrent, laissant place à des paysages bien différents de ce que Nicolas avait imaginé trouver en ces lieux. Des constructions réalisées à partir de coquillages et de roches pavaient le sable et des sirènes les dévisageaient sur leur passage. Ariane le guidait à travers ce paysage irréel. Le jeune homme, quant à lui, ne put s’empêcher de s’émerveiller. Des hippocampes qui jouaient avec les enfants, aux seiches qui taquinaient les hommes qui s’occupaient des constructions, tout ce qui l’entourait semblait tout droit sorti d’un conte. Ils traversèrent le village et progressèrent un moment sous les regards étonnés et apeurés des êtres de l’eau jusqu’à atteindre une forêt sous-marine. - C’est là que nous jouions avec Malo avant de nous faire attaquer par les pêcheurs. annonça Ariane. Nos assaillants auront peut-être fait tomber quelque chose qui nous donnera une piste de recherche. Ils fouillèrent un moment parmi les algues et Nicolas se trouvait sur le point d’abandonner lorsqu’il vit un objet briller au loin. - Là ! s’écria-t-il en se précipitant vers l’étincelle d’espoir. Ariane le rejoint et il lui tendit un porte clé portant l’inscription « Radeau de la Daurade ». - Le nom du bateau ? demanda Ariane. - C’est très possible. Regarde, il est amarré au port du Rocher si l’on en croit ce qu’il y a écrit derrière ! s’exclama Nicolas. - Tu sais où cela se trouve - Il me semble que c’est à La Teste ! Sais-tu comment nous y rendre Ariane acquiesça et l’entraina promptement dans son sillage. Le chemin lui parut interminable comparé à l’aller. Si on lui avait dit qu’un jour, il traverserait tout le Bassin à la nage, Nicolas ne l’aurait pas cru. A mi-chemin, Ariane poussa un cri strident et fonça vers les profondeurs. Le jeune homme la suivit, inquiet de savoir ce qu’elle avait découvert. Elle s’empara d’un objet qui gisait dans le sable et se redressa, troublée. Elle tenait un poignard dans le creux de sa main. - Il est à lui... murmura Ariane, la voix tremblante, nous sommes sur la bonne voie. Il a dû se défendre, je sens encore l’odeur du sang... J’espère que ce n’est pas le sien... - Je suis certain qu’il n’a rien ! assura Nicolas. Dépêchons-nous, plus nous attendons, plus il risque de lui arriver malheur. Ariane redoubla d’effort, perdant Nicolas dans son sillage, mais le jeune homme s’efforça de tenir la distance, comprenant ses craintes et ne voulant pas devenir un fardeau pour elle. Quelques instants plus tard, la lumière se fit plus présente alors qu’ils approchaient du bord du littoral. Ils risquèrent un regard à l’extérieur. Le soleil les aveugla lorsqu'ils émergèrent après plusieurs heures dans l'obscurité des fonds sous-marins, mais le tumulte en surface ne leur laissa pas un moment de répit. À quelques mètres d'eux, un attroupement d'humains criait et se mouvait dans tous les sens sur le ponton du port. La foule était tellement dense qu'ils ne voyaient rien, mais la raison de leur émoi semblait évidente à Nicolas. La présence d'une sirène dans le port d'une petite commune du Bassin d'Arcachon, ça fait du bruit ! Ariane s'élança, mais Nicolas la stoppa dans son élan et prit les devants pour qu'elle ne se fasse pas capturer à son tour. Il atteignit rapidement le ponton, l'escalada et se joignit à la foule en ébullition pour se rapprocher au maximum du centre de l'attention. La sirène retint son souffle en attendant la suite des événements. Sans crier gare, la foule se mit à courir en tous sens, visiblement effrayée, découvrant la scène centrale aux yeux d’Ariane. Malo se trouvait au sol et se dépêtrait d'un filet en lambeaux, étalé autour de lui, pendant que Nicolas se battait à mains nues avec l'un des pêcheurs, blessé à l'épaule et visiblement ivre de colère. "Courageux, mais pas téméraires, ces humains !" songea Ariane en constatant qu'ils avaient fui à la libération de son frère. Ce dernier se tortillait pour se défaire de ses liens. Ariane le rejoignit rapidement à la nage et lui prêta main forte, sous couvert de la mer, avant de l'attirer avec elle dans les flots. Nicolas décocha un dernier coup de poing à l'un des pêcheurs avant de prendre la fuite à son tour et de les rejoindre dans l'eau. Il n'eut pas le temps d'atteindre la mer qu'il trébucha, saisi à la cheville par l'homme qu'il avait envoyé au tapis, visiblement furieux qu'on lui ait ravi sa proie. - Nicolas ! hurla Ariane, désemparée. Ce dernier se retourna promptement afin de se défendre mais reçu un violent coup à la tempe. -Nicolas ! entendit-il hurler une dernière fois Ariane avant de sombrer dans l’inconscience.mp;gt; Son prénom résonna en écho de nombreuses fois tandis qu’il errait dans les ténèbres, jusqu’à ce que son corps s’agite de secousses. Il ouvrit violemment les yeux en espérant être enfin en sécurité dans les eaux du Bassin. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’il se retrouva de nouveau sur la plage, nez à nez, avec Juliette, complétement affolée. Il prit sa tête dans ses mains, son crâne le faisait atrocement souffrir. - Tu m’as fait une peur bleue ! reprocha Juliette. Je t’attendais mais tu n’es jamais venu et je viens de te trouver ici, inconscient. Il regarda autour de lui, hagard. Il était de retour sur le sable de sa petite plage au milieu de ses affaires. Il ne sut jamais s’il avait rêvé ou s’il était rentré grâce à l’aide de ses amis aquatiques. Il aurait juré voir un reflet bleu s’enfonçait dans les flots à son réveil ! Il n’osa jamais en parler à Juliette et ne pourrait jamais en être sûr, mais ce soir-là, il s’endormirait serein de les savoir en sécurité. Il ne se remettrait jamais en revanche de n’avoir pu conserver cet anneau aux reflets argentés qui lui aurait permis de les revoir... Qui sait ?
Mélissa CONTE
Entre Terre et Mer
Nous sommes le 20 juin 1936. Ce jour-là, il fait très chaud, le soleil réchauffe les andernosiens, mais un petit air marin, frais et iodé, rend la balade très agréable en bord de mer, que ce soit sur la plage ou sur les ports ostréicoles. D'ailleurs c'est ce jour-là que le petit Bernard fit une incroyable découverte ! Bernard est un petit garçon de 6 ans qui a des yeux rieurs, un sourire charmeur, des cheveux en bataille, et cette date est très spéciale pour lui, puisque c'est le jour de son anniversaire ! Étant un grand gourmand, il demande alors à ses parents : " Papa, maman, ze voudrais aller manger des huîtres au port, siouplait ? Pour mon anniversaire !" suivi d'un grand sourire à croquer. Avec cette demande si mignonne et ce joli minois, sa mère ne pouvait pas le lui refuser : " Allons-y mon petit loulou, nous irons chez Huguette tout au bout du port, les huîtres y sont délicieuses, et le paysage est splendide ! Tu vas adorer !" Sur ces mots, le petit Bernard enjoué, prit son chapeau, ses lunettes de soleil et ses sandalettes : il ne s'était jamais muni de toutes ses affaires aussi vite ! Ses parents échangèrent un regard complice et rempli d'amour. "On y va à vélo ?" Proposa le papa de Bernard. Ni une, ni deux, Bernard enfourcha son vélo et commença la route vers le port, avant que ses parents ne le rejoignent. Une petite virée au centre d’Andernos, en continuant de longer la plage, puis la petite famille admire la belle église St Eloi et ça y est, ils peuvent apercevoir les cabanes typiques de ce port pittoresque. Arrivé tout au bout de la quatrième darse, il aperçoit un visage familier. « Et bonjour mon petit, Didon qu'est-ce que tu as grandi ! La dernière fois que je t'ai vu tu étais comme ça ! » Dit-elle en montrant une taille qui semble vraiment minuscule à Bernard ! "Mon petit loulou, cette dame c'est ta cousine Huguette, c'est elle qui tient ce restaurant" lui explique sa maman. "Et bah les cousins, suivez-moi que je vous installe à ma meilleure table" dit la grande femme costaud, avec son accent typique du bassin. Bernard et ses parents s'exécutent. Une fois installé, haut perché sur un mange debout, le petit "loulou" est aux anges ! " Cousine, ze voudrai une douzaine d'huitres siteplait ?! J'adooooooooore les huîtres et c'est mon anniversaire " s'exclame Bernard ! Ses parents commandent à leur tour, et dix minutes plus tard... ça y est le grand moment est arrivé... Les assiettes arrivent ! Les yeux du mignon petit garçon brillent de mille feux. Il gobe alors une huître, puis 2, puis 3, en croquant un peu pour avoir une explosion de saveur dans la bouche... Puis vient le tour de la quatrième, il croque et là... Oh oh... il sent quelque chose a choisi sous la dent. "Pourtant une huître, ça n'a pas de noyau" se dit-il. Il recrache alors pour voir ce qui se cache dans sa bouche. C'est rond, dur, blanc et sa brille... Bernard n'avait jamais vu quelque chose d'aussi beau ! "Oh mon p'tit gars, tu as trouvé une perle dans ton huître !" Dit le papa de Bernard. Il continue de la contempler de très près quand, tout à coup, il voit une ligne dorée scindé la perle en deux, la partie supérieure de la perle est expulsée à toute vitesse dans un nuage de poudre arc-en ciel et pailletée ! Bernard toussote avec toute cette "poussière"... Et devant les yeux ébahis de la famille andernosienne, une fée magnifique déploie ses ailes. Elle a de longs cheveux tressés aux couleurs de l'arc-en-ciel en plus pastel, une robe bustier courte nacrée et de petits escarpins munis de mini perles sur le dessus, ses ailes sont roses poudré pailletées d'un millier de mini perles. Elle commence alors à parler et une petite voix fluette sort de ce petit être. " Bonjour, je m'appelle Ostrea, cela fait longtemps que j'attends pour sortir ! Je suis la fée des huîtres ! " Huguette n'en revient pas...&amp;lt;br&amp;gt;"Alors ça y est... Ça y est, ça a marché !" Dit-elle en se frottant les yeux ! Devant le regard perdu de ses invités, elle explique alors : "il y a 3 ans de ça, c'était une année compliquée pour l'ostréiculture, entre les prédateurs de l'huitre et le dinophysis, j'avais perdu plus de la moitié de mes huîtres, j'ai donc voulu créer une fée pour veiller sur mes petits coquillages, et j'avais lu dans le manuscrit de mes ancêtres, qu'en mettant un grain de sable rose dans une huître, une fée pouvait être créée. Suis alors allée à la dune du Pilat et j'ai fouillé le sable pendant des jours et des jours, pour enfin trouver l’un des cent grains de sable rose que possède la dune du Pilat... Et nous voilà aujourd'hui !" Bernard ouvre grand ses yeux, il n'en revient toujours pas... Huguette continue : " Bonjour Ostrea, je suis Huguette ta créatrice, et je suis ravie de te voir aujourd'hui ! Tu ne sais pas à quel point je t'attendais!" Ostrea rougit à l'écoute de ses belles déclarations. Et Huguette enchaîne alors : " D'ailleurs, maintenant que tu es là, ma beauté, pourrais-tu aller faire un tour dans l 'eau iodé de notre si beau bassin, pour vérifier que tout se passe bien ?!" Ostrea hoche alors la tête :&amp;lt;br&amp;gt; "J'y vais de ce pas, je reviendrai demain soir à 19h pour vous faire un rapport !" Elle fait un grand plongeon, nage, et nage encore pour rejoindre l'île aux oiseaux, elle fait alors le tour des parcs... Tout va bien ! Elle longe le village de l'herbe, la vigne, le Mimbeau... Rien à signaler ... Elle continue donc son périple jusqu'au banc d'Arguin... Et là, au loin, elle semble reconnaître une armée entière de dinophysis... C’est une algue qui ressemble à une punaise rouge avec des pinces, des pattes et une queue de poisson... Et il y en a 100, 1000, 10000... Impossible de savoir combien exactement. Ostrea commence à paniquer... Comment pourrait-elle faire pour protéger les huîtres de cette armée de dinophysis ? Qui pourrait lui venir en aide ? Car toute seule, elle ne pourra jamais gagner ! Prise de panique, elle revient sur ces pas, les larmes aux yeux, elle s'arrête au pied d'une cabane tchanquée... "Comment vais-je faire ?! Je ne sais même pas quels pouvoirs je possède et comment les utiliser... Et je suis toute seule... Ostrea sanglote, et pour essayer de trouver quelques bras, pinces ou nageoires pour l'aider à vaincre cet immense groupe d'envahisseurs, elle chantonne " ohééé ohééé, mes amis, venez tous nous sauveeer". Et elle reprend de plus belle... Au bout de 2 ou 3 chansonnettes, elle s'arrête et soupire en voyant l'inefficacité de sa chanson d'alarme. Elle se recroqueville alors sur elle-même, et pleure la tête entre ses bras croisés. Elle est désespérée, et elle se demande comment réagira sa créatrice si elle lui rapporte les faits. &amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;span&amp;gt;Une fois calmée, elle relève la tête et, contre toute attente, une armada de mollusques, coquillages et poissons en tous genres lui font face ! C'est donc cela son pouvoir, parler aux animaux marins par le chant et pouvoir communiquer avec eux ! Reboostée à fond, elle chante alors : "Merciiiii les amis, préparez-vous pour la gueeeerre, nous allons réduire ces inconvénients en poussière". Ostrea ouvre alors la marche, cap sur le banc d'Arguin ! La troupe des protecteurs est alors arrivée à bon port pour participer à la défense, ils se préparent tous à faire face à Dinophysis. La première rangée d'algue attaque. Pour la contrer, les hippocampes projettent avec leurs trompes, des petits bouts de coquilles afin de transpercer les algues. Une autre vague de Dinophysis arrive et c'est au tour des seiches et des soles de les exterminer, les seiches propulsant leurs ancres gluantes pour les coller au sol, quant aux poissons plats, ils font rouler les "punaises rouges" sur leurs dos pour les faire glisser jusqu'à l'océan. Malheureusement quelques soles se font blesser par les pinces de leurs adversaires et une plus amochée que les autres perd même la vie. Une centaine de dinophysis s'approche encore, et les étrilles les découpent en tout petits morceaux avec leurs pinces tranchantes. C’est à ce moment-là,qu’une étrille toute gringalette perdu le combat face à une "punaise rouge" qui lui arracha sa pince avec la sienne. C’est alors que la dernière lignée de dinophysis s’avance, les raies viennent en aide à Ostrea afin de les repousser. D'un battement d'ailes, les raies font apparaître un tourbillon de courant qui projette les nuisibles tout droit dans l'océan, Ostrea participe également à cette attaque. Grâce à son chant très aigu, elle arrive à former une vague extrêmement violente qui ravage toute l'armée restante de dinophysis et les renvoie tout droit dans l'océan. Cette énorme troupe est prise dans un courant et est éjectée bien plus au sud. Le bassin et ses huîtres sont sauvés grâce à Ostrea et tous ses amis qui lui ont prêté main forte ! "Merci à tous de m'avoir aidée à combattre ces monstres pollueurs d'huîtres, vous êtes vraiment des amis loyaux, et grâce à vous l'équilibre du Bassin et de ses habitants est maintenu, nous garderons toujours en mémoire nos amis partis pour cette cause" Après ce discours touchant d'Ostrea, tous reprennent le cours de leur vie avec une petite part de chagrin en eux. Ostrea, se retrouvant de nouveau seule, se remémore cette incroyable lutte offerte de ses amis, elle lève les yeux au ciel... "Mince, mais quelle heure est-il ? Je vais être en retard pour faire le rapport à mon adorable créateur !" En 6 coups d'ailes, elle est plus rapide qu'une fusée traversant la couche d'ozone, et la voilà arrivée au port d'Andernos. Au loin, Huguette, Bernard et ses parents l'attendent en la saluant. "Alors ma petite gringalette, qu'as-tu à me raconter ?" Dit Huguette de toute sa bienveillance. Ostrea lui raconte alors toute cette aventure, l'aide apportée par les raies, les soles, les seiches, les étrilles, les hippocampes pour venir à bout de l'armée de dinophysis, elle lui raconte la perte de quelques-uns de ses amis et lui expliquent qu'elle a découvert ses pouvoirs magiques grâce à cette guerre "passe-bassin". C'est alors que le petit Bernard a présenté une excellente idée : " Pour célébrer la victoire des animaux du Bassin, organisons une grande fête avec de la musique ! Et comme Ostrea a une très belle voix, peut-être qu'elle pourrait chanter sa victoire !?" Depuis ce jour, pour célébrer la victoire d'Ostrea sur l'armée du dinophysis, nous lui rendons hommage tous les ans, le 21 juin, en fêtant la musique.
Célia KUPPE
L'incroyable aventure d'OSTREA
NOUVELles
Je vis sur le bassin au rythme des marées. Quel que soit le temps, je suis dans l'eau. J'ai vite fait connaissance avec le quartier du Mauret, au fil de mes promenades et de mes baignades. Mon oncle avait acheté une maison au Mauret qu'il avait cédé à ma mère voici plus de soixante ans. La plupart des maisons sont malheureusement détruites et remplacées par des constructions nouvelles sans âme. J'ai la chance d’habiter dans une maison rénovée récemment mais restée dans son pur jus. Une des maisons du patrimoine Andernosien, je savoure chaque jour le bonheur d’y vivre. J'y ai trouvé refuge en Mai 202O après avoir connu le confinement en Mars, dans le quartier parisien le plus peuplé de l'est parisien. Je suis très heureuse d'être revenue vivre en Gironde et surtout au bord du bassin. Le bassin est un milieu très ouvert, il est facile d'entamer une conversation et de la poursuivre, quelquefois à quelques jours d'écart, d'autres fois à quelques mois. Des rencontres ont marqué. Cette dame qui amenait ses chiens en voiture trois fois par jour, les baladaient et s’en retournait. Elle les choyait chaque jour. Je l'ai rencontré pendant plus d'un an. Croisée un jour au détour d’une promenade, elle me parle de maux d’estomac,elle va consulter son medecin. Quelques semaines plus tard, ne la croisant plus du tout, j’apprendrai par des promeneurs de chiens qu'elle est décédée d’un cancer du pancréas. Je rencontre les maitres des chiens et au fil du temps, connait leurs prénoms, prénoms des chiens puis prénoms des maitres. J’apprends à déceler leurs caractéristiques, leurs habitudes ; tel chien, chien d’eau, parcoure chaque jour sans relâche des kilomètres, tel autre chien est accro au frisbee, tel autre est très peureux mais s’aventure avec le temps dans l’eau avec moi. Partout des panneaux chiens interdits mais heureusement, cet interdit s’efface dans les faits dès l’automne, après les journées d’été ou vacanciers viennent en villégiature sur le bassin. J’aime les ambiances changeantes ; je suis chaque jour gâtée par le bassin. Chaque heure du jour, du soir a une ambiance différente. A chaque heure son ambiance, à chaque saison ses habitudes. Je fais des photos de couchers de soleil sur des mois et des mois. Les photos se succèdent et aucunes ne se ressemblent. Une symphonie de couleurs, chaque soir, illumine le bassin. Au fil de mes promenades le soir au coucher du soleil, je perçois des ombres, certaines troncs de tamaris tordus me semblent être des personnes, je rêve en me promenant, mes yeux saisissent les derniers éclats de couleurs des couchers de soleil flamboyants. Des habitués du Mauret se retrouvent au moindre rayon de soleil, à partir du printemps et au fil des marées. La rencontre est au rendez-vous de la journée. Les vacanciers arrivent dès les jours fériés pour des longs weekends et se mêlent aux locaux ; des conversations se nouent, se dénouent aussi subitement qu'elles ont commencé Liberté d'être, liberté de rencontre, liberté de partir, ce petit monde foisonnant est riche en découvertes et en sensations. Toute petite, j'ai connu mes premiers bains au Mauret. Plus de quarante ans plus tard, mon fils connaitra ses premiers bains au même endroit. Joli maillot deux pièces, un sourire radieux je me vois sur une photo d’un autre temps. Beaucoup de choses ont changé au Mauret et pourtant sur la photo de mon fils, je retrouve les mêmes repères, seules les couleurs des photos ont changé. Temps immuable, s’égrenant au fil des jours, douceur de vivre à l’ombre des tamaris et au gré des marées. La faible profondeur de l’eau procure des petits et grands plaisirs d’eau à tout moment. Coquillages enfouis dans la vase, vaguelettes ou calme plat, symphonie de bleus et verts, des sensations oubliées et retrouvées réjouissent mon âme. L'hiver doux arrive, les bateaux disparaissent de l'horizon. Ils réapparaissent avec les beaux jours au printemps, un par un, chaque jour voit un paysage différent en carte postale. Coup de vent sur le bassin, je me rappelle de ces bateaux échoués. Cette magnifique pinasse totalement rénovée par son propriétaire suscitait l'émotion très vive des passants. Chaque marée apporte son lot de surprise et de découvertes sur le bassin. Je rencontre Jean-Pierre B, un de mes voisins du Mauret. Une autre rencontre particulièrement marquante pour moi. Il est une figure emblématique du bassin. Tout le monde le connait dans le quartier, baptisé Jésus Christ par certains, Papa Noel par d’autres, et j'en oublie ... des petits yeux perçants, une grande chevelure et barbe grise, il va partout dépanner les habitants ; plus de chauffage, plus d'eau, des petits travaux d'urgence il est toujours là pour chacun d'entre nous, en cas d'urgence. Cette année il a perdu sa compagne de vie. Chaque vendredi, il me prend du pain aux blés anciens, au marché d’Andernos les bains. Il me l'apporte et nous entamons toutes les semaines de grandes conversations. Jean pierre a des passions multiples et variées. Il me raconte ses folles aventures de jeunesse. D'une famille de gabariers de père en Fils, il est parti très jeune de sa Dordogne natale et s'est embarqué pour des expéditions de pêche à la morue. Les longues journées, le plaisir d'être en mer toujours gardé intact malgré la dureté de la vie, il naviguera ensuite sur des voiliers. Se crée entre moi et Jean Pierre une intimité avec cette rencontre hebdomadaire et ses grandes discussions. La grande passion de Jean Pierre, être sur l’eau. Ma grande passion, être dans l'eau. Au fil de discussions animées, nous nous découvrons des points communs. Jean Pierre a une fille dont il a fait connaissance très tard, elle a soudainement surgi dans sa vie, souhaitant rencontrer son géniteur. J’ai découvert mes racines très tard aussi, mon géniteur s’appelant jean Pierre B. Père disparu, que j’ai pu entrapercevoir au fil des discussions avec Jean Pierre. Mon géniteur avait financé ses études de médecine avec des pêchers et des ruches. Il a fondé l'un des premiers cabinets médicaux en Gironde, qui porte d'ailleurs son nom dans une petite ville girondine. Jean pierre et moi partageons certaines valeurs. Par mes échanges avec jean Pierre, je retrouve ce père naturel que je n'ai pas connu. Mon histoire et son histoire entremêlent dans un ballet de conversations, à deux pas du bassin. Jean Pierre sait tout faire ; il est d’une intelligence brillante. Il a le bio en passion, le respect de la nature, des animaux, des insectes. Il n'écrase ni les mouches, ni les araignées ni les moustiques. Fort respectueux des êtres vivants, des végétaux, il défend les valeurs profondes, l'écologie de tous les jours. Il a décidé voici longtemps à une époque où on ne parlait pas de tout de consommer bio. Il fut le seul de sa famille à le faire, il est le seul en bonne santé et il n'hésite pas à le claironner. Dans mon imaginaire, se mêlent mes propres souvenirs, les souvenirs du bassin et mon réel depuis 2020. Il m'est impossible de renoncer à ces plaisirs quotidiens. J’aime prendre cette allée qui me mène au bassin. Mille fois arpentée, mille fois parcourue et pourtant toujours source d’intérêt.
Sabine LATOUMETIE
Le MAURET au fil du temps
Nouvelles



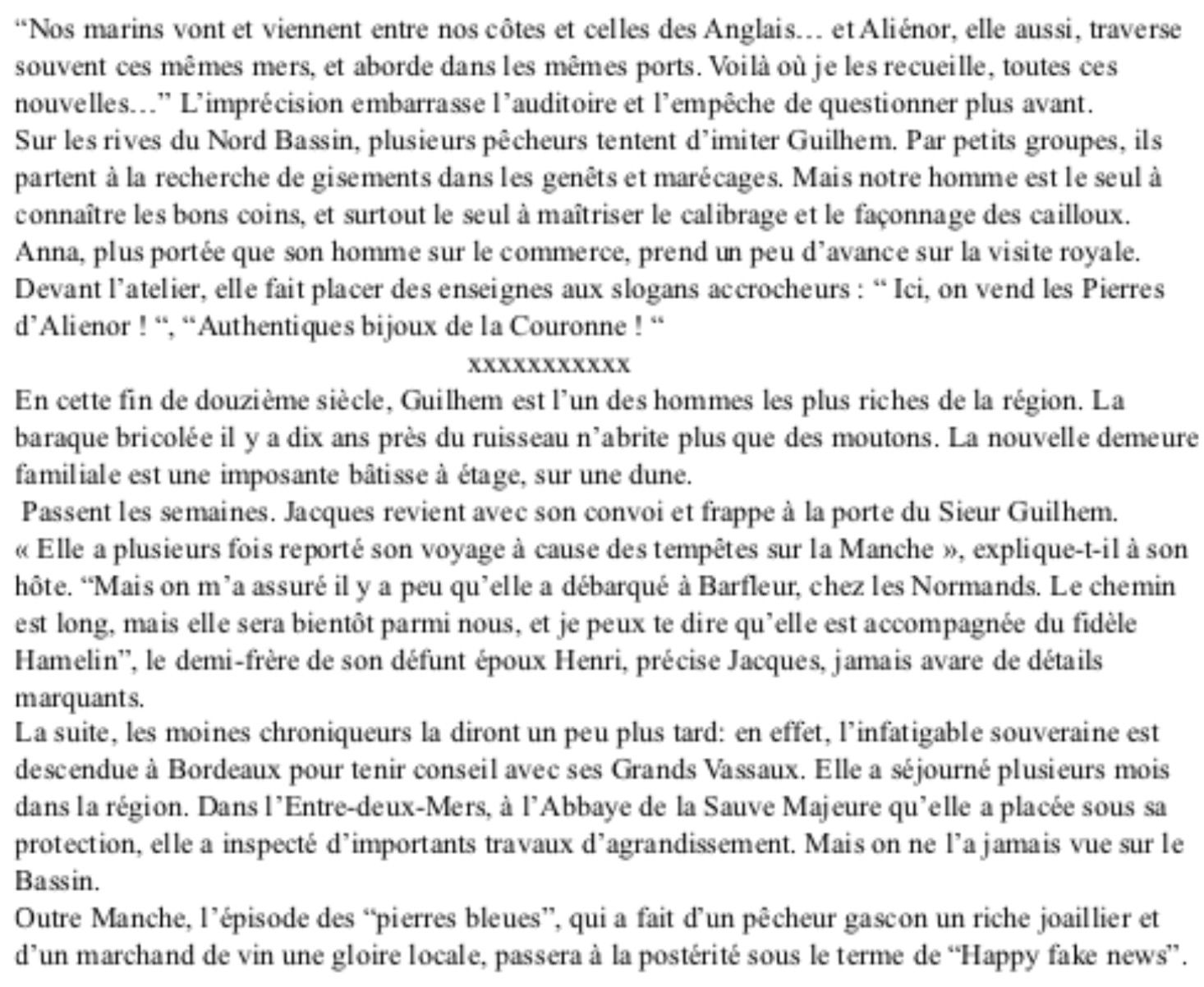
Michel SAILHAN : À portée de cailloux
Nouvelles
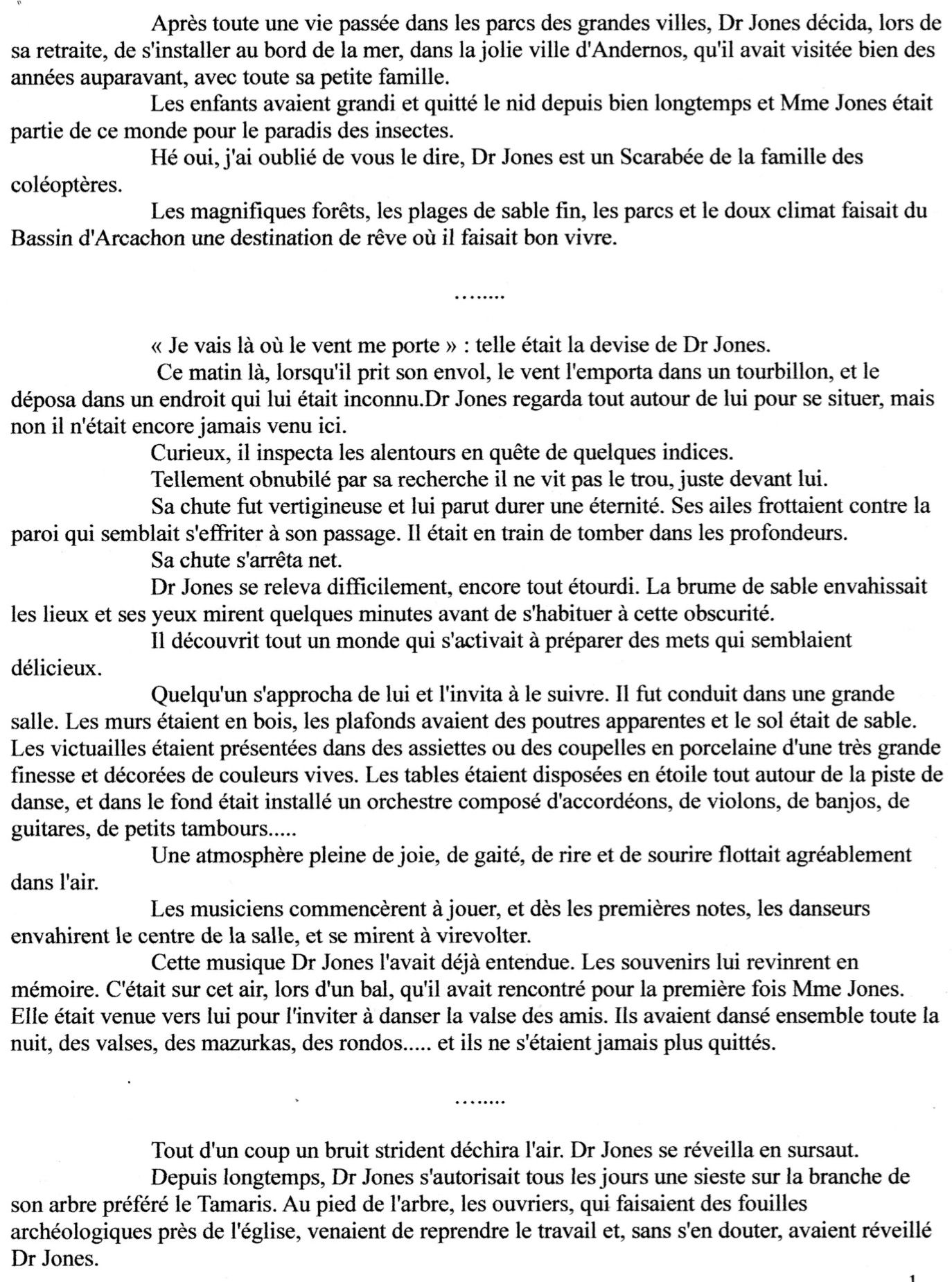
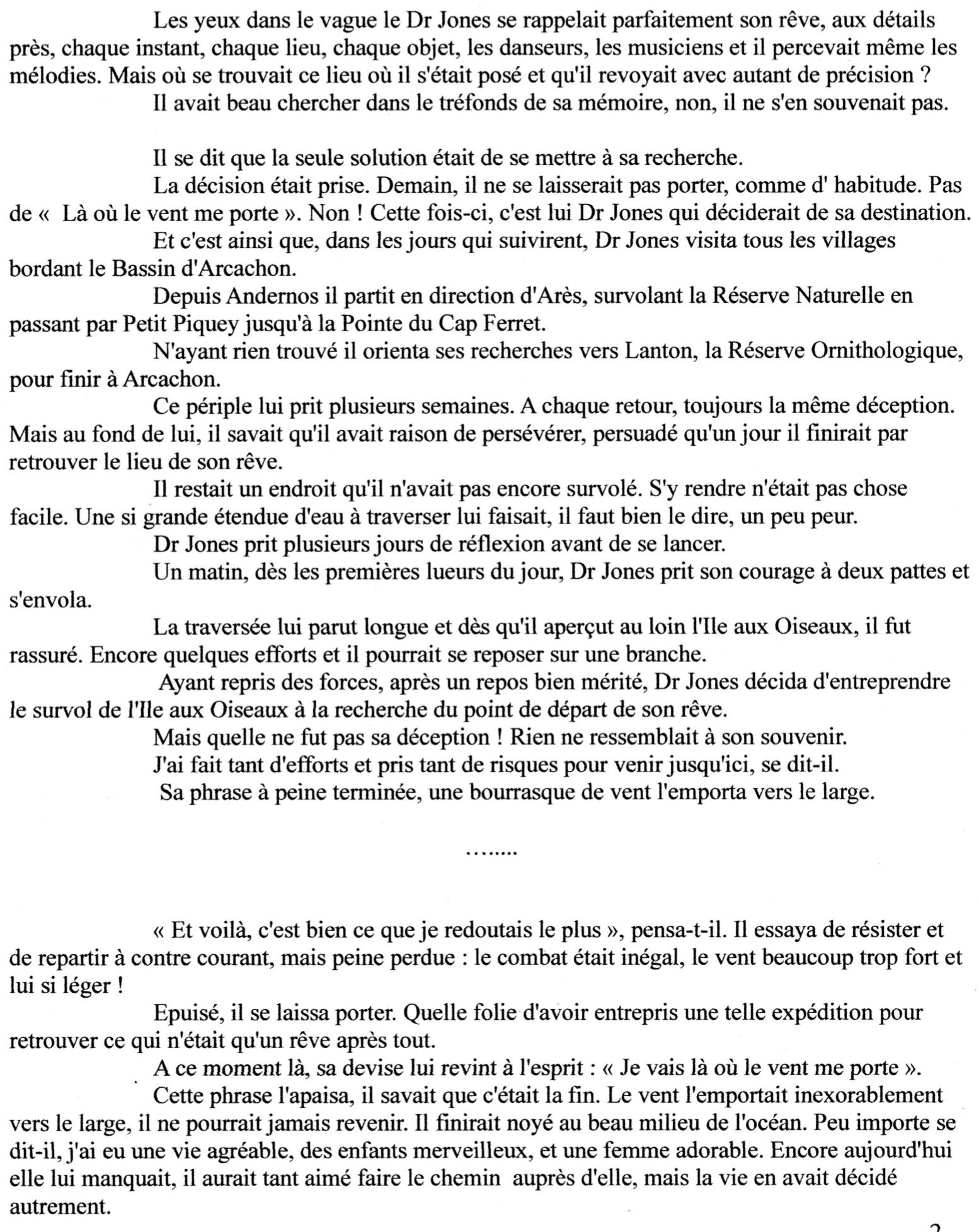

Hélène BRONZOM : Là où le vente me porte
Nouvelles
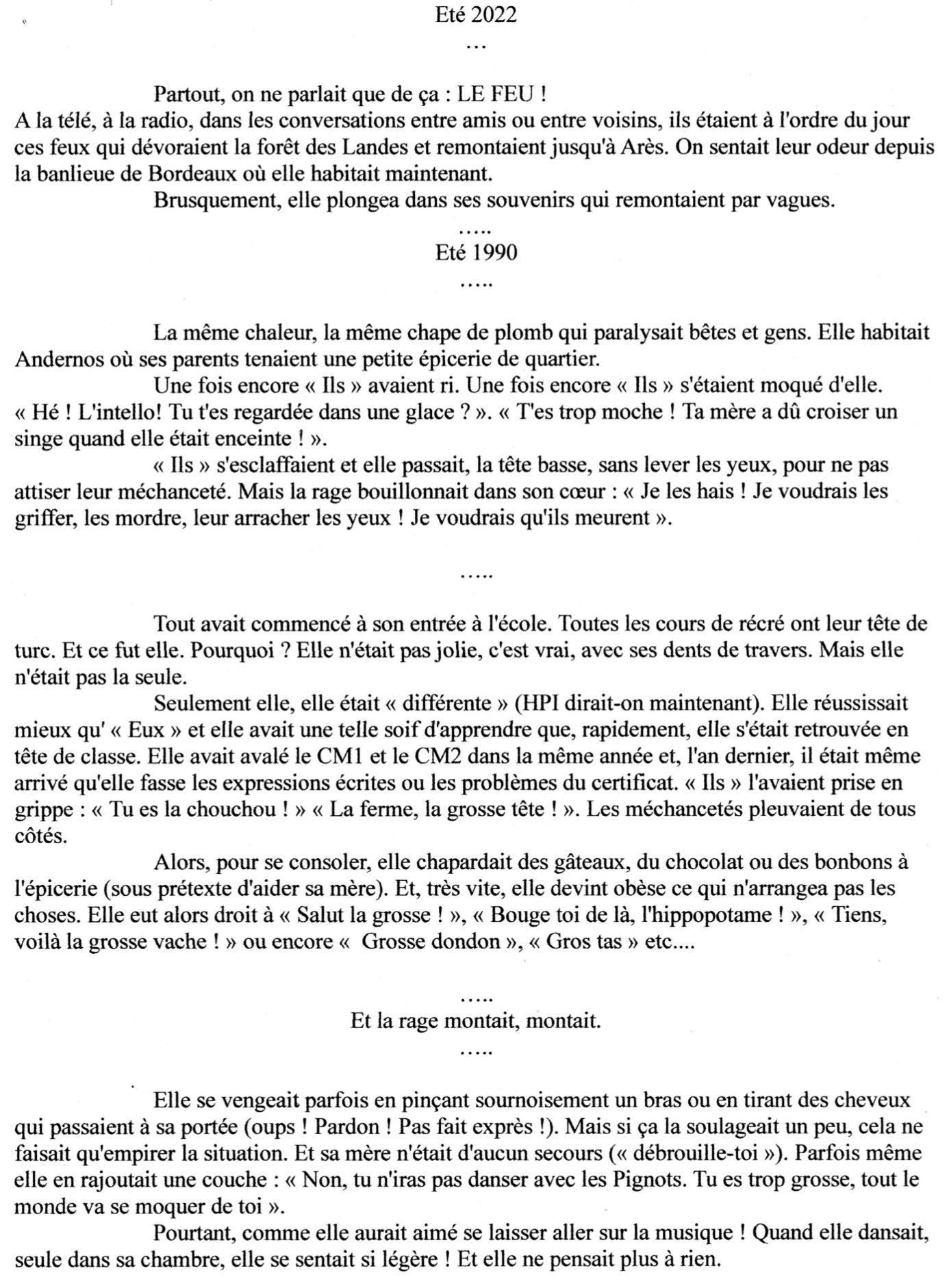
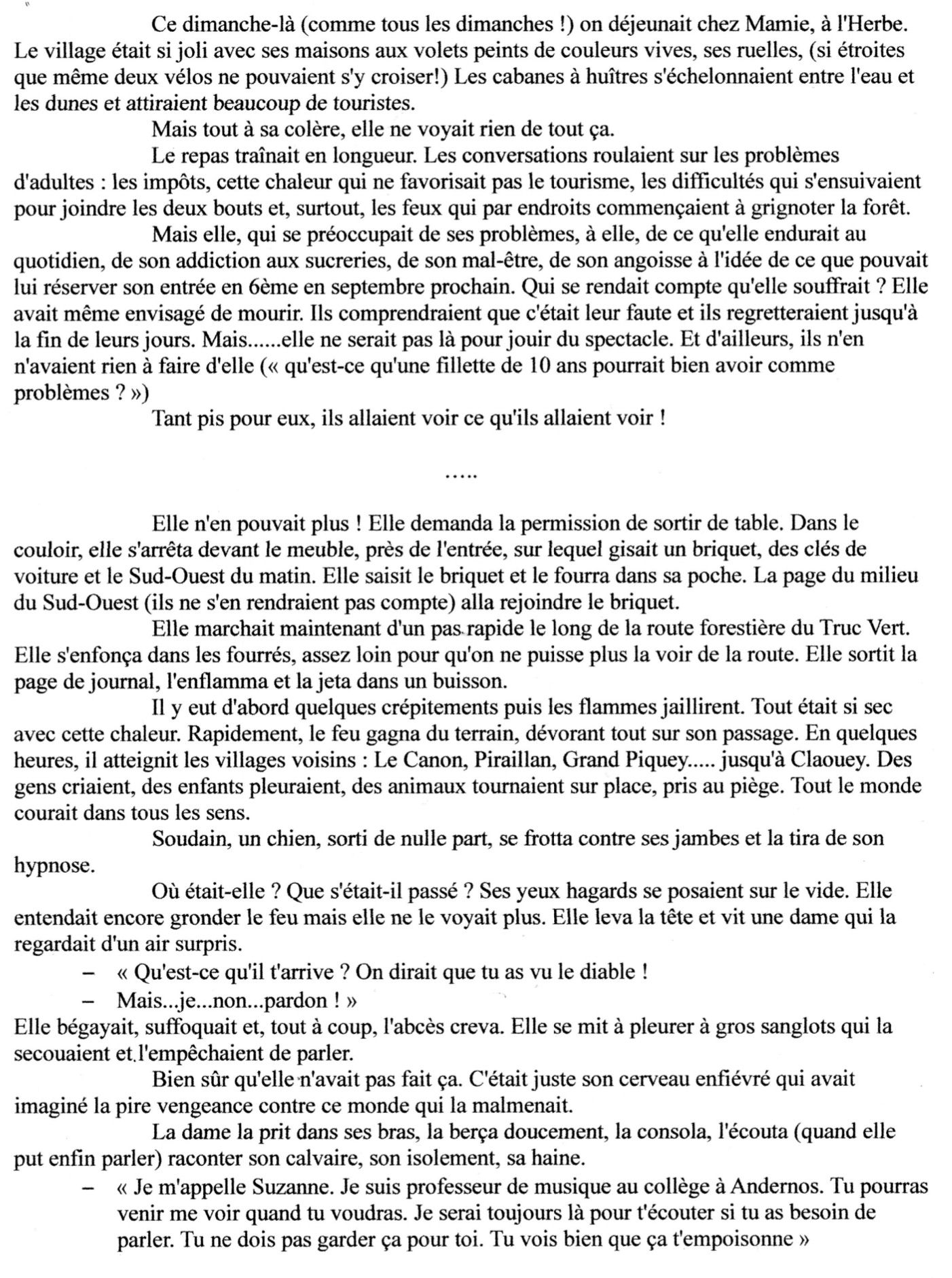
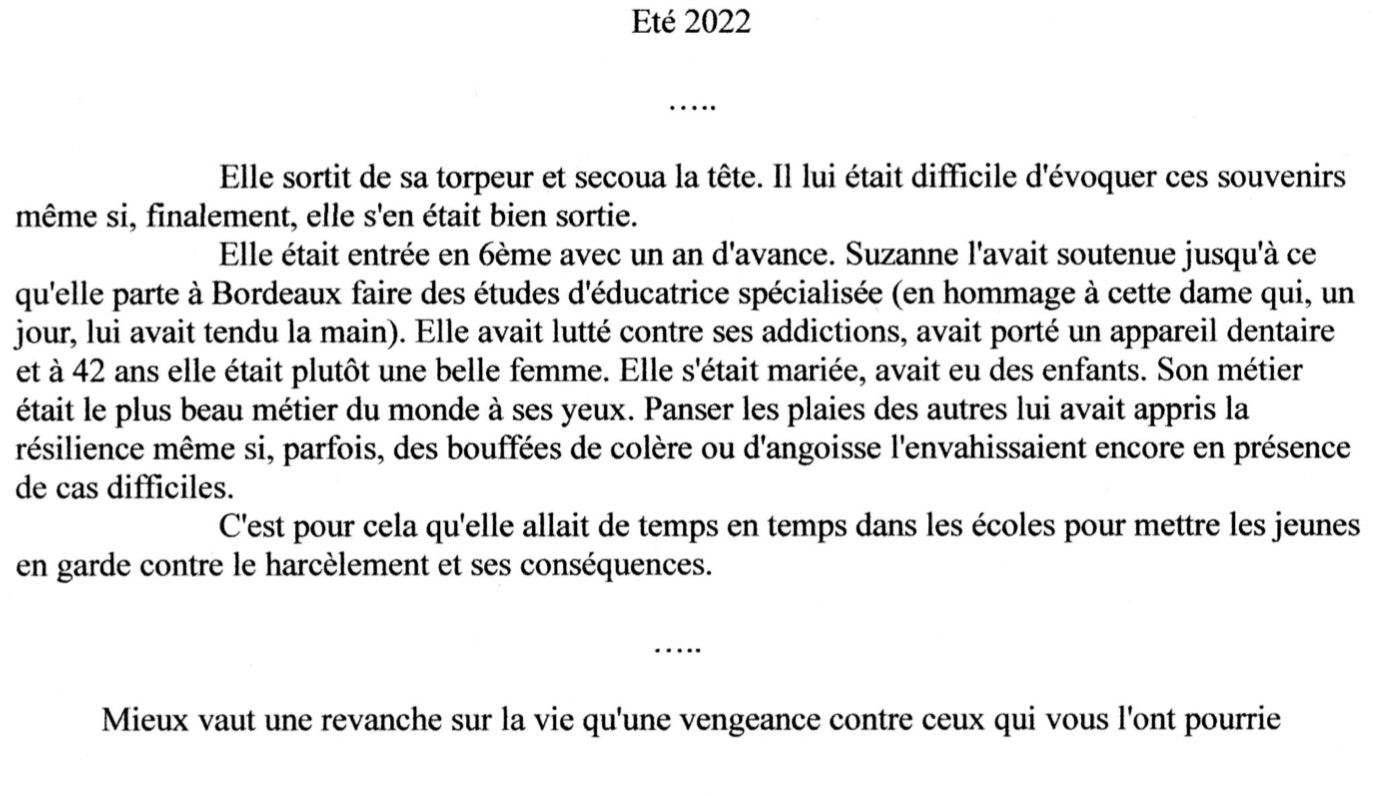
Sylvette NICOLAS : Le feu aux poudres
Nouvelles
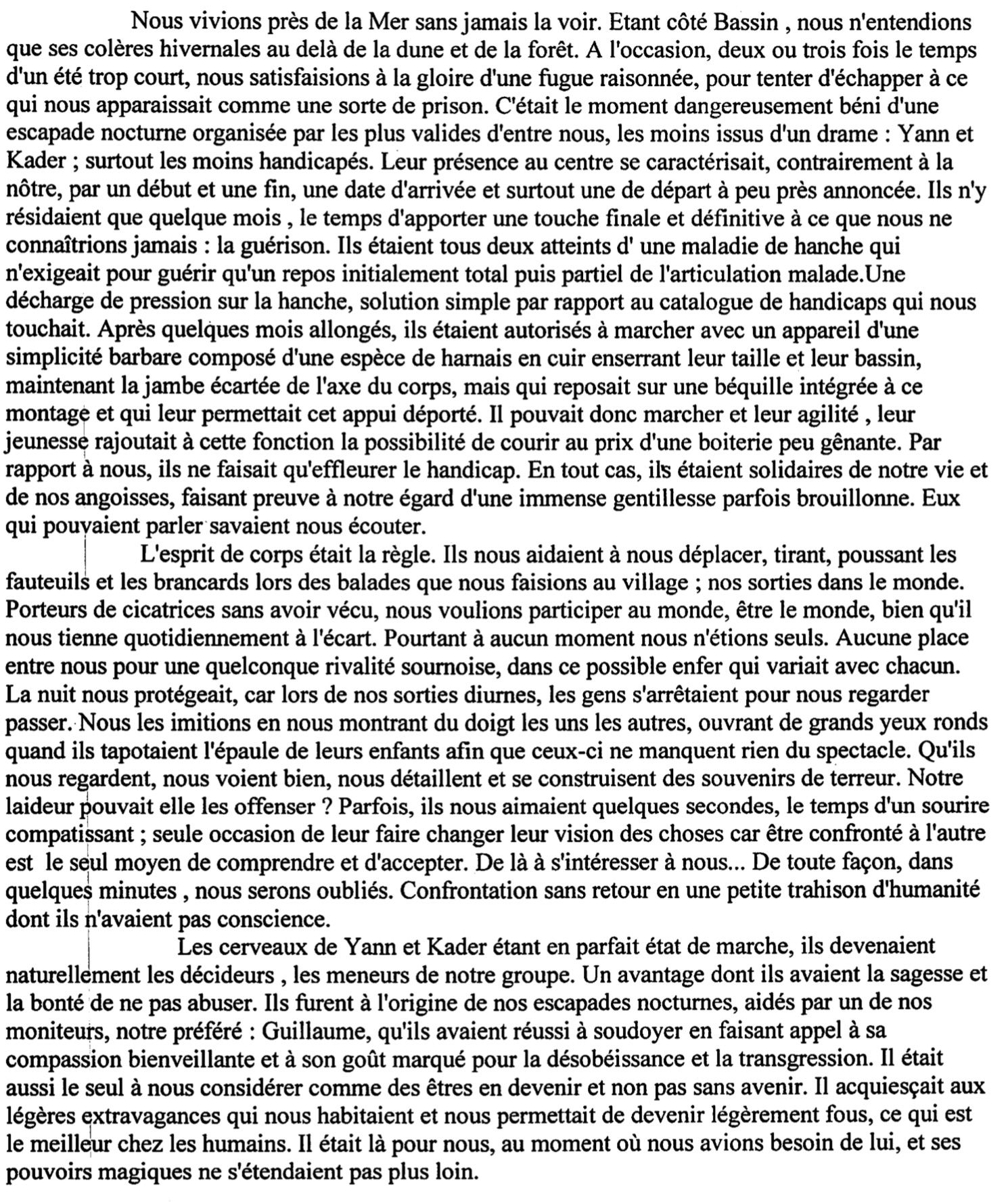

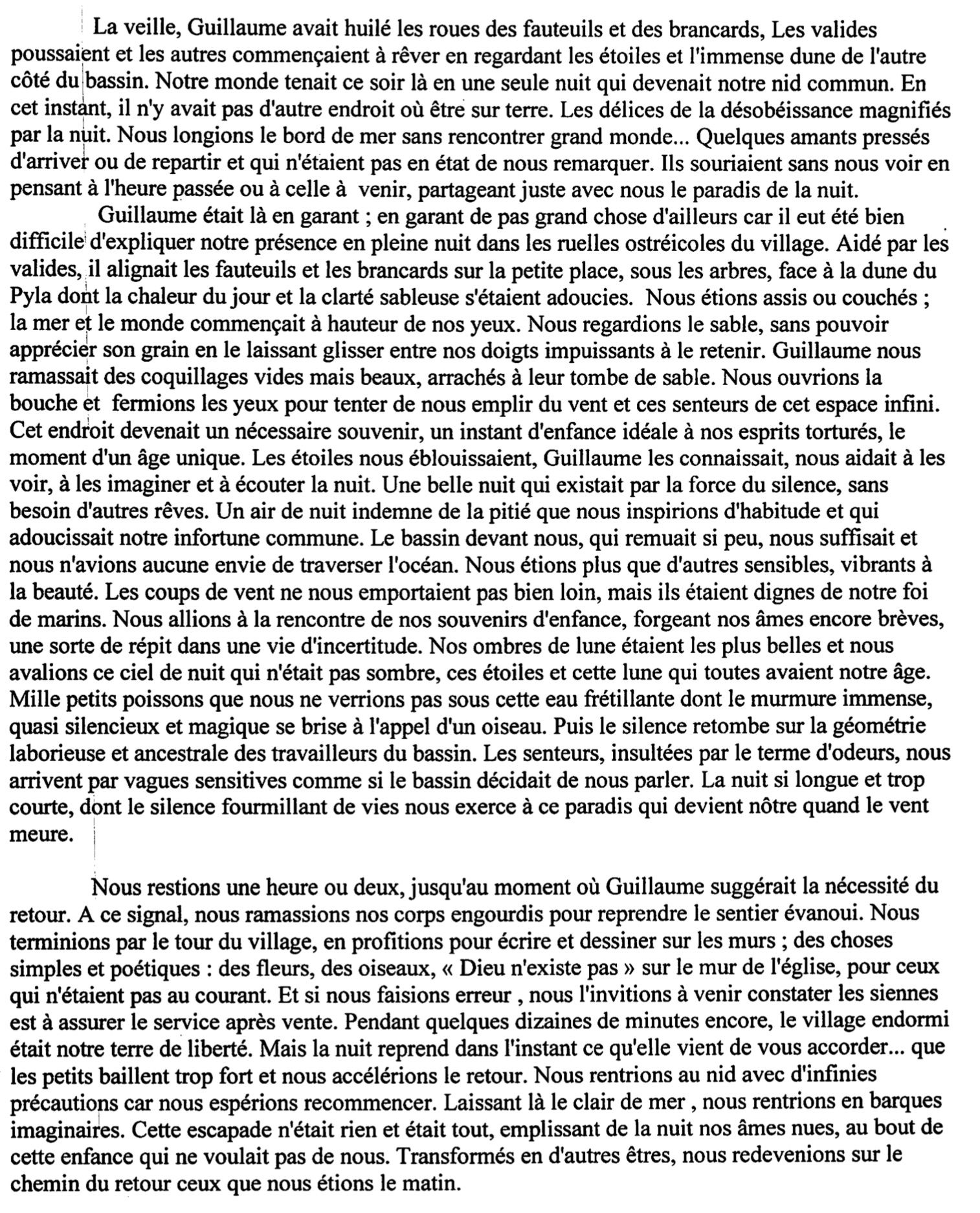
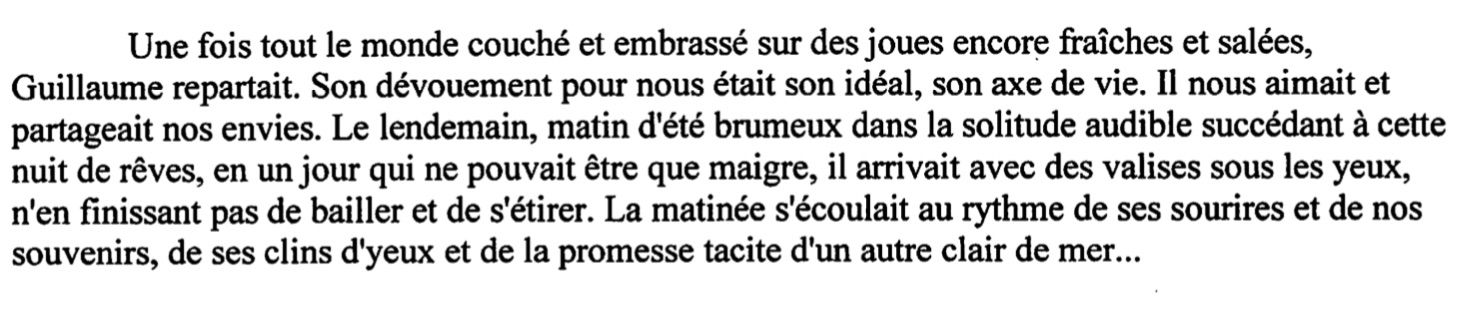
François TESTUT : Clair de mer
Nouvelles

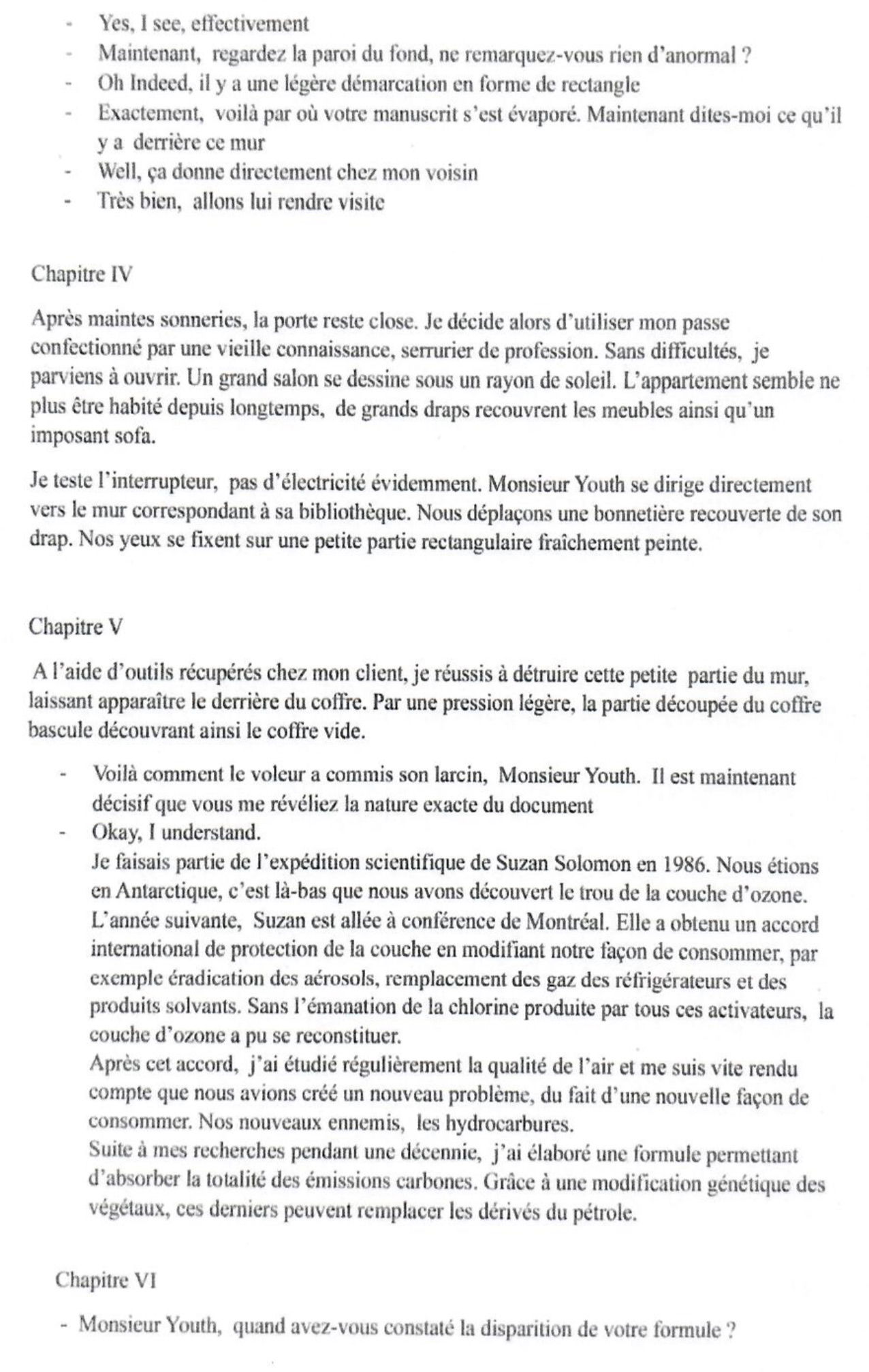


Nicolas DOURNET : L'affaire YOUTH
Nouvelles
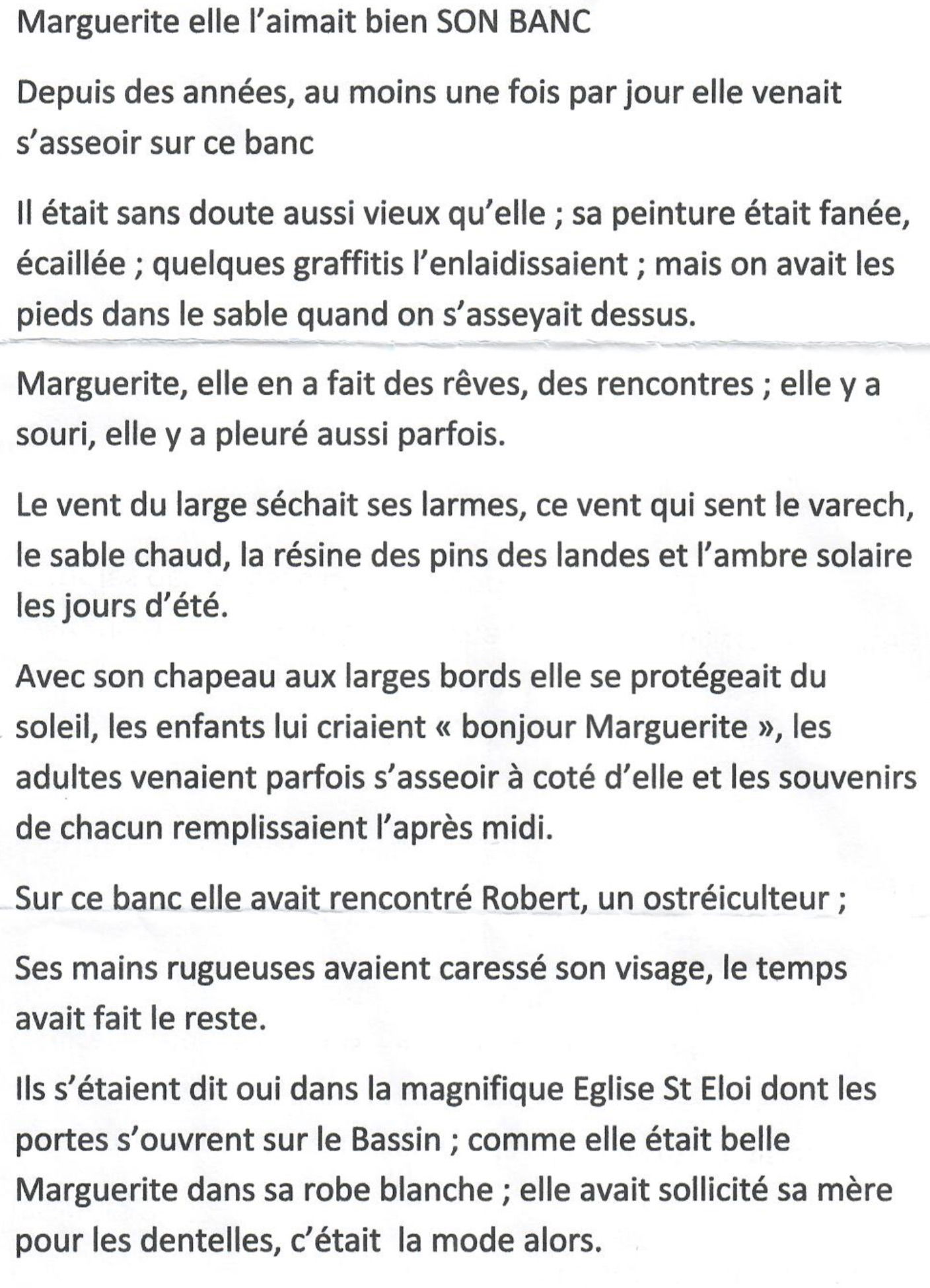
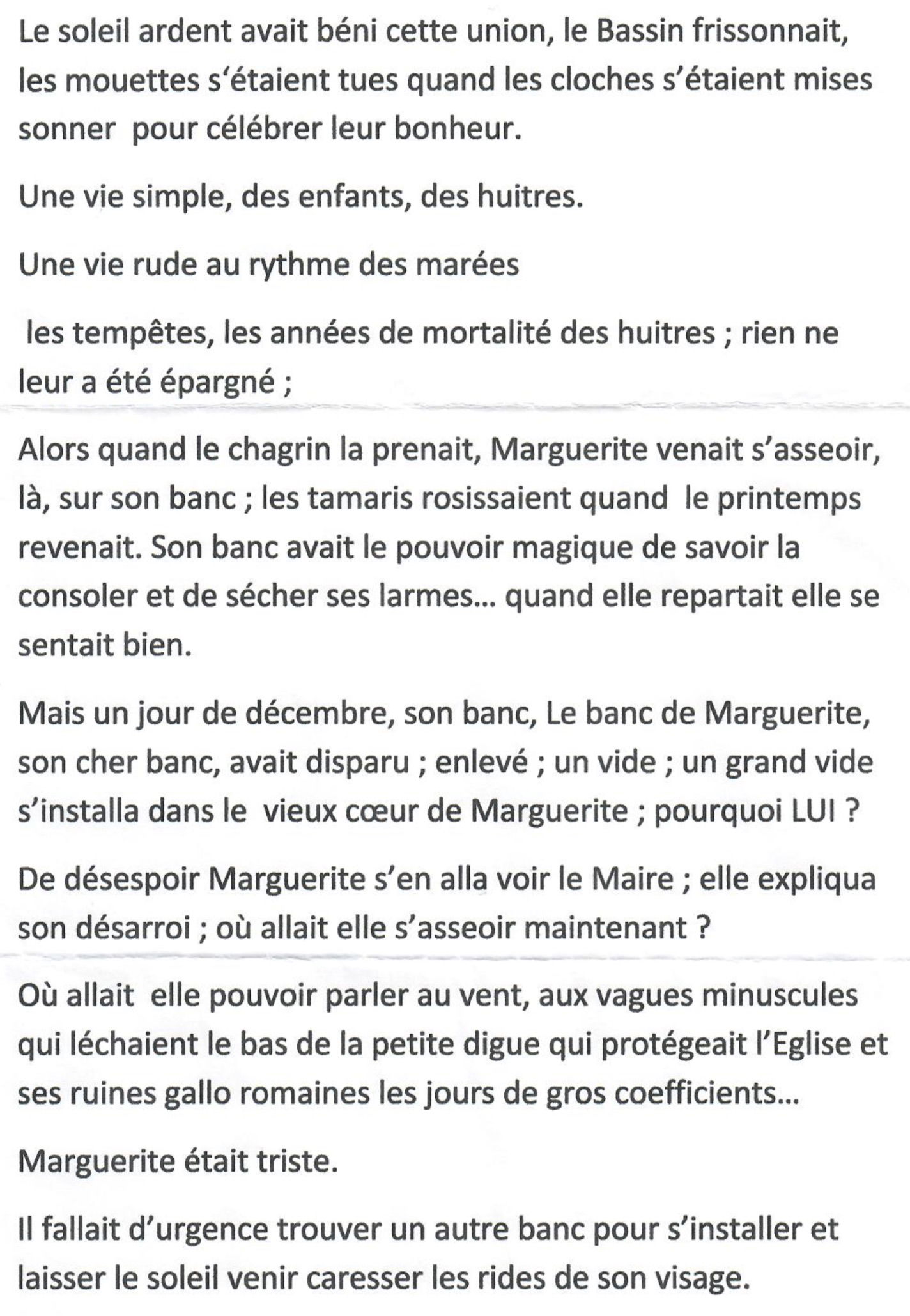
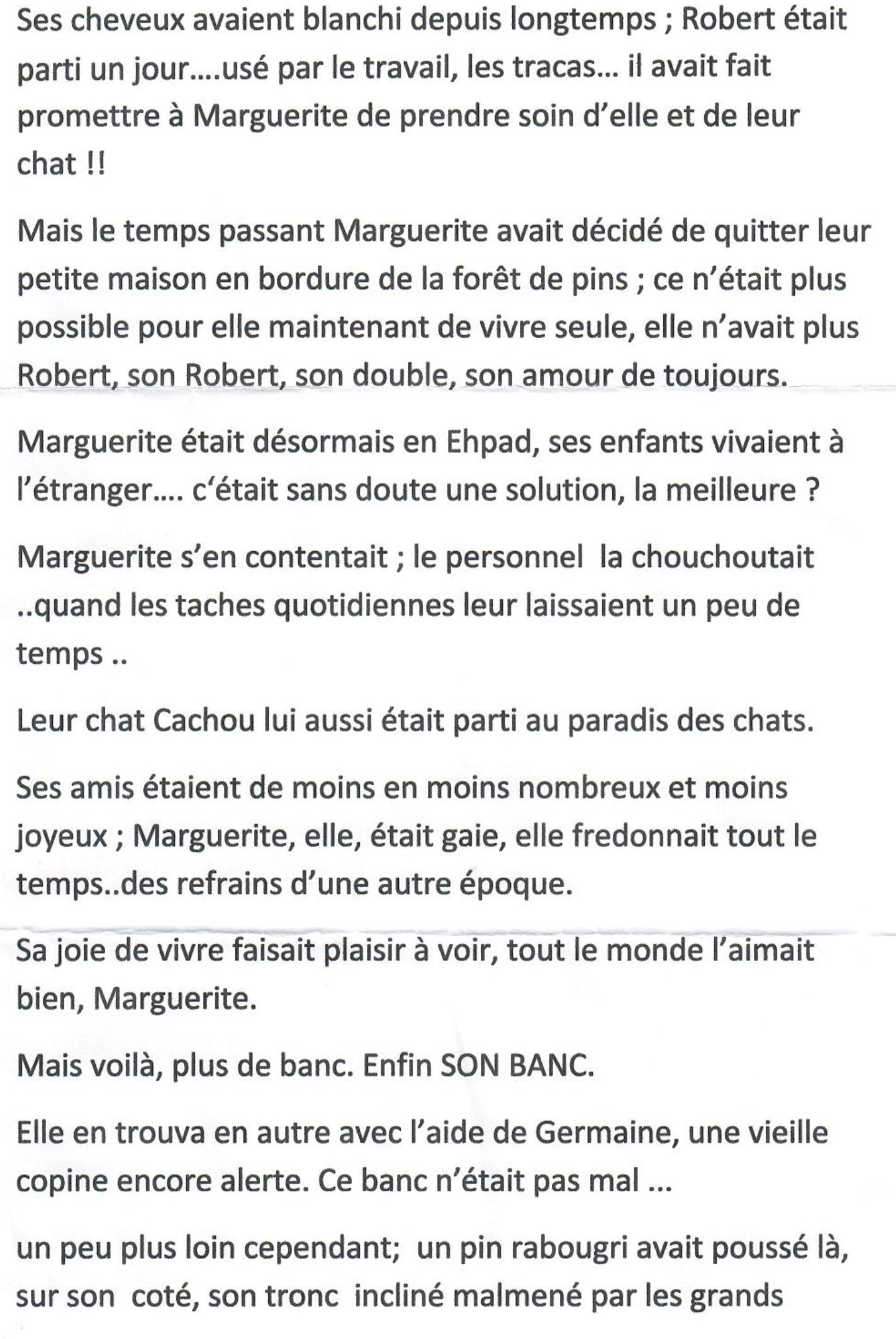
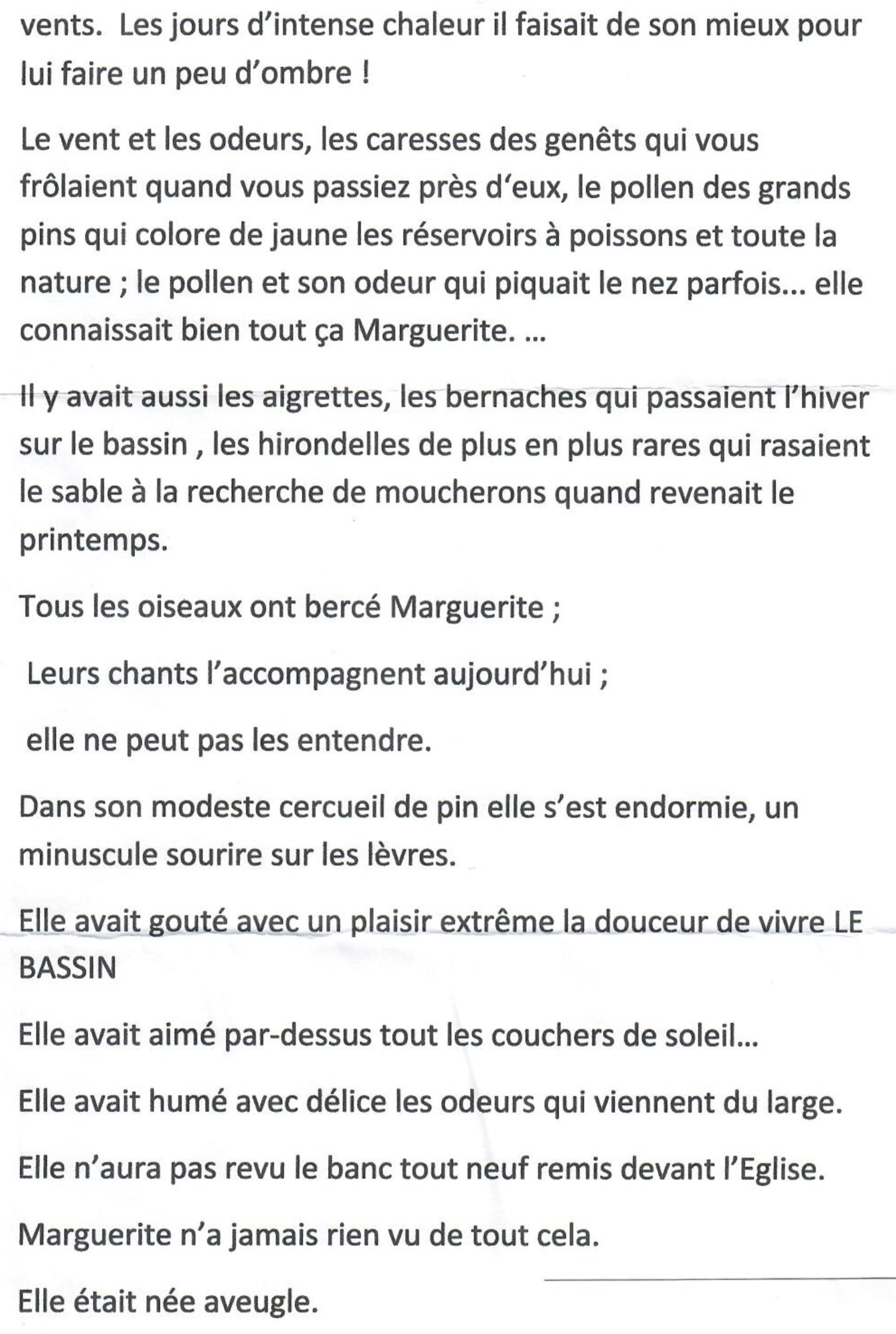
Michèle LEGENDRE. Le banc
Contact
- Gujan-Mestras, Nouvelle-Aquitaine, France